Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
4 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 •  1, 2, 3
1, 2, 3 
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 19: Un tout nouveau jeu de balle
Après la victoire des démocrates lors des élections de mi-mandat en 2002, la Maison Blanche savait que la présidence Bush allait devenir beaucoup plus ardue. Au cours de ses deux premières années, le président avait déjà eu du mal à travailler avec ses collègues démocrates et, à l'occasion, même les républicains s'étaient montrés assez critiques à l'égard de l'administration. Une grande partie de la frustration de l'opposition provenait de son élection contestée et de la conviction omniprésente que son ascension était au mieux entachée d'irrégularités et au pire complètement véreuse. Les démocrates étaient désormais armés du pouvoir législatif, du pouvoir de la bourse et de la possibilité d'enquêter sur le président. La représentante Pelosi, la deuxième démocrate la plus puissante de la Chambre des représentants, a clairement indiqué qu'elle enquêterait sur toute allégation selon laquelle les dirigeants d'Enron auraient eu une influence sur la politique énergétique ou fiscale de Bush et sur le choix de ces responsables. "Le peuple américain mérite de connaître les faits, nous devons donc attendre de voir les faits". En ce qui concernait les allégations relatives aux efforts d'influence d'Enron, elle a déclaré : "Mais il ne fait aucun doute, et sans jeu de mots, qu'Enron a mis de l'énergie dans ces efforts".

La chef de la majorité Nancy Pelosi (à gauche) et le président de la Chambre des représentants Richard "Dick" Gephardt (à droite)
Toutefois, d'autres démocrates étaient prêts (du moins pour l'instant) à tendre une branche d'olivier. Dick Gephardt, président de la Chambre des représentants, a demandé à la Maison Blanche de s'expliquer, tout en critiquant l'administration : "À l'avenir, j'espère que le président sera à nos côtés pour assainir le système politique et faire en sorte que les grosses fortunes ne s'y mêlent plus". Les propos de M. Gephardt faisaient référence à la loi sur la réforme des campagnes électorales que la Maison-Blanche, l'ancien président de la Chambre des représentants, Dennis Hastert, et les dirigeants républicains, Tom Delay et Mitch McConnell, avaient réussi à faire échouer l'année précédente.
Le président avait encore quelques projets législatifs importants à faire adopter et restait confiant, même avec les nouvelles majorités démocrates, dans sa capacité à faire passer des projets de loi. En tête de liste figurait une deuxième série de réductions d'impôts. Malheureusement, la majorité démocrate a clairement fait savoir que tout effort en ce sens serait voué à l'échec. En fait, une grande partie des dirigeants démocrates étaient favorables à l'annulation des réductions d'impôts de 2001, y compris le président Gephardt. Gephardt a fait valoir que ces réductions d'impôts étaient un cadeau aux riches et qu'elles augmentaient inutilement la dette du pays. "Le plan du président n'a pas fonctionné, nous devons changer de politique et faire autre chose, c'est ce que veut le peuple américain". Il était clair qu'il n'y avait pas d'accord à trouver et qu'un Washington divisé rencontrait son premier obstacle.
Les démocrates ont tenu leur promesse de collaborer avec les républicains pour adopter un projet de loi sur la réforme du financement des campagnes électorales. Il constituait une attaque en règle contre l'ancien Congrès, contrôlé par les républicains, qui n'avait pas réussi à faire passer un tel projet de loi l'année précédente. Maintenant qu'ils disposaient de la majorité, ils allaient devoir affronter le président, qui avait jusqu'à présent réussi à échapper à tout reproche concernant l'échec du projet de loi bipartisan en restant publiquement silencieux sur la mesure, alors que les dirigeants républicains s'y opposaient fermement. Si le projet de loi était adopté par les deux chambres du Congrès, le président Bush serait contraint de le signer ou d'y opposer son veto. Le projet de loi (qui reprend en grande partie le projet de loi McCain-Feingold) visait à limiter le montant de ce que l'on a appelé l'"argent flou" dans les campagnes politiques et à obliger les candidats à "soutenir" les publicités politiques en affichant clairement l'identité des intéressés et en montrant qu'ils approuvaient ce type de publicité. Le président de la Chambre des représentants, M. Gephardt, était depuis longtemps partisan d'une réforme du financement des campagnes électorales, car cela faisait dix ans que le Congrès ne parvenait pas à adopter de telles mesures. Le projet de loi a été rapidement proposé et a été adopté par la Chambre des représentants grâce à plusieurs dizaines de républicains qui ont fait défection.
Au Sénat, la situation était différente : les démocrates disposaient d'une majorité de quatre sièges, mais il leur fallait 60 voix pour vaincre l'obstruction. Les dirigeants républicains du Congrès se sont unis contre l'adoption du projet de loi, affirmant qu'il outrepassait la Constitution en portant atteinte aux droits du premier amendement des Américains en restreignant le "discours politique". Le président Bush a tenté de rester muet sur le sujet, mais au fur et à mesure que l'adoption du projet de loi devenait de plus en plus probable, la Maison Blanche a fait part de son opposition. M. Bush a déclaré que le projet de loi comportait des "défauts" et qu'il avait de "sérieuses préoccupations constitutionnelles", bien que les partisans de la réforme se soient réjouis que le président n'ait pas brandi le spectre du veto. Le projet de loi avait des partisans républicains, notamment les quatre modérés, McCain bien sûr (l'un des auteurs originaux du projet de loi), Lincoln Chafee (Rhode Island) et les deux sénatrices du Maine, Susan Collins et Olympia Snowe. Grâce à leur soutien, le projet de loi a recueilli 56 voix, en raison de deux défections démocrates. Les chiffres semblaient serrés, mais il restait une douzaine de républicains susceptibles de voter pour ou contre le projet de loi, et la Maison Blanche a émis ses critiques les plus virulentes à ce jour. Le président a décrit le projet de loi comme "ignorant les principes que j'ai besoin de voir, pour toute législation qui arrive sur mon bureau". Cependant, le Sénat a ignoré les principes du Président et a voté par 61 voix contre 49 en faveur de l'adoption du projet de loi, ce qui a obligé le Président à coucher sa position sur le papier.

Les auteurs originaux du projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales, les sénateurs John McCain (R, à gauche) et Russ Feingold (D, à droite). Intervenant à la suite de l'adoption du projet de loi
Le Président aurait dû être plus clair, pousser plus fort, c'est sans doute ce qu'ont pensé les stratèges de la Maison Blanche. Si le président avait fait connaître sa position dès le début, pour ou contre, le Congrès se serait probablement aligné, peu de républicains signant un texte de loi pour qu'un président républicain y oppose son veto, et se prononcer en faveur du projet de loi aurait au moins renforcé l'image du président, mais W était trop préoccupé par le fait de répéter les erreurs de son père. George H. W. Bush avait dû faire face à un effort similaire de réforme des campagnes électorales à la suite de scandales d'entreprises, il avait menacé d'opposer son veto, le Congrès l'avait défié, Bush avait opposé son veto et le Congrès n'avait pas réussi à passer outre. Le président n'était pas le mieux placé pour débattre des détails de la réforme du financement des campagnes électorales. Il valait mieux se taire et laisser Rove, Delay et McConnell s'en occuper, ce qui s'est avéré être une bonne chose. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais Bush a cédé et a fait une brève déclaration.
"Le système actuel de financement des campagnes électorales est gravement défectueux. Pendant des années, en tant que gouverneur du Texas et candidat à l'élection présidentielle, j'ai réclamé une législation visant à lutter contre l'influence des intérêts particuliers, à rétablir la confiance dans les partis politiques et à renforcer le rôle des citoyens dans le processus politique. Ce projet de loi n'accomplirait aucune de ces missions. En plus de maintenir l'influence corrompue des intérêts spéciaux et des groupes d'argent flou, il limiterait sérieusement le discours politique protégé par le premier amendement et restreindrait le discours d'une grande variété de groupes sur des questions d'importance publique dans les mois les plus proches d'une élection, ... Ce projet de loi ne représente pas les idéaux complets de mon administration et, par conséquent, j'oppose mon veto à H.R.2356"

Le président Bush met son veto au projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales
Bien entendu, le principal projet législatif sur lequel l'administration Bush voulait que les citoyens se concentrent était celui des soins de santé. Au cours de sa campagne présidentielle, le président Bush avait fait de grandes promesses en matière de soins de santé, la principale étant de faire en sorte que Medicare couvre le coût des médicaments délivrés sur ordonnance. Medicare était la plus grande initiative du pays en matière de soins de santé financés par l'État et, en tant que telle, toute extension équivaudrait à la plus grande expansion de l'État fédéral avec la création de ce programme, pour un coût de plusieurs centaines de milliards de dollars.
c'était un virage très surprenant pour une Maison Blanche conservatrice et il était censé résumer la partie humanitaire du "conservatisme compassionnel". Bush était convaincu qu'un compromis entre les deux partis pouvait être trouvé : "Nous sommes venus à Washington pour résoudre des problèmes. ... C'est pourquoi nous devons adopter ces réformes de l'assurance-maladie, afin de fournir aux patients des médicaments sur ordonnance et d'offrir des choix aux personnes âgées".
M. Bush pensait qu'il avait la possibilité d'obtenir des résultats, même avec un gouvernement divisé. Les prix des médicaments prescrits étaient près de deux fois supérieurs à ce qu'ils étaient cinq ans auparavant. En effet, Gore et Bush avaient tous deux inscrit la couverture des médicaments sur ordonnance à leur programme, et le principal problème concernait le montant de la couverture offerte. La question a également touché un groupe démographique important, les personnes âgées, et le fossé qui se creusait en matière d'accès aux soins de santé s'est avéré un puissant moteur de vote.

Le président Bush fait campagne pour la réforme de l'assurance-maladie dans le Connecticut
Les Républicains ont présenté leur proposition, plus de 300 milliards de dollars pour subventionner 10 ans de médicaments sur ordonnance. Il constituait un changement radical, les républicains n'ayant proposé auparavant qu'un cinquième de cette somme lorsqu'ils étaient dans l'opposition à Bill Clinton.
Pour les conservateurs déterminés à priver le gouvernement de fonds, il s'agissait d'un projet difficile à vendre et Bush aurait eu besoin de toutes les voix républicaines pour qu'il ait une chance d'être adopté. Afin que le projet de loi reste conservateur, les républicains du Congrès ont largement pris en charge la rédaction du contenu du projet de loi: leur plan consistant à éloigner les bénéficiaires de Medicare du système actuel (auquel 90 % d'entre eux étaient affiliés) et à les orienter vers des plans de santé privés.
Le prix était élevé, mais les démocrates (et les analystes) se sont gaussés, brandissant des projections selon lesquelles un tel projet nécessiterait au moins le double de fonds pour fonctionner correctement, et ils ont tous déclaré que le projet de loi était médiocre. Financé par un mélange d'allègements fiscaux et de subventions, le plan républicain prévoyait également l'intégration d'assurances privées dans l'assurance-maladie ordinaire, afin d'apaiser les conservateurs fiscaux qui craignaient une initiative gouvernementale onéreuse. Tout cela ne tenait pas compte du fait que les Républicains n'étaient plus les maîtres du jeu et que les Démocrates avaient rédigé leur propre plan. Avec 600 milliards de dollars, soit le double du plan républicain, le chef de la majorité, Tom Daschle, et le colosse sénatorial Ted Kennedy proposait un plan démocrate allant à l'encontre des exigences républicaines : il cherchait à étendre la couverture, et pas seulement à réduire le coût pour ceux qui cotisaient déjà, rejetait l'idée de pousser les gens vers des programmes privés et permettait également au gouvernement de négocier directement le prix des médicaments.
M. Daschle a qualifié le projet de loi républicain de "minable" et M. Kennedy a déclaré qu'il s'agissait d'un "accord brutal pour les personnes âgées du pays", alors que leur projet de loi "réaffirmera la confiance des personnes âgées dans Medicare ... il défendra et développera Medicare".

Le leader de la majorité au Sénat, Tom Daschle (à gauche), et le sénateur Ted Kennedy (à droite), discutent du projet de loi démocrate sur la réforme de l'assurance-maladie.
La différence frappante entre les deux projets de loi signifiait que si un compromis devait être trouvé, la marge de manœuvre était grande, mais en dépit des paroles chaleureuses échangées par les deux parties, les chances d'un accord devenaient de plus en plus minces. Joe Lieberman, sénateur démocrate conservateur (et candidat à la vice-présidence trois ans plus tôt), a qualifié le plan de Bush d'insuffisant et plusieurs républicains conservateurs n'ont même pas soutenu le plan de Bush. Parmi eux, Jeff Flake, de l'Arizona, a déclaré : "Je ne suis pas venu ici pour accroître le gouvernement, ce projet de loi est un droit qui va nous échapper", et Mike Pence, de l'Indiana, a déclaré : "La conséquence la plus inquiétante d'une assurance-médicaments universelle pourrait être qu'elle inaugure le début d'une médecine socialisée en Amérique". John Breaux, de Louisiane, a déclaré : "Nous ne pouvons pas en faire une question partisane. Medicare, tel que nous le connaissons, va disparaître de lui-même si nous n'apportons pas certains changements", faisant référence aux avantages d'une certaine privatisation, et quelques autres ont souligné la nécessité de trouver un compromis pour faire passer un projet de loi.
La sénatrice Dianne Feinstein a déclaré : "Il est important qu'un projet de loi soit adopté et nous ne pouvons pas laisser le parfait être l'ennemi du bien". Un tel compromis nécessiterait des mois de travail et de discussions, afin de créer un projet de loi qui obtiendrait un soutien bipartisan suffisant, sans compter qu'aucune des deux parties n'était disposée à abandonner sa position à l'égard de la privatisation. Pour compliquer encore les choses, tout cela se déroulait alors que les démocrates se préparaient à se lancer dans la course à la Maison Blanche.

Les critiques républicains et démocrates, (de gauche à droite) Mike Pence, Jeff Flake, Diane Feinstein et John Breaux.
La loi sur l'assurance-maladie parrainée par les démocrates a été adoptée par les partis à la Chambre des représentants. La Maison Blanche n'allait pas répéter le scénario du veto sur le financement des campagnes électorales. Elle a mis la pression sur les républicains susceptibles de changer d'avis, en indiquant clairement que la signature du président ne figurerait pas sur le projet de loi. Cela a fonctionné et l'obstruction a été maintenue jusqu'à ce qu'un "compromis" soit trouvé. Malgré l'optimisme initial, aucun progrès n'a été réalisé au fil des semaines et, en dépit d'une ouverture explosive, la Maison Blanche s'est retirée discrètement du combat et la réforme de l'assurance-maladie a disparu de l'ordre du jour.
La sénatrice Hillary Clinton, qui avait mené la bataille pour la réforme du système de santé pendant la présidence de son mari, a fait porter le chapeau à la Maison-Blanche : "Le président n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite à nos aînés". Le sénateur John Kerry est allé dans le même sens : "Une fois de plus, cette administration cherche à se cacher du peuple américain et lorsque les prix des médicaments continueront d'augmenter, ils sauront que c'est la faute du président Bush"
Bush n'a pas réussi à obtenir de résultats sur le plan intérieur au cours de sa troisième année et il était pratiquement impossible d'espérer qu'il y parvienne au cours de sa quatrième année, étant donné que la saison des campagnes électorales allait prendre le dessus et qu'il serait impossible de faire des compromis. Bush devrait chercher une victoire ailleurs.

Le Président s'exprime lors d'une conférence de presse en 2003

Columbia est de retour après une mission de recherche de grande envergure
Par William Harwood, consultant spatial de CBS News
28 février 2003

La navette Columbia se pose au Centre spatial Kennedy après une mission de recherche de 16 jours couronnée de succès. Photo : NASA TV/Spaceflight Now NASA TV/Spaceflight Now
La navette spatiale Columbia s'est posée en douceur aujourd'hui sur la piste 33 du Centre spatial Kennedy pour clôturer une mission de recherche couronnée de succès, au cours de laquelle plus de 80 expériences ont été menées, notamment sur la croissance des cristaux, la densité osseuse et la croissance des cellules cancéreuses.
Avec le commandant Rick Husband et le pilote William McCool aux commandes, la plus ancienne navette spatiale de la NASA est sortie d'un ciel bleu limpide et a atterri dans le spatioport de Floride après un plongeon d'une heure vers la Terre. L'atterrissage a eu lieu à 9.02.32 AM EST.
"Houston, Columbia, magnifique atterrissage au KSC", a déclaré par radio M. Husband, ancien pilote de F-15, après l'immobilisation de la navette.
"Columbia, Houston, nous enregistrons l'arrêt des roues", a répondu l'astronaute Mark Polansky depuis le centre de contrôle de la mission. "Nous vous félicitons tous pour cette mission très réussie, au cours de laquelle vous avez mené à bien ces expériences. Nous n'avons pas de deltas après l'atterrissage".
L'atterrissage d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un voyage de 6,6 millions de kilomètres qui s'est étalé sur près de 16 jours et 255 orbites complètes depuis le décollage, le 12 février, de la plateforme 39A située à proximité. Il s'agit du 62e atterrissage dans le spatioport de Floride. La durée de la mission, depuis le lancement jusqu'à l'atterrissage,a été de 15 jours 22 heures 23 minutes et 32 secondes. Il s'agissait du 28e vol de Columbia.
"Columbia a fait une excellente entrée dans l'espace", a déclaré Linda Ham, responsable du programme de la navette. "Une fois de plus, les performances de Columbia ont été mises en évidence".
Mais un problème qui nécessitera des réparations après l'atterrissage pourrait affecter son prochain lancement prévu en novembre. Certains dommages subis lors du lancement ont failli endommager le système de protection thermique du vaisseau et ont suscité des craintes quant à la rentrée de Columbia dans l'atmosphère. La cause de ces dommages devra être étudiée afin de respecter la date de lancement de novembre, mais la Nasa est convaincue qu'elle n'aura pas à repousser autant le lancement que précédemment.
Husband, McCool, l'ingénieur de vol américano-indien Chawla Kalpana et les spécialistes de mission David Brown, Michael Anderson, Laurel Clark et l'astronaute israélien Ilan Ramon prévoient de passer la journée au Centre spatial Kennedy avant de rentrer à Houston samedi.
"Houston, nous tous à bord de Columbia voulons vous remercier pour l'énorme travail que vous avez accompli et qui nous a facilité la tâche tout au long de la mission", a déclaré Altman par radio au centre de contrôle de la mission avant de quitter la navette. "Vous avez fait un super travail, vous nous avez apporté une journée fraîche et claire et c'est formidable d'être de retour ici, au Centre spatial Kennedy, après cette belle expérience à Hubble. Nous vous remercions tous chaleureusement".
Au cours de ces expériences, Husband et son équipe ont étudié les sciences de la Terre et de l'espace ainsi que la microgravité, notamment la caméra Mediterranean-Israel Dust Experiment conçue pour mesurer l'impact des aérosols sur la formation des nuages et les précipitations ; un examen du phénomène des éclairs rouges et bleus - connus sous le nom de sprites - qui apparaissent pendant les orages ; une expérience sur les effets de l'apesanteur sur les bactéries ; et un projet de chimie d'un élève israélien de huitième année.
Les expériences ont été réalisées sur du matériel expérimental et ont été couronnées de succès, avec un taux de réussite opérationnel de 100 % pour la quasi-totalité d'entre elles. Les connaissances ainsi acquises serviront à améliorer les fondations des bâtiments et à mieux comprendre comment les tremblements de terre et d'autres forces perturbent les particules de sable et de terre.
"Il s'agit d'une mission purement scientifique, qui a nécessité cinq ans de préparation, mais tout vient à point à qui sait attendre", a déclaré Mike Leinbach, directeur du lancement. "Cette mission était remplie de tâches ardues et difficiles, et de nombreuses personnes participant à cette mission ne pensaient pas que nous serions en mesure d'accomplir tout ce que nous avions prévu dans notre plan", a-t-il ajouté.
"Cette mission a nécessité une quantité incroyable de dévouement et de travail acharné de la part d'une énorme équipe au Centre spatial Johnson, au Centre spatial Kennedy, au Centre des vols spatiaux Goddard, dans l'industrie privée et dans le monde universitaire. Je tiens à les remercier tous, et tout particulièrement les sept membres de l'équipage de Columbia, qui ont fait preuve d'une intelligence remarquable pour mener à bien cette mission."
Prochaine étape pour la Nasa : Le lancement de la navette Discovery en juillet pour une mission vers la station spatiale internationale...

Après la victoire des démocrates lors des élections de mi-mandat en 2002, la Maison Blanche savait que la présidence Bush allait devenir beaucoup plus ardue. Au cours de ses deux premières années, le président avait déjà eu du mal à travailler avec ses collègues démocrates et, à l'occasion, même les républicains s'étaient montrés assez critiques à l'égard de l'administration. Une grande partie de la frustration de l'opposition provenait de son élection contestée et de la conviction omniprésente que son ascension était au mieux entachée d'irrégularités et au pire complètement véreuse. Les démocrates étaient désormais armés du pouvoir législatif, du pouvoir de la bourse et de la possibilité d'enquêter sur le président. La représentante Pelosi, la deuxième démocrate la plus puissante de la Chambre des représentants, a clairement indiqué qu'elle enquêterait sur toute allégation selon laquelle les dirigeants d'Enron auraient eu une influence sur la politique énergétique ou fiscale de Bush et sur le choix de ces responsables. "Le peuple américain mérite de connaître les faits, nous devons donc attendre de voir les faits". En ce qui concernait les allégations relatives aux efforts d'influence d'Enron, elle a déclaré : "Mais il ne fait aucun doute, et sans jeu de mots, qu'Enron a mis de l'énergie dans ces efforts".
La chef de la majorité Nancy Pelosi (à gauche) et le président de la Chambre des représentants Richard "Dick" Gephardt (à droite)
Toutefois, d'autres démocrates étaient prêts (du moins pour l'instant) à tendre une branche d'olivier. Dick Gephardt, président de la Chambre des représentants, a demandé à la Maison Blanche de s'expliquer, tout en critiquant l'administration : "À l'avenir, j'espère que le président sera à nos côtés pour assainir le système politique et faire en sorte que les grosses fortunes ne s'y mêlent plus". Les propos de M. Gephardt faisaient référence à la loi sur la réforme des campagnes électorales que la Maison-Blanche, l'ancien président de la Chambre des représentants, Dennis Hastert, et les dirigeants républicains, Tom Delay et Mitch McConnell, avaient réussi à faire échouer l'année précédente.
Le président avait encore quelques projets législatifs importants à faire adopter et restait confiant, même avec les nouvelles majorités démocrates, dans sa capacité à faire passer des projets de loi. En tête de liste figurait une deuxième série de réductions d'impôts. Malheureusement, la majorité démocrate a clairement fait savoir que tout effort en ce sens serait voué à l'échec. En fait, une grande partie des dirigeants démocrates étaient favorables à l'annulation des réductions d'impôts de 2001, y compris le président Gephardt. Gephardt a fait valoir que ces réductions d'impôts étaient un cadeau aux riches et qu'elles augmentaient inutilement la dette du pays. "Le plan du président n'a pas fonctionné, nous devons changer de politique et faire autre chose, c'est ce que veut le peuple américain". Il était clair qu'il n'y avait pas d'accord à trouver et qu'un Washington divisé rencontrait son premier obstacle.
Les démocrates ont tenu leur promesse de collaborer avec les républicains pour adopter un projet de loi sur la réforme du financement des campagnes électorales. Il constituait une attaque en règle contre l'ancien Congrès, contrôlé par les républicains, qui n'avait pas réussi à faire passer un tel projet de loi l'année précédente. Maintenant qu'ils disposaient de la majorité, ils allaient devoir affronter le président, qui avait jusqu'à présent réussi à échapper à tout reproche concernant l'échec du projet de loi bipartisan en restant publiquement silencieux sur la mesure, alors que les dirigeants républicains s'y opposaient fermement. Si le projet de loi était adopté par les deux chambres du Congrès, le président Bush serait contraint de le signer ou d'y opposer son veto. Le projet de loi (qui reprend en grande partie le projet de loi McCain-Feingold) visait à limiter le montant de ce que l'on a appelé l'"argent flou" dans les campagnes politiques et à obliger les candidats à "soutenir" les publicités politiques en affichant clairement l'identité des intéressés et en montrant qu'ils approuvaient ce type de publicité. Le président de la Chambre des représentants, M. Gephardt, était depuis longtemps partisan d'une réforme du financement des campagnes électorales, car cela faisait dix ans que le Congrès ne parvenait pas à adopter de telles mesures. Le projet de loi a été rapidement proposé et a été adopté par la Chambre des représentants grâce à plusieurs dizaines de républicains qui ont fait défection.
Au Sénat, la situation était différente : les démocrates disposaient d'une majorité de quatre sièges, mais il leur fallait 60 voix pour vaincre l'obstruction. Les dirigeants républicains du Congrès se sont unis contre l'adoption du projet de loi, affirmant qu'il outrepassait la Constitution en portant atteinte aux droits du premier amendement des Américains en restreignant le "discours politique". Le président Bush a tenté de rester muet sur le sujet, mais au fur et à mesure que l'adoption du projet de loi devenait de plus en plus probable, la Maison Blanche a fait part de son opposition. M. Bush a déclaré que le projet de loi comportait des "défauts" et qu'il avait de "sérieuses préoccupations constitutionnelles", bien que les partisans de la réforme se soient réjouis que le président n'ait pas brandi le spectre du veto. Le projet de loi avait des partisans républicains, notamment les quatre modérés, McCain bien sûr (l'un des auteurs originaux du projet de loi), Lincoln Chafee (Rhode Island) et les deux sénatrices du Maine, Susan Collins et Olympia Snowe. Grâce à leur soutien, le projet de loi a recueilli 56 voix, en raison de deux défections démocrates. Les chiffres semblaient serrés, mais il restait une douzaine de républicains susceptibles de voter pour ou contre le projet de loi, et la Maison Blanche a émis ses critiques les plus virulentes à ce jour. Le président a décrit le projet de loi comme "ignorant les principes que j'ai besoin de voir, pour toute législation qui arrive sur mon bureau". Cependant, le Sénat a ignoré les principes du Président et a voté par 61 voix contre 49 en faveur de l'adoption du projet de loi, ce qui a obligé le Président à coucher sa position sur le papier.
Les auteurs originaux du projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales, les sénateurs John McCain (R, à gauche) et Russ Feingold (D, à droite). Intervenant à la suite de l'adoption du projet de loi
Le Président aurait dû être plus clair, pousser plus fort, c'est sans doute ce qu'ont pensé les stratèges de la Maison Blanche. Si le président avait fait connaître sa position dès le début, pour ou contre, le Congrès se serait probablement aligné, peu de républicains signant un texte de loi pour qu'un président républicain y oppose son veto, et se prononcer en faveur du projet de loi aurait au moins renforcé l'image du président, mais W était trop préoccupé par le fait de répéter les erreurs de son père. George H. W. Bush avait dû faire face à un effort similaire de réforme des campagnes électorales à la suite de scandales d'entreprises, il avait menacé d'opposer son veto, le Congrès l'avait défié, Bush avait opposé son veto et le Congrès n'avait pas réussi à passer outre. Le président n'était pas le mieux placé pour débattre des détails de la réforme du financement des campagnes électorales. Il valait mieux se taire et laisser Rove, Delay et McConnell s'en occuper, ce qui s'est avéré être une bonne chose. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais Bush a cédé et a fait une brève déclaration.
"Le système actuel de financement des campagnes électorales est gravement défectueux. Pendant des années, en tant que gouverneur du Texas et candidat à l'élection présidentielle, j'ai réclamé une législation visant à lutter contre l'influence des intérêts particuliers, à rétablir la confiance dans les partis politiques et à renforcer le rôle des citoyens dans le processus politique. Ce projet de loi n'accomplirait aucune de ces missions. En plus de maintenir l'influence corrompue des intérêts spéciaux et des groupes d'argent flou, il limiterait sérieusement le discours politique protégé par le premier amendement et restreindrait le discours d'une grande variété de groupes sur des questions d'importance publique dans les mois les plus proches d'une élection, ... Ce projet de loi ne représente pas les idéaux complets de mon administration et, par conséquent, j'oppose mon veto à H.R.2356"
Le président Bush met son veto au projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales
Bien entendu, le principal projet législatif sur lequel l'administration Bush voulait que les citoyens se concentrent était celui des soins de santé. Au cours de sa campagne présidentielle, le président Bush avait fait de grandes promesses en matière de soins de santé, la principale étant de faire en sorte que Medicare couvre le coût des médicaments délivrés sur ordonnance. Medicare était la plus grande initiative du pays en matière de soins de santé financés par l'État et, en tant que telle, toute extension équivaudrait à la plus grande expansion de l'État fédéral avec la création de ce programme, pour un coût de plusieurs centaines de milliards de dollars.
c'était un virage très surprenant pour une Maison Blanche conservatrice et il était censé résumer la partie humanitaire du "conservatisme compassionnel". Bush était convaincu qu'un compromis entre les deux partis pouvait être trouvé : "Nous sommes venus à Washington pour résoudre des problèmes. ... C'est pourquoi nous devons adopter ces réformes de l'assurance-maladie, afin de fournir aux patients des médicaments sur ordonnance et d'offrir des choix aux personnes âgées".
M. Bush pensait qu'il avait la possibilité d'obtenir des résultats, même avec un gouvernement divisé. Les prix des médicaments prescrits étaient près de deux fois supérieurs à ce qu'ils étaient cinq ans auparavant. En effet, Gore et Bush avaient tous deux inscrit la couverture des médicaments sur ordonnance à leur programme, et le principal problème concernait le montant de la couverture offerte. La question a également touché un groupe démographique important, les personnes âgées, et le fossé qui se creusait en matière d'accès aux soins de santé s'est avéré un puissant moteur de vote.
Le président Bush fait campagne pour la réforme de l'assurance-maladie dans le Connecticut
Les Républicains ont présenté leur proposition, plus de 300 milliards de dollars pour subventionner 10 ans de médicaments sur ordonnance. Il constituait un changement radical, les républicains n'ayant proposé auparavant qu'un cinquième de cette somme lorsqu'ils étaient dans l'opposition à Bill Clinton.
Pour les conservateurs déterminés à priver le gouvernement de fonds, il s'agissait d'un projet difficile à vendre et Bush aurait eu besoin de toutes les voix républicaines pour qu'il ait une chance d'être adopté. Afin que le projet de loi reste conservateur, les républicains du Congrès ont largement pris en charge la rédaction du contenu du projet de loi: leur plan consistant à éloigner les bénéficiaires de Medicare du système actuel (auquel 90 % d'entre eux étaient affiliés) et à les orienter vers des plans de santé privés.
Le prix était élevé, mais les démocrates (et les analystes) se sont gaussés, brandissant des projections selon lesquelles un tel projet nécessiterait au moins le double de fonds pour fonctionner correctement, et ils ont tous déclaré que le projet de loi était médiocre. Financé par un mélange d'allègements fiscaux et de subventions, le plan républicain prévoyait également l'intégration d'assurances privées dans l'assurance-maladie ordinaire, afin d'apaiser les conservateurs fiscaux qui craignaient une initiative gouvernementale onéreuse. Tout cela ne tenait pas compte du fait que les Républicains n'étaient plus les maîtres du jeu et que les Démocrates avaient rédigé leur propre plan. Avec 600 milliards de dollars, soit le double du plan républicain, le chef de la majorité, Tom Daschle, et le colosse sénatorial Ted Kennedy proposait un plan démocrate allant à l'encontre des exigences républicaines : il cherchait à étendre la couverture, et pas seulement à réduire le coût pour ceux qui cotisaient déjà, rejetait l'idée de pousser les gens vers des programmes privés et permettait également au gouvernement de négocier directement le prix des médicaments.
M. Daschle a qualifié le projet de loi républicain de "minable" et M. Kennedy a déclaré qu'il s'agissait d'un "accord brutal pour les personnes âgées du pays", alors que leur projet de loi "réaffirmera la confiance des personnes âgées dans Medicare ... il défendra et développera Medicare".
Le leader de la majorité au Sénat, Tom Daschle (à gauche), et le sénateur Ted Kennedy (à droite), discutent du projet de loi démocrate sur la réforme de l'assurance-maladie.
La différence frappante entre les deux projets de loi signifiait que si un compromis devait être trouvé, la marge de manœuvre était grande, mais en dépit des paroles chaleureuses échangées par les deux parties, les chances d'un accord devenaient de plus en plus minces. Joe Lieberman, sénateur démocrate conservateur (et candidat à la vice-présidence trois ans plus tôt), a qualifié le plan de Bush d'insuffisant et plusieurs républicains conservateurs n'ont même pas soutenu le plan de Bush. Parmi eux, Jeff Flake, de l'Arizona, a déclaré : "Je ne suis pas venu ici pour accroître le gouvernement, ce projet de loi est un droit qui va nous échapper", et Mike Pence, de l'Indiana, a déclaré : "La conséquence la plus inquiétante d'une assurance-médicaments universelle pourrait être qu'elle inaugure le début d'une médecine socialisée en Amérique". John Breaux, de Louisiane, a déclaré : "Nous ne pouvons pas en faire une question partisane. Medicare, tel que nous le connaissons, va disparaître de lui-même si nous n'apportons pas certains changements", faisant référence aux avantages d'une certaine privatisation, et quelques autres ont souligné la nécessité de trouver un compromis pour faire passer un projet de loi.
La sénatrice Dianne Feinstein a déclaré : "Il est important qu'un projet de loi soit adopté et nous ne pouvons pas laisser le parfait être l'ennemi du bien". Un tel compromis nécessiterait des mois de travail et de discussions, afin de créer un projet de loi qui obtiendrait un soutien bipartisan suffisant, sans compter qu'aucune des deux parties n'était disposée à abandonner sa position à l'égard de la privatisation. Pour compliquer encore les choses, tout cela se déroulait alors que les démocrates se préparaient à se lancer dans la course à la Maison Blanche.
Les critiques républicains et démocrates, (de gauche à droite) Mike Pence, Jeff Flake, Diane Feinstein et John Breaux.
La loi sur l'assurance-maladie parrainée par les démocrates a été adoptée par les partis à la Chambre des représentants. La Maison Blanche n'allait pas répéter le scénario du veto sur le financement des campagnes électorales. Elle a mis la pression sur les républicains susceptibles de changer d'avis, en indiquant clairement que la signature du président ne figurerait pas sur le projet de loi. Cela a fonctionné et l'obstruction a été maintenue jusqu'à ce qu'un "compromis" soit trouvé. Malgré l'optimisme initial, aucun progrès n'a été réalisé au fil des semaines et, en dépit d'une ouverture explosive, la Maison Blanche s'est retirée discrètement du combat et la réforme de l'assurance-maladie a disparu de l'ordre du jour.
La sénatrice Hillary Clinton, qui avait mené la bataille pour la réforme du système de santé pendant la présidence de son mari, a fait porter le chapeau à la Maison-Blanche : "Le président n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite à nos aînés". Le sénateur John Kerry est allé dans le même sens : "Une fois de plus, cette administration cherche à se cacher du peuple américain et lorsque les prix des médicaments continueront d'augmenter, ils sauront que c'est la faute du président Bush"
Bush n'a pas réussi à obtenir de résultats sur le plan intérieur au cours de sa troisième année et il était pratiquement impossible d'espérer qu'il y parvienne au cours de sa quatrième année, étant donné que la saison des campagnes électorales allait prendre le dessus et qu'il serait impossible de faire des compromis. Bush devrait chercher une victoire ailleurs.
Le Président s'exprime lors d'une conférence de presse en 2003
Columbia est de retour après une mission de recherche de grande envergure
Par William Harwood, consultant spatial de CBS News
28 février 2003
La navette Columbia se pose au Centre spatial Kennedy après une mission de recherche de 16 jours couronnée de succès. Photo : NASA TV/Spaceflight Now NASA TV/Spaceflight Now
La navette spatiale Columbia s'est posée en douceur aujourd'hui sur la piste 33 du Centre spatial Kennedy pour clôturer une mission de recherche couronnée de succès, au cours de laquelle plus de 80 expériences ont été menées, notamment sur la croissance des cristaux, la densité osseuse et la croissance des cellules cancéreuses.
Avec le commandant Rick Husband et le pilote William McCool aux commandes, la plus ancienne navette spatiale de la NASA est sortie d'un ciel bleu limpide et a atterri dans le spatioport de Floride après un plongeon d'une heure vers la Terre. L'atterrissage a eu lieu à 9.02.32 AM EST.
"Houston, Columbia, magnifique atterrissage au KSC", a déclaré par radio M. Husband, ancien pilote de F-15, après l'immobilisation de la navette.
"Columbia, Houston, nous enregistrons l'arrêt des roues", a répondu l'astronaute Mark Polansky depuis le centre de contrôle de la mission. "Nous vous félicitons tous pour cette mission très réussie, au cours de laquelle vous avez mené à bien ces expériences. Nous n'avons pas de deltas après l'atterrissage".
L'atterrissage d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un voyage de 6,6 millions de kilomètres qui s'est étalé sur près de 16 jours et 255 orbites complètes depuis le décollage, le 12 février, de la plateforme 39A située à proximité. Il s'agit du 62e atterrissage dans le spatioport de Floride. La durée de la mission, depuis le lancement jusqu'à l'atterrissage,a été de 15 jours 22 heures 23 minutes et 32 secondes. Il s'agissait du 28e vol de Columbia.
"Columbia a fait une excellente entrée dans l'espace", a déclaré Linda Ham, responsable du programme de la navette. "Une fois de plus, les performances de Columbia ont été mises en évidence".
Mais un problème qui nécessitera des réparations après l'atterrissage pourrait affecter son prochain lancement prévu en novembre. Certains dommages subis lors du lancement ont failli endommager le système de protection thermique du vaisseau et ont suscité des craintes quant à la rentrée de Columbia dans l'atmosphère. La cause de ces dommages devra être étudiée afin de respecter la date de lancement de novembre, mais la Nasa est convaincue qu'elle n'aura pas à repousser autant le lancement que précédemment.
Husband, McCool, l'ingénieur de vol américano-indien Chawla Kalpana et les spécialistes de mission David Brown, Michael Anderson, Laurel Clark et l'astronaute israélien Ilan Ramon prévoient de passer la journée au Centre spatial Kennedy avant de rentrer à Houston samedi.
"Houston, nous tous à bord de Columbia voulons vous remercier pour l'énorme travail que vous avez accompli et qui nous a facilité la tâche tout au long de la mission", a déclaré Altman par radio au centre de contrôle de la mission avant de quitter la navette. "Vous avez fait un super travail, vous nous avez apporté une journée fraîche et claire et c'est formidable d'être de retour ici, au Centre spatial Kennedy, après cette belle expérience à Hubble. Nous vous remercions tous chaleureusement".
Au cours de ces expériences, Husband et son équipe ont étudié les sciences de la Terre et de l'espace ainsi que la microgravité, notamment la caméra Mediterranean-Israel Dust Experiment conçue pour mesurer l'impact des aérosols sur la formation des nuages et les précipitations ; un examen du phénomène des éclairs rouges et bleus - connus sous le nom de sprites - qui apparaissent pendant les orages ; une expérience sur les effets de l'apesanteur sur les bactéries ; et un projet de chimie d'un élève israélien de huitième année.
Les expériences ont été réalisées sur du matériel expérimental et ont été couronnées de succès, avec un taux de réussite opérationnel de 100 % pour la quasi-totalité d'entre elles. Les connaissances ainsi acquises serviront à améliorer les fondations des bâtiments et à mieux comprendre comment les tremblements de terre et d'autres forces perturbent les particules de sable et de terre.
"Il s'agit d'une mission purement scientifique, qui a nécessité cinq ans de préparation, mais tout vient à point à qui sait attendre", a déclaré Mike Leinbach, directeur du lancement. "Cette mission était remplie de tâches ardues et difficiles, et de nombreuses personnes participant à cette mission ne pensaient pas que nous serions en mesure d'accomplir tout ce que nous avions prévu dans notre plan", a-t-il ajouté.
"Cette mission a nécessité une quantité incroyable de dévouement et de travail acharné de la part d'une énorme équipe au Centre spatial Johnson, au Centre spatial Kennedy, au Centre des vols spatiaux Goddard, dans l'industrie privée et dans le monde universitaire. Je tiens à les remercier tous, et tout particulièrement les sept membres de l'équipage de Columbia, qui ont fait preuve d'une intelligence remarquable pour mener à bien cette mission."
Prochaine étape pour la Nasa : Le lancement de la navette Discovery en juillet pour une mission vers la station spatiale internationale...

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Rayan du Griffoul et ezaski aiment ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 20: Les inconnus connues
26 avril 2003.
Les manœuvres quotidiennes d'une mission militaire longue de dix ans se poursuivaient : l'opération Southern Watch, menée par les forces aériennes américaines et britanniques pour contrôler l'espace aérien dans le sud de l'Irak. Cette opération était menée officiellement pour dissuader l'Irak de mener un autre engagement militaire d'envergure, soit contre une nation voisine, par exemple une deuxième tentative d'annexion du Koweït, soit pour empêcher une action interne contre les chiites, similaire à la répression des Kurdes. La mission consistait à effectuer des centaines de sorties (opérations militaires) au-dessus de la région et à attaquer les principales installations militaires et les avions à réaction irakiens. En avril 2003, plus de 300 000 sorties avaient été effectuées au-dessus de l'Irak et, à la suite des frappes de missiles de l'ère Clinton en 1998 (Renard du désert), le gouvernement irakien a déclaré son intention de s'opposer à la mission sur le plan militaire. De 1998 à 2003, les avions américains et britanniques ont été la cible de tirs antiaériens irakiens. Le succès de la mission était difficile à déterminer, l'armée de l'air irakienne ayant largement évité les pertes en ne perdant que 3 MIG, et ayant délibérément manœuvré pour éviter la confrontation avec les appareils de la coalition. Au sol, les missiles sol-air et les armes antiaériennes ont régulièrement tiré sur les avions de la coalition, mais en vain. La coalition n'a subi aucune perte au cours de la campagne, et ses seules pertes ont été 4 drones de type "predator".
Les avions alliés ont à leur tour ciblé le matériel militaire irakien, mais il a été difficile de déterminer le succès de l'opération. La presse étrangère a décrit les attaques comme étant essentiellement punitives, réussissant à détruire leurs cibles moins d'une fois sur deux, et l'armée irakienne a très rapidement reconstitué ses pertes à chaque fois. Le faible taux de pertes s'explique par le fait que les avions de la coalition volaient très haut , obligeant les forces irakiennes à tirer à l'aveugle. Seule une "balle d'or" chanceuse pourrait abattre un avion allié, car les forces irakiennes avaient désactivé tout système de ciblage, pour éviter une riposte immédiate des alliés.

Un avion américain survole la zone d'exclusion aérienne irakienne dans le cadre de l'opération Southern Watch.
En 2003, le président George W. Bush a décidé d'augmenter le nombre de sorties au-dessus de l'Irak, prétextant de nouvelles menaces pour la sécurité du pays. Les vols ont doublé et le désir de Saddam de punir les États-Unis a également doublé. Il a fait passer de 14 000 à 20 000 dollars (40 000 si le pilote était capturé vivant) la prime prévue de longue date pour descendre les avions de la coalition. Le conflit était devenu si banal que la presse américaine l'avait qualifié de "guerre oubliée", mais les nouveaux engagements de Bush ont changé la donne : sa promesse ne signifiait pas seulement une augmentation des vols, elle signifiait des vols plus agressifs, triplant presque le nombre de sorties de combat. Certains analystes ont vu dans la rhétorique belliqueuse de la Maison Blanche un précurseur potentiel d'une invasion américaine. En décembre 2002, le New York Times a publié des documents classifiés montrant que le ministère de la défense avait élaboré de nouveaux plans d'invasion ; ces plans prévoyaient la pré-destruction des défenses aériennes irakiennes comme élément clé de tout plan et certains craignaient que l'administration n'en soit à ce stade ; cependant, l'administration est restée muette sur ces questions, arguant que le nouvel engagement était nécessaire uniquement en raison de la nouvelle menace que représentait Saddam Hussein.
La guerre oubliée s'est achevée le 26 avril 2003, lorsqu'un F-15 Eagle américain a perdu le contact avec le commandement central alors qu'il effectuait une sortie à l'intérieur de l'Irak. L'avion a été perdu près de la ville d'Al-Kut, l'une des cibles les plus septentrionales de la zone neutre sud. Il volait en duo lorsque les tirs antiaériens irakiens ont éclaté, provoquant la séparation des deux appareils qui ne se sont jamais retrouvés, silence radio. Les premiers rapports sur la disparition ont été divulgués par des sources arabes, mais le ministère de la défense a refusé de les confirmer ou de les infirmer. Jusqu'à présent, le seul autre cas avéré de perte temporaire d'un avion au-dessus de l'Irak remontait à 1997, lorsqu'un dysfonctionnement mécanique dans le nord du pays avait entraîné la perte de puissance d'un avion à réaction, qui avait dû regagner la Turquie en planant. Cette fois-ci, les choses étaient différentes - le F-15 était trop loin en territoire irakien. Si un avion subissait une panne similaire, le pilote n'aurait aucune chance de regagner une base américaine en Irak ou en Arabie Saoudite. Son meilleur espoir serait de pénétrer dans l'espace aérien iranien (ce qui pourrait entraîner une riposte militaire) ou d'atterrir en Irak même, et tout cela si un dysfonctionnement se produisait et non une balle "magique".

Emplacement approximatif du F-15 disparu
Les heures passèrent et l'espoir d'un retour miraculeux s'estompa lentement. Le ministère de la Défense devait désormais faire face au pire scénario possible, à savoir qu'un avion à réaction américain avait été perdu, voire détruit, au-dessus de l'Irak. Le commandement américain a autorisé un balayage complet et la recherche de l'appareil, et les premiers rapports officiels sur la disparition du jet ont été rédigés, sans qu'aucune raison ne soit avancée pour expliquer la perte de l'appareil. La première reconnaissance n'a révélé aucun signe du F-15 disparu, mais compte tenu des centaines de kilomètres carrés de désert à ratisser, ce ne fut pas une surprise. Le premier rapport détaillé sur la disparition est venu de l'Irak lui-même. L'Agence de presse irakienne (la seule chaîne d'information irakienne) a cité un porte-parole de la défense qui a déclaré que "les aigles de l'Irak et les hommes courageux chargés des armes antiaériennes ont abattu un avion de chasse américain qui s'est envolé de l'espace aérien koweïtien pour violer notre espace aérien et tuer le peuple irakien,". Le ministère de la défense et le secrétaire d'État Rumsfeld ont rapidement réagi pour mettre en doute les affirmations irakiennes : "Si nous savons que nous avons perdu le contact avec un avion, nous n'avons aucune raison de croire qu'il a été abattu". En privé, les responsables étaient beaucoup plus inquiets et chacun se préparait à la pire nouvelle possible. Le ministère de la défense ayant reconnu la situation, celle-ci a été transmise à la chaîne de commandement, qui a décidé des mesures à prendre.
Le président assistait à une réunion concernant l'aide fédérale en réponse aux violentes tempêtes hivernales lorsque les premières informations concernant l'avion disparu lui sont parvenues. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre plus d'informations, mais une heure plus tard, le président a été informé qu'un briefing de sécurité d'urgence avait été préparé pour discuter de ses "options" et la réunion sur les tempêtes a été écourtée. Pendant des années, le ministère de la défense a préparé de telles "options". Bush a appris que si l'Irak avait réussi à abattre un avion à réaction, les États-Unis devaient agir rapidement pour empêcher la capture du pilote et de l'officier chargé de l'armement à bord, ce qui serait de loin le pire scénario possible.

Le président Bush rencontre ses conseillers en matière de sécurité nationale
Les protocoles en place pour une telle opération existaient depuis l'administration Clinton, mais Rumsfeld, avec l'approbation du président, avait très tôt renforcé les conséquences militaires d'une telle opération, baptisée Desert Badger. Le plan Clinton prévoyait des frappes immédiates (effectuées par des avions américains et/ou des missiles de croisière) sur des cibles à travers l'Irak afin de désorganiser le commandement militaire irakien et d'empêcher la capture du pilote abattu. L'expansion de Rumsfeld était la deuxième option qui visait plus que l'armée irakienne - elle s'attaquait au régime dans son ensemble - et était conçue pour paralyser non seulement l'armée, mais aussi l'infrastructure et l'industrie de l'Irak, y compris les éventuelles installations d'armes de destruction massive (ADM). Enfin, le Desert Badger de Rumsfeld prévoyait une mission de sauvetage des pilotes abattus ou potentiellement déjà capturés. Certains ajouts de Rumsfeld allaient même plus loin : la troisième option prévoyait non seulement la destruction des bases irakiennes depuis les airs, mais aussi l'envoi de troupes américaines sur le terrain, pour s'emparer de régions clés de l'Irak, ce qui aurait permis de mettre en œuvre en douceur la stratégie de Wolfowitz visant à séparer totalement Bagdad des zones d'exclusion aérienne du sud et du nord, dans l'espoir d'un soulèvement irakien.
Le président a choisi la deuxième option, rejetant le plan Wolfowitz et convenant avec les responsables militaires que les États-Unis n'étaient pas en mesure de déclencher une invasion immédiate de l'Irak.
L'image d'aviateurs américains traînés dans les rues, battus et soumis à un simulacre de procès était impossible à ignorer et le président savait qu'une action forte était nécessaire. Desert Badger constituerait l'action militaire la plus importante menée par les États-Unis depuis la guerre du Golfe. Comme l'a déclaré plus tard Rumsfeld, "ces frappes devaient être d'une ampleur telle qu'elles indiqueraient aux Irakiens (Saddam Hussein) que les États-Unis ne toléreraient pas les actions du régime... afin d'instiller un sentiment de choc et de stupeur"
Quelques heures après la décision du président et au moment où l'agence de presse irakienne et les médias internationaux publiaient leurs rapports sur la disparition de l'avion, les cibles ont été déterminées, les pilotes ont été dépêchés aux postes d'action et les premiers missiles de croisière ont été lancés par la flotte américaine.
Opération Desert Badger

(A gauche) un avion américain décolle du Koweït pour participer à Desert Badger, (A droite) missiles de croisière lancés par la 5e flotte américaine.
Les premières bombes tombèrent sur l'Irak le 26 au soir, un peu moins de 7 heures après la disparition. Le monde tournait en rond, n'ayant toujours pas reçu d'explication complète sur les événements de la journée. Incertaine de l'ampleur des attaques américaines, la télévision en direct montrait Bagdad en proie à des tirs anti-aériens, et les destructions qui s'ensuivaient au sein même de la ville. La précipitation de l'opération a semé le chaos parmi les journalistes sur le terrain, qui ne savaient pas jusqu'où irait la campagne américaine. Les correspondants étrangers à Bagdad n'ont eu que quelques minutes pour réagir après que les agences de presse ont été informées de la décision du président avant la diffusion d'un message présidentiel. Les journalistes se sont empressés d'assembler un flux en direct pour capturer l'extraordinaire spectacle de lumière en cours.
Contrairement à Desert Fox en 1998, l'action de Bush a été lancée sans soutien étranger confirmé et avec peu de moyens militaires ou politiques. Clinton a passé des mois à faire pression sur l'Irak avant l'action militaire de Bush, mais même sans ces moyens, les États-Unis pensaient être prêts à une action immédiate. Au moment où les premières bombes américaines transperçaient les défenses aériennes irakiennes et frappaient Bagdad, le discours du président Bush commençait, CNN a, de manière mémorable, fait passer les paroles du président sur un écran partagé et les Américains ont pu voir simultanément les paroles et les actes du président.

Tirs anti-aériens irakiens au-dessus de Bagdad
Mes chers concitoyens, à cette heure, les forces américaines sont au début d'une opération militaire visant à désarmer l'Irak de ses capacités offensives afin de défendre le peuple irakien libre et de protéger le monde d'un régime agressif et oppressif.
Aujourd'hui, les forces américaines et britanniques, qui poursuivaient la stratégie de la zone d'exclusion aérienne et menaient des opérations de routine pour décourager l'agression irakienne, ont été attaquées et, ce faisant, un avion à réaction américain a été touché et s'est écrasé à l'intérieur de l'Irak. Je suis extrêmement préoccupé par cette perte et par le sort des pilotes américains et je continue à suivre la situation de près. Ces zones d'exclusion aérienne utilisées pour protéger les minorités irakiennes doivent être maintenues. Sur mon ordre, les forces américaines ont commencé à frapper des cibles sélectionnées d'importance militaire et stratégique et détruiront la capacité de Saddam Hussein à faire la guerre à son propre peuple et à ses voisins. Ces frappes doivent marquer le début d'une nouvelle politique qui ne tolérera pas la menace de Saddam Hussein, et nous demandons au monde entier de nous soutenir dans cette mission. Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre britannique Tony Blair, qui s'est engagé à soutenir les efforts que nous déployons actuellement pour ramener la paix dans cette région troublée. À partir de leurs bases navales et aériennes, nos troupes entreprendront cet effort et auront le devoir de servir des objectifs justes et humanitaires.
M. Bush a poursuivi son discours en exposant les raisons pour lesquelles l'opération en cours devait avoir lieu, sans évoquer, curieusement, la disparition de l'avion américain.
Saddam Hussein a commis des atrocités contre son propre peuple et les peuples des pays qui l'entourent. Pendant les dix années qui ont suivi l'invasion du Koweït par l'Irak, Saddam Hussein a contourné les sanctions internationales pour acheter des armes et des technologies de missiles, son peuple a souffert pendant qu'il construisait des palais et achetait des armes et qu'il rejetait la responsabilité de ses échecs sur le monde.
Le régime irakien n'a pas respecté ses promesses et le droit international, il n'a pas renoncé à son implication dans le terrorisme international, il a approuvé les attaques contre les dissidents irakiens, les chefs d'État étrangers et les civils innocents dans le monde entier. Le régime irakien a menti sur ses armes biologiques et a cherché à tromper le monde sur son programme d'armes nucléaires. Aujourd'hui, l'Irak continue de fuir les inspecteurs en désarmement. Cela fait maintenant cinq ans que les derniers inspecteurs en désarmement ont mis le pied en Irak, et les renseignements américains fiables ne laissent guère de doute sur le fait que le régime irakien a continué à chercher à se doter de ces armes.
Bush a également énuméré une série d'exigences à l'égard de l'Irak
Le dictateur irakien doit enfin répondre aux demandes internationales de désarmement de l'Irak et s'engager fermement à réadmettre les inspecteurs en désarmement de l'ONU et à coopérer pleinement avec eux, ainsi qu'à se conformer à toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Il doit cesser de menacer ses voisins, d'attaquer les avions alliés et de s'en prendre à ses propres citoyens.
Jusqu'à ce que ces engagements soient pris et tenus, nous devons poursuivre dans cette voie avec réticence. Le peuple des États-Unis, nos amis et nos alliés ne peuvent tolérer un régime qui continue à menacer la paix, et c'est pourquoi nous répondons à cette menace, nous choisissons la force décisive maintenant pour éviter un conflit plus grave plus tard. Nous ne reculerons pas devant notre devoir et nous n'accepterons pas d'autre issue que la victoire... Que Dieu bénisse notre pays et tous les hommes et femmes courageux qui le défendent.

(A gauche) Discours de George Bush sur le début de l'opération Desert Badger, (A droite) Images des frappes de missiles à Bagdad.
La soudaineté des événements a pris le monde entier par surprise et les journalistes et les citoyens ont été submergés par le contenu du discours combiné aux images du terrain. La vague de confusion a entraîné une certaine imprécision dans les reportages. L'Irak avait-il attaqué les États-Unis ? Les États-Unis avaient-ils déclaré la guerre à l'Irak ? Des troupes terrestres étaient-elles en route pour renverser le dictateur ? Les paroles du président laissaient beaucoup à désirer : des explications sur l'ampleur du rôle actuel de l'Amérique dans le conflit, une sorte de calendrier ou d'objectifs clairs pour la fin de l'attaque. Heureusement, les journalistes ont été plus satisfaits lorsque le secrétaire à la défense, Don Rumsfeld, est sorti pour prendre part à un point de presse, suivi par le président des chefs d'état-major interarmées, le général Myers. Presque fous, les journalistes ont été un peu plus rassurés lorsque Rumsfeld a déclaré sans ambages : "Il ne s'agit pas d'une invasion de l'Irak. Comme certains l'ont dit, si vous avez écouté les paroles du président, il a été clair : il s'agit d'une réponse à une attaque de l'Irak contre les forces aériennes américaines et britanniques plus tôt dans la journée. ... Le président a clairement indiqué que ces attaques ne pouvaient rester impunies et c'est de cela qu'il s'agit ... le président voulait une action, des options ont été présentées et c'est sa décision".
Comme d'habitude pour une conférence de presse de Rumsfeld, il l'a dirigée personnellement et a parfois joué avec les journalistes, tout en fournissant plus d'informations que la plupart des conférences. Lorsqu'on lui a demandé quand l'opération militaire s'arrêterait et si elle durerait plus longtemps que la campagne de 4 jours de Clinton ? "C'est à Saddam de décider, lorsqu'il choisira de mettre fin à ses attaques contre les avions alliés, de renoncer aux armes de destruction massive et de s'ouvrir aux inspecteurs, alors nous pourrons constater des progrès". Interrogé sur la planification de l'opération, il s'est empressé de réfuter l'idée qu'il s'agissait d'une opération mal planifiée et improvisée : "Nous sommes préparés ici (au Pentagone) à la mise en œuvre d'une telle opération depuis un certain temps, au moins depuis la guerre du Golfe, et il est clair que nous devions le faire maintenant ! Nous le savons".

Donald Rumsfeld et le général Myers informent les journalistes et le public
Les cibles visées ne se limitaient pas à Bagdad, où le monde a assisté au tir de barrage de missiles, mais des missiles de croisière navals étaient lancés dans tout le pays et les premières attaques aériennes ont commencé. Des centaines de missiles sillonnaient déjà le pays, touchant des dizaines de cibles telles que des bases militaires, des quartiers généraux du parti Baas, des camps d'entraînement terroristes supposés et des installations de production d'armes de destruction massive présumées. Les infrastructures irakiennes ont également été endommagées, notamment les ponts et les réseaux électriques déjà affaiblis. Tout cela faisait partie de l'opération publique visant à porter un coup au régime, mais la Maison Blanche et le ministère de la défense l'utilisaient dans le cadre de l'opération de sauvetage pour ralentir les mouvements de troupes.
Le sort du F-15 disparu, de son pilote et de son officier d'armement n'a toujours pas été confirmé, mais il y a désormais trois possibilités. 1 : les Américains ont été tragiquement tués soit dans l'attaque qui a provoqué l'écrasement, soit dans le crash qui a suivi, soit encore dans un échange de tirs avec les forces irakiennes ; 2 : ils ont survécu, peut-être en faisant atterrir l'avion ou en s'éjectant, et sont maintenant bloqués à des centaines de kilomètres dans un désert hostile, entourés de forces ennemies ;
3 : Ils étaient déjà capturés, ni le président ni Rumsfeld, dans leurs discours et conférences, n'ont fait d'autres commentaires que de reconnaître l'engagement militaire antérieur et le fait que sa localisation était inconnue. Rumsfeld s'est un peu étendu, déclarant qu'ils étaient au courant des rapports des services de renseignement et des médias irakiens, mais a noté que ces rapports étaient "un peu moins précis que ceux des médias américains". Mais tous deux étaient conscients des pires scénarios possibles. Des missions de reconnaissance au-dessus de la zone étaient déjà en cours, utilisant les premières attaques contre l'Irak comme couverture pour s'approcher beaucoup plus près que d'habitude. Un site probable de crash au nord d'Al-Kut a été identifié mais aucune communication radio ni aucun signe de déploiement de parachute n'ont pu être trouvés ou confirmés avec le commandement, les images de l'épave montraient des signes inquiétants qu'elle avait déjà été ramassée par des habitants et peut-être des militaires. Tout cela était prévisible, mais rendait une éventuelle opération de sauvetage de plus en plus délicate. Le temps était compté, survivre au terrain serait tout aussi décourageant que d'être capturé pour les aviateurs, et toute opération de sauvetage devrait être préparée pour combattre les forces irakiennes. Le président avait déjà autorisé les préparatifs d'une telle opération et, par la suite, des marines et une douzaine d'hélicoptères de transport, d'hélicoptères d'attaque, de jets et d'avions espions ont été préparés pour la mission, mais le président n'a pu agir qu'une fois que l'on a connu le lieu possible de l'opération.
La campagne de bombardement était vaste, couvrant l'ensemble du pays, c'était la plus grande campagne de bombardement menée par les États-Unis depuis la guerre du Golfe, mais indépendamment de l'ampleur et du mystère omniprésent, l'opinion publique a largement soutenu l'action militaire. 3 quarts des Américains ont approuvé la réponse du président, Desert Badger a reçu une plus grande approbation que la campagne Desert Fox de 1998 dirigée par Clinton, Fox ayant donné lieu à des accusations selon lesquelles le président détournait l'attention de la procédure de destitution en cours, et bien que les frappes Badger aient été accueillies par les mêmes protestations dovish/isolationnistes et quelques libéraux affirmant que le président tentait de répéter la guerre de son père pour améliorer sa cote dans les sondages, l'action du président a bénéficié d'un soutien bipartisan dans l'ensemble. La réaction à l'opération Badger pourrait se résumer à un soutien stupéfait, surtout lorsqu'elle a été associée à la nouvelle de l'écrasement d'un avion américain. Historiquement, elle a reflété l'impact d'autres tragédies militaires telles que Pearl Harbour ou, plus précisément, l'incident du golfe du Tonkin ou l'USS Maine, qui ont suscité l'indignation de l'opinion publique et augmenté le soutien à l'action militaire. Le président de la Chambre des représentants, M. Gephardt, a déclaré que "le peuple américain et le Congrès, malgré leurs divergences politiques, soutiennent fermement nos hommes et nos femmes des forces armées".
Et même si le chef de la majorité au Sénat, M. Daschle, a insisté pour obtenir l'autorisation du Congrès avant d'aller plus loin, il a déclaré qu'il soutenait la décision et qu'il espérait que "ces efforts forceront Saddam à s'asseoir à la table des négociations, à laisser la diplomatie reprendre ses droits". Le président de la commission des affaires étrangères, M. Joe Biden, s'est montré un peu plus blasé : "Si Saddam continue, il est clair que cela ne se terminera que de deux façons : soit il désarme, soit nous le désarmerons". Les républicains ont uniformément soutenu le président, même son rival John McCain (lui-même ancien pilote capturé pendant la guerre du Viêt Nam), et l'ont poussé à poursuivre l'action militaire : "La situation a changé, les Américains ont été attaqués, le Congrès a signé l'ILA (Iraqi Liberation Act), une menace doit être éliminée et le peuple irakien doit être libéré". Il y avait quelques opposants déclarés à l'action à la Chambre des représentants, et quelques-uns ont grommelé que le Congrès aurait dû être correctement informé et inclus dans la décision, et certains ont mis en garde contre toute nouvelle action sans le consentement de la Chambre, mais la plupart se sont tus jusqu'à ce que la poussière soit retombée, au sens proverbial et littéral du terme.

De gauche à droite, un manifestant isolé contre les frappes en Irak, le président de la Chambre des représentants Gephardt et les sénateurs Lieberman (D) et McCain (R), tous partisans de la décision du président.
La réaction du monde a été moins unanime. Il y a eu un certain soutien, le Président ayant mentionné que le Premier ministre britannique Tony Blair avait donné son appui aux actions de Bush après que les détails lui eurent été expliqués lors d'un appel téléphonique, et qu'il s'était ensuite engagé à soutenir les manœuvres américaines en cours. Blair a déclaré à propos de Desert Badger : "Depuis la guerre du Golfe, la communauté internationale tout entière s'est efforcée d'empêcher Saddam Hussein de conserver et de développer des armes nucléaires, chimiques et biologiques, de continuer à menacer ses voisins et d'empêcher l'oppression des citoyens irakiens. Saddam Hussein a réagi en rompant les accords, en développant ces armes et en multipliant les attaques contre nos avions... Je suis d'accord avec la décision prise aujourd'hui par le président Bush, l'action militaire était l'option claire et nécessaire".
La décision unilatérale prise par la Maison Blanche de lancer une vaste campagne de bombardements sans aucun avertissement, dans le cadre d'une "zone d'exclusion aérienne" qui n'était soutenue par aucune loi internationale, a sans surprise suscité la colère et l'indignation de la communauté internationale. Les membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, mais aussi la France, se sont montrés très mécontents. La France, qui s'était retirée de la coalition de la zone d'exclusion aérienne en 1996 en raison de l'absence d'applications humanitaires, a émis une opinion négative.
Le président socialiste Jospin a condamné la décision américaine : "Il est honteux que les Etats-Unis aient cédé à l'unilatéralisme ... traiter avec l'Irak exige une approche internationale équilibrée et cette attaque, sans consultation de quiconque, blesse la diplomatie et les efforts diplomatiques, ainsi que le peuple irakien ... Je regrette vivement la décision américaine d'aujourd'hui". Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a formulé des critiques similaires, bien que moins tranchées : "J'espère que les résolutions du Conseil de sécurité seront pleinement et pacifiquement respectées afin d'éviter le recours à la force ; les actions d'aujourd'hui ne peuvent être inversées, mais nous devons voir demain et après-demain, en Irak et dans toute la région, une diplomatie de la guérison".

à droite, le premier ministre Blair s'adresse au Parlement, le président français Jospin et le secrétaire général de l'ONU, M. Annan.
Bien entendu, les plus grands détracteurs des actions américaines ont été le gouvernement irakien qui, alors que cette longue journée touchait à sa fin et que le barrage initial de frappes ralentissait, a prononcé un discours particulièrement enflammé, essentiellement un appel aux armes. Le dictateur irakien Saddam Hussein a prononcé un discours emporté, qui était en fait un véritable appel au combat. "Notre grand peuple irakien et nos courageuses forces irakiennes sont appelés à combattre et à détruire nos ennemis. Les ennemis de Dieu, de tous les peuples arabes et de toute l'humanité. ... Ce sont des criminels, des sionistes, un agresseur diabolique qui pense que le bombardement du pays et la destruction de nos bâtiments anéantiront l'énorme volonté de notre peuple. Les lâches ne nous affronteront pas, car ils savent qu'ils ne sont pas de taille à faire face à notre bravoure féroce, au lieu de cela, le jeune Bush ne fait que nous menacer. Notre peuple, notre grand peuple irakien ! Comme le veut Dieu, nous serons victorieux !"

26 avril 2003.
Les manœuvres quotidiennes d'une mission militaire longue de dix ans se poursuivaient : l'opération Southern Watch, menée par les forces aériennes américaines et britanniques pour contrôler l'espace aérien dans le sud de l'Irak. Cette opération était menée officiellement pour dissuader l'Irak de mener un autre engagement militaire d'envergure, soit contre une nation voisine, par exemple une deuxième tentative d'annexion du Koweït, soit pour empêcher une action interne contre les chiites, similaire à la répression des Kurdes. La mission consistait à effectuer des centaines de sorties (opérations militaires) au-dessus de la région et à attaquer les principales installations militaires et les avions à réaction irakiens. En avril 2003, plus de 300 000 sorties avaient été effectuées au-dessus de l'Irak et, à la suite des frappes de missiles de l'ère Clinton en 1998 (Renard du désert), le gouvernement irakien a déclaré son intention de s'opposer à la mission sur le plan militaire. De 1998 à 2003, les avions américains et britanniques ont été la cible de tirs antiaériens irakiens. Le succès de la mission était difficile à déterminer, l'armée de l'air irakienne ayant largement évité les pertes en ne perdant que 3 MIG, et ayant délibérément manœuvré pour éviter la confrontation avec les appareils de la coalition. Au sol, les missiles sol-air et les armes antiaériennes ont régulièrement tiré sur les avions de la coalition, mais en vain. La coalition n'a subi aucune perte au cours de la campagne, et ses seules pertes ont été 4 drones de type "predator".
Les avions alliés ont à leur tour ciblé le matériel militaire irakien, mais il a été difficile de déterminer le succès de l'opération. La presse étrangère a décrit les attaques comme étant essentiellement punitives, réussissant à détruire leurs cibles moins d'une fois sur deux, et l'armée irakienne a très rapidement reconstitué ses pertes à chaque fois. Le faible taux de pertes s'explique par le fait que les avions de la coalition volaient très haut , obligeant les forces irakiennes à tirer à l'aveugle. Seule une "balle d'or" chanceuse pourrait abattre un avion allié, car les forces irakiennes avaient désactivé tout système de ciblage, pour éviter une riposte immédiate des alliés.
Un avion américain survole la zone d'exclusion aérienne irakienne dans le cadre de l'opération Southern Watch.
En 2003, le président George W. Bush a décidé d'augmenter le nombre de sorties au-dessus de l'Irak, prétextant de nouvelles menaces pour la sécurité du pays. Les vols ont doublé et le désir de Saddam de punir les États-Unis a également doublé. Il a fait passer de 14 000 à 20 000 dollars (40 000 si le pilote était capturé vivant) la prime prévue de longue date pour descendre les avions de la coalition. Le conflit était devenu si banal que la presse américaine l'avait qualifié de "guerre oubliée", mais les nouveaux engagements de Bush ont changé la donne : sa promesse ne signifiait pas seulement une augmentation des vols, elle signifiait des vols plus agressifs, triplant presque le nombre de sorties de combat. Certains analystes ont vu dans la rhétorique belliqueuse de la Maison Blanche un précurseur potentiel d'une invasion américaine. En décembre 2002, le New York Times a publié des documents classifiés montrant que le ministère de la défense avait élaboré de nouveaux plans d'invasion ; ces plans prévoyaient la pré-destruction des défenses aériennes irakiennes comme élément clé de tout plan et certains craignaient que l'administration n'en soit à ce stade ; cependant, l'administration est restée muette sur ces questions, arguant que le nouvel engagement était nécessaire uniquement en raison de la nouvelle menace que représentait Saddam Hussein.
La guerre oubliée s'est achevée le 26 avril 2003, lorsqu'un F-15 Eagle américain a perdu le contact avec le commandement central alors qu'il effectuait une sortie à l'intérieur de l'Irak. L'avion a été perdu près de la ville d'Al-Kut, l'une des cibles les plus septentrionales de la zone neutre sud. Il volait en duo lorsque les tirs antiaériens irakiens ont éclaté, provoquant la séparation des deux appareils qui ne se sont jamais retrouvés, silence radio. Les premiers rapports sur la disparition ont été divulgués par des sources arabes, mais le ministère de la défense a refusé de les confirmer ou de les infirmer. Jusqu'à présent, le seul autre cas avéré de perte temporaire d'un avion au-dessus de l'Irak remontait à 1997, lorsqu'un dysfonctionnement mécanique dans le nord du pays avait entraîné la perte de puissance d'un avion à réaction, qui avait dû regagner la Turquie en planant. Cette fois-ci, les choses étaient différentes - le F-15 était trop loin en territoire irakien. Si un avion subissait une panne similaire, le pilote n'aurait aucune chance de regagner une base américaine en Irak ou en Arabie Saoudite. Son meilleur espoir serait de pénétrer dans l'espace aérien iranien (ce qui pourrait entraîner une riposte militaire) ou d'atterrir en Irak même, et tout cela si un dysfonctionnement se produisait et non une balle "magique".
Emplacement approximatif du F-15 disparu
Les heures passèrent et l'espoir d'un retour miraculeux s'estompa lentement. Le ministère de la Défense devait désormais faire face au pire scénario possible, à savoir qu'un avion à réaction américain avait été perdu, voire détruit, au-dessus de l'Irak. Le commandement américain a autorisé un balayage complet et la recherche de l'appareil, et les premiers rapports officiels sur la disparition du jet ont été rédigés, sans qu'aucune raison ne soit avancée pour expliquer la perte de l'appareil. La première reconnaissance n'a révélé aucun signe du F-15 disparu, mais compte tenu des centaines de kilomètres carrés de désert à ratisser, ce ne fut pas une surprise. Le premier rapport détaillé sur la disparition est venu de l'Irak lui-même. L'Agence de presse irakienne (la seule chaîne d'information irakienne) a cité un porte-parole de la défense qui a déclaré que "les aigles de l'Irak et les hommes courageux chargés des armes antiaériennes ont abattu un avion de chasse américain qui s'est envolé de l'espace aérien koweïtien pour violer notre espace aérien et tuer le peuple irakien,". Le ministère de la défense et le secrétaire d'État Rumsfeld ont rapidement réagi pour mettre en doute les affirmations irakiennes : "Si nous savons que nous avons perdu le contact avec un avion, nous n'avons aucune raison de croire qu'il a été abattu". En privé, les responsables étaient beaucoup plus inquiets et chacun se préparait à la pire nouvelle possible. Le ministère de la défense ayant reconnu la situation, celle-ci a été transmise à la chaîne de commandement, qui a décidé des mesures à prendre.
Le président assistait à une réunion concernant l'aide fédérale en réponse aux violentes tempêtes hivernales lorsque les premières informations concernant l'avion disparu lui sont parvenues. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre plus d'informations, mais une heure plus tard, le président a été informé qu'un briefing de sécurité d'urgence avait été préparé pour discuter de ses "options" et la réunion sur les tempêtes a été écourtée. Pendant des années, le ministère de la défense a préparé de telles "options". Bush a appris que si l'Irak avait réussi à abattre un avion à réaction, les États-Unis devaient agir rapidement pour empêcher la capture du pilote et de l'officier chargé de l'armement à bord, ce qui serait de loin le pire scénario possible.
Le président Bush rencontre ses conseillers en matière de sécurité nationale
Les protocoles en place pour une telle opération existaient depuis l'administration Clinton, mais Rumsfeld, avec l'approbation du président, avait très tôt renforcé les conséquences militaires d'une telle opération, baptisée Desert Badger. Le plan Clinton prévoyait des frappes immédiates (effectuées par des avions américains et/ou des missiles de croisière) sur des cibles à travers l'Irak afin de désorganiser le commandement militaire irakien et d'empêcher la capture du pilote abattu. L'expansion de Rumsfeld était la deuxième option qui visait plus que l'armée irakienne - elle s'attaquait au régime dans son ensemble - et était conçue pour paralyser non seulement l'armée, mais aussi l'infrastructure et l'industrie de l'Irak, y compris les éventuelles installations d'armes de destruction massive (ADM). Enfin, le Desert Badger de Rumsfeld prévoyait une mission de sauvetage des pilotes abattus ou potentiellement déjà capturés. Certains ajouts de Rumsfeld allaient même plus loin : la troisième option prévoyait non seulement la destruction des bases irakiennes depuis les airs, mais aussi l'envoi de troupes américaines sur le terrain, pour s'emparer de régions clés de l'Irak, ce qui aurait permis de mettre en œuvre en douceur la stratégie de Wolfowitz visant à séparer totalement Bagdad des zones d'exclusion aérienne du sud et du nord, dans l'espoir d'un soulèvement irakien.
Le président a choisi la deuxième option, rejetant le plan Wolfowitz et convenant avec les responsables militaires que les États-Unis n'étaient pas en mesure de déclencher une invasion immédiate de l'Irak.
L'image d'aviateurs américains traînés dans les rues, battus et soumis à un simulacre de procès était impossible à ignorer et le président savait qu'une action forte était nécessaire. Desert Badger constituerait l'action militaire la plus importante menée par les États-Unis depuis la guerre du Golfe. Comme l'a déclaré plus tard Rumsfeld, "ces frappes devaient être d'une ampleur telle qu'elles indiqueraient aux Irakiens (Saddam Hussein) que les États-Unis ne toléreraient pas les actions du régime... afin d'instiller un sentiment de choc et de stupeur"
Quelques heures après la décision du président et au moment où l'agence de presse irakienne et les médias internationaux publiaient leurs rapports sur la disparition de l'avion, les cibles ont été déterminées, les pilotes ont été dépêchés aux postes d'action et les premiers missiles de croisière ont été lancés par la flotte américaine.
Opération Desert Badger
(A gauche) un avion américain décolle du Koweït pour participer à Desert Badger, (A droite) missiles de croisière lancés par la 5e flotte américaine.
Les premières bombes tombèrent sur l'Irak le 26 au soir, un peu moins de 7 heures après la disparition. Le monde tournait en rond, n'ayant toujours pas reçu d'explication complète sur les événements de la journée. Incertaine de l'ampleur des attaques américaines, la télévision en direct montrait Bagdad en proie à des tirs anti-aériens, et les destructions qui s'ensuivaient au sein même de la ville. La précipitation de l'opération a semé le chaos parmi les journalistes sur le terrain, qui ne savaient pas jusqu'où irait la campagne américaine. Les correspondants étrangers à Bagdad n'ont eu que quelques minutes pour réagir après que les agences de presse ont été informées de la décision du président avant la diffusion d'un message présidentiel. Les journalistes se sont empressés d'assembler un flux en direct pour capturer l'extraordinaire spectacle de lumière en cours.
Contrairement à Desert Fox en 1998, l'action de Bush a été lancée sans soutien étranger confirmé et avec peu de moyens militaires ou politiques. Clinton a passé des mois à faire pression sur l'Irak avant l'action militaire de Bush, mais même sans ces moyens, les États-Unis pensaient être prêts à une action immédiate. Au moment où les premières bombes américaines transperçaient les défenses aériennes irakiennes et frappaient Bagdad, le discours du président Bush commençait, CNN a, de manière mémorable, fait passer les paroles du président sur un écran partagé et les Américains ont pu voir simultanément les paroles et les actes du président.
Tirs anti-aériens irakiens au-dessus de Bagdad
Mes chers concitoyens, à cette heure, les forces américaines sont au début d'une opération militaire visant à désarmer l'Irak de ses capacités offensives afin de défendre le peuple irakien libre et de protéger le monde d'un régime agressif et oppressif.
Aujourd'hui, les forces américaines et britanniques, qui poursuivaient la stratégie de la zone d'exclusion aérienne et menaient des opérations de routine pour décourager l'agression irakienne, ont été attaquées et, ce faisant, un avion à réaction américain a été touché et s'est écrasé à l'intérieur de l'Irak. Je suis extrêmement préoccupé par cette perte et par le sort des pilotes américains et je continue à suivre la situation de près. Ces zones d'exclusion aérienne utilisées pour protéger les minorités irakiennes doivent être maintenues. Sur mon ordre, les forces américaines ont commencé à frapper des cibles sélectionnées d'importance militaire et stratégique et détruiront la capacité de Saddam Hussein à faire la guerre à son propre peuple et à ses voisins. Ces frappes doivent marquer le début d'une nouvelle politique qui ne tolérera pas la menace de Saddam Hussein, et nous demandons au monde entier de nous soutenir dans cette mission. Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre britannique Tony Blair, qui s'est engagé à soutenir les efforts que nous déployons actuellement pour ramener la paix dans cette région troublée. À partir de leurs bases navales et aériennes, nos troupes entreprendront cet effort et auront le devoir de servir des objectifs justes et humanitaires.
M. Bush a poursuivi son discours en exposant les raisons pour lesquelles l'opération en cours devait avoir lieu, sans évoquer, curieusement, la disparition de l'avion américain.
Saddam Hussein a commis des atrocités contre son propre peuple et les peuples des pays qui l'entourent. Pendant les dix années qui ont suivi l'invasion du Koweït par l'Irak, Saddam Hussein a contourné les sanctions internationales pour acheter des armes et des technologies de missiles, son peuple a souffert pendant qu'il construisait des palais et achetait des armes et qu'il rejetait la responsabilité de ses échecs sur le monde.
Le régime irakien n'a pas respecté ses promesses et le droit international, il n'a pas renoncé à son implication dans le terrorisme international, il a approuvé les attaques contre les dissidents irakiens, les chefs d'État étrangers et les civils innocents dans le monde entier. Le régime irakien a menti sur ses armes biologiques et a cherché à tromper le monde sur son programme d'armes nucléaires. Aujourd'hui, l'Irak continue de fuir les inspecteurs en désarmement. Cela fait maintenant cinq ans que les derniers inspecteurs en désarmement ont mis le pied en Irak, et les renseignements américains fiables ne laissent guère de doute sur le fait que le régime irakien a continué à chercher à se doter de ces armes.
Bush a également énuméré une série d'exigences à l'égard de l'Irak
Le dictateur irakien doit enfin répondre aux demandes internationales de désarmement de l'Irak et s'engager fermement à réadmettre les inspecteurs en désarmement de l'ONU et à coopérer pleinement avec eux, ainsi qu'à se conformer à toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Il doit cesser de menacer ses voisins, d'attaquer les avions alliés et de s'en prendre à ses propres citoyens.
Jusqu'à ce que ces engagements soient pris et tenus, nous devons poursuivre dans cette voie avec réticence. Le peuple des États-Unis, nos amis et nos alliés ne peuvent tolérer un régime qui continue à menacer la paix, et c'est pourquoi nous répondons à cette menace, nous choisissons la force décisive maintenant pour éviter un conflit plus grave plus tard. Nous ne reculerons pas devant notre devoir et nous n'accepterons pas d'autre issue que la victoire... Que Dieu bénisse notre pays et tous les hommes et femmes courageux qui le défendent.
(A gauche) Discours de George Bush sur le début de l'opération Desert Badger, (A droite) Images des frappes de missiles à Bagdad.
La soudaineté des événements a pris le monde entier par surprise et les journalistes et les citoyens ont été submergés par le contenu du discours combiné aux images du terrain. La vague de confusion a entraîné une certaine imprécision dans les reportages. L'Irak avait-il attaqué les États-Unis ? Les États-Unis avaient-ils déclaré la guerre à l'Irak ? Des troupes terrestres étaient-elles en route pour renverser le dictateur ? Les paroles du président laissaient beaucoup à désirer : des explications sur l'ampleur du rôle actuel de l'Amérique dans le conflit, une sorte de calendrier ou d'objectifs clairs pour la fin de l'attaque. Heureusement, les journalistes ont été plus satisfaits lorsque le secrétaire à la défense, Don Rumsfeld, est sorti pour prendre part à un point de presse, suivi par le président des chefs d'état-major interarmées, le général Myers. Presque fous, les journalistes ont été un peu plus rassurés lorsque Rumsfeld a déclaré sans ambages : "Il ne s'agit pas d'une invasion de l'Irak. Comme certains l'ont dit, si vous avez écouté les paroles du président, il a été clair : il s'agit d'une réponse à une attaque de l'Irak contre les forces aériennes américaines et britanniques plus tôt dans la journée. ... Le président a clairement indiqué que ces attaques ne pouvaient rester impunies et c'est de cela qu'il s'agit ... le président voulait une action, des options ont été présentées et c'est sa décision".
Comme d'habitude pour une conférence de presse de Rumsfeld, il l'a dirigée personnellement et a parfois joué avec les journalistes, tout en fournissant plus d'informations que la plupart des conférences. Lorsqu'on lui a demandé quand l'opération militaire s'arrêterait et si elle durerait plus longtemps que la campagne de 4 jours de Clinton ? "C'est à Saddam de décider, lorsqu'il choisira de mettre fin à ses attaques contre les avions alliés, de renoncer aux armes de destruction massive et de s'ouvrir aux inspecteurs, alors nous pourrons constater des progrès". Interrogé sur la planification de l'opération, il s'est empressé de réfuter l'idée qu'il s'agissait d'une opération mal planifiée et improvisée : "Nous sommes préparés ici (au Pentagone) à la mise en œuvre d'une telle opération depuis un certain temps, au moins depuis la guerre du Golfe, et il est clair que nous devions le faire maintenant ! Nous le savons".
Donald Rumsfeld et le général Myers informent les journalistes et le public
Les cibles visées ne se limitaient pas à Bagdad, où le monde a assisté au tir de barrage de missiles, mais des missiles de croisière navals étaient lancés dans tout le pays et les premières attaques aériennes ont commencé. Des centaines de missiles sillonnaient déjà le pays, touchant des dizaines de cibles telles que des bases militaires, des quartiers généraux du parti Baas, des camps d'entraînement terroristes supposés et des installations de production d'armes de destruction massive présumées. Les infrastructures irakiennes ont également été endommagées, notamment les ponts et les réseaux électriques déjà affaiblis. Tout cela faisait partie de l'opération publique visant à porter un coup au régime, mais la Maison Blanche et le ministère de la défense l'utilisaient dans le cadre de l'opération de sauvetage pour ralentir les mouvements de troupes.
Le sort du F-15 disparu, de son pilote et de son officier d'armement n'a toujours pas été confirmé, mais il y a désormais trois possibilités. 1 : les Américains ont été tragiquement tués soit dans l'attaque qui a provoqué l'écrasement, soit dans le crash qui a suivi, soit encore dans un échange de tirs avec les forces irakiennes ; 2 : ils ont survécu, peut-être en faisant atterrir l'avion ou en s'éjectant, et sont maintenant bloqués à des centaines de kilomètres dans un désert hostile, entourés de forces ennemies ;
3 : Ils étaient déjà capturés, ni le président ni Rumsfeld, dans leurs discours et conférences, n'ont fait d'autres commentaires que de reconnaître l'engagement militaire antérieur et le fait que sa localisation était inconnue. Rumsfeld s'est un peu étendu, déclarant qu'ils étaient au courant des rapports des services de renseignement et des médias irakiens, mais a noté que ces rapports étaient "un peu moins précis que ceux des médias américains". Mais tous deux étaient conscients des pires scénarios possibles. Des missions de reconnaissance au-dessus de la zone étaient déjà en cours, utilisant les premières attaques contre l'Irak comme couverture pour s'approcher beaucoup plus près que d'habitude. Un site probable de crash au nord d'Al-Kut a été identifié mais aucune communication radio ni aucun signe de déploiement de parachute n'ont pu être trouvés ou confirmés avec le commandement, les images de l'épave montraient des signes inquiétants qu'elle avait déjà été ramassée par des habitants et peut-être des militaires. Tout cela était prévisible, mais rendait une éventuelle opération de sauvetage de plus en plus délicate. Le temps était compté, survivre au terrain serait tout aussi décourageant que d'être capturé pour les aviateurs, et toute opération de sauvetage devrait être préparée pour combattre les forces irakiennes. Le président avait déjà autorisé les préparatifs d'une telle opération et, par la suite, des marines et une douzaine d'hélicoptères de transport, d'hélicoptères d'attaque, de jets et d'avions espions ont été préparés pour la mission, mais le président n'a pu agir qu'une fois que l'on a connu le lieu possible de l'opération.
La campagne de bombardement était vaste, couvrant l'ensemble du pays, c'était la plus grande campagne de bombardement menée par les États-Unis depuis la guerre du Golfe, mais indépendamment de l'ampleur et du mystère omniprésent, l'opinion publique a largement soutenu l'action militaire. 3 quarts des Américains ont approuvé la réponse du président, Desert Badger a reçu une plus grande approbation que la campagne Desert Fox de 1998 dirigée par Clinton, Fox ayant donné lieu à des accusations selon lesquelles le président détournait l'attention de la procédure de destitution en cours, et bien que les frappes Badger aient été accueillies par les mêmes protestations dovish/isolationnistes et quelques libéraux affirmant que le président tentait de répéter la guerre de son père pour améliorer sa cote dans les sondages, l'action du président a bénéficié d'un soutien bipartisan dans l'ensemble. La réaction à l'opération Badger pourrait se résumer à un soutien stupéfait, surtout lorsqu'elle a été associée à la nouvelle de l'écrasement d'un avion américain. Historiquement, elle a reflété l'impact d'autres tragédies militaires telles que Pearl Harbour ou, plus précisément, l'incident du golfe du Tonkin ou l'USS Maine, qui ont suscité l'indignation de l'opinion publique et augmenté le soutien à l'action militaire. Le président de la Chambre des représentants, M. Gephardt, a déclaré que "le peuple américain et le Congrès, malgré leurs divergences politiques, soutiennent fermement nos hommes et nos femmes des forces armées".
Et même si le chef de la majorité au Sénat, M. Daschle, a insisté pour obtenir l'autorisation du Congrès avant d'aller plus loin, il a déclaré qu'il soutenait la décision et qu'il espérait que "ces efforts forceront Saddam à s'asseoir à la table des négociations, à laisser la diplomatie reprendre ses droits". Le président de la commission des affaires étrangères, M. Joe Biden, s'est montré un peu plus blasé : "Si Saddam continue, il est clair que cela ne se terminera que de deux façons : soit il désarme, soit nous le désarmerons". Les républicains ont uniformément soutenu le président, même son rival John McCain (lui-même ancien pilote capturé pendant la guerre du Viêt Nam), et l'ont poussé à poursuivre l'action militaire : "La situation a changé, les Américains ont été attaqués, le Congrès a signé l'ILA (Iraqi Liberation Act), une menace doit être éliminée et le peuple irakien doit être libéré". Il y avait quelques opposants déclarés à l'action à la Chambre des représentants, et quelques-uns ont grommelé que le Congrès aurait dû être correctement informé et inclus dans la décision, et certains ont mis en garde contre toute nouvelle action sans le consentement de la Chambre, mais la plupart se sont tus jusqu'à ce que la poussière soit retombée, au sens proverbial et littéral du terme.
De gauche à droite, un manifestant isolé contre les frappes en Irak, le président de la Chambre des représentants Gephardt et les sénateurs Lieberman (D) et McCain (R), tous partisans de la décision du président.
La réaction du monde a été moins unanime. Il y a eu un certain soutien, le Président ayant mentionné que le Premier ministre britannique Tony Blair avait donné son appui aux actions de Bush après que les détails lui eurent été expliqués lors d'un appel téléphonique, et qu'il s'était ensuite engagé à soutenir les manœuvres américaines en cours. Blair a déclaré à propos de Desert Badger : "Depuis la guerre du Golfe, la communauté internationale tout entière s'est efforcée d'empêcher Saddam Hussein de conserver et de développer des armes nucléaires, chimiques et biologiques, de continuer à menacer ses voisins et d'empêcher l'oppression des citoyens irakiens. Saddam Hussein a réagi en rompant les accords, en développant ces armes et en multipliant les attaques contre nos avions... Je suis d'accord avec la décision prise aujourd'hui par le président Bush, l'action militaire était l'option claire et nécessaire".
La décision unilatérale prise par la Maison Blanche de lancer une vaste campagne de bombardements sans aucun avertissement, dans le cadre d'une "zone d'exclusion aérienne" qui n'était soutenue par aucune loi internationale, a sans surprise suscité la colère et l'indignation de la communauté internationale. Les membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, mais aussi la France, se sont montrés très mécontents. La France, qui s'était retirée de la coalition de la zone d'exclusion aérienne en 1996 en raison de l'absence d'applications humanitaires, a émis une opinion négative.
Le président socialiste Jospin a condamné la décision américaine : "Il est honteux que les Etats-Unis aient cédé à l'unilatéralisme ... traiter avec l'Irak exige une approche internationale équilibrée et cette attaque, sans consultation de quiconque, blesse la diplomatie et les efforts diplomatiques, ainsi que le peuple irakien ... Je regrette vivement la décision américaine d'aujourd'hui". Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a formulé des critiques similaires, bien que moins tranchées : "J'espère que les résolutions du Conseil de sécurité seront pleinement et pacifiquement respectées afin d'éviter le recours à la force ; les actions d'aujourd'hui ne peuvent être inversées, mais nous devons voir demain et après-demain, en Irak et dans toute la région, une diplomatie de la guérison".
à droite, le premier ministre Blair s'adresse au Parlement, le président français Jospin et le secrétaire général de l'ONU, M. Annan.
Bien entendu, les plus grands détracteurs des actions américaines ont été le gouvernement irakien qui, alors que cette longue journée touchait à sa fin et que le barrage initial de frappes ralentissait, a prononcé un discours particulièrement enflammé, essentiellement un appel aux armes. Le dictateur irakien Saddam Hussein a prononcé un discours emporté, qui était en fait un véritable appel au combat. "Notre grand peuple irakien et nos courageuses forces irakiennes sont appelés à combattre et à détruire nos ennemis. Les ennemis de Dieu, de tous les peuples arabes et de toute l'humanité. ... Ce sont des criminels, des sionistes, un agresseur diabolique qui pense que le bombardement du pays et la destruction de nos bâtiments anéantiront l'énorme volonté de notre peuple. Les lâches ne nous affronteront pas, car ils savent qu'ils ne sont pas de taille à faire face à notre bravoure féroce, au lieu de cela, le jeune Bush ne fait que nous menacer. Notre peuple, notre grand peuple irakien ! Comme le veut Dieu, nous serons victorieux !"

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas et Rayan du Griffoul aiment ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 21: Les inconnues inconnues.
Desert Badger Suite - Jour 2
En l'espace de 24 heures, les États-Unis ont entrepris une opération militaire d'envergure contre l'Irak, avec très peu d'avertissement quant à leurs actions. Un premier barrage de missiles et de jets a visé une longue liste de sites militaires, politiques, industriels et logistiques irakiens, dans le but de "réduire la capacité de l'Irak à faire la guerre". Tout cela en représailles à la disparition d'un jet américain que les médias d'État irakiens et certaines sources au sein du ministère de la défense ont attribué à une attaque irakienne. Pour simplifier la situation, il s'agissait d'une série d'événements stupéfiants et peu de gens se sentaient en mesure de deviner où les choses allaient se terminer.
Tout au long de la nuit, les forces américaines (avec l'aide des Britanniques) ont effectué des sorties au-dessus de la région où l'avion avait été perdu, dans l'espoir de retrouver les aviateurs manquants (un pilote et un officier armement) et de déclencher une mission de sauvetage adéquate. Le temps était compté, deux Américains ne pouvaient espérer survivre longtemps dans l'Irak baasiste, mais depuis la disparition et le supposé crash, le commandement américain n'a eu que le silence radio. Malgré tout, Desert Badger a continué, tandis que les frappes sur les grandes villes et les centres de population irakiens se sont ralenties après la vague initiale, dans tout l'Irak, les bombes ont tenté de perturber (et peut-être de détruire) le commandement et le contrôle irakiens afin de gagner du temps pour retrouver les hommes et endommager le régime de Saddam en général.

Un porte-avions américain de la 5e flotte lance des avions à réaction sur l'Irak.
Le monde s'est réveillé pour observer les conséquences de l'attaque du premier jour. Ce qu'ils ont vu était une opération beaucoup plus destructrice que les bombardements de 2001 ou 1998, car les Américains ont frappé beaucoup plus de cibles que prévu, les aérodromes du pays, les principales structures de communication, les bases d'approvisionnement et les dépôts de carburant ont été attaqués pour brouiller toute réponse irakienne. Les attaques américaines ont été lancées avec un temps de préparation extrêmement réduit pour les militaires et les citoyens irakiens. Selon certaines estimations, les centaines de victimes de la seule ville de Bagdad ont été plus nombreuses que celles de la campagne Desert Fox, qui avait duré quatre jours.
L'opinion publique américaine a largement soutenu l'exercice et les explications de l'administration Bush en ont satisfait plus d'un, mais des questions subsistaient, notamment en ce qui concerne l'escalade potentielle : le président devait-il prendre d'autres mesures et aller au-delà d'une simple campagne aérienne ? Il n'y avait pas de véritable objectif politique déclaré, si ce n'est que Saddam devait se démilitariser, se conformer à toutes les résolutions de l'ONU et mettre fin aux attaques contre les avions alliés. Ces exigences étaient partagées par tous les hommes politiques nationaux, mais les détracteurs de l'administration étaient au courant des discours musclés et des fuites du ministère de la défense concernant Saddam et l'Irak, et craignaient que le conflit actuel ne serve de prétexte à une guerre plus vaste visant à éliminer Saddam Hussein par la force.
Ce n'était pas si exagéré, compte tenu de la politique américaine déclarée de changement de régime et, selon la durée de la campagne de bombardement, les États-Unis pourraient s'engager sur la voie de la guerre. Cependant, la Chambre des représentants a manifesté son soutien à l'action militaire en cours en adoptant une résolution visant à soutenir "les hommes et les femmes de nos forces armées dans l'accomplissement de leurs missions". Seuls 11 représentants se sont opposés au vote, parmi lesquels les démocrates Barbara Lee et Cynthia McKinney, l'indépendant Bernie Sanders et le seul détracteur républicain, Ron Paul.

(De gauche à droite) Les représentants Lee, Sanders et Paul, tous critiques des frappes.
Le deuxième jour, alors que des questions continuaient d'être soulevées, l'administration Bush s'est prononcée plus clairement sur ses objectifs en Irak. Rumsfeld a vanté le succès de l'opération en présentant une carte des bases anti-aériennes, des camps d'entraînement terroristes et des installations supposées de production d'armes de destruction massive qui avaient été touchées. Satisfait des "énormes progrès réalisés par nos forces aériennes et navales pour désarmer Saddam de ses armes offensives, sans aucune perte", le secrétaire d'État à la défense, interrogé à nouveau sur la possibilité d'une nouvelle participation américaine, a déclaré : "Nous sommes prêts à toutes les options, mais il est clair que l'action américaine dépendra de la manière dont le gouvernement irakien ira de l'avant, mais je répète que nous restons prêts à intervenir sans limite de temps". Ces propos indiquaient que l'administration restait, au mieux, dans le flou quant aux prochaines étapes de l'opération. Le président a fait une brève déclaration indiquant qu'il était satisfait du déroulement de l'opération, décrivant l'attaque comme "le seul moyen de poursuivre Saddam" et assimilant les frappes à une punition pour les actions des dictateurs plutôt qu'à une doctrine spécifique.
Les journalistes ont été un peu plus combatifs, un rapport du Washington Post détaillant comment les frappes à Bagdad le premier jour visaient clairement plus que des sites militaires, et que l'administration visait à déstabiliser le régime dans son ensemble. Le gouvernement irakien est resté plus hostile que jamais, accusant les États-Unis d'une attaque non provoquée. Des journalistes étrangers ont été emmenés visiter des cratères à Bagdad et on leur a dit que les États-Unis avaient délibérément visé des zones civiles. L'Irak a également accusé les États-Unis de viser personnellement Hussein et sa famille lors des frappes ratées, bien que Rumsfeld ait contesté toute affirmation irakienne quant aux objectifs des États-Unis. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Ari Fleischer, à qui l'on demandait si les États-Unis avaient l'intention d'entreprendre une nouvelle action militaire, a donné une réponse curieuse, réitérant tout d'abord les nombreuses options dont disposaient les États-Unis face à l'Irak, mais il a également précisé que la politique de la Maison Blanche était la suivante : "Le changement de régime a été et continue d'être notre politique".
Interrogé sur la manière dont un changement de régime serait opéré, il a déclaré : "Eh bien, je dis au peuple irakien que nous l'encourageons à prendre lui-même cette mesure", ce qui ne pouvait être interprété que comme un encouragement à une révolution en Irak de la part du porte-parole du président.

Le secrétaire de presse de la Maison Blanche, M. Fleischer
Le discours de fermeté n'a pas été unilatéral à Washington, puisque certains ont cherché à revenir sur la politique de la corde raide qui était à l'œuvre. Le secrétaire d'État Powell, apparemment absent de la décision de déclencher Desert Badger, a fait un briefing pour présenter les objectifs de son ministère en Irak. Il a déclaré qu'il soutenait la décision du président, mais qu'il était moins clair quant à la politique américaine en matière de changement de régime : "En ce qui concerne l'Irak, cela (le changement de régime) n'a rien à voir avec la question ; en parlant avec le président, il a dit très clairement que tout était lié aux attaques de l'Irak contre les avions de la coalition, et que nous devions obliger l'Irak à mettre fin à ces attaques [...] il n'est pas question de changement de régime, bien au contraire".
La recherche des pilotes disparus était le facteur tacite de l'opération militaire en Irak, mais ce n'était pas un secret pour la marine et l'armée de l'air américaines qui ont mené des recherches massives dans l'espoir de capter des communications radio, des mouvements de troupes et tout indice sur l'endroit où se trouverait un pilote, vivant ou mort. Les Américains pensaient alors que les pilotes étaient probablement détenus par des Irakiens, qu'il s'agisse de civils, de policiers ou de militaires. Les mouvements à proximité du site probable du crash penchaient en faveur de cette solution, étant donné les possibilités moins probables que les deux pilotes puissent échapper à la capture dans une région aussi hostile.
L'opération de sauvetage a consisté à surveiller les forces irakiennes pour repérer toute tentative de transport des pilotes plus au nord, ce qui est allé à l'encontre des objectifs d'autres frappes militaires, car cela a obligé les forces américaines à ne pas attaquer les forces irakiennes autour du site du crash. Les services de renseignement américains ont rapidement été associés à l'opération pour contribuer aux recherches, en traduisant les renseignements et en disséquant les photographies, ainsi qu'en utilisant toutes les sources présentes en Irak pour les presser de fournir des informations.
Troisième jour
Au troisième jour de l'opération, les frappes, les vols et la surveillance se sont poursuivis dans tout l'Irak. Tandis que les différents secrétaires et membres du personnel exécutif faisaient l'éloge des hommes et des femmes sur le terrain et vantaient les mérites d'une liste de cibles détruites, une lutte s'engageait dans les allées du pouvoir. Dans les allées du pouvoir, les différents cabinets se plaignaient d'être tenus à l'écart d'une opération dont ils avaient été aussi peu avertis que le grand public américain. L'ensemble de l'opération sentait à plein nez la mise en scène du DoD Rumsfeld/Wolfowitz, sans doute présentée au président comme la seule action possible. C'était certainement le point de vue du secrétaire d'État Powell qui, en tant que diplomate en chef du pays, estimait qu'il aurait dû être associé à la décision de bombarder les grandes villes (l'exclusion de Powell de la décision a par la suite été démentie par des membres de l'administration Bush, mais a été confirmée par des sources confidentielles). D'autres ont été contrariés par la décision de Rumsfeld d'étendre Desert Badger sans l'avis de la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice ou du directeur de la CIA George Tenet. Une fois que l'ampleur de l'opération leur a été révélée, les soupçons se sont portés sur Rumsfeld, conscient que son adjoint et lui-même souhaitaient depuis longtemps faire tomber le dictateur.
A l'intérieur de la Maison Blanche, il n'y avait guère de temps pour une contemplation solennelle de l'opération en cours, même si Rumsfeld, les chefs d'état-major et le président faisaient bonne figure, les querelles intestines sur ce que seraient exactement les prochaines étapes consumaient la branche exécutive. Peu de personnes avaient été informées de la décision d'opter pour Desert Badger. C'était peut-être excusable, après tout, une action immédiate était nécessaire pour empêcher la capture d'aviateurs américains, mais quelqu'un aurait dû au moins prévenir le secrétaire d'État et la CIA, qui n'ont été informés de la décision qu'une fois celle-ci prise, et seulement ensuite pour demander les cibles disponibles à frapper. Mais dès que les bombes ont commencé à tomber, tout le monde s'est empressé d'être au courant, d'influencer la prise de décision du président, ou au moins de ne pas se mettre dans l'embarras en se contredisant les uns les autres.

Le président Bush rencontre son équipe de sécurité nationale
Il était clair que le Président ne savait pas exactement quoi faire ensuite, il était certain d'avoir pris les bonnes décisions jusqu'à présent, il avait été appelé à agir et il était absolument certain de sa décision. Il a rejeté catégoriquement toute idée des médias selon laquelle il aurait été manipulé par Rumsfeld, il était le Président et c'est lui qui prenait les décisions. Mais aussi certain qu'il ait été d'ordonner les frappes, son esprit était principalement concentré sur l'opération de sauvetage et non sur la politique irakienne au sens large. Bush a réuni ses équipes de sécurité nationale pour discuter justement de cela, pour déterminer leurs objectifs et la manière de les atteindre. Lors de la réunion, Rumsfeld s'est lancé dans le vif du sujet, énumérant les nombreuses victoires des forces américaines et dressant la liste des anciennes structures à l'intérieur de l'Irak, Rumsfeld a présenté le régime de Saddam comme effondré, son armée en déroute et ses dirigeants en fuite ; il a souligné qu'ils n'avaient pas vu Saddam depuis le premier jour, ce qui laissait entendre qu'il se cachait probablement. Avant qu'il ne parvienne à sa conclusion, la conseillère à la sécurité nationale, Mme Rice, l'a interrompu pour lui demander des informations sur les pilotes, ce que le président a accepté. Rumsfeld a donné des nouvelles décevantes, sans changement. "Nous prions tous pour qu'ils reviennent sains et saufs", a déclaré le président.
Il y a quelques mois, le président avait modifié la politique américaine pour adopter une position agressive à l'égard de l'Irak, autorisant des actions secrètes pour aider l'opposition irakienne et une application plus stricte de la politique actuelle, et maintenant Saddam a défié les États-Unis une fois de plus : "Il essaie de nous tester, de voir ce que nous sommes prêts à faire, mais je ne reculerai pas". Le président, qui n'est pas l'orateur le plus précis lorsqu'il faut intervenir, a rendu la salle tout aussi incertaine lorsqu'il a posé la question. Rumsfeld a hoché la tête, a pris un air aussi pensif que possible et a dit directement:
"Nous devrions le tuer, nous devrions aller à Bagdad et le capturer ou le tuer, en ce moment même, les Américains se battent pour défendre les Américains et libérer un peuple, le Congrès l'a approuvé et l'opinion publique le soutient."
Nous avons élaboré les plans, je dis allons-y". C'était le genre de discours direct que seul le secrétaire à la défense pouvait tenir, pour proposer une opération militaire d'une ampleur inégalée depuis la guerre du Viêt Nam, sur un ton presque sarcastique. "Nous utilisons les frappes pour détruire les défenses de l'Irak, nous frappons le régime dans tous les sens, pendant que nous déplaçons les forces terrestres nécessaires au Koweït et que nous nous dirigeons directement vers Bagdad". Powell semblait peiné. La rivalité entre les deux secrétaires était légendaire et le fait d'entendre Rumsfeld passer sous silence le sang et la sueur d'une telle opération en disant qu'il fallait "aller directement à Bagdad" a profondément blessé Powell. Il s'est senti personnellement insulté par les actions de Rumsfeld, convaincu que ce dernier l'avait délibérément exclu de la décision de l'opération pour lui nuire, mais il était maintenant prêt à contrer les suppositions grossières de Rumsfeld.

Les secrétaires Powell et Rumsfeld
"Don, vous faites beaucoup de suppositions générales" Powell, qui avait étudié de près les nombreux plans de guerre, les a démantelés "Nous allons avoir besoin de plus de temps, de plus d'équipement et de plus d'alliés pour quelque chose d'aussi grand" (on estime qu'il faudrait au moins une demi-année pour que les troupes terrestres suffisantes soient mises en place), pour garantir la victoire avant toute opération, Rumsfeld était à l'opposé, il considérait l'aversion au risque comme un problème et avait cherché à l'extirper de son Pentagone, il s'était battu pour élever le niveau de risque, avait réduit les coûts et les effectifs (le plan de guerre de Rumsfeld a réduit de moitié les effectifs estimés pour une invasion de l'Irak, estimant qu'une telle opération pourrait débuter en 2 à 3 mois). La vision de Powell a été soutenue par le général Tommy Franks, chef du commandement central, qui a souligné que l'ennemi essaierait de s'adapter et pourrait ne pas plier comme l'avait prédit Rumsfeld, en particulier face à une force d'invasion réduite. Powell a toujours considéré Saddam comme un calcul rénal, inconfortable, voire douloureux par moments, mais qui finira par passer, et il s'en est tenu à la politique d'endiguement pour contrer suffisamment l'Irak. Il n'a pas contredit le président sur Desert Badger une fois la décision prise, mais il a fortement insisté pour que l'on avance avec légèreté et que l'on évite les décisions irréfléchies ;
Il a souligné qu'une invasion enflammerait les marchés pétroliers, accroîtrait les tensions en Israël, renforcerait les régimes et groupes anti-américains, ce qui pourrait déstabiliser les alliés des États-Unis : "Si un général américain dirige un pays arabe, un Macarthur à Bagdad, combien de temps cela durera-t-il ? Comment définir les termes de la victoire ? Si nous renversons Saddam jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit en place, vous serez le gouvernement, un pays de 25 millions d'habitants se tournera vers vous le temps qu'il faudra pour stabiliser le pays", a déclaré M. Powell en évoquant la règle de la maison de poterie, "vous la cassez, vous l'achetez". Powell a réservé ses plus vives critiques à l'unilatéralisme du plan de Rumsfeld : "Ce serait bien de faire les choses de cette façon, mais nous ne pouvons pas, la Jordanie, la Turquie, les Saoudiens et le Koweït doivent être de la partie, nous avons besoin d'accès, nous avons besoin d'alliés et de bien d'autres choses encore". M. Powell a décrit un scénario catastrophe dans lequel Saddam utiliserait des armes chimiques ou radiologiques contre les forces américaines, et tout cela se déroulerait pendant les élections présidentielles de l'année prochaine. La mise en garde de M. Powell a fait mouche auprès du président : il avait ordonné une action militaire pour défendre les Américains immédiatement en danger, mais sa stratégie à long terme devait être différente. Cependant, il n'était pas satisfait de céder et de permettre à Saddam de s'en aller et de continuer à persécuter son peuple et à comploter contre les États-Unis.
Le vice-président s'est assis d'une manière qui traduisait son éternel mécontentement, il savait qu'amener d'autres nations à bord ralentirait tout, il a présenté Saddam non pas comme un obstacle à l'hégémonie américaine ou comme des raisons morales, mais comme une menace directe pour les Américains.
Cheney avait pris l'initiative d'"étudier" l'Irak et pensait que des agents de l'Irak ou financés par l'Irak complotaient pour attaquer les États-Unis : "Il ne fait aucun doute que l'Irak a accumulé des armes de destruction massive et qu'il va les utiliser contre nous ou nos alliés, Monsieur le Président, l'inaction est un risque bien plus grand". Le président a acquiescé, de même que son adjoint.

Le vice-président Dick Cheney
"La CIA avait intensifié ses activités anti-Saddam et avait été spécifiquement chargée par le président de trouver des preuves de la production d'armes de destruction massive par Saddam ainsi que d'éventuelles faiblesses du régime. Ce travail était lent, il y avait peu d'agents à l'intérieur de l'Irak, et encore moins de personnes capables de fournir des renseignements fiables, et les sources restantes étaient conscientes des sanctions qu'elles encouraient, elles et leurs familles, si elles étaient découvertes en train de conspirer avec les États-Unis. Ce qu'ils avaient, c'était des données, des données brutes et non filtrées, l'emplacement d'installations potentielles de production ou de stockage (une liste que la 5e flotte parcourait en ce moment même), des rumeurs de liaisons entre l'Irak et le marché noir de l'armement ou des organisations terroristes, rien de tout cela n'était confirmé, mais Tenet savait que le vice-président était au courant de tout cela, son bureau obtenait d'une manière ou d'une autre des rapports de la CIA, Cheney faisait une fixation sur cette question depuis un certain temps et était convaincu que les États-Unis étaient la cible d'un complot mené par les Irakiens. Tenet en a minimisé l'importance.
"Depuis notre dernière évaluation en 2000, nous n'avons pas été en mesure de tirer de nouvelles conclusions, mais nous sommes convaincus que l'Irak continue de construire et d'étendre son infrastructure pour produire des armes de destruction massive, et nous pensons que Saddam a toujours des plans pour son programme d'armement atomique", c'était un recul spectaculaire par rapport à la certitude de Cheney, mais suffisamment ouvert pour laisser place à un doute considérable. Cheney a de nouveau grogné.

George Tenet, directeur de la CIA
"Le vice-président s'est montré inquiet, peut-être a-t-il pris au sérieux les données qui décrivaient Saddam comme une véritable bête de somme prête à frapper partout à la fois, ou peut-être n'a-t-il tout simplement pas apprécié de se voir opposer une résistance dans un tel contexte. Bush a pris conscience de l'ampleur de l'argument et a pris sa décision
"Je veux savoir ce qu'il faudra faire pour que les inspecteurs reviennent, il doit prouver au monde que c'est possible, et s'il ne peut pas le faire, il y aura des conséquences, c'est ce que nous demandons, sinon nous continuons à bombarder et nous construisons notre coalition, nous obtenons l'adhésion de tout le monde et je veux voir les plans sur mon bureau".
La Maison Blanche a enfin défini ses objectifs pour l'opération en cours en Irak, à court et à long terme, afin de mettre fin à la crise du désarmement, soit en forçant Saddam Hussein à réadmettre les inspections d'armement et à s'y conformer, soit en s'exposant à une invasion potentielle des États-Unis et de leurs alliés. Toutes les parties étaient d'accord pour dire que Saddam Hussein était une menace et que la meilleure façon de le contrôler était la menace d'une invasion, Powell a toujours insisté sur le fait que la guerre devait être sur la table et que la pire des options était de reculer. Condoleezza Rice et Andy Card (le chef de cabinet de la Maison Blanche) ont applaudi Powell pour son rôle dans la mise sur la table de la diplomatie, tandis que les faucons étaient convaincus que Saddam était bien trop fourbe pour que l'option diplomatique porte ses fruits. Le président a d'abord annoncé publiquement sa décision cette nuit-là, devant les journalistes, en déclarant que "la meilleure façon de mettre fin à cette situation est que l'Irak s'engage et coopère pleinement avec les résolutions de l'ONU, sinon nous devrons peut-être emprunter une voie plus dangereuse". Le président s'est entretenu avec le Premier ministre Blair au sujet de l'opération en cours et les deux hommes ont discuté de la voie à suivre. Blair a soutenu la demande de respect des résolutions de l'ONU, conscient que le refus de Saddam de s'y conformer pourrait conduire à la guerre. Pour sa part, Saddam a répondu aux attentes des faucons en réitérant sa promesse de ne jamais "faire de compromis ou s'agenouiller" face aux frappes aériennes, et il espérait pouvoir résister aux frappes comme il l'avait fait à maintes reprises auparavant.

(A gauche) Le président Bush annonce sa demande de reprise des inspections en matière d'armement, (A droite) Le président Bush et le premier ministre britannique Blair
Tandis que l'administration mettait de l'ordre dans ses propres affaires, l'opinion publique américaine et le reste du monde continuaient à réconcilier les leurs. Malgré un fort soutien dans l'immédiat, plusieurs jours de messages contradictoires sur les objectifs des États-Unis dans le cadre de la campagne ont permis à un certain mécontentement de s'installer, de la part des anti-interventionnistes, où quelques protestations ont vu le jour. Selon les sondages, bien qu'une majorité écrasante approuve l'action militaire, deux tiers des personnes interrogées étaient favorables à une solution diplomatique. Les 11 membres du Congrès qui ont rejeté l'approbation de la Chambre des représentants ont mis en doute le raisonnement de la Maison Blanche. Le représentant indépendant Bernie Sanders, du Vermont, a déclaré, comme il l'avait fait en 1991 et 1998, qu'il était "très préoccupé par l'action militaire entreprise par le président, en dépit du fait que la Constitution indique clairement que c'est cet organe (le Congrès) qui déclare la guerre". Le républicain Ron Paul a déclaré que cette action était "illégale et inconstitutionnelle, et qu'elle avait probablement pour but de détourner l'attention des Américains de l'économie, et qu'elle risquait de nous entraîner dans une guerre et de faire tuer davantage de militaires". Mais plus haut dans la hiérarchie, la représentante Pelosi a déclaré :
"Bien que je sois éternellement reconnaissant des sacrifices consentis par nos hommes et nos femmes dans les forces armées, j'implore l'administration de rechercher toutes les options diplomatiques avant d'en mettre d'autres en danger". Le leader du Sénat, M. Daschle (D), qui entretenait au mieux des relations glaciales avec la Maison Blanche après avoir commencé ses commentaires par un éloge de l'armée, a déclaré : "J'espère sincèrement que le Président ne s'est pas précipité vers la guerre". Trent Lott (R) (qui avait lui-même été impliqué dans un scandale de racisme après avoir fait l'éloge de l'ancien sénateur Strom Thurmond à l'occasion de son 100e anniversaire) a déclaré que les commentaires de Daschle montraient qu'il n'avait "aucun intérêt à protéger les Américains", ce qui a déclenché une guerre des mots entre les républicains et les démocrates. L'administration a également bénéficié d'une certaine décence de la part des médias, qui ont mis en doute les succès annoncés par le ministère de la défense et contesté l'idée selon laquelle seules des cibles militaires avaient été frappées, en indiquant que ces cibles comprenaient des brasseries et des entrepôts commerciaux.
En Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Palestine et dans l'ensemble du monde arabe, des protestations ont éclaté, accompagnées d'incidents parfois violents, comme à Damas, où l'ambassade des États-Unis a été évacuée pendant un certain temps, les manifestants ayant menacé de prendre d'assaut le bâtiment, une action que le président Assad a refusé de condamner. Le président égyptien Moubarak a appelé à la fin de l'action militaire, mais la plupart des dirigeants arabes sont restés silencieux sur les frappes, ce qui a provoqué des protestations non seulement contre les États-Unis, mais aussi contre leurs propres gouvernements. En Jordanie et en Arabie saoudite (où l'ascendance est fortement restreinte), certaines actions de rue se sont concentrées sur les États-Unis, tandis qu'au Liban, la colère a été projetée sur le silence des dirigeants arabes. Au Royaume-Uni, d'importantes manifestations ont été organisées par la communauté musulmane, notamment une marche autour du Parlement.

(de gauche à droite) les conséquences des manifestations à Londres, les manifestations anti-américaines et britanniques au Liban, les voitures brûlées devant l'ambassade des États-Unis à Damas.
Loin des périphériques, la recherche des deux aviateurs s'est poursuivie avec peu de résultats, aucune trace de tentative de communication au cas où les pilotes seraient en fuite et aucune manœuvre militaire d'envergure qui pourrait suggérer de déplacer les militaires capturés de la zone où ils ont été abattus. La plus grande lacune de l'armée américaine était la barrière de la langue. Il est plus facile de former quelqu'un au pilotage d'un F-14 que de parler arabe, et la recherche dans les câbles et les radios irakiens a donc pris du temps. Ils ont révélé la grande confusion qui régnait au sein du commandement militaire irakien après le début des frappes, les commandants s'efforçant de donner des ordres alors que les communications étaient interrompues, que les bases étaient frappées et que les forces s'efforçaient de s'adapter. Elle a également fourni des informations sur les soldats disparus. Selon l'interception, ils ont été amenés dans la ville d'Al-Kut, mais aucune information n'a été donnée sur leur état de santé actuel. Le premier indice en trois jours était un peu réconfortant, mais Kut était encore une ville d'un quart de million d'habitants. Néanmoins, les marines américains se tenaient prêts à lancer un raid sur la ville pour récupérer les hommes.
L'opposition irakienne s'est également tenue à l'écart. Cette opposition fracturée a assisté avec impatience à la campagne de bombardements et a exprimé son désir de jouer un rôle dans le conflit avec l'Irak. Elle avait bénéficié d'un nouveau financement et d'une nouvelle organisation sous la direction de la CIA, et ses dirigeants avaient joué un rôle considérable dans le lobbying auprès des législateurs et des fonctionnaires du ministère pour qu'ils soutiennent le renversement complet de l'Irak. Ils ont applaudi les citations d'Ari Fleischer selon lesquelles les États-Unis étaient prêts à soutenir l'opposition irakienne, mais pour l'instant, ils voulaient maintenir l'élan de la campagne, convaincre l'administration de ne pas relâcher ses efforts comme elle l'a fait par le passé en permettant à Saddam de garder le contrôle : "Donnez aux Irakiens les moyens d'agir", a déclaré Sharif al-Hussein, membre du Congrès national irakien (et prétendant au défunt trône irakien). Les groupes d'opposition ont joué un rôle considérable dans le lobbying auprès des hauts responsables du ministère de la défense et étaient parfaitement conscients des options dont disposait le président pour menacer réellement le régime. Les activités de libération de l'Irak (IFR) comprenaient la fourniture d'armes à l'opposition irakienne par le déploiement d'expatriés irakiens formés par les Américains et l'expulsion totale par les États-Unis des forces irakiennes de la zone d'exclusion aérienne du sud du pays.
Cependant, la CIA avait des doutes sérieux quant à la capacité de l'opposition irakienne, qui comptait moins de 500 membres et était généralement indisciplinée, mais le Pentagone a ignoré ces plaintes et a poursuivi le programme. Plus que tout, l'opposition irakienne avait besoin d'une issue, et la déclaration du président semblait enfin en dessiner une à l'horizon. Avec la demande du président de reprendre les inspections et le refus catégorique de Saddam, il semblait que l'Irak était sur la voie d'une épreuve de force.

(A gauche) Réunion de l'opposition irakienne à Londres, (à droite) CNN titre les événements en cours sur "épreuve de force en Irak".
Desert Badger Suite - Jour 2
En l'espace de 24 heures, les États-Unis ont entrepris une opération militaire d'envergure contre l'Irak, avec très peu d'avertissement quant à leurs actions. Un premier barrage de missiles et de jets a visé une longue liste de sites militaires, politiques, industriels et logistiques irakiens, dans le but de "réduire la capacité de l'Irak à faire la guerre". Tout cela en représailles à la disparition d'un jet américain que les médias d'État irakiens et certaines sources au sein du ministère de la défense ont attribué à une attaque irakienne. Pour simplifier la situation, il s'agissait d'une série d'événements stupéfiants et peu de gens se sentaient en mesure de deviner où les choses allaient se terminer.
Tout au long de la nuit, les forces américaines (avec l'aide des Britanniques) ont effectué des sorties au-dessus de la région où l'avion avait été perdu, dans l'espoir de retrouver les aviateurs manquants (un pilote et un officier armement) et de déclencher une mission de sauvetage adéquate. Le temps était compté, deux Américains ne pouvaient espérer survivre longtemps dans l'Irak baasiste, mais depuis la disparition et le supposé crash, le commandement américain n'a eu que le silence radio. Malgré tout, Desert Badger a continué, tandis que les frappes sur les grandes villes et les centres de population irakiens se sont ralenties après la vague initiale, dans tout l'Irak, les bombes ont tenté de perturber (et peut-être de détruire) le commandement et le contrôle irakiens afin de gagner du temps pour retrouver les hommes et endommager le régime de Saddam en général.
Un porte-avions américain de la 5e flotte lance des avions à réaction sur l'Irak.
Le monde s'est réveillé pour observer les conséquences de l'attaque du premier jour. Ce qu'ils ont vu était une opération beaucoup plus destructrice que les bombardements de 2001 ou 1998, car les Américains ont frappé beaucoup plus de cibles que prévu, les aérodromes du pays, les principales structures de communication, les bases d'approvisionnement et les dépôts de carburant ont été attaqués pour brouiller toute réponse irakienne. Les attaques américaines ont été lancées avec un temps de préparation extrêmement réduit pour les militaires et les citoyens irakiens. Selon certaines estimations, les centaines de victimes de la seule ville de Bagdad ont été plus nombreuses que celles de la campagne Desert Fox, qui avait duré quatre jours.
L'opinion publique américaine a largement soutenu l'exercice et les explications de l'administration Bush en ont satisfait plus d'un, mais des questions subsistaient, notamment en ce qui concerne l'escalade potentielle : le président devait-il prendre d'autres mesures et aller au-delà d'une simple campagne aérienne ? Il n'y avait pas de véritable objectif politique déclaré, si ce n'est que Saddam devait se démilitariser, se conformer à toutes les résolutions de l'ONU et mettre fin aux attaques contre les avions alliés. Ces exigences étaient partagées par tous les hommes politiques nationaux, mais les détracteurs de l'administration étaient au courant des discours musclés et des fuites du ministère de la défense concernant Saddam et l'Irak, et craignaient que le conflit actuel ne serve de prétexte à une guerre plus vaste visant à éliminer Saddam Hussein par la force.
Ce n'était pas si exagéré, compte tenu de la politique américaine déclarée de changement de régime et, selon la durée de la campagne de bombardement, les États-Unis pourraient s'engager sur la voie de la guerre. Cependant, la Chambre des représentants a manifesté son soutien à l'action militaire en cours en adoptant une résolution visant à soutenir "les hommes et les femmes de nos forces armées dans l'accomplissement de leurs missions". Seuls 11 représentants se sont opposés au vote, parmi lesquels les démocrates Barbara Lee et Cynthia McKinney, l'indépendant Bernie Sanders et le seul détracteur républicain, Ron Paul.
(De gauche à droite) Les représentants Lee, Sanders et Paul, tous critiques des frappes.
Le deuxième jour, alors que des questions continuaient d'être soulevées, l'administration Bush s'est prononcée plus clairement sur ses objectifs en Irak. Rumsfeld a vanté le succès de l'opération en présentant une carte des bases anti-aériennes, des camps d'entraînement terroristes et des installations supposées de production d'armes de destruction massive qui avaient été touchées. Satisfait des "énormes progrès réalisés par nos forces aériennes et navales pour désarmer Saddam de ses armes offensives, sans aucune perte", le secrétaire d'État à la défense, interrogé à nouveau sur la possibilité d'une nouvelle participation américaine, a déclaré : "Nous sommes prêts à toutes les options, mais il est clair que l'action américaine dépendra de la manière dont le gouvernement irakien ira de l'avant, mais je répète que nous restons prêts à intervenir sans limite de temps". Ces propos indiquaient que l'administration restait, au mieux, dans le flou quant aux prochaines étapes de l'opération. Le président a fait une brève déclaration indiquant qu'il était satisfait du déroulement de l'opération, décrivant l'attaque comme "le seul moyen de poursuivre Saddam" et assimilant les frappes à une punition pour les actions des dictateurs plutôt qu'à une doctrine spécifique.
Les journalistes ont été un peu plus combatifs, un rapport du Washington Post détaillant comment les frappes à Bagdad le premier jour visaient clairement plus que des sites militaires, et que l'administration visait à déstabiliser le régime dans son ensemble. Le gouvernement irakien est resté plus hostile que jamais, accusant les États-Unis d'une attaque non provoquée. Des journalistes étrangers ont été emmenés visiter des cratères à Bagdad et on leur a dit que les États-Unis avaient délibérément visé des zones civiles. L'Irak a également accusé les États-Unis de viser personnellement Hussein et sa famille lors des frappes ratées, bien que Rumsfeld ait contesté toute affirmation irakienne quant aux objectifs des États-Unis. Le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Ari Fleischer, à qui l'on demandait si les États-Unis avaient l'intention d'entreprendre une nouvelle action militaire, a donné une réponse curieuse, réitérant tout d'abord les nombreuses options dont disposaient les États-Unis face à l'Irak, mais il a également précisé que la politique de la Maison Blanche était la suivante : "Le changement de régime a été et continue d'être notre politique".
Interrogé sur la manière dont un changement de régime serait opéré, il a déclaré : "Eh bien, je dis au peuple irakien que nous l'encourageons à prendre lui-même cette mesure", ce qui ne pouvait être interprété que comme un encouragement à une révolution en Irak de la part du porte-parole du président.
Le secrétaire de presse de la Maison Blanche, M. Fleischer
Le discours de fermeté n'a pas été unilatéral à Washington, puisque certains ont cherché à revenir sur la politique de la corde raide qui était à l'œuvre. Le secrétaire d'État Powell, apparemment absent de la décision de déclencher Desert Badger, a fait un briefing pour présenter les objectifs de son ministère en Irak. Il a déclaré qu'il soutenait la décision du président, mais qu'il était moins clair quant à la politique américaine en matière de changement de régime : "En ce qui concerne l'Irak, cela (le changement de régime) n'a rien à voir avec la question ; en parlant avec le président, il a dit très clairement que tout était lié aux attaques de l'Irak contre les avions de la coalition, et que nous devions obliger l'Irak à mettre fin à ces attaques [...] il n'est pas question de changement de régime, bien au contraire".
La recherche des pilotes disparus était le facteur tacite de l'opération militaire en Irak, mais ce n'était pas un secret pour la marine et l'armée de l'air américaines qui ont mené des recherches massives dans l'espoir de capter des communications radio, des mouvements de troupes et tout indice sur l'endroit où se trouverait un pilote, vivant ou mort. Les Américains pensaient alors que les pilotes étaient probablement détenus par des Irakiens, qu'il s'agisse de civils, de policiers ou de militaires. Les mouvements à proximité du site probable du crash penchaient en faveur de cette solution, étant donné les possibilités moins probables que les deux pilotes puissent échapper à la capture dans une région aussi hostile.
L'opération de sauvetage a consisté à surveiller les forces irakiennes pour repérer toute tentative de transport des pilotes plus au nord, ce qui est allé à l'encontre des objectifs d'autres frappes militaires, car cela a obligé les forces américaines à ne pas attaquer les forces irakiennes autour du site du crash. Les services de renseignement américains ont rapidement été associés à l'opération pour contribuer aux recherches, en traduisant les renseignements et en disséquant les photographies, ainsi qu'en utilisant toutes les sources présentes en Irak pour les presser de fournir des informations.
Troisième jour
Au troisième jour de l'opération, les frappes, les vols et la surveillance se sont poursuivis dans tout l'Irak. Tandis que les différents secrétaires et membres du personnel exécutif faisaient l'éloge des hommes et des femmes sur le terrain et vantaient les mérites d'une liste de cibles détruites, une lutte s'engageait dans les allées du pouvoir. Dans les allées du pouvoir, les différents cabinets se plaignaient d'être tenus à l'écart d'une opération dont ils avaient été aussi peu avertis que le grand public américain. L'ensemble de l'opération sentait à plein nez la mise en scène du DoD Rumsfeld/Wolfowitz, sans doute présentée au président comme la seule action possible. C'était certainement le point de vue du secrétaire d'État Powell qui, en tant que diplomate en chef du pays, estimait qu'il aurait dû être associé à la décision de bombarder les grandes villes (l'exclusion de Powell de la décision a par la suite été démentie par des membres de l'administration Bush, mais a été confirmée par des sources confidentielles). D'autres ont été contrariés par la décision de Rumsfeld d'étendre Desert Badger sans l'avis de la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice ou du directeur de la CIA George Tenet. Une fois que l'ampleur de l'opération leur a été révélée, les soupçons se sont portés sur Rumsfeld, conscient que son adjoint et lui-même souhaitaient depuis longtemps faire tomber le dictateur.
A l'intérieur de la Maison Blanche, il n'y avait guère de temps pour une contemplation solennelle de l'opération en cours, même si Rumsfeld, les chefs d'état-major et le président faisaient bonne figure, les querelles intestines sur ce que seraient exactement les prochaines étapes consumaient la branche exécutive. Peu de personnes avaient été informées de la décision d'opter pour Desert Badger. C'était peut-être excusable, après tout, une action immédiate était nécessaire pour empêcher la capture d'aviateurs américains, mais quelqu'un aurait dû au moins prévenir le secrétaire d'État et la CIA, qui n'ont été informés de la décision qu'une fois celle-ci prise, et seulement ensuite pour demander les cibles disponibles à frapper. Mais dès que les bombes ont commencé à tomber, tout le monde s'est empressé d'être au courant, d'influencer la prise de décision du président, ou au moins de ne pas se mettre dans l'embarras en se contredisant les uns les autres.
Le président Bush rencontre son équipe de sécurité nationale
Il était clair que le Président ne savait pas exactement quoi faire ensuite, il était certain d'avoir pris les bonnes décisions jusqu'à présent, il avait été appelé à agir et il était absolument certain de sa décision. Il a rejeté catégoriquement toute idée des médias selon laquelle il aurait été manipulé par Rumsfeld, il était le Président et c'est lui qui prenait les décisions. Mais aussi certain qu'il ait été d'ordonner les frappes, son esprit était principalement concentré sur l'opération de sauvetage et non sur la politique irakienne au sens large. Bush a réuni ses équipes de sécurité nationale pour discuter justement de cela, pour déterminer leurs objectifs et la manière de les atteindre. Lors de la réunion, Rumsfeld s'est lancé dans le vif du sujet, énumérant les nombreuses victoires des forces américaines et dressant la liste des anciennes structures à l'intérieur de l'Irak, Rumsfeld a présenté le régime de Saddam comme effondré, son armée en déroute et ses dirigeants en fuite ; il a souligné qu'ils n'avaient pas vu Saddam depuis le premier jour, ce qui laissait entendre qu'il se cachait probablement. Avant qu'il ne parvienne à sa conclusion, la conseillère à la sécurité nationale, Mme Rice, l'a interrompu pour lui demander des informations sur les pilotes, ce que le président a accepté. Rumsfeld a donné des nouvelles décevantes, sans changement. "Nous prions tous pour qu'ils reviennent sains et saufs", a déclaré le président.
Il y a quelques mois, le président avait modifié la politique américaine pour adopter une position agressive à l'égard de l'Irak, autorisant des actions secrètes pour aider l'opposition irakienne et une application plus stricte de la politique actuelle, et maintenant Saddam a défié les États-Unis une fois de plus : "Il essaie de nous tester, de voir ce que nous sommes prêts à faire, mais je ne reculerai pas". Le président, qui n'est pas l'orateur le plus précis lorsqu'il faut intervenir, a rendu la salle tout aussi incertaine lorsqu'il a posé la question. Rumsfeld a hoché la tête, a pris un air aussi pensif que possible et a dit directement:
"Nous devrions le tuer, nous devrions aller à Bagdad et le capturer ou le tuer, en ce moment même, les Américains se battent pour défendre les Américains et libérer un peuple, le Congrès l'a approuvé et l'opinion publique le soutient."
Nous avons élaboré les plans, je dis allons-y". C'était le genre de discours direct que seul le secrétaire à la défense pouvait tenir, pour proposer une opération militaire d'une ampleur inégalée depuis la guerre du Viêt Nam, sur un ton presque sarcastique. "Nous utilisons les frappes pour détruire les défenses de l'Irak, nous frappons le régime dans tous les sens, pendant que nous déplaçons les forces terrestres nécessaires au Koweït et que nous nous dirigeons directement vers Bagdad". Powell semblait peiné. La rivalité entre les deux secrétaires était légendaire et le fait d'entendre Rumsfeld passer sous silence le sang et la sueur d'une telle opération en disant qu'il fallait "aller directement à Bagdad" a profondément blessé Powell. Il s'est senti personnellement insulté par les actions de Rumsfeld, convaincu que ce dernier l'avait délibérément exclu de la décision de l'opération pour lui nuire, mais il était maintenant prêt à contrer les suppositions grossières de Rumsfeld.
Les secrétaires Powell et Rumsfeld
"Don, vous faites beaucoup de suppositions générales" Powell, qui avait étudié de près les nombreux plans de guerre, les a démantelés "Nous allons avoir besoin de plus de temps, de plus d'équipement et de plus d'alliés pour quelque chose d'aussi grand" (on estime qu'il faudrait au moins une demi-année pour que les troupes terrestres suffisantes soient mises en place), pour garantir la victoire avant toute opération, Rumsfeld était à l'opposé, il considérait l'aversion au risque comme un problème et avait cherché à l'extirper de son Pentagone, il s'était battu pour élever le niveau de risque, avait réduit les coûts et les effectifs (le plan de guerre de Rumsfeld a réduit de moitié les effectifs estimés pour une invasion de l'Irak, estimant qu'une telle opération pourrait débuter en 2 à 3 mois). La vision de Powell a été soutenue par le général Tommy Franks, chef du commandement central, qui a souligné que l'ennemi essaierait de s'adapter et pourrait ne pas plier comme l'avait prédit Rumsfeld, en particulier face à une force d'invasion réduite. Powell a toujours considéré Saddam comme un calcul rénal, inconfortable, voire douloureux par moments, mais qui finira par passer, et il s'en est tenu à la politique d'endiguement pour contrer suffisamment l'Irak. Il n'a pas contredit le président sur Desert Badger une fois la décision prise, mais il a fortement insisté pour que l'on avance avec légèreté et que l'on évite les décisions irréfléchies ;
Il a souligné qu'une invasion enflammerait les marchés pétroliers, accroîtrait les tensions en Israël, renforcerait les régimes et groupes anti-américains, ce qui pourrait déstabiliser les alliés des États-Unis : "Si un général américain dirige un pays arabe, un Macarthur à Bagdad, combien de temps cela durera-t-il ? Comment définir les termes de la victoire ? Si nous renversons Saddam jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit en place, vous serez le gouvernement, un pays de 25 millions d'habitants se tournera vers vous le temps qu'il faudra pour stabiliser le pays", a déclaré M. Powell en évoquant la règle de la maison de poterie, "vous la cassez, vous l'achetez". Powell a réservé ses plus vives critiques à l'unilatéralisme du plan de Rumsfeld : "Ce serait bien de faire les choses de cette façon, mais nous ne pouvons pas, la Jordanie, la Turquie, les Saoudiens et le Koweït doivent être de la partie, nous avons besoin d'accès, nous avons besoin d'alliés et de bien d'autres choses encore". M. Powell a décrit un scénario catastrophe dans lequel Saddam utiliserait des armes chimiques ou radiologiques contre les forces américaines, et tout cela se déroulerait pendant les élections présidentielles de l'année prochaine. La mise en garde de M. Powell a fait mouche auprès du président : il avait ordonné une action militaire pour défendre les Américains immédiatement en danger, mais sa stratégie à long terme devait être différente. Cependant, il n'était pas satisfait de céder et de permettre à Saddam de s'en aller et de continuer à persécuter son peuple et à comploter contre les États-Unis.
Le vice-président s'est assis d'une manière qui traduisait son éternel mécontentement, il savait qu'amener d'autres nations à bord ralentirait tout, il a présenté Saddam non pas comme un obstacle à l'hégémonie américaine ou comme des raisons morales, mais comme une menace directe pour les Américains.
Cheney avait pris l'initiative d'"étudier" l'Irak et pensait que des agents de l'Irak ou financés par l'Irak complotaient pour attaquer les États-Unis : "Il ne fait aucun doute que l'Irak a accumulé des armes de destruction massive et qu'il va les utiliser contre nous ou nos alliés, Monsieur le Président, l'inaction est un risque bien plus grand". Le président a acquiescé, de même que son adjoint.
Le vice-président Dick Cheney
"La CIA avait intensifié ses activités anti-Saddam et avait été spécifiquement chargée par le président de trouver des preuves de la production d'armes de destruction massive par Saddam ainsi que d'éventuelles faiblesses du régime. Ce travail était lent, il y avait peu d'agents à l'intérieur de l'Irak, et encore moins de personnes capables de fournir des renseignements fiables, et les sources restantes étaient conscientes des sanctions qu'elles encouraient, elles et leurs familles, si elles étaient découvertes en train de conspirer avec les États-Unis. Ce qu'ils avaient, c'était des données, des données brutes et non filtrées, l'emplacement d'installations potentielles de production ou de stockage (une liste que la 5e flotte parcourait en ce moment même), des rumeurs de liaisons entre l'Irak et le marché noir de l'armement ou des organisations terroristes, rien de tout cela n'était confirmé, mais Tenet savait que le vice-président était au courant de tout cela, son bureau obtenait d'une manière ou d'une autre des rapports de la CIA, Cheney faisait une fixation sur cette question depuis un certain temps et était convaincu que les États-Unis étaient la cible d'un complot mené par les Irakiens. Tenet en a minimisé l'importance.
"Depuis notre dernière évaluation en 2000, nous n'avons pas été en mesure de tirer de nouvelles conclusions, mais nous sommes convaincus que l'Irak continue de construire et d'étendre son infrastructure pour produire des armes de destruction massive, et nous pensons que Saddam a toujours des plans pour son programme d'armement atomique", c'était un recul spectaculaire par rapport à la certitude de Cheney, mais suffisamment ouvert pour laisser place à un doute considérable. Cheney a de nouveau grogné.
George Tenet, directeur de la CIA
"Le vice-président s'est montré inquiet, peut-être a-t-il pris au sérieux les données qui décrivaient Saddam comme une véritable bête de somme prête à frapper partout à la fois, ou peut-être n'a-t-il tout simplement pas apprécié de se voir opposer une résistance dans un tel contexte. Bush a pris conscience de l'ampleur de l'argument et a pris sa décision
"Je veux savoir ce qu'il faudra faire pour que les inspecteurs reviennent, il doit prouver au monde que c'est possible, et s'il ne peut pas le faire, il y aura des conséquences, c'est ce que nous demandons, sinon nous continuons à bombarder et nous construisons notre coalition, nous obtenons l'adhésion de tout le monde et je veux voir les plans sur mon bureau".
La Maison Blanche a enfin défini ses objectifs pour l'opération en cours en Irak, à court et à long terme, afin de mettre fin à la crise du désarmement, soit en forçant Saddam Hussein à réadmettre les inspections d'armement et à s'y conformer, soit en s'exposant à une invasion potentielle des États-Unis et de leurs alliés. Toutes les parties étaient d'accord pour dire que Saddam Hussein était une menace et que la meilleure façon de le contrôler était la menace d'une invasion, Powell a toujours insisté sur le fait que la guerre devait être sur la table et que la pire des options était de reculer. Condoleezza Rice et Andy Card (le chef de cabinet de la Maison Blanche) ont applaudi Powell pour son rôle dans la mise sur la table de la diplomatie, tandis que les faucons étaient convaincus que Saddam était bien trop fourbe pour que l'option diplomatique porte ses fruits. Le président a d'abord annoncé publiquement sa décision cette nuit-là, devant les journalistes, en déclarant que "la meilleure façon de mettre fin à cette situation est que l'Irak s'engage et coopère pleinement avec les résolutions de l'ONU, sinon nous devrons peut-être emprunter une voie plus dangereuse". Le président s'est entretenu avec le Premier ministre Blair au sujet de l'opération en cours et les deux hommes ont discuté de la voie à suivre. Blair a soutenu la demande de respect des résolutions de l'ONU, conscient que le refus de Saddam de s'y conformer pourrait conduire à la guerre. Pour sa part, Saddam a répondu aux attentes des faucons en réitérant sa promesse de ne jamais "faire de compromis ou s'agenouiller" face aux frappes aériennes, et il espérait pouvoir résister aux frappes comme il l'avait fait à maintes reprises auparavant.
(A gauche) Le président Bush annonce sa demande de reprise des inspections en matière d'armement, (A droite) Le président Bush et le premier ministre britannique Blair
Tandis que l'administration mettait de l'ordre dans ses propres affaires, l'opinion publique américaine et le reste du monde continuaient à réconcilier les leurs. Malgré un fort soutien dans l'immédiat, plusieurs jours de messages contradictoires sur les objectifs des États-Unis dans le cadre de la campagne ont permis à un certain mécontentement de s'installer, de la part des anti-interventionnistes, où quelques protestations ont vu le jour. Selon les sondages, bien qu'une majorité écrasante approuve l'action militaire, deux tiers des personnes interrogées étaient favorables à une solution diplomatique. Les 11 membres du Congrès qui ont rejeté l'approbation de la Chambre des représentants ont mis en doute le raisonnement de la Maison Blanche. Le représentant indépendant Bernie Sanders, du Vermont, a déclaré, comme il l'avait fait en 1991 et 1998, qu'il était "très préoccupé par l'action militaire entreprise par le président, en dépit du fait que la Constitution indique clairement que c'est cet organe (le Congrès) qui déclare la guerre". Le républicain Ron Paul a déclaré que cette action était "illégale et inconstitutionnelle, et qu'elle avait probablement pour but de détourner l'attention des Américains de l'économie, et qu'elle risquait de nous entraîner dans une guerre et de faire tuer davantage de militaires". Mais plus haut dans la hiérarchie, la représentante Pelosi a déclaré :
"Bien que je sois éternellement reconnaissant des sacrifices consentis par nos hommes et nos femmes dans les forces armées, j'implore l'administration de rechercher toutes les options diplomatiques avant d'en mettre d'autres en danger". Le leader du Sénat, M. Daschle (D), qui entretenait au mieux des relations glaciales avec la Maison Blanche après avoir commencé ses commentaires par un éloge de l'armée, a déclaré : "J'espère sincèrement que le Président ne s'est pas précipité vers la guerre". Trent Lott (R) (qui avait lui-même été impliqué dans un scandale de racisme après avoir fait l'éloge de l'ancien sénateur Strom Thurmond à l'occasion de son 100e anniversaire) a déclaré que les commentaires de Daschle montraient qu'il n'avait "aucun intérêt à protéger les Américains", ce qui a déclenché une guerre des mots entre les républicains et les démocrates. L'administration a également bénéficié d'une certaine décence de la part des médias, qui ont mis en doute les succès annoncés par le ministère de la défense et contesté l'idée selon laquelle seules des cibles militaires avaient été frappées, en indiquant que ces cibles comprenaient des brasseries et des entrepôts commerciaux.
En Syrie, en Jordanie, en Égypte, en Palestine et dans l'ensemble du monde arabe, des protestations ont éclaté, accompagnées d'incidents parfois violents, comme à Damas, où l'ambassade des États-Unis a été évacuée pendant un certain temps, les manifestants ayant menacé de prendre d'assaut le bâtiment, une action que le président Assad a refusé de condamner. Le président égyptien Moubarak a appelé à la fin de l'action militaire, mais la plupart des dirigeants arabes sont restés silencieux sur les frappes, ce qui a provoqué des protestations non seulement contre les États-Unis, mais aussi contre leurs propres gouvernements. En Jordanie et en Arabie saoudite (où l'ascendance est fortement restreinte), certaines actions de rue se sont concentrées sur les États-Unis, tandis qu'au Liban, la colère a été projetée sur le silence des dirigeants arabes. Au Royaume-Uni, d'importantes manifestations ont été organisées par la communauté musulmane, notamment une marche autour du Parlement.
(de gauche à droite) les conséquences des manifestations à Londres, les manifestations anti-américaines et britanniques au Liban, les voitures brûlées devant l'ambassade des États-Unis à Damas.
Loin des périphériques, la recherche des deux aviateurs s'est poursuivie avec peu de résultats, aucune trace de tentative de communication au cas où les pilotes seraient en fuite et aucune manœuvre militaire d'envergure qui pourrait suggérer de déplacer les militaires capturés de la zone où ils ont été abattus. La plus grande lacune de l'armée américaine était la barrière de la langue. Il est plus facile de former quelqu'un au pilotage d'un F-14 que de parler arabe, et la recherche dans les câbles et les radios irakiens a donc pris du temps. Ils ont révélé la grande confusion qui régnait au sein du commandement militaire irakien après le début des frappes, les commandants s'efforçant de donner des ordres alors que les communications étaient interrompues, que les bases étaient frappées et que les forces s'efforçaient de s'adapter. Elle a également fourni des informations sur les soldats disparus. Selon l'interception, ils ont été amenés dans la ville d'Al-Kut, mais aucune information n'a été donnée sur leur état de santé actuel. Le premier indice en trois jours était un peu réconfortant, mais Kut était encore une ville d'un quart de million d'habitants. Néanmoins, les marines américains se tenaient prêts à lancer un raid sur la ville pour récupérer les hommes.
L'opposition irakienne s'est également tenue à l'écart. Cette opposition fracturée a assisté avec impatience à la campagne de bombardements et a exprimé son désir de jouer un rôle dans le conflit avec l'Irak. Elle avait bénéficié d'un nouveau financement et d'une nouvelle organisation sous la direction de la CIA, et ses dirigeants avaient joué un rôle considérable dans le lobbying auprès des législateurs et des fonctionnaires du ministère pour qu'ils soutiennent le renversement complet de l'Irak. Ils ont applaudi les citations d'Ari Fleischer selon lesquelles les États-Unis étaient prêts à soutenir l'opposition irakienne, mais pour l'instant, ils voulaient maintenir l'élan de la campagne, convaincre l'administration de ne pas relâcher ses efforts comme elle l'a fait par le passé en permettant à Saddam de garder le contrôle : "Donnez aux Irakiens les moyens d'agir", a déclaré Sharif al-Hussein, membre du Congrès national irakien (et prétendant au défunt trône irakien). Les groupes d'opposition ont joué un rôle considérable dans le lobbying auprès des hauts responsables du ministère de la défense et étaient parfaitement conscients des options dont disposait le président pour menacer réellement le régime. Les activités de libération de l'Irak (IFR) comprenaient la fourniture d'armes à l'opposition irakienne par le déploiement d'expatriés irakiens formés par les Américains et l'expulsion totale par les États-Unis des forces irakiennes de la zone d'exclusion aérienne du sud du pays.
Cependant, la CIA avait des doutes sérieux quant à la capacité de l'opposition irakienne, qui comptait moins de 500 membres et était généralement indisciplinée, mais le Pentagone a ignoré ces plaintes et a poursuivi le programme. Plus que tout, l'opposition irakienne avait besoin d'une issue, et la déclaration du président semblait enfin en dessiner une à l'horizon. Avec la demande du président de reprendre les inspections et le refus catégorique de Saddam, il semblait que l'Irak était sur la voie d'une épreuve de force.
(A gauche) Réunion de l'opposition irakienne à Londres, (à droite) CNN titre les événements en cours sur "épreuve de force en Irak".

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Rayan du Griffoul aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 22: Un interlude néerlandais
Au cours des huit dernières années, les Pays-Bas ont connu un boom économique, la prospérité a augmenté et le chômage a diminué. Tout au long de cette période, le gouvernement, une coalition de partis de gauche et libéraux, a bénéficié d'une forte cote de popularité, sous la houlette du chef du parti travailliste (PvdA) et Premier ministre Wim Kok. Kok a été salué et reconnu comme l'un des fondateurs du système de la troisième vague que le président Bill Clinton et le premier ministre Tony Blair ont utilisé de la même manière. Cependant, en 2001, à l'approche des élections de 2002, Kok a annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il n'occuperait plus le poste de chef du PvdA. Au moment des élections, il était largement admis que Melkert ou les libéraux de centre-droit (VVD) dirigés par Hans Dijkstal (qui avait été vice-premier ministre dans le gouvernement de coalition) deviendraient premiers ministres, l'un ou l'autre des deux partis au pouvoir obtenant le plus grand nombre de sièges. Le principal adversaire des partis au pouvoir est le parti chrétien-démocrate (CDA), qui a été le parti le plus puissant du pays jusqu'à ce qu'une série de controverses et de luttes intestines le renvoie dans l'opposition. Les chances d'une résurgence semblaient minces étant donné qu'il venait juste de nommer son chef Jan Balkenende, qui n'était entré au parlement qu'il y a quatre ans et dont on pensait généralement qu'il n'était guère plus qu'un chef intérimaire du parti.

De gauche à droite, le Premier ministre Wim Kok et les principaux candidats Ad Melkert, Hand Dijkstal et Jan Balkenende.
Avec trois bureaucrates sans prétention se disputant la première place, le pays ne semblait pas prêt à connaître des bouleversements politiques, jusqu'à l'arrivée d'un certain Pim Fortuyn. Fortuyn a traversé le spectre politique tout au long de sa vie en tant que stratège et commentateur politique, à l'origine communiste marxiste. Dans sa jeunesse, il est passé à droite, devenant social-démocrate dans les années 70, puis, dans les années 80, néo-libéral, soutenant le marché libre et la privatisation, ce qui s'est transformé en un libéralisme radical promouvant une vaste réduction du gouvernement, qu'il a affiné dans les années 90 en un message populiste (bien que Pim ait rejeté le terme) de détestation générale de l'élite. Les années 90 ont également apporté des changements sociaux aux Pays-Bas, les droits des femmes, des homosexuels et de l'euthanasie ayant été généralement acceptés sans grande contestation. Fortuyn a déclaré que ces changements vastes et rapides avaient créé une "société orpheline" et a dénoncé la perte des normes et valeurs traditionnelles, bien qu'il n'ait pas préconisé un retour aux normes conservatrices et qu'il ait conservé une position libérale sur de nombreuses questions sociales (lui-même étant ouvertement homosexuel).
Avec la fin de la guerre froide, Fortuyn a identifié la nouvelle menace fondamentale pour la société occidentale comme étant l'Islam. Pour Fortuyn, l'islam et la culture musulmane étaient intrinsèquement opposés aux valeurs néerlandaises. Il a exprimé son point de vue dans un langage direct, appelant à "une guerre froide avec l'Islam. Je considère l'Islam comme une menace extraordinaire, comme une religion hostile". Pim était encore peu connu en dehors des cercles politiques lorsqu'en août 2001, il s'est lancé dans les élections de mai, un geste que beaucoup ont considéré comme une protestation théâtrale, mais Pim a tenu sa promesse et a réitéré son annonce qu'il se présenterait au parlement. Sa décision, combinée à son franc-parler, son flamboiement, son attitude conflictuelle et sa grande capacité d'expression, l'ont rendu unique dans la politique néerlandaise actuelle. Il était l'opposé évident de la coalition établie, qu'il critiquait dès qu'il en avait l'occasion, la dépeignant comme un parti unique sans réelles différences entre eux, et, compte tenu de l'état terne de la course, une campagne médiatique éclair l'a fait apparaître dans tous les journaux et à la télévision du pays, chacune de ses apparitions attirant de nombreuses critiques mais aussi de nombreuses louanges, le tout sans annoncer le parti pour lequel il se présenterait.

Le populiste d'extrême droite Pim Fortuyn
Il a été invité par Jan Nagel, le président du parti Liveable Netherlands (LN), un parti qui se présentait comme un groupe démocratique radical dirigé par des personnes issues principalement du monde des médias. Pim a accepté l'offre et a commencé à diriger la section de Rotterdam du parti (les sections locales de Liveable Netherlands étaient gérées séparément du parti national, en raison de leur idéologie démocratique radicale). Bien qu'il ne soit pas le leader du parti, sa personnalité et ses apparitions dans les médias en firent rapidement la figure de proue et il était bien plus connu que le candidat principal Fred Teeven. En février 2002, ses perspectives politiques s'améliorant rapidement, Fortuyn a lancé un ultimatum aux dirigeants du parti : il a exigé une nouvelle élection pour devenir le candidat principal, faute de quoi il quitterait le parti et emporterait son soutien (environ 6 % dans les sondages d'un parti qui comptait jusqu'alors 5 % de sympathisants). Sa demande a été soutenue par les nouveaux membres qui n'avaient rejoint le parti que grâce à Pim, mais les présidents du parti étaient beaucoup plus méfiants à l'égard d'une telle décision, en particulier en raison de la tendance de Pim à s'écarter du script.
Après une réunion tendue de la direction du parti, le parti a cédé et Pim a été élu à l'unanimité comme nouveau chef du parti. Malgré son attitude souvent controversée à l'égard de l'immigration et de l'islam, il a bénéficié d'une couverture généralement favorable tout au long du mois de février, les nouvelles se concentrant souvent sur la base et l'enthousiasme de sa campagne. Le LN a bénéficié d'une couverture médiatique importante par rapport à l'opposition plutôt fade et Pim a grimpé dans les sondages jusqu'à 12 %, le parti dépassant désormais le parti vert, vieux de dix ans. La montée de LN a enlevé des voix aux partis travaillistes et libéraux au pouvoir, qui ont eu du mal à s'adapter au nouvel état de la course. Les travaillistes ont alterné entre la présentation de leurs succès passés et la promotion de réformes futures, sans parler de l'immigration, et les deux principaux partis ont été entraînés dans des joutes oratoires, que Pim, un vétéran du débat, a réussi à contrer grâce à son style d'expression, auquel les politiciens traditionnels n'étaient pas formés. Au fur et à mesure que la candidature de Pim devenait une réalité, la couverture nationale (et internationale) est devenue plus négative, il a été comparé à d'autres leaders européens d'extrême droite tels que Jorg Haider en Autriche ou Le Pen en France dont les liens ultranationalistes et néo-nazis étaient plus flagrants.
Les candidats ne le qualifient plus de "clown", mais de menace explicite pour la démocratie libérale néerlandaise. Certains décidèrent d'agir dans la rue et Pim fut victime de moqueries, de tartes à la crème et, dans un cas, d'une agression physique avec un seau de faux sang ainsi que le même seau par un militant des droits des animaux, mais il continua à donner des interviews en détournant les critiques et en se moquant des agressions[1].

Pim Fortuyn s'exprime après avoir été victime d'un gâteau.
Pim a célébré une victoire considérable en mars lors des élections du conseil municipal de Rotterdam, Liveable Rotterdam s'est hissé à la deuxième place, légèrement derrière le parti travailliste. Une ville avec un pourcentage élevé d'immigrés et l'impression croissante qu'ils ne parviennent pas à s'adapter à la société néerlandaise ont contribué à l'augmentation des niveaux d'insatisfaction dans les zones fortement urbanisées. Les psychologues politiques néerlandais ont appelé cela "l'amertume entre les tulipes". Cette situation, combinée à la capacité de Pim d'établir rapidement un message, de créer et d'adopter des campagnes de base, a encore renforcé le parti. Au cours de la dernière ligne droite avant les élections, alors que Le Pen était battu en France, certains ont prédit une défaite similaire pour Pim et la menace qu'il représentait a semblé se dissiper alors que les Pays-Bas semblaient s'installer dans ce que tout le monde supposait être une course à deux partis entre les travaillistes et les libéraux. En effet, la croisade individuelle de Pim contre "l'ordre violet" (la collation entre le rouge et le bleu) a fait basculer l'opinion publique sur le gouvernement et a donné l'occasion aux autres partis de critiquer la coalition pour son incapacité à traiter les problèmes publics. Les chrétiens-démocrates ont notamment refusé de s'associer à la critique de Fortuyn, ce qui a conduit certains à soupçonner qu'ils espéraient bénéficier de Fortuyn et éventuellement entrer dans une coalition avec lui.
Les résultats du jour de l'élection ont été un choc pour le système, alors que le parti travailliste est resté le plus important avec une marge d'un seul siège, suivi par son partenaire de coalition, le VVD, les deux partis ont subi des pertes significatives au profit des démocrates-chrétiens et des Pays-Bas vivables qui sont arrivés en tête des sondages pour atteindre 13 % dans l'élection nationale, obtenant ainsi 20 sièges. La dépréciation des sièges du gouvernement signifie que pour former un gouvernement, le parti travailliste avait désormais besoin du soutien du parti démocrate 66, plus petit, et du parti libéral progressiste. Pim a annoncé que le vote marquait le début d'une nouvelle ère dans la politique néerlandaise pour ceux qui "veulent en finir avec la culture du compromis et des coalitions, et avec une élite politique qui ne fait rien pour ses intérêts tout en laissant la porte ouverte à certains groupes pour qu'ils viennent ici, car nous savons tous que nous affichons complet ici"
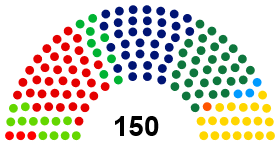
La composition du nouveau parlement et du cabinet néerlandais après les élections de 2002.
Ce ne fut pas la victoire fulgurante promise par Fortuyn, mais passer du statut de commentateur politique à celui de leader du quatrième parti en moins d'un an, c'était bien plus que Haider, Le Pen ou n'importe quel autre parti d'extrême-droite européen, L'état instable du gouvernement néerlandais signifiait que la promesse de Pims selon laquelle "je serai le Premier ministre de ce pays" n'était plus aussi farfelue qu'auparavant et il était clair que, bien que n'étant pas au gouvernement, son assaut d'attaques contre la politique consensuelle des Pays-Bas avait considérablement perturbé le pays et, potentiellement, l'Europe.

Le leader de la LN, Pim Fortuyn, et le Premier ministre, Ad Melkert, lors d'un célèbre débat houleux.
[Sans le 11 septembre, l'ascension de Pim est modifiée : il est moins manifestement anti-islam, ne prononçant pas la fameuse phrase "religion rétrograde" qui lui a valu d'être exclu de Liveable Netherlands et l'a contraint à créer son propre parti. Mais surtout, il n'est pas assassiné comme il l'a été dans OTL.
[Après le 11 septembre et la mort de Pim, la politique néerlandaise a été fortement affectée par l'arrivée au pouvoir des démocrates-chrétiens vaincus et le climat politique moins tendu. Pim dépasse les attentes de TTL, mais ses performances sont inférieures à celles d'OTL.
Au cours des huit dernières années, les Pays-Bas ont connu un boom économique, la prospérité a augmenté et le chômage a diminué. Tout au long de cette période, le gouvernement, une coalition de partis de gauche et libéraux, a bénéficié d'une forte cote de popularité, sous la houlette du chef du parti travailliste (PvdA) et Premier ministre Wim Kok. Kok a été salué et reconnu comme l'un des fondateurs du système de la troisième vague que le président Bill Clinton et le premier ministre Tony Blair ont utilisé de la même manière. Cependant, en 2001, à l'approche des élections de 2002, Kok a annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il n'occuperait plus le poste de chef du PvdA. Au moment des élections, il était largement admis que Melkert ou les libéraux de centre-droit (VVD) dirigés par Hans Dijkstal (qui avait été vice-premier ministre dans le gouvernement de coalition) deviendraient premiers ministres, l'un ou l'autre des deux partis au pouvoir obtenant le plus grand nombre de sièges. Le principal adversaire des partis au pouvoir est le parti chrétien-démocrate (CDA), qui a été le parti le plus puissant du pays jusqu'à ce qu'une série de controverses et de luttes intestines le renvoie dans l'opposition. Les chances d'une résurgence semblaient minces étant donné qu'il venait juste de nommer son chef Jan Balkenende, qui n'était entré au parlement qu'il y a quatre ans et dont on pensait généralement qu'il n'était guère plus qu'un chef intérimaire du parti.
De gauche à droite, le Premier ministre Wim Kok et les principaux candidats Ad Melkert, Hand Dijkstal et Jan Balkenende.
Avec trois bureaucrates sans prétention se disputant la première place, le pays ne semblait pas prêt à connaître des bouleversements politiques, jusqu'à l'arrivée d'un certain Pim Fortuyn. Fortuyn a traversé le spectre politique tout au long de sa vie en tant que stratège et commentateur politique, à l'origine communiste marxiste. Dans sa jeunesse, il est passé à droite, devenant social-démocrate dans les années 70, puis, dans les années 80, néo-libéral, soutenant le marché libre et la privatisation, ce qui s'est transformé en un libéralisme radical promouvant une vaste réduction du gouvernement, qu'il a affiné dans les années 90 en un message populiste (bien que Pim ait rejeté le terme) de détestation générale de l'élite. Les années 90 ont également apporté des changements sociaux aux Pays-Bas, les droits des femmes, des homosexuels et de l'euthanasie ayant été généralement acceptés sans grande contestation. Fortuyn a déclaré que ces changements vastes et rapides avaient créé une "société orpheline" et a dénoncé la perte des normes et valeurs traditionnelles, bien qu'il n'ait pas préconisé un retour aux normes conservatrices et qu'il ait conservé une position libérale sur de nombreuses questions sociales (lui-même étant ouvertement homosexuel).
Avec la fin de la guerre froide, Fortuyn a identifié la nouvelle menace fondamentale pour la société occidentale comme étant l'Islam. Pour Fortuyn, l'islam et la culture musulmane étaient intrinsèquement opposés aux valeurs néerlandaises. Il a exprimé son point de vue dans un langage direct, appelant à "une guerre froide avec l'Islam. Je considère l'Islam comme une menace extraordinaire, comme une religion hostile". Pim était encore peu connu en dehors des cercles politiques lorsqu'en août 2001, il s'est lancé dans les élections de mai, un geste que beaucoup ont considéré comme une protestation théâtrale, mais Pim a tenu sa promesse et a réitéré son annonce qu'il se présenterait au parlement. Sa décision, combinée à son franc-parler, son flamboiement, son attitude conflictuelle et sa grande capacité d'expression, l'ont rendu unique dans la politique néerlandaise actuelle. Il était l'opposé évident de la coalition établie, qu'il critiquait dès qu'il en avait l'occasion, la dépeignant comme un parti unique sans réelles différences entre eux, et, compte tenu de l'état terne de la course, une campagne médiatique éclair l'a fait apparaître dans tous les journaux et à la télévision du pays, chacune de ses apparitions attirant de nombreuses critiques mais aussi de nombreuses louanges, le tout sans annoncer le parti pour lequel il se présenterait.
Le populiste d'extrême droite Pim Fortuyn
Il a été invité par Jan Nagel, le président du parti Liveable Netherlands (LN), un parti qui se présentait comme un groupe démocratique radical dirigé par des personnes issues principalement du monde des médias. Pim a accepté l'offre et a commencé à diriger la section de Rotterdam du parti (les sections locales de Liveable Netherlands étaient gérées séparément du parti national, en raison de leur idéologie démocratique radicale). Bien qu'il ne soit pas le leader du parti, sa personnalité et ses apparitions dans les médias en firent rapidement la figure de proue et il était bien plus connu que le candidat principal Fred Teeven. En février 2002, ses perspectives politiques s'améliorant rapidement, Fortuyn a lancé un ultimatum aux dirigeants du parti : il a exigé une nouvelle élection pour devenir le candidat principal, faute de quoi il quitterait le parti et emporterait son soutien (environ 6 % dans les sondages d'un parti qui comptait jusqu'alors 5 % de sympathisants). Sa demande a été soutenue par les nouveaux membres qui n'avaient rejoint le parti que grâce à Pim, mais les présidents du parti étaient beaucoup plus méfiants à l'égard d'une telle décision, en particulier en raison de la tendance de Pim à s'écarter du script.
Après une réunion tendue de la direction du parti, le parti a cédé et Pim a été élu à l'unanimité comme nouveau chef du parti. Malgré son attitude souvent controversée à l'égard de l'immigration et de l'islam, il a bénéficié d'une couverture généralement favorable tout au long du mois de février, les nouvelles se concentrant souvent sur la base et l'enthousiasme de sa campagne. Le LN a bénéficié d'une couverture médiatique importante par rapport à l'opposition plutôt fade et Pim a grimpé dans les sondages jusqu'à 12 %, le parti dépassant désormais le parti vert, vieux de dix ans. La montée de LN a enlevé des voix aux partis travaillistes et libéraux au pouvoir, qui ont eu du mal à s'adapter au nouvel état de la course. Les travaillistes ont alterné entre la présentation de leurs succès passés et la promotion de réformes futures, sans parler de l'immigration, et les deux principaux partis ont été entraînés dans des joutes oratoires, que Pim, un vétéran du débat, a réussi à contrer grâce à son style d'expression, auquel les politiciens traditionnels n'étaient pas formés. Au fur et à mesure que la candidature de Pim devenait une réalité, la couverture nationale (et internationale) est devenue plus négative, il a été comparé à d'autres leaders européens d'extrême droite tels que Jorg Haider en Autriche ou Le Pen en France dont les liens ultranationalistes et néo-nazis étaient plus flagrants.
Les candidats ne le qualifient plus de "clown", mais de menace explicite pour la démocratie libérale néerlandaise. Certains décidèrent d'agir dans la rue et Pim fut victime de moqueries, de tartes à la crème et, dans un cas, d'une agression physique avec un seau de faux sang ainsi que le même seau par un militant des droits des animaux, mais il continua à donner des interviews en détournant les critiques et en se moquant des agressions[1].
Pim Fortuyn s'exprime après avoir été victime d'un gâteau.
Pim a célébré une victoire considérable en mars lors des élections du conseil municipal de Rotterdam, Liveable Rotterdam s'est hissé à la deuxième place, légèrement derrière le parti travailliste. Une ville avec un pourcentage élevé d'immigrés et l'impression croissante qu'ils ne parviennent pas à s'adapter à la société néerlandaise ont contribué à l'augmentation des niveaux d'insatisfaction dans les zones fortement urbanisées. Les psychologues politiques néerlandais ont appelé cela "l'amertume entre les tulipes". Cette situation, combinée à la capacité de Pim d'établir rapidement un message, de créer et d'adopter des campagnes de base, a encore renforcé le parti. Au cours de la dernière ligne droite avant les élections, alors que Le Pen était battu en France, certains ont prédit une défaite similaire pour Pim et la menace qu'il représentait a semblé se dissiper alors que les Pays-Bas semblaient s'installer dans ce que tout le monde supposait être une course à deux partis entre les travaillistes et les libéraux. En effet, la croisade individuelle de Pim contre "l'ordre violet" (la collation entre le rouge et le bleu) a fait basculer l'opinion publique sur le gouvernement et a donné l'occasion aux autres partis de critiquer la coalition pour son incapacité à traiter les problèmes publics. Les chrétiens-démocrates ont notamment refusé de s'associer à la critique de Fortuyn, ce qui a conduit certains à soupçonner qu'ils espéraient bénéficier de Fortuyn et éventuellement entrer dans une coalition avec lui.
Les résultats du jour de l'élection ont été un choc pour le système, alors que le parti travailliste est resté le plus important avec une marge d'un seul siège, suivi par son partenaire de coalition, le VVD, les deux partis ont subi des pertes significatives au profit des démocrates-chrétiens et des Pays-Bas vivables qui sont arrivés en tête des sondages pour atteindre 13 % dans l'élection nationale, obtenant ainsi 20 sièges. La dépréciation des sièges du gouvernement signifie que pour former un gouvernement, le parti travailliste avait désormais besoin du soutien du parti démocrate 66, plus petit, et du parti libéral progressiste. Pim a annoncé que le vote marquait le début d'une nouvelle ère dans la politique néerlandaise pour ceux qui "veulent en finir avec la culture du compromis et des coalitions, et avec une élite politique qui ne fait rien pour ses intérêts tout en laissant la porte ouverte à certains groupes pour qu'ils viennent ici, car nous savons tous que nous affichons complet ici"
La composition du nouveau parlement et du cabinet néerlandais après les élections de 2002.
Ce ne fut pas la victoire fulgurante promise par Fortuyn, mais passer du statut de commentateur politique à celui de leader du quatrième parti en moins d'un an, c'était bien plus que Haider, Le Pen ou n'importe quel autre parti d'extrême-droite européen, L'état instable du gouvernement néerlandais signifiait que la promesse de Pims selon laquelle "je serai le Premier ministre de ce pays" n'était plus aussi farfelue qu'auparavant et il était clair que, bien que n'étant pas au gouvernement, son assaut d'attaques contre la politique consensuelle des Pays-Bas avait considérablement perturbé le pays et, potentiellement, l'Europe.
Le leader de la LN, Pim Fortuyn, et le Premier ministre, Ad Melkert, lors d'un célèbre débat houleux.
[Sans le 11 septembre, l'ascension de Pim est modifiée : il est moins manifestement anti-islam, ne prononçant pas la fameuse phrase "religion rétrograde" qui lui a valu d'être exclu de Liveable Netherlands et l'a contraint à créer son propre parti. Mais surtout, il n'est pas assassiné comme il l'a été dans OTL.
[Après le 11 septembre et la mort de Pim, la politique néerlandaise a été fortement affectée par l'arrivée au pouvoir des démocrates-chrétiens vaincus et le climat politique moins tendu. Pim dépasse les attentes de TTL, mais ses performances sont inférieures à celles d'OTL.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Rayan du Griffoul et Uranium Colonel aiment ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 23: Épreuve de force en Irak.
Dire que les tensions étaient fortes serait un euphémisme. Les États-Unis et leur allié, le Royaume-Uni, participaient depuis quatre jours à une vaste campagne de bombardements sur l'ensemble du territoire irakien. L'objectif déclaré était de forcer l'Irak à se conformer aux résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations unies et, en particulier, à réadmettre les inspecteurs en désarmement de l'ONU. La menace implicite est que, dans le cas contraire, les États-Unis mobiliseraient une coalition pour désarmer l'Irak par la force et probablement renverser le régime de Saddam Hussein. La veille, le président Bush avait fait part de ses exigences aux médias nationaux, mais aucune déclaration officielle, aucun câble ni aucune demande n'avait été adressé au gouvernement irakien, que ce soit en public ou en privé. Alors que les rouages de l'État se mettaient en branle, que les plans de guerre étaient précisés et que les responsables étaient informés de la nouvelle politique, les États-Unis devaient se préparer à deux éventualités : la première était que Saddam Hussein accède à la demande des États-Unis et admette les inspecteurs, la seconde était qu'il refuse à nouveau et que la campagne visant à le destituer commence officiellement. La Maison Blanche était consciente que si la guerre devait avoir lieu, les préparatifs devaient commencer immédiatement afin qu'une invasion potentielle puisse débuter à la fin de l'année ou au début de 2004, car personne ne voulait lancer la guerre plus tard, au milieu de la campagne de réélection de Bush, ainsi qu'en raison des restrictions météorologiques. Cela signifiait que les préparatifs de guerre commenceraient en même temps que les ouvertures diplomatiques visant à résoudre la crise de manière pacifique.

Harrier américain atterrissant à bord de l'USS Belleau-Wood
Cela a donné à tout le monde un délai très court pour mettre les choses en place. Il fallait adresser à Saddam un nouvel ultimatum, de préférence par l'intermédiaire des Nations unies, réitérant les exigences américaines. Si ces exigences étaient rejetées, l'administration devait alors obtenir le soutien mondial et national nécessaire à une invasion, ce qui impliquait de démontrer que le régime violait les résolutions des Nations unies, de mettre en place des troupes américaines en nombre suffisant, d'obtenir l'autorisation du Congrès et de constituer une coalition avec, espérons-le, l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU. Le défi était de taille, mais l'administration était convaincue qu'elle pourrait obtenir un soutien suffisant pour réussir. La Maison Blanche a commencé à contacter ses alliés les plus proches pour les informer des plans en cours d'élaboration, notamment les ambassadeurs et les diplomates des pays alliés du Moyen-Orient, y compris les voisins de l'Irak, et des appels ont été passés dans le monde entier pour les informer, certes, mais aussi pour les rassurer sur le fait qu'il n'y avait rien de ferme sur son bureau et que la guerre n'était pas une certitude. Les réactions ont été diverses : la Grande-Bretagne ou l'Australie ont apporté leur soutien, mais la plupart des alliés régionaux arabes étaient pour le moins hésitants.
Les gouvernements jordanien et saoudien étant déchirés entre leur désir de stabilité régionale et leur alliance de sécurité avec les États-Unis, toutes les nations ont convenu que la poursuite de la diplomatie, ainsi que la menace d'une intervention militaire forte, étaient nécessaires pour ramener Saddam à la table des négociations. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont immédiatement mis au travail en faisant pression sur les Nations unies pour obtenir une nouvelle résolution du Conseil de sécurité.
Pendant que les appels étaient lancés, les missiles continuaient à tomber sur l'Irak et, pour beaucoup, la guerre semblait avoir déjà commencé. Le conflit en Irak couvait depuis la fin de la première guerre du Golfe en 1991 et s'était récemment ravivé à la suite de la perte d'un avion de chasse américain qui patrouillait dans une zone d'exclusion aérienne. L'ensemble de la campagne de bombardement avait été conçu à l'origine pour faciliter une opération de sauvetage visant à libérer les aviateurs potentiellement capturés, mais après plus de trois jours, la seule information dont disposait le commandement central sur leur localisation était qu'ils étaient probablement détenus dans la ville d'Al-Kut. Les marines américains se tenaient prêts pour la mission de sauvetage et les avions à réaction continuaient à effectuer des reconnaissances. Tout le monde était prêt pour le quatrième jour de recherche, mais un rapport publié par les médias d'État irakiens a mis le feu aux poudres.
Un rapport a été publié, soutenu par le ministère irakien des affaires étrangères, détaillant sa version de l'incident de l'avion abattu. Ce rapport contestait la thèse américaine qui prétendait que l'avion avait été touché par des tirs antiaériens irakiens, affirmant qu'il s'était en fait écrasé tout seul en Irak ; les "preuves" du rapport comprenaient des photos de l'accident qui ne laissaient supposer aucun indice permettant de penser que l'avion avait été abattu. Le rapport ne se contentait pas de contredire les affirmations du gouvernement américain, il revenait également sur le propre rapport de l'Irak publié il y a quelques jours, qui célébrait l'exploit militaire irakien d'avoir abattu l'avion à réaction. Tout cela était secondaire par rapport à l'affirmation principale du rapport, à savoir que le pilote américain et l'officier chargé de l'armement avaient été tués dans l'accident. Il s'agissait de la première déclaration officielle irakienne reconnaissant la disparition des militaires américains. Bien entendu, le commandement central américain et le Pentagone étaient extrêmement méfiants à l'égard de toute affirmation irakienne, et le différend entre l'écrasement du jet et le fait qu'il ait été abattu lui a ôté beaucoup de crédibilité aux yeux des Américains. Les États-Unis n'étaient pas en mesure de croire l'Irak sur parole, mais les responsables américains savaient que le gouvernement irakien ne soutiendrait pas le rapport à la légère.
Les médias américains ont couvert la thèse de la mort des deux piolotes et ont ensuite interrogé l'administration, qui a refusé de donner une légitimité au rapport et a profité de l'occasion pour s'en prendre aux sources d'information qui avaient publié le rapport comme un fait (alors qu'aucune ne l'avait fait). Le ministère de la défense n'a pas eu à travailler longtemps pour obtenir la confirmation qu'il redoutait, sous la forme de séquences et d'images prises immédiatement après le crash, envoyées aux États-Unis par l'armée irakienne, ainsi que d'appels téléphoniques échangés entre les deux gouvernements. Après avoir examiné les preuves, les services de renseignement américains sont parvenus à la conclusion que les images étaient authentiques et qu'elles confirmaient (le gouvernement a insisté sur une confirmation personnelle ou par un tiers, obtenue plus tard au Viêt Nam) que les deux militaires américains disparus depuis quatre jours avaient été tués très probablement dans l'accident de l'avion ou peu après (qui, selon les États-Unis, avait été abattu).
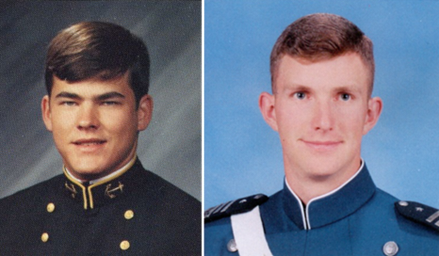
Le lieutenant-colonel William R. "Salty" Watkins III et le capitaine Eric B. "Boot" Das[1]
Ce fut un moment choquant, qui frappa particulièrement le président. Il a d'abord été incrédule, pensant qu'il s'agissait d'une tromperie du régime de Saddam, mais il s'est ensuite rendu à la triste vérité. Il s'agissait des premiers morts au combat de sa présidence et cela lui a permis de comprendre pour la première fois la mission qu'il se préparait à entreprendre : se préparer à débarrasser totalement l'Irak de Saddam. Il y avait beaucoup de beaux parleurs et d'égoïstes à Washington, mais en fin de compte, c'est lui qui prenait les décisions, c'était sa seule responsabilité, et il le savait. Mais au lieu de s'éloigner de sa vision ou d'être effrayé comme il pensait que Clinton l'avait été lorsqu'il a été confronté à ces décisions difficiles, cela a renforcé sa foi dans la justesse de son objectif. Son équipe travaillait à rallier le monde entier à sa cause, les enjeux étaient plus importants mais le poids sur ses épaules était plus léger, il était animé d'une énergie sans précédent depuis son investiture. Son équipe se préparait à codifier cette mission en exigeant de Saddam qu'il se plie à ses exigences et en le menaçant des conséquences ultimes en cas d'échec. Toute son équipe se démenait pour que le président prononce, dans quelques jours, un discours aux Nations unies dans lequel il demanderait le vote de la résolution pertinente au Conseil de sécurité, et ses rédacteurs de discours travaillaient d'arrache-pied à cette préparation, tandis que le département d'État et les diplomates concernés se mobilisaient pour faire pression sur chaque pays afin qu'il vote en conséquence.
Mais alors que l'exécutif se préparait à la guerre, il ne faut pas oublier qu'une guerre aérienne était toujours en cours au-dessus de l'Irak et que des cibles continuaient d'être cochées sur la longue liste de Rumsfeld. Du point de vue du ministère de la défense, la mission devait se poursuivre comme prévu, les ordres permanents restaient en vigueur, le gouvernement irakien n'avait pas accepté de remettre les corps et il y avait toutes les chances que l'armée de l'air et la marine soient encore chargées d'une mission de récupération, après tout, "aucun homme n'est laissé pour compte" était encore la devise des centaines de marines qui avaient été mobilisés et qui, après quatre jours de préparation, n'auraient pas apprécié qu'on leur dise de se retirer des combats. Les bombardements et les frappes de missiles se sont donc poursuivis, diffusés en continu dans le monde entier et suscitant les passions de nombreuses personnes.
Une semaine s'est écoulée après la révélation de la mort de Das et Watkins. Le président a exprimé ses condoléances aux familles par téléphone et, comparé à cela, un discours devant une session extraordinaire des Nations unies ne serait qu'une promenade de santé. Kofi Annan a dû arracher l'accord de la moitié des membres et, pendant un temps, la Maison Blanche a envisagé d'abandonner l'idée et d'organiser une conférence de presse à Crawford, mais après quelques discussions, tout le monde a fini par se rallier à l'idée. Les estimés délégués sont arrivés à New York, avec toute la fanfare et le chaos habituel de la circulation, où ils ont été accueillis par quelques centaines de manifestants pacifistes qui ont réussi à encercler l'ONU, ce qui a retardé certaines procédures, mais les événements sont restés pacifiques. Une fois à l'intérieur du bâtiment, le président a prononcé son discours définissant le cadre dans lequel le monde devait aborder la question de l'Irak. Dans un langage assez direct, il a déclaré qu'une action militaire était "inévitable" si l'Irak continuait à défier les sanctions internationales : "Les justes exigences de la paix et de la sécurité seront satisfaites, ou une action sera inévitable", mais il est resté ambigu sur la question de savoir s'il s'agissait d'une guerre ou d'une poursuite d'une intervention limitée.
Il a réitéré son argument selon lequel Hussein avait défié 12 années de résolutions, y compris celles concernant les armes de destruction massive, l'aide aux organisations terroristes et les crimes commis contre les prisonniers dans la guerre du Golfe, le génocide et la répression. Il a déclaré que son administration ferait pression sur les Nations unies pour qu'elles élaborent un plan d'action que le Conseil de sécurité reprendrait. Il a insisté sur l'urgence d'agir, cherchant à réfuter les affirmations de certains membres selon lesquelles une invasion rendrait l'action plus immédiate. "Les inspections doivent commencer dans quelques semaines, pas dans des mois ou des années". Ce discours visait à montrer que les Etats-Unis recherchaient la coopération et non l'unilatéralisme que les délégués craignaient de voir s'installer : "nous devons nous assurer que les Nations Unies ne se transforment pas en la Ligue des Nations qui n'a pas su faire face à Hitler ... Il est de la responsabilité de ce Conseil d'agir".

(A gauche) Le Président Bush s'adresse aux Nations Unies, (A droite) des pancartes de protestation à l'extérieur des Nations Unies déclarant "Pas de sang pour le pétrole".
Le discours du président a été bien accueilli par ses partisans et même par ses détracteurs, car pour une fois, il semblait diriger correctement l'administration et imposer à ses collaborateurs la poursuite de sa propre vision, le tout dans un langage sobre et franc, contrairement aux déclarations vagues du passé. En conséquence, un certain nombre de pays ont commencé à soutenir ouvertement la position des États-Unis en faveur d'une reprise immédiate des inspections. Le Premier ministre Blair a pleinement approuvé le discours, le qualifiant de seule option logique. "La Russie et la Chine ont déclaré qu'elles soutenaient M. Bush sur le principe, tout en préconisant la poursuite de la diplomatie telle qu'elle a été définie par M. Bush. Le président russe, M. Poutine, a cité de manière sélective le discours du président en déclarant : "Nous sommes d'accord avec le président pour dire que la diplomatie n'a pas encore été épuisée". Le ministère chinois des affaires étrangères a quant à lui déclaré que "l'ONU est le meilleur moyen de résoudre le problème politique de l'Irak et la Chine est prête à jouer un rôle dans ce processus". D'autres pays ont été encouragés par le ton du discours, le chancelier allemand Stoiber s'est montré particulièrement favorable :
"La politique de l'Allemagne est le retour des inspecteurs, et nous soutenons les mesures prises, ce sont des actions sages". Toutefois, certaines nations ont choisi de rappeler au monde les actions agressives déjà en cours, notamment la France, cinquième membre permanent du Conseil de sécurité : "C'est une bonne chose que le président Bush veuille négocier, mais il sera difficile de le faire tant que les bombardements se poursuivront ; les inspecteurs de l'ONU ne reviendront probablement pas tant que ces bombardements n'auront pas cessé". Des dirigeants arabes, tels que le secrétaire de la Ligue arabe, Amr Moussa, ont déclaré que l'ouverture de M. Bush aux États-Unis était "une bonne initiative, mais qu'elle n'était pas sincère si les États-Unis ne réduisaient pas également leurs actions agressives" et, pour sa part, le vice-premier ministre irakien a qualifié le discours de "masse de mensonges et d'inventions".
Alors que les diplomates se battaient à New York pour obtenir le soutien du monde, la bataille pour obtenir le soutien de la nation commençait à Washington. Si les Etats-Unis devaient mener une coalition contre l'Irak, l'administration a décidé qu'elle aurait besoin de l'autorisation du Congrès. Les avis divergent à la Maison Blanche sur cette stratégie, la faction Powell pensant qu'elle pourrait compromettre les efforts diplomatiques en plaçant le pays sur le pied de guerre avant que l'ONU ne propose sa résolution et ne menace d'opposer son veto, et les juristes arguant que depuis l'accord du Congrès en 1991, les Etats-Unis n'avaient plus besoin de l'autorisation du Congrès pour mener une coalition contre l'Irak.
Et même sans cela, ce n'est pas comme si les présidents n'avaient jamais utilisé leurs pouvoirs de guerre de manière extra-légale auparavant et certains pourraient soutenir qu'il était déjà en infraction avec la loi, mais le président a convenu avec ses conseillers politiques que contourner le Congrès n'aiderait pas ses efforts de formation de coalition et pourrait nuire au soutien intérieur si une bataille partisane éclatait à l'intérieur des États-Unis et qu'une guerre potentielle n'était pas finie rapidement. La lutte risque d'être rude, les républicains ne contrôlant aucune des deux chambres du Congrès, et si Bush Jr devait rencontrer autant d'opposition à une résolution que son père en 1991, cela pourrait se terminer en queue de poisson. L'impulsion législative a été donnée principalement par le chef de cabinet Andy Card et le vice-président Dick Cheney (compte tenu de son expérience législative et de sa position de leader du Sénat). Contrairement à la présentation rationalisée à l'ONU, l'approche du Congrès était dispersée, une résolution sur l'usage de la force étant simultanément présentée aux membres du Congrès comme donnant une colonne vertébrale aux résolutions de l'ONU en faveur de la paix, tout en étant nécessaire en raison de la menace que l'Irak représentait déjà pour les préparatifs de la guerre.
Au lieu de se concentrer sur l'objectif du retour des inspecteurs en désarmement, Cheney a réitéré sa conviction que Saddam Hussein possédait déjà des armes de destruction massive, insinuant que les résolutions ultérieures étaient dénuées de sens. Cheney a même fait part publiquement de sa conviction, sapant potentiellement le président lorsqu'il a répondu à une question d'interview que les États-Unis devraient agir "assez rapidement", indépendamment des Nations unies, pour empêcher Saddam d'acquérir l'arme nucléaire. Le lobbying a placé les exilés irakiens sur le devant de la scène, comme ils l'avaient fait lors de la bataille pour la résolution de 1991, pour raconter des histoires d'horreur sur l'oppression et le génocide sous Saddam Hussein, et ils ont été heureux de réitérer les affirmations de Cheney sur les capacités de l'Irak en matière d'armement et sur ses liens avec le terrorisme.

Le vice-président Cheney interviewé lors de l'émission Meet the Press.
Le leader de la majorité au Sénat, M. Daschle, a déclaré à la Maison Blanche que la résolution du Conseil de sécurité devrait passer avant celle du Congrès, comme cela avait été le cas lors de la guerre du Golfe persique, et de nombreux démocrates ont hésité à voter tant qu'ils n'auraient pas reçu les preuves des affirmations de M. Cheney, Certains ont fait part publiquement de leurs réserves, notamment le sénateur Dick Durbin de l'Illinois, qui a qualifié une telle résolution de "mal venue", et il y a eu quelques faiblesses dans le camp républicain également, le sénateur Lincoln Chafee, une épine récurrente dans le pied du président, a reconnu qu'il avait besoin de voir les preuves avant de voter et a été rejoint par le sénateur Richard Lugar au sein de la commission des relations étrangères, qui s'est opposé à certains messages de la Maison Blanche en déclarant que toute résolution du Congrès devrait être liée à une résolution de l'ONU. Il a été rejoint par quelques autres modérés qui ont exprimé des réserves sur le fait de préempter les Nations Unies. L'opposition signifiait qu'un vote risquait de se heurter à une menace d'obstruction, alors même que le sénateur Joe Lieberman et quelques autres démocrates conservateurs pouvaient apporter un certain soutien aux démocrates.
Bush espérait trouver un soutien plus fort à la Chambre des représentants, où le président Gephardt s'était déjà montré ouvertement favorable à l'élimination de Saddam Hussein et, en tant que speaker, souhaitait ardemment que le Congrès ait son mot à dire dans les événements qui se déroulaient en Irak, mais lorsqu'il a été invité à participer à la rédaction d'une résolution commune avec la Maison Blanche, il s'est opposé à l'adoption rapide de la résolution : "Le président a raison d'énoncer nos objectifs et de s'adresser à la communauté internationale", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, "mais de nombreuses questions restent en suspens ; nous devons veiller à ce que nos objectifs soient clairs et à ce que nos alliés nous soutiennent pour que cette opération ne soit pas l'apanage d'un seul pays [...]. Si nécessaire, je soutiendrais une résolution, mais tant que les options diplomatiques sont encore sur la table, nous pourrons peut-être éviter une nouvelle guerre".

(de gauche à droite) Le leader du Sénat, Daschle, et le président de la Chambre des représentants, Gephardt, opposés à l'idée d'une autorisation immédiate de l'usage de la force.
Le refus des dirigeants démocrates n'a pas fait capoter la résolution et l'équipe Bush était persuadée qu'elle pourrait obtenir un soutien suffisant de la part des démocrates à la Chambre des représentants et que ces derniers seraient effrayés à l'idée de faire de l'obstruction systématique à une résolution de guerre. Ne voulant pas prendre ce risque, le président a choisi d'attendre qu'un accord soit conclu au Conseil de sécurité avant de s'engager sur le plan intérieur[2].
Alors que l'équipe Bush célébrait le discours du président, elle planifiait ses prochaines actions de lobbying auprès du Conseil de sécurité en vue de l'adoption de la nouvelle résolution. Mais une autre surprise est survenue quatre jours seulement après le discours de Bush. Kofi Annan a reçu une lettre du ministre irakien des affaires étrangères invitant le chef des inspecteurs en désarmement de l'ONU, Hans Blix, à revenir en Irak. Bien que M. Annan n'ait pas pu accepter l'offre immédiatement, car elle fixait un calendrier rigide en rupture avec les résolutions précédentes, il a annoncé qu'il entamerait des négociations avec l'Irak et a déclaré qu'il s'agissait d'un pas en avant positif. Le discours de Bush à l'ONU et la lettre de l'Irak qui a suivi ont semblé constituer une désescalade significative, mais Washington s'est empressé de jeter le doute sur la proposition irakienne en rappelant que l'Irak s'était déjà ingéré dans les affaires des inspecteurs et le secrétaire de presse de Bush a clairement indiqué que "les inspections ne sont pas la même chose que le désarmement". Un à un, tout au long du mois de mai, les États-Unis se sont efforcés de rallier le Conseil de sécurité, au prix de nombreuses négociations et d'un grand nombre de réécritures, notamment en précisant que le non-respect par l'Irak de ses obligations ne justifiait pas une invasion et qu'il n'y avait pas non plus d'autres conséquences spécifiques, une proposition nettement plus légère que la résolution relative à la guerre du Golfe il y a 12 ans.
Mais la poursuite des frappes militaires a suscité la colère des principaux membres du Conseil de sécurité, à savoir la Russie, la Chine et la France, qui ont tous trois menacé d'opposer leur veto si les États-Unis ne s'engageaient pas pleinement en faveur de l'option diplomatique et n'atténuaient pas les frappes. Le président s'était publiquement engagé à maintenir la pression sur l'Irak et Rumsfeld affirmait encore qu'il y avait des cibles à atteindre, mais comme la résolution était presque achevée et qu'il n'y avait plus d'objectifs urgents, Bush a cédé en privé aux membres du Conseil et les frappes ont de nouveau été limitées aux zones d'exclusion aérienne, après plus d'un mois, Bagdad n'était plus une ville en état de siège. Quelques jours plus tard, le 3 juillet 2003, le Conseil de sécurité votait et adoptait avec 11 voix, 3 abstentions (Russie, France et Pakistan) et 1 voix contre (Syrie)[3], la résolution 1486 déclarant l'Irak en violation des résolutions précédentes et offrant à l'Irak la possibilité de se conformer, peu après que l'Irak ait annoncé son intention de s'y conformer. Au bout de cinq ans, les inspecteurs en désarmement reviendraient en Irak.

(à gauche) Les inspecteurs en désarmement de l'ONU retournent en Irak, (à droite) Un bâtiment irakien détruit par des frappes américaines.
[1] Les deux pilotes ici présents ont effectué des missions de combat lors de la guerre d'Irak.
[2] Le vote de la résolution de guerre a eu lieu avant les élections législatives. Les démocrates espéraient donc qu'en accélérant le processus, ils pourraient se concentrer sur la politique intérieure, ce qui n'est pas le cas ici.
[3] Le Conseil de sécurité compte 10 membres non permanents, dont le Pakistan et la Syrie faisaient partie à l'époque.
Dire que les tensions étaient fortes serait un euphémisme. Les États-Unis et leur allié, le Royaume-Uni, participaient depuis quatre jours à une vaste campagne de bombardements sur l'ensemble du territoire irakien. L'objectif déclaré était de forcer l'Irak à se conformer aux résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations unies et, en particulier, à réadmettre les inspecteurs en désarmement de l'ONU. La menace implicite est que, dans le cas contraire, les États-Unis mobiliseraient une coalition pour désarmer l'Irak par la force et probablement renverser le régime de Saddam Hussein. La veille, le président Bush avait fait part de ses exigences aux médias nationaux, mais aucune déclaration officielle, aucun câble ni aucune demande n'avait été adressé au gouvernement irakien, que ce soit en public ou en privé. Alors que les rouages de l'État se mettaient en branle, que les plans de guerre étaient précisés et que les responsables étaient informés de la nouvelle politique, les États-Unis devaient se préparer à deux éventualités : la première était que Saddam Hussein accède à la demande des États-Unis et admette les inspecteurs, la seconde était qu'il refuse à nouveau et que la campagne visant à le destituer commence officiellement. La Maison Blanche était consciente que si la guerre devait avoir lieu, les préparatifs devaient commencer immédiatement afin qu'une invasion potentielle puisse débuter à la fin de l'année ou au début de 2004, car personne ne voulait lancer la guerre plus tard, au milieu de la campagne de réélection de Bush, ainsi qu'en raison des restrictions météorologiques. Cela signifiait que les préparatifs de guerre commenceraient en même temps que les ouvertures diplomatiques visant à résoudre la crise de manière pacifique.
Harrier américain atterrissant à bord de l'USS Belleau-Wood
Cela a donné à tout le monde un délai très court pour mettre les choses en place. Il fallait adresser à Saddam un nouvel ultimatum, de préférence par l'intermédiaire des Nations unies, réitérant les exigences américaines. Si ces exigences étaient rejetées, l'administration devait alors obtenir le soutien mondial et national nécessaire à une invasion, ce qui impliquait de démontrer que le régime violait les résolutions des Nations unies, de mettre en place des troupes américaines en nombre suffisant, d'obtenir l'autorisation du Congrès et de constituer une coalition avec, espérons-le, l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU. Le défi était de taille, mais l'administration était convaincue qu'elle pourrait obtenir un soutien suffisant pour réussir. La Maison Blanche a commencé à contacter ses alliés les plus proches pour les informer des plans en cours d'élaboration, notamment les ambassadeurs et les diplomates des pays alliés du Moyen-Orient, y compris les voisins de l'Irak, et des appels ont été passés dans le monde entier pour les informer, certes, mais aussi pour les rassurer sur le fait qu'il n'y avait rien de ferme sur son bureau et que la guerre n'était pas une certitude. Les réactions ont été diverses : la Grande-Bretagne ou l'Australie ont apporté leur soutien, mais la plupart des alliés régionaux arabes étaient pour le moins hésitants.
Les gouvernements jordanien et saoudien étant déchirés entre leur désir de stabilité régionale et leur alliance de sécurité avec les États-Unis, toutes les nations ont convenu que la poursuite de la diplomatie, ainsi que la menace d'une intervention militaire forte, étaient nécessaires pour ramener Saddam à la table des négociations. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont immédiatement mis au travail en faisant pression sur les Nations unies pour obtenir une nouvelle résolution du Conseil de sécurité.
Pendant que les appels étaient lancés, les missiles continuaient à tomber sur l'Irak et, pour beaucoup, la guerre semblait avoir déjà commencé. Le conflit en Irak couvait depuis la fin de la première guerre du Golfe en 1991 et s'était récemment ravivé à la suite de la perte d'un avion de chasse américain qui patrouillait dans une zone d'exclusion aérienne. L'ensemble de la campagne de bombardement avait été conçu à l'origine pour faciliter une opération de sauvetage visant à libérer les aviateurs potentiellement capturés, mais après plus de trois jours, la seule information dont disposait le commandement central sur leur localisation était qu'ils étaient probablement détenus dans la ville d'Al-Kut. Les marines américains se tenaient prêts pour la mission de sauvetage et les avions à réaction continuaient à effectuer des reconnaissances. Tout le monde était prêt pour le quatrième jour de recherche, mais un rapport publié par les médias d'État irakiens a mis le feu aux poudres.
Un rapport a été publié, soutenu par le ministère irakien des affaires étrangères, détaillant sa version de l'incident de l'avion abattu. Ce rapport contestait la thèse américaine qui prétendait que l'avion avait été touché par des tirs antiaériens irakiens, affirmant qu'il s'était en fait écrasé tout seul en Irak ; les "preuves" du rapport comprenaient des photos de l'accident qui ne laissaient supposer aucun indice permettant de penser que l'avion avait été abattu. Le rapport ne se contentait pas de contredire les affirmations du gouvernement américain, il revenait également sur le propre rapport de l'Irak publié il y a quelques jours, qui célébrait l'exploit militaire irakien d'avoir abattu l'avion à réaction. Tout cela était secondaire par rapport à l'affirmation principale du rapport, à savoir que le pilote américain et l'officier chargé de l'armement avaient été tués dans l'accident. Il s'agissait de la première déclaration officielle irakienne reconnaissant la disparition des militaires américains. Bien entendu, le commandement central américain et le Pentagone étaient extrêmement méfiants à l'égard de toute affirmation irakienne, et le différend entre l'écrasement du jet et le fait qu'il ait été abattu lui a ôté beaucoup de crédibilité aux yeux des Américains. Les États-Unis n'étaient pas en mesure de croire l'Irak sur parole, mais les responsables américains savaient que le gouvernement irakien ne soutiendrait pas le rapport à la légère.
Les médias américains ont couvert la thèse de la mort des deux piolotes et ont ensuite interrogé l'administration, qui a refusé de donner une légitimité au rapport et a profité de l'occasion pour s'en prendre aux sources d'information qui avaient publié le rapport comme un fait (alors qu'aucune ne l'avait fait). Le ministère de la défense n'a pas eu à travailler longtemps pour obtenir la confirmation qu'il redoutait, sous la forme de séquences et d'images prises immédiatement après le crash, envoyées aux États-Unis par l'armée irakienne, ainsi que d'appels téléphoniques échangés entre les deux gouvernements. Après avoir examiné les preuves, les services de renseignement américains sont parvenus à la conclusion que les images étaient authentiques et qu'elles confirmaient (le gouvernement a insisté sur une confirmation personnelle ou par un tiers, obtenue plus tard au Viêt Nam) que les deux militaires américains disparus depuis quatre jours avaient été tués très probablement dans l'accident de l'avion ou peu après (qui, selon les États-Unis, avait été abattu).
Le lieutenant-colonel William R. "Salty" Watkins III et le capitaine Eric B. "Boot" Das[1]
Ce fut un moment choquant, qui frappa particulièrement le président. Il a d'abord été incrédule, pensant qu'il s'agissait d'une tromperie du régime de Saddam, mais il s'est ensuite rendu à la triste vérité. Il s'agissait des premiers morts au combat de sa présidence et cela lui a permis de comprendre pour la première fois la mission qu'il se préparait à entreprendre : se préparer à débarrasser totalement l'Irak de Saddam. Il y avait beaucoup de beaux parleurs et d'égoïstes à Washington, mais en fin de compte, c'est lui qui prenait les décisions, c'était sa seule responsabilité, et il le savait. Mais au lieu de s'éloigner de sa vision ou d'être effrayé comme il pensait que Clinton l'avait été lorsqu'il a été confronté à ces décisions difficiles, cela a renforcé sa foi dans la justesse de son objectif. Son équipe travaillait à rallier le monde entier à sa cause, les enjeux étaient plus importants mais le poids sur ses épaules était plus léger, il était animé d'une énergie sans précédent depuis son investiture. Son équipe se préparait à codifier cette mission en exigeant de Saddam qu'il se plie à ses exigences et en le menaçant des conséquences ultimes en cas d'échec. Toute son équipe se démenait pour que le président prononce, dans quelques jours, un discours aux Nations unies dans lequel il demanderait le vote de la résolution pertinente au Conseil de sécurité, et ses rédacteurs de discours travaillaient d'arrache-pied à cette préparation, tandis que le département d'État et les diplomates concernés se mobilisaient pour faire pression sur chaque pays afin qu'il vote en conséquence.
Mais alors que l'exécutif se préparait à la guerre, il ne faut pas oublier qu'une guerre aérienne était toujours en cours au-dessus de l'Irak et que des cibles continuaient d'être cochées sur la longue liste de Rumsfeld. Du point de vue du ministère de la défense, la mission devait se poursuivre comme prévu, les ordres permanents restaient en vigueur, le gouvernement irakien n'avait pas accepté de remettre les corps et il y avait toutes les chances que l'armée de l'air et la marine soient encore chargées d'une mission de récupération, après tout, "aucun homme n'est laissé pour compte" était encore la devise des centaines de marines qui avaient été mobilisés et qui, après quatre jours de préparation, n'auraient pas apprécié qu'on leur dise de se retirer des combats. Les bombardements et les frappes de missiles se sont donc poursuivis, diffusés en continu dans le monde entier et suscitant les passions de nombreuses personnes.
Une semaine s'est écoulée après la révélation de la mort de Das et Watkins. Le président a exprimé ses condoléances aux familles par téléphone et, comparé à cela, un discours devant une session extraordinaire des Nations unies ne serait qu'une promenade de santé. Kofi Annan a dû arracher l'accord de la moitié des membres et, pendant un temps, la Maison Blanche a envisagé d'abandonner l'idée et d'organiser une conférence de presse à Crawford, mais après quelques discussions, tout le monde a fini par se rallier à l'idée. Les estimés délégués sont arrivés à New York, avec toute la fanfare et le chaos habituel de la circulation, où ils ont été accueillis par quelques centaines de manifestants pacifistes qui ont réussi à encercler l'ONU, ce qui a retardé certaines procédures, mais les événements sont restés pacifiques. Une fois à l'intérieur du bâtiment, le président a prononcé son discours définissant le cadre dans lequel le monde devait aborder la question de l'Irak. Dans un langage assez direct, il a déclaré qu'une action militaire était "inévitable" si l'Irak continuait à défier les sanctions internationales : "Les justes exigences de la paix et de la sécurité seront satisfaites, ou une action sera inévitable", mais il est resté ambigu sur la question de savoir s'il s'agissait d'une guerre ou d'une poursuite d'une intervention limitée.
Il a réitéré son argument selon lequel Hussein avait défié 12 années de résolutions, y compris celles concernant les armes de destruction massive, l'aide aux organisations terroristes et les crimes commis contre les prisonniers dans la guerre du Golfe, le génocide et la répression. Il a déclaré que son administration ferait pression sur les Nations unies pour qu'elles élaborent un plan d'action que le Conseil de sécurité reprendrait. Il a insisté sur l'urgence d'agir, cherchant à réfuter les affirmations de certains membres selon lesquelles une invasion rendrait l'action plus immédiate. "Les inspections doivent commencer dans quelques semaines, pas dans des mois ou des années". Ce discours visait à montrer que les Etats-Unis recherchaient la coopération et non l'unilatéralisme que les délégués craignaient de voir s'installer : "nous devons nous assurer que les Nations Unies ne se transforment pas en la Ligue des Nations qui n'a pas su faire face à Hitler ... Il est de la responsabilité de ce Conseil d'agir".
(A gauche) Le Président Bush s'adresse aux Nations Unies, (A droite) des pancartes de protestation à l'extérieur des Nations Unies déclarant "Pas de sang pour le pétrole".
Le discours du président a été bien accueilli par ses partisans et même par ses détracteurs, car pour une fois, il semblait diriger correctement l'administration et imposer à ses collaborateurs la poursuite de sa propre vision, le tout dans un langage sobre et franc, contrairement aux déclarations vagues du passé. En conséquence, un certain nombre de pays ont commencé à soutenir ouvertement la position des États-Unis en faveur d'une reprise immédiate des inspections. Le Premier ministre Blair a pleinement approuvé le discours, le qualifiant de seule option logique. "La Russie et la Chine ont déclaré qu'elles soutenaient M. Bush sur le principe, tout en préconisant la poursuite de la diplomatie telle qu'elle a été définie par M. Bush. Le président russe, M. Poutine, a cité de manière sélective le discours du président en déclarant : "Nous sommes d'accord avec le président pour dire que la diplomatie n'a pas encore été épuisée". Le ministère chinois des affaires étrangères a quant à lui déclaré que "l'ONU est le meilleur moyen de résoudre le problème politique de l'Irak et la Chine est prête à jouer un rôle dans ce processus". D'autres pays ont été encouragés par le ton du discours, le chancelier allemand Stoiber s'est montré particulièrement favorable :
"La politique de l'Allemagne est le retour des inspecteurs, et nous soutenons les mesures prises, ce sont des actions sages". Toutefois, certaines nations ont choisi de rappeler au monde les actions agressives déjà en cours, notamment la France, cinquième membre permanent du Conseil de sécurité : "C'est une bonne chose que le président Bush veuille négocier, mais il sera difficile de le faire tant que les bombardements se poursuivront ; les inspecteurs de l'ONU ne reviendront probablement pas tant que ces bombardements n'auront pas cessé". Des dirigeants arabes, tels que le secrétaire de la Ligue arabe, Amr Moussa, ont déclaré que l'ouverture de M. Bush aux États-Unis était "une bonne initiative, mais qu'elle n'était pas sincère si les États-Unis ne réduisaient pas également leurs actions agressives" et, pour sa part, le vice-premier ministre irakien a qualifié le discours de "masse de mensonges et d'inventions".
Alors que les diplomates se battaient à New York pour obtenir le soutien du monde, la bataille pour obtenir le soutien de la nation commençait à Washington. Si les Etats-Unis devaient mener une coalition contre l'Irak, l'administration a décidé qu'elle aurait besoin de l'autorisation du Congrès. Les avis divergent à la Maison Blanche sur cette stratégie, la faction Powell pensant qu'elle pourrait compromettre les efforts diplomatiques en plaçant le pays sur le pied de guerre avant que l'ONU ne propose sa résolution et ne menace d'opposer son veto, et les juristes arguant que depuis l'accord du Congrès en 1991, les Etats-Unis n'avaient plus besoin de l'autorisation du Congrès pour mener une coalition contre l'Irak.
Et même sans cela, ce n'est pas comme si les présidents n'avaient jamais utilisé leurs pouvoirs de guerre de manière extra-légale auparavant et certains pourraient soutenir qu'il était déjà en infraction avec la loi, mais le président a convenu avec ses conseillers politiques que contourner le Congrès n'aiderait pas ses efforts de formation de coalition et pourrait nuire au soutien intérieur si une bataille partisane éclatait à l'intérieur des États-Unis et qu'une guerre potentielle n'était pas finie rapidement. La lutte risque d'être rude, les républicains ne contrôlant aucune des deux chambres du Congrès, et si Bush Jr devait rencontrer autant d'opposition à une résolution que son père en 1991, cela pourrait se terminer en queue de poisson. L'impulsion législative a été donnée principalement par le chef de cabinet Andy Card et le vice-président Dick Cheney (compte tenu de son expérience législative et de sa position de leader du Sénat). Contrairement à la présentation rationalisée à l'ONU, l'approche du Congrès était dispersée, une résolution sur l'usage de la force étant simultanément présentée aux membres du Congrès comme donnant une colonne vertébrale aux résolutions de l'ONU en faveur de la paix, tout en étant nécessaire en raison de la menace que l'Irak représentait déjà pour les préparatifs de la guerre.
Au lieu de se concentrer sur l'objectif du retour des inspecteurs en désarmement, Cheney a réitéré sa conviction que Saddam Hussein possédait déjà des armes de destruction massive, insinuant que les résolutions ultérieures étaient dénuées de sens. Cheney a même fait part publiquement de sa conviction, sapant potentiellement le président lorsqu'il a répondu à une question d'interview que les États-Unis devraient agir "assez rapidement", indépendamment des Nations unies, pour empêcher Saddam d'acquérir l'arme nucléaire. Le lobbying a placé les exilés irakiens sur le devant de la scène, comme ils l'avaient fait lors de la bataille pour la résolution de 1991, pour raconter des histoires d'horreur sur l'oppression et le génocide sous Saddam Hussein, et ils ont été heureux de réitérer les affirmations de Cheney sur les capacités de l'Irak en matière d'armement et sur ses liens avec le terrorisme.
Le vice-président Cheney interviewé lors de l'émission Meet the Press.
Le leader de la majorité au Sénat, M. Daschle, a déclaré à la Maison Blanche que la résolution du Conseil de sécurité devrait passer avant celle du Congrès, comme cela avait été le cas lors de la guerre du Golfe persique, et de nombreux démocrates ont hésité à voter tant qu'ils n'auraient pas reçu les preuves des affirmations de M. Cheney, Certains ont fait part publiquement de leurs réserves, notamment le sénateur Dick Durbin de l'Illinois, qui a qualifié une telle résolution de "mal venue", et il y a eu quelques faiblesses dans le camp républicain également, le sénateur Lincoln Chafee, une épine récurrente dans le pied du président, a reconnu qu'il avait besoin de voir les preuves avant de voter et a été rejoint par le sénateur Richard Lugar au sein de la commission des relations étrangères, qui s'est opposé à certains messages de la Maison Blanche en déclarant que toute résolution du Congrès devrait être liée à une résolution de l'ONU. Il a été rejoint par quelques autres modérés qui ont exprimé des réserves sur le fait de préempter les Nations Unies. L'opposition signifiait qu'un vote risquait de se heurter à une menace d'obstruction, alors même que le sénateur Joe Lieberman et quelques autres démocrates conservateurs pouvaient apporter un certain soutien aux démocrates.
Bush espérait trouver un soutien plus fort à la Chambre des représentants, où le président Gephardt s'était déjà montré ouvertement favorable à l'élimination de Saddam Hussein et, en tant que speaker, souhaitait ardemment que le Congrès ait son mot à dire dans les événements qui se déroulaient en Irak, mais lorsqu'il a été invité à participer à la rédaction d'une résolution commune avec la Maison Blanche, il s'est opposé à l'adoption rapide de la résolution : "Le président a raison d'énoncer nos objectifs et de s'adresser à la communauté internationale", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, "mais de nombreuses questions restent en suspens ; nous devons veiller à ce que nos objectifs soient clairs et à ce que nos alliés nous soutiennent pour que cette opération ne soit pas l'apanage d'un seul pays [...]. Si nécessaire, je soutiendrais une résolution, mais tant que les options diplomatiques sont encore sur la table, nous pourrons peut-être éviter une nouvelle guerre".
(de gauche à droite) Le leader du Sénat, Daschle, et le président de la Chambre des représentants, Gephardt, opposés à l'idée d'une autorisation immédiate de l'usage de la force.
Le refus des dirigeants démocrates n'a pas fait capoter la résolution et l'équipe Bush était persuadée qu'elle pourrait obtenir un soutien suffisant de la part des démocrates à la Chambre des représentants et que ces derniers seraient effrayés à l'idée de faire de l'obstruction systématique à une résolution de guerre. Ne voulant pas prendre ce risque, le président a choisi d'attendre qu'un accord soit conclu au Conseil de sécurité avant de s'engager sur le plan intérieur[2].
Alors que l'équipe Bush célébrait le discours du président, elle planifiait ses prochaines actions de lobbying auprès du Conseil de sécurité en vue de l'adoption de la nouvelle résolution. Mais une autre surprise est survenue quatre jours seulement après le discours de Bush. Kofi Annan a reçu une lettre du ministre irakien des affaires étrangères invitant le chef des inspecteurs en désarmement de l'ONU, Hans Blix, à revenir en Irak. Bien que M. Annan n'ait pas pu accepter l'offre immédiatement, car elle fixait un calendrier rigide en rupture avec les résolutions précédentes, il a annoncé qu'il entamerait des négociations avec l'Irak et a déclaré qu'il s'agissait d'un pas en avant positif. Le discours de Bush à l'ONU et la lettre de l'Irak qui a suivi ont semblé constituer une désescalade significative, mais Washington s'est empressé de jeter le doute sur la proposition irakienne en rappelant que l'Irak s'était déjà ingéré dans les affaires des inspecteurs et le secrétaire de presse de Bush a clairement indiqué que "les inspections ne sont pas la même chose que le désarmement". Un à un, tout au long du mois de mai, les États-Unis se sont efforcés de rallier le Conseil de sécurité, au prix de nombreuses négociations et d'un grand nombre de réécritures, notamment en précisant que le non-respect par l'Irak de ses obligations ne justifiait pas une invasion et qu'il n'y avait pas non plus d'autres conséquences spécifiques, une proposition nettement plus légère que la résolution relative à la guerre du Golfe il y a 12 ans.
Mais la poursuite des frappes militaires a suscité la colère des principaux membres du Conseil de sécurité, à savoir la Russie, la Chine et la France, qui ont tous trois menacé d'opposer leur veto si les États-Unis ne s'engageaient pas pleinement en faveur de l'option diplomatique et n'atténuaient pas les frappes. Le président s'était publiquement engagé à maintenir la pression sur l'Irak et Rumsfeld affirmait encore qu'il y avait des cibles à atteindre, mais comme la résolution était presque achevée et qu'il n'y avait plus d'objectifs urgents, Bush a cédé en privé aux membres du Conseil et les frappes ont de nouveau été limitées aux zones d'exclusion aérienne, après plus d'un mois, Bagdad n'était plus une ville en état de siège. Quelques jours plus tard, le 3 juillet 2003, le Conseil de sécurité votait et adoptait avec 11 voix, 3 abstentions (Russie, France et Pakistan) et 1 voix contre (Syrie)[3], la résolution 1486 déclarant l'Irak en violation des résolutions précédentes et offrant à l'Irak la possibilité de se conformer, peu après que l'Irak ait annoncé son intention de s'y conformer. Au bout de cinq ans, les inspecteurs en désarmement reviendraient en Irak.
(à gauche) Les inspecteurs en désarmement de l'ONU retournent en Irak, (à droite) Un bâtiment irakien détruit par des frappes américaines.
[1] Les deux pilotes ici présents ont effectué des missions de combat lors de la guerre d'Irak.
[2] Le vote de la résolution de guerre a eu lieu avant les élections législatives. Les démocrates espéraient donc qu'en accélérant le processus, ils pourraient se concentrer sur la politique intérieure, ce qui n'est pas le cas ici.
[3] Le Conseil de sécurité compte 10 membres non permanents, dont le Pakistan et la Syrie faisaient partie à l'époque.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas et vigilae aiment ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Pas de guerre en Irak? Je suis curieux de voir ce qu'il va se passer.
_________________
« Ce n’est que devant l’épreuve, la vraie, celle qui met en jeu l’existence même, que les hommes cessent de se mentir et révèlent vraiment ce qu’ils sont. »
Alexandre Lang.
Au Bord de l'Abîme et au-delà
Uranium Colonel aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
L'Amérique va définitivement partir en guerre.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 24: Résolutions.

1]
Le cercueil d'un soldat américain ramené aux États-Unis
Les cercueils contenant deux Américains décédés ont été renvoyés aux États-Unis en juillet 2003. Cette sombre scène a constitué un moment macabre et curieux de l'histoire. De l'extérieur, on pouvait croire que le monde s'était éloigné du bord de la falaise. L'appel du président George Bush à la diplomatie et aux négociations, la lettre de Saddam Hussein acceptant les pourparlers avec l'ONU et la fin des bombardements américains dans le centre de l'Irak, tout cela a culminé avec la réadmission des inspecteurs en désarmement de l'ONU. C'était comme si un coup d'État diplomatique avait eu lieu, que toutes les manœuvres et les stratégies avaient peut-être réussi et que les États-Unis avaient remis l'Irak dans sa boîte, pour reprendre l'expression de Colin Powell. Mais les célébrations sont restées discrètes à la Maison Blanche, et tout le monde pouvait encore entendre le battement régulier des tambours de guerre.
Alors que le pouvoir exécutif continuait à faire pression sur les membres du Congrès, les délégués internationaux et le grand public sur la possibilité (et la nécessité potentielle) d'un nouveau conflit, le secrétaire d'État Rumsfeld a déclaré : "Depuis la guerre du Golfe persique, l'Irak a accepté une série d'engagements de l'ONU et n'a pas respecté chacun d'entre eux ; je ne vois pas quelle sera la différence aujourd'hui". Ou, comme l'a dit le secrétaire de presse Ari Fleischer, "leurs paroles changent après un mois d'attaques, et leur armée a été décimée, mais leurs actions ne changent pas". Même avant le retour officiel des inspecteurs en Irak, la route était semée d'embûches : les destructions causées par l'opération américaine "Desert Badger" comprenaient le bombardement d'éventuels sites de production ou de stockage d'armes de destruction massive, ce qui laissait supposer que si de telles installations avaient existé, elles étaient déjà ensevelies sous des centaines de tonnes de décombres. Washington craignait, en public comme en privé, qu'un long délai ne repousse considérablement le calendrier militaire et ne donne à Saddam Hussein la possibilité de tromper les inspecteurs ou de s'immiscer dans les inspections, ou encore de mieux se préparer à un conflit avec les États-Unis, tandis que l'Irak craignait que des inspections de longue haleine ne soient utilisées pour espionner le régime ou s'immiscer dans ses affaires.
Malheureusement pour les deux, l'inspecteur en chef Hans Blix s'est dit convaincu que les inspections complètes pourraient prendre jusqu'à un an : "Nous avons des centaines de sites à visiter et de nombreux entretiens à mener, c'est un processus qui ne prendra pas fin dans un court laps de temps".

(à gauche) Hans Blix, chef des inspecteurs en désarmement (à droite) inspecteurs en désarmement de l'ONU
Parallèlement aux affirmations et aux rapports sur les méfaits du gouvernement irakien, Rumsfeld a annoncé l'envoi de milliers de marines au Koweït pour de prétendus exercices d'entraînement de routine.
Toutefois, le nombre de marines envoyés (près de 7 000) aurait triplé par rapport à l'année précédente, ce qui a suscité une couverture médiatique indiquant que les États-Unis se préparaient peut-être à la guerre. Lorsque le président Bush a obtenu sa première résolution de l'ONU et que les inspecteurs sont retournés en Irak, il s'est à nouveau attaché à convaincre le Congrès d'adopter une résolution donnant au président l'autorité nécessaire pour entreprendre une action militaire en cas de besoin. Bien que la résolution de l'ONU ait facilité la tâche du Congrès, elle restait controversée pour la plupart des démocrates, qui étaient sceptiques quant aux affirmations de la Maison Blanche selon lesquelles une résolution était destinée à des objectifs purement diplomatiques et non militaires, ainsi qu'aux affirmations concernant les capacités de l'Irak en matière d'armes de destruction massive (ADM). Nombre d'entre eux ont insisté pour voir les preuves par eux-mêmes avant de décider d'accorder ou non l'autorisation au président. Les agences de renseignement américaines étaient réticentes à fournir de telles informations en raison d'un conflit interne sur la solidité de ces renseignements.
Lorsque la commission sénatoriale du renseignement a demandé au directeur de la CIA, George Tenet, de lui fournir une évaluation de la CIA, il a refusé de le faire. Le sénateur Bob Graham, président de la commission, a été stupéfait : "Cela allait être l'un des votes les plus importants depuis longtemps, nous ne voulions pas voler à l'aveuglette, nous avons dit clairement que nous ne pouvions pas voter si nous ne savions pas dans quoi nous nous engagions".
Le président avait besoin d'obtenir des votes, il savait que s'il ne parvenait pas à rallier le Congrès à sa cause, cela perturberait gravement toute coalition et nuirait à tout effort de guerre potentiel, même s'il était certain qu'en tant que président, il pouvait agir seul, il était déterminé à faire en sorte qu'il n'ait pas à le faire, et il a commencé à faire personnellement pression sur les sénateurs et le public pour qu'ils aillent dans son sens sur cette question. "Si vous voulez maintenir la paix, vous devez avoir l'autorisation d'utiliser la force. Mais c'est - ce sera - c'est une chance pour le Congrès d'indiquer son soutien. C'est l'occasion pour le Congrès de dire qu'il soutient la capacité de l'administration à maintenir la paix. C'est de cela qu'il s'agit". Alors que le ton du président était toujours celui d'un diplomate en chef soutenant qu'une résolution de force donnerait aux États-Unis une plus grande liberté dans les négociations, d'autres membres de l'administration se sont montrés plus directs dans leur persuasion, le vice-président Cheney, lors d'un discours devant un groupe de réflexion conservateur, s'est dit sceptique à l'égard de toute proposition de l'ONU : "Il s'agit d'une menace émergente. Et nous aimerions avoir le soutien de la communauté internationale et du Congrès pour aller de l'avant. Toute suggestion selon laquelle il suffirait de faire revenir les inspecteurs en Irak pour que nos soucis disparaissent est erronée ... Le retour des inspecteurs n'apporterait aucune garantie quant au respect des résolutions de l'ONU ... nous ne pouvons pas remettre Saddam dans sa boîte".

Le président Bush et le vice-président Cheney
Les efforts de l'administration ont permis de rallier la grande majorité des républicains, même ceux qui avaient des doutes étaient prêts à faire confiance à la Maison Blanche et à soutenir une vaste résolution contre l'Irak, mais les démocrates restaient généralement opposés à cette idée, à moins qu'on ne leur présente des preuves. Après trois semaines de négociations, la Maison Blanche a finalement cédé et Tenet a accepté de présenter à la commission du renseignement une évaluation des renseignements nationaux (NIE) sur les armes de destruction massive de l'Irak. C'était la mission que George Tenet redoutait, lui qui était un chef de la CIA passionné, désireux de combler le fossé entre le président et la communauté du renseignement (une relation parfois conflictuelle). Il considérait son rôle comme celui d'un bureaucrate serviable, chargé d'aider le président d'un point de vue neutre. Il s'en est bien acquitté, parvenant à conserver son poste depuis l'administration Clinton jusqu'à celle de Bush, un miracle dans ce Washington. Cela lui a valu mépris et louanges : ce que certains considéraient comme un béni-oui-oui du président, il le considérait comme la "chaîne de commandement". Mais Tenet prenait progressivement conscience du nouveau rôle que la Maison-Blanche était en train de se tailler, et de ce que le bureau du vice-président et le ministère de la Défense attendaient de lui : ils voulaient promouvoir des renseignements spécifiques, éventuellement erronés, pour soutenir leur politique sur l'Irak.
John Brennan, alors adjoint de Tenet, a expliqué plus tard sa propre frustration : "En répondant aux demandes de la Colline concernant ce rapport national de renseignement dans un délai très court et un calendrier très serré pour faire quelque chose d'aussi important, on craignait que le renseignement ne soit présenté comme une justification de la guerre. ...". La Maison Blanche a mis la CIA dans une position où elle pouvait finir par embarrasser l'administration, l'agence ou les deux, car la vérité est que la CIA ne disposait que de très peu d'informations solides sur l'Irak à partir de 1998. Ce dont elle disposait était un mélange d'informations peu fiables, non confirmées ou inintelligibles. Cela aurait été clair pour quiconque aurait pu lire un tel rapport. Cela ne satisferait pas non plus la Maison Blanche ou le Congrès. Il a dû faire des choix difficiles, mais il a finalement décidé d'éliminer autant de renseignements douteux que possible pour le bien de l'agence[2].
L'estimation nationale du renseignement a laissé beaucoup de choses de côté : il n'a pas été fait mention de la manière dont une invasion américaine devrait se dérouler ni des conséquences possibles d'une invasion, Tenet ayant déclaré que ces questions dépassaient largement le champ d'action des agences de renseignement. Il n'a pas non plus été question d'armes biologiques, la CIA n'ayant pas été en mesure de corroborer les affirmations selon lesquelles l'Irak poursuivait son programme[3]. En ce qui concernait les armes chimiques, les preuves les plus solides étaient les stocks non comptabilisés de gaz moutarde, VX et sarin, ainsi que des milliers d'obus contenant des agents chimiques connus pour avoir été utilisés lors de la guerre Irak-Iran et du génocide kurde, et la CIA disposait de renseignements provenant de sources multiples selon lesquels Saddam cherchait à poursuivre les programmes chimiques et entretenait des liens avec des scientifiques irakiens spécialisés dans les armes chimiques[4]. [En ce qui concerne l'armement nucléaire, quelques pistes laissaient entendre que l'Irak avait tenté d'acheter des milliers de tubes d'aluminium susceptibles d'être utilisés pour des centrifugeuses nucléaires, mais le rapport montrait qu'il était plus probable qu'ils soient utilisés pour des missiles[5], il ne fixait pas de calendrier pour son programme nucléaire actuel, mais estimait que si rien n'était fait, l'Irak pourrait obtenir une arme nucléaire d'ici la fin de la décennie.
La NEI a conclu que le régime de Saddam maintenait un programme rudimentaire d'armes de destruction massive et n'avait pas rendu compte de toutes ses armes de destruction massive, contrairement aux résolutions de l'ONU, que l'Irak était probablement en possession d'armes chimiques et entretenait des scientifiques spécialisés dans l'armement, que ces armes pourraient être utilisées sur le champ de bataille, mais probablement pas dans le cadre d'une première frappe. Le NEI s'est montré particulièrement critique à l'égard des théories de Cheney sur les relations entre l'Irak et le terrorisme international, montrant qu'il n'avait pas été en mesure d'imputer au régime irakien le financement ou l'entraînement de terroristes, ce que le vice-président a pris comme une attaque personnelle, Cheney commentant plus tard le NEI et Tenet en le qualifiant de "peu sérieux et déshonorant ... ne voit-il pas ce que nous voyons ?

George Tenet, directeur de la CIA
Le rapport a été communiqué aux membres du Congrès. Pour lire le rapport, les membres du Congrès ont dû le lire dans une petite pièce, seuls pour des raisons de sécurité, mais certains ont critiqué cette mesure comme étant une tactique visant à dissuader les membres du Congrès de lire l'ensemble du document[6]. Le sénateur Graham, qui a demandé le rapport, a déclaré plus tard qu'il comprenait pourquoi la CIA avait hésité à le remettre : "Je pense que [Tenet] savait ce que c'était, c'était de la poudre aux yeux, il n'y avait rien de fondamentalement différent de ce qui existait auparavant". Le sénateur John McCain a déclaré qu'il n'y avait désormais "aucune place pour le doute" quant à la possession par Saddam d'armes de destruction massive, et le sénateur démocrate John Edwards (un vote clé pour le président) a déclaré que "les armes de destruction massive de Saddam constituaient une menace claire pour les alliés de l'Amérique". Mais Robert Byrd, le sénateur démocrate modéré de Virginie occidentale, a vu le contraire : "Il n'y a pas de nécessité ici, cela me dit que ce serait une guerre de choix".
Le président du Sénat, Tom Daschle, faisait partie des démocrates qui n'étaient pas impressionnés par les renseignements, déclarant que "ce rapport montrait qu'une étude plus approfondie était nécessaire", mais Daschle craignait en privé que l'obstruction d'une résolution de guerre ne se retourne contre eux, car la Maison Blanche ferait du foin politique pour avoir bloqué un projet de loi sur la sécurité nationale ; dans ce cas, plusieurs démocrates pourraient se joindre au président pour soutenir le projet et éviter cette association.
Au lieu de cela, M. Daschle a opté pour une troisième option entre le soutien et l'obstruction, une solution bipartisane. Développée par les sénateurs démocrate Joe Biden du Delaware et républicain Richard Lugar de l'Indiana, elle proposait une résolution en deux parties. Cette résolution en deux parties autoriserait le président à recourir à la force pour obtenir le démantèlement des armes de destruction massive de l'Irak, et non de l'Irak dans son ensemble, sous réserve de l'approbation du Conseil de sécurité des Nations unies. Si le président n'était pas en mesure d'obtenir l'approbation de l'ONU, il serait renvoyé au Congrès qui voterait la deuxième partie de la résolution pour autoriser le président à agir unilatéralement. Il s'agissait d'un projet de loi fourre-tout, qui couvrait ceux qui se concentraient sur la sécurité nationale, le désir d'obtenir un soutien international et de ne pas donner au président un "chèque en blanc", et qui a donc reçu le soutien de la direction démocrate. Le plan avait des détracteurs à gauche, des puristes de la paix qui insistaient pour voter contre la guerre à tout prix. Mais Biden a présenté le plan à ces démocrates de la manière suivante : "Si nous n'avons pas d'alternative, ils obtiendront les votes pour leur résolution". Le projet de loi Biden-Lugar a commencé à attirer le soutien de certains démocrates et républicains réticents et représentait une réelle menace pour la stratégie de la Maison Blanche.
Bush, qui voulait à tout prix faire échouer le projet de loi, s'est empressé de convaincre les dirigeants républicains en leur disant qu'il n'y avait "aucun sens à ce que le Congrès envoie une résolution plus faible" et que cela risquait de lui "lier les mains". Biden a répliqué aux critiques en déclarant : "Ce projet de loi se concentre sur notre principale préoccupation, les armes de destruction massive, et tous ceux qui affirment qu'il s'agit d'un pinaillage ou d'un geste symbolique sont tout simplement malhonnêtes". Lors d'une réunion avec Powell et Rice, le président Bush a subi les pressions des deux intéressés, qui ont fait valoir que le projet de loi Biden-Lugar lui permettrait d'atteindre ses objectifs. Powell a souligné que la stratégie américaine contre l'Irak consistait toujours à obtenir un soutien mondial et Rice a rencontré personnellement Biden et Lugar pour travailler sur la formulation du projet de loi afin qu'il corresponde mieux aux besoins de la Maison-Blanche. La proposition a suscité de vives tensions au sein de l'exécutif : pour les faucons, il constituait un recul considérable qui limiterait considérablement le recours à la force par l'administration (d'une manière que certains ont jugée inconstitutionnelle), même si aucune résolution ne valait mieux que cela.

(de gauche à droite) Colin Powell, secrétaire d'État, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale, Joe Biden et Richard Lugar, sénateurs.
Son chef de cabinet a poussé le président à rencontrer personnellement les sénateurs pour leur faire part de ses préoccupations, à savoir que toute résolution devait s'étendre à l'ensemble de l'Irak. "Je comprends qu'il y ait des désaccords, mais l'Irak est une menace et ne rien faire n'est pas une option, [Saddam Hussein] représente la plus grande menace pour les États-Unis, il veut une bombe nucléaire pour détruire Israël", a répondu Daschle, "Je pense que nous sommes préoccupés par le soutien, nous avons besoin que ces préoccupations soient prises en compte", Gephardt a acquiescé : "Nous sommes d'accord avec votre évaluation de Saddam Hussein, mais s'il ne s'agit pas d'armes de destruction massive, nous ne pouvons tout simplement pas le voir". Certains sénateurs se sont inquiétés de la capacité de l'armée américaine, Carl Levin, président de la commission des forces armées, a déclaré avoir reçu de "profondes inquiétudes" de la part d'officiers, notamment en ce qui concernait l'utilisation d'armes chimiques par Saddam, son cantonnement dans la "forteresse de Bagdad" ou une éventuelle insurrection baasiste post-Saddam. Le président a répliqué : "Ce serait bien qu'ils me fassent part de leurs préoccupations à moi plutôt qu'à un membre du Sénat". Lorsque les républicains du Congrès lui ont demandé de se concentrer davantage sur les violations des droits de l'homme en Irak, le président s'est montré émotif : "Je suis bien conscient, vous savez, ce type a essayé de tuer mon père !"
Certaines tentatives pour convaincre le Congrès ont échoué. Le secrétaire d'État Rumsfeld aurait fait un exposé antagoniste, à la limite du non-sens, d'une heure sur la menace de Saddam, se caricaturant lui-même en expliquant que "nous savons qu'il y a des choses que nous savons, nous savons qu'il y a des choses que nous ne savons pas", ce qui a joué en sa défaveur et n'a convaincu que certains démocrates de la circonspection de la Maison-Blanche, La sénatrice Feinstein, membre de la commission du renseignement, aurait conclu du briefing qu'"il n'y a pas de nouvelle preuve de la capacité nucléaire de Saddam" et qu'elle ne serait pas disposée à entrer en guerre, rejointe dans cette critique par plusieurs républicains.
"Nous voulons être avec vous", a finalement déclaré Don Nickles, sénateur de l'Oklahoma, à Rumsfeld. " Mais vous ne nous en donnez pas assez ". et d'autres tentatives de convaincre sont apparues comme trop musclées, comme le témoignage saisissant du Dr Bruce Ivins, expert en anthrax, sur le danger d'une attaque biologique contre les États-Unis, présenté au Congrès, qui a été critiqué pour son alarmisme et qui n'a pas réussi à convaincre ou à paniquer les Américains.
Le Congrès est resté bloqué sur la rédaction de la résolution jusqu'au mois d'août. Colin Powell et Condoleezza Rice ont travaillé d'arrache-pied pour modifier la résolution démocrate. Powell a mis le doigt sur le problème en déclarant que la menace d'une action unilatérale devait être présente : "nous devons défier [Saddam], espérons-le avec une résolution forte du Congrès, avec une résolution forte de l'ONU, pour le forcer à changer ses habitudes, à changer le comportement de ce régime, ou bien le régime devra être changé". Les républicains ont réussi à modifier le projet de loi Biden-Lugar pour soutenir une autorisation générale de recours à la force contre l'Irak dans l'attente du soutien des Nations unies, ce qui, en cas d'échec, déclencherait un second vote du Congrès pour autoriser une action unilatérale. Alors que le calendrier du président s'écoulait, le Congrès a voté une semaine plus tard, le dernier jour avant les vacances d'été, et a adopté la "Résolution d'autorisation de recours à la force militaire contre l'Irak" de 2003 ou "Résolution conjointe autorisant le recours aux forces armées des États-Unis conformément à l'action du Conseil de sécurité des Nations unies", à une large majorité : 82 voix au Sénat et 319 voix à la Chambre des représentants. Une fois de plus, la balle était dans le camp des Nations unies.
Tout au long de la crise du désarmement irakien, les sondages d'opinion ont beaucoup fluctué. Dès le début de l'opération Desert Badger, la cote de popularité du président Bush a augmenté de 10 points pour atteindre le milieu des 50 %, et une large majorité, les 3/4 des Américains, ont approuvé la campagne de bombardements. Mais l'approbation d'une invasion à plus grande échelle était plus délicate à cerner. Depuis 1992, les Américains étaient divisés sur la question d'une invasion visant à éliminer Saddam, la plupart des sondages oscillant entre 48 et 52 % de soutien à une guerre. L'opinion des Américains a évolué une fois que d'importantes mises en garde ont été ajoutées : s'il s'agissait d'une guerre longue ou si le nombre élevé de victimes évoquait des souvenirs du Viêt Nam, le soutien a chuté de façon spectaculaire et un tiers des Américains pensaient que l'appel sous les drapeaux serait rétabli dans un tel cas de figure. La plupart des Américains soutenaient les inspections en désarmement de l'ONU, mais restaient incertains quant à leur valeur réelle. 70 % d'entre eux pensaient que les États-Unis devraient attendre la fin des inspections. La moitié des Américains pensaient que Saddam avait des armes de destruction massive, mais la plupart d'entre eux, plus de 60 %, estimaient que l'administration n'en avait pas apporté la preuve. Au fur et à mesure que la bataille sur les résolutions du Conseil de sécurité et du Congrès s'éternisait, le soutien à la guerre a régulièrement diminué pour se situer entre 42% et 47% (ces chiffres ont encore baissé de 7% sans le soutien de l'ONU et de 8% sans l'approbation du Congrès). Au cours de cette période, la cote de popularité de Bush s'est stabilisée autour de 50 %.
L'opinion polarisée du pays a commencé à se refléter dans le public. Alors qu'il n'y avait qu'un seul manifestant devant la Maison Blanche le jour du début des frappes, et des centaines devant le siège des Nations unies à New York, un mouvement anti-guerre largement populaire s'est développé pendant quatre mois, entre juillet et septembre, lentement mais sûrement, avec quelques milliers de personnes à Washington ici, et quelques milliers à Chicago là, une opposition vocale s'est développée. Le mouvement n'était pas seulement national, le Royaume-Uni s'est rapidement doté d'un tel mouvement, aidé par l'opposition d'arrière-ban du parti travailliste au pouvoir, qui s'opposait à l'aide apportée aux États-Unis dans une guerre. Ces manifestations et marches ont pris de l'ampleur, atteignant parfois des centaines de milliers de personnes, tandis que les images des Américains combattant dans le Golfe et les discours du président Bush commençaient à disparaître des écrans de télévision, remplacés par des manifestations (dont certains se sont plaints qu'elles donnaient un poids excessif à la minorité protestataire). Très vite, les Américains se sont également divisés entre colombes et faucons[7].

Grandes manifestations à Washington, Chicago et Londres
La critique d'une guerre potentielle a été davantage mise en avant par l'opposition "professionnelle", en particulier par d'anciens inspecteurs en désarmement, des généraux, des diplomates et des hommes politiques. Ces personnalités de premier plan ont évoqué l'idée que l'administration déformait les faits ou ont déclaré qu'une guerre en Irak serait beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient. Scott Ritter, l'ancien responsable des inspections d'armement avant 1998, a déclaré que les armes irakiennes avaient été détruites à 95 % après la guerre du Golfe et que ce qui restait serait désormais totalement inutilisable. L'officier Brent Scowcroft (conseiller à la sécurité nationale de Bush père) a déclaré qu'une invasion américaine pourrait transformer le Moyen-Orient en un grand conflit israélo-palestinien, et l'ancien chef du commandement central Anthony Zinni a déclaré que l'Irak était loin d'être une priorité pour la défense de l'Amérique. L'ancien agent spécial du FBI, John P. O'Neill, a déclaré qu'une invasion de l'Irak aiderait considérablement les groupes terroristes anti-américains. Al Gore, désormais candidat à l'élection présidentielle, a également attaqué ouvertement la politique de Bush pour ses excès : "Mais regardez les différences entre la résolution votée en 1991 et celle que cette administration propose au Congrès de voter en 2002. Les circonstances sont vraiment complètement différentes".
Cette opposition s'est également manifestée au sein de l'administration : des dizaines de fuites ont montré une Maison Blanche qui se démenait pour agir et ont fait état de la désapprobation des militaires quant à la planification d'une telle opération et au manque de préparation ; des critiques assez explicites ont été formulées à l'encontre de Rumsfeld, selon lesquelles il sous-préparait massivement les forces américaines et a fait état d'un manque de moral dans les rangs des forces américaines.
Les médias ont réagi différemment : la presse écrite s'est montrée beaucoup plus ouvertement critique que la télévision, en particulier les chaînes câblées, mais la couverture, surtout lorsque le mouvement anti-guerre a pris de l'ampleur, a divisé les principales chaînes câblées. MSNBC, la chaîne la plus à gauche, a présenté d'éminents critiques anti-guerre tels que Phil Donahue, CNN a été la plus neutre et FOX a clairement soutenu la guerre et s'est montrée particulièrement critique à l'égard des manifestants pacifistes. Les critiques de la presse écrite à l'égard de la Maison Blanche et de ses sources de renseignement pouvaient être accablantes, notamment en ce qui concernait le Congrès national irakien en exil, accusé d'avoir fourni des informations trompeuses ou infondées à l'administration Bush et au Congrès lors de ses témoignages. Le scandale a également éclaboussé plusieurs partisans de la guerre en Irak qui défendaient le leader du CNI, Ahmed Chalabi, comme le secrétaire adjoint à la défense, Paul Wolfowitz, en exposant notamment les dossiers du département d'État qui le déclaraient "fraudeur condamné". Le célèbre journaliste du Washington Post, Bob Woodward, a écrit un article très critique qui démontait la thèse de la Maison Blanche sur les armes de destruction massive, simplement intitulé "Where is the smoking gun ?
Les intellectuels et chroniqueurs américains ont vivement débattu des positions pro-guerre et anti-guerre et de la moralité de l'interventionnisme. La libérale Arianna Huffington a critiqué la position pro-guerre en demandant : "Je me demande comment les gens répondraient à la question de savoir combien de housses mortuaires américaines ils sont prêts à accepter pour se débarrasser de Saddam Hussein", s'opposant à Christopher Hitchens : "Dans ces conditions, il n'y a aucune circonstance dans laquelle une intervention militaire en Irak pourrait être justifiée. Quelqu'un pourrait être tué. Mais encore une fois, un homme si profondément engagé dans le mouvement Habitat pour l'humanité pourrait se demander de quel genre d'habitat il s'agit, où les civils sont utilisés comme boucliers humains"[8].

Les opposants à la guerre en Irak, (de gauche à droite) l'ancien inspecteur en désarmement Scott Ritter, le général Anthony Zinni, l'ancien vice-président Al Gore, le journaliste Bob Woodward et la chroniqueuse Arianna Huffington.
Personne ne savait exactement ce qu'il était possible de faire sur le plan diplomatique pendant que les inspections se poursuivaient, mais pour satisfaire à l'exigence du Congrès concernant la deuxième résolution, il fallait essayer. L'administration a donc monté son dossier. Une réunion dans le bureau ovale a été organisée pour permettre à la CIA de présenter ses preuves au président. Bush, Rice, Card et Cheney étaient présents et ont présenté un diaporama de toutes les violations présumées par l'Irak des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris le programme de drones de Saddam, les missiles restants, les armes chimiques non comptabilisées et les rapports selon lesquels Saddam tenait toujours des réunions avec des scientifiques nucléaires. A la fin de la présentation, il était clair que le président n'était pas convaincu : "Bien essayé, mais je ne pense pas que le public puisse comprendre". Il s'est tourné vers Tenet et lui a demandé : "On m'a fourni toutes les preuves concernant les armes de destruction massive et c'est le mieux que nous ayons ?". Tenet, qui a assisté à la présentation de la CIA, répond cordialement : "Voilà ce que nous avons, c'est à prendre ou à laisser"[9]. Le président réfléchit un instant : "Il faut encore beaucoup de travail", puis il ajoute : "Mais ne l'étirez pas, je ne veux pas qu'on l'étire, contentez-vous des faits"[10].
Si vendre le dossier à la Maison Blanche était difficile, l'U.N.S.C. était à un autre niveau. Powell travaillait jour et nuit pour négocier avec les autres membres du Conseil afin d'obtenir leur vote. Certains considéraient déjà qu'il s'agissait d'une cause perdue, Cheney qualifiait le Conseil d'"entreprise d'inspection" et n'appréciait pas du tout d'être pris en otage par le Congrès. Mais Powell s'est fortement engagé à obtenir le soutien des Nations unies, qu'il considérait comme essentiel pour légitimer toute action militaire et aider un éventuel Irak post-Saddam.
Le Premier ministre Blair, partisan de longue date de la destitution de Saddam Hussein, était confronté à une descente considérable au sein de son propre parti et espérait un mandat des Nations unies pour consolider son soutien. Il en va de même pour le deuxième allié le plus solide des États-Unis à ce jour, l'Australie, dont le premier ministre Kim Beazley a déclaré à Bush qu'il ne pourrait pas participer à un conflit sans le soutien des Nations unies, confiant que son propre parti pourrait le démettre de ses fonctions. Le Premier ministre italien, M. Berlusconi, a également hésité à soutenir un vote de l'ONU à la suite d'une forte opposition du Parlement et de l'opinion publique.
L'administration s'est efforcée d'obtenir un soutien en faveur d'une résolution militaire. Powell pensait pouvoir réunir les neuf voix nécessaires : le Mexique, l'Espagne, l'Allemagne, la Bulgarie, le Cameroun, la Guinée et l'Angola, associés aux membres permanents que sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, constitueraient la majorité, mais la question se posait de savoir si les autres membres permanents, la France, la Russie ou la Chine, opposeraient leur veto à la décision. Les trois pays ont fermement soutenu la poursuite des inspections, la Chine a exhorté à "utiliser tous les moyens possibles pour éviter la guerre", la Russie a souligné les déclarations de Blix affirmant que les inspections fonctionnaient, "il y a un mouvement dans la bonne direction", et la France a maintenu une ligne ferme pour donner aux inspections ce qu'elles méritaient, le ministre des affaires étrangères Hubert Vedrine (un critique connu de l'hégémonie américaine qui a popularisé le terme d'hyperpuissance) a déclaré "il est dans l'intérêt de tous que l'Irak soit autorisé à voir la lumière au bout du tunnel" donnant à l'Irak la possibilité de se conformer à la décision. Bien qu'aucun ne l'ait explicité[11], il est apparu clairement qu'un effort immédiat en faveur d'une résolution serait probablement voué à l'échec.

Le Premier ministre britannique Tony Blair, le Premier ministre australien Kim Beazley et le Premier ministre italien Silvio Berlusconi.
Un mois après le début des négociations à l'ONU, le président s'est senti frustré : "Il trompe les inspecteurs, il trompe l'ONU et il trompe le monde, je l'ai déjà dit et je le répète, si Saddam Hussein n'est pas traduit en justice par la communauté internationale, les États-Unis doivent être prêts à agir unilatéralement". Il était furieux d'apprendre que les inspecteurs étaient menés par le bout du nez par des gardes irakiens souriants : "Bien sûr qu'ils ne trouvaient rien, Saddam Hussein le cachait !" Hans Blix a remis son premier rapport le 27 août, détaillant la recherche d'armes en Irak. Le thème était que l'Irak s'était montré peu enthousiaste à l'égard des inspections, leur permettant un accès total à tous les sites, bien qu'il y ait eu des rapports d'intimidation et que certains Irakiens ne se soient pas soumis à des entretiens, mais la conclusion était relativement positive, Blix rapportant également qu'aucune ADM n'avait été trouvée. Saddam a également fait une apparition publique, déclarant qu'il autorisait les inspecteurs à entrer dans le pays afin de contrecarrer les affirmations des États-Unis. Certains à la Maison Blanche ont pris la confiance grandissante de Saddam pour une insulte et ont blâmé publiquement Blix et l'ONU. Le secrétaire de presse Fleischer a qualifié le rapport d'insignifiant et s'est moqué de l'équipe chargée de l'armement : "Le problème avec les armes cachées, c'est qu'on ne peut pas voir leur fumée".
L'administration n'est parvenue à convaincre aucun des membres permanents - ni la France, ni la Russie, ni la Chine ne voulaient concéder une intervention pendant la durée des inspections - et plusieurs autres membres non permanents ont commencé à hésiter, le Cameroun s'est rangé derrière la France, le président mexicain Vincente Fox a laissé entendre que son pays pourrait s'abstenir et le chancelier allemand Stoiber (qui avait besoin de maintenir une alliance avec les libéraux centristes) a commencé à prôner la modération. La Maison Blanche a commencé à s'inquiéter du calendrier des opérations militaires qui pourraient débuter en novembre, et a poussé Powell à conclure aux Nations Unies afin de pouvoir retourner au Congrès et dire que les Nations Unies refusaient d'agir. Mais Powell avait du mal à abandonner la voie diplomatique, il reconnaissait qu'il n'y avait pas de preuve irréfutable, et même s'il partageait l'enthousiasme pour "se débarrasser de ce salaud de Saddam", il voyait bien que les choses n'allaient pas bien, que Rumsfeld envoyait beaucoup trop peu de troupes et sous-estimait grandement le niveau de résistance auquel elles étaient susceptibles d'être confrontées, que l'opinion publique n'était pas unie derrière eux et qu'il y avait trop peu d'alliés à leurs côtés. Powell ne cessait d'être confronté aux doutes des militaires et des diplomates et commençait à se lasser de devoir les rassurer en permanence. Le bureau du vice-président et le ministère de la défense lui demandaient à présent de présenter des renseignements manifestement erronés: un projet de discours émanant du bureau de Cheney contenait des informations déjà réfutées.
Il avait acquis une grande influence politique en tant que secrétaire d'État, et son code de soldat l'obligeait à ne pas trahir le président, ce qui aurait été un acte de déloyauté inimaginable. Avec la plus grande déférence possible, il a demandé au président ce qu'il attendait de lui aux Nations unies. Il a passé en revue les différentes options possibles et, sans jamais critiquer, il a demandé si la diplomatie était toujours d'actualité. Il a réaffirmé qu'il soutiendrait le président quelle que soit sa décision, mais il a laissé au président son opinion claire : "si vous envoyez des jeunes hommes et des jeunes femmes au péril de leur vie, vous devez avoir un objectif politique clair"[12].

Le chancelier allemand Edmund Stoiber, le président mexicain Vincente Fox et le secrétaire d'État Powell à l'ONU.
Le président se trouvait dans une impasse : le commandement central avait repoussé de novembre à décembre la date de début de l'action militaire, la Turquie, la Jordanie et l'Arabie saoudite refusaient l'utilisation de leur territoire pour une invasion terrestre, et les Nations unies n'étaient pas encore parvenues à s'entendre. Le président savait également qu'il se trouvait en eaux troubles dans son pays, les démocrates disposant désormais des voix nécessaires pour faire obstruction à une résolution de guerre (le décompte actuel était de 47 voix pour le non au Sénat[13]). Plusieurs facteurs entraient en ligne de compte : le mouvement anti-guerre grandissant, le manque d'alliés solides, les inspections d'armement en cours dont certains disaient qu'elles ne devaient pas être interrompues (un processus qui pourrait prendre des mois comme l'avait prédit Blix), l'absence de décision ferme du Conseil de sécurité, ainsi que l'élection présidentielle de 2004 qui prenait de plus en plus d'ampleur et donnait à beaucoup de gens une bonne raison de s'opposer à l'administration. Mais la décision a été prise pour lui lorsque le leader du Sénat, M. Daschle, a déclaré : "Ce n'est pas parce que le président a lamentablement échoué sur le plan diplomatique que les États-Unis doivent entrer en guerre. Se précipiter dans une guerre sans se préoccuper suffisamment des ramifications d'une action unilatérale, avec une très petite coalition, sans un soutien suffisant, serait prématuré ... cette guerre n'est pas inévitable".
Le président pourrait tenter de forcer la main du Sénat en proposant un vote pour que les démocrates signent leur refus, mais lorsque quelques démocrates de premier plan ont fait part de leurs critiques, il est apparu clairement que les lignes de combat étaient tracées et que, sauf changement de circonstances, une résolution du Congrès n'était pas à l'ordre du jour, les tambours de guerre semblaient s'estomper.
Si nous permettons au président Bush de commencer une guerre sans l'approbation du Congrès, cela nous hantera pendant des années, nous ne pouvons pas partir en guerre simplement parce que le président fixe une date limite irréaliste" - Ted Kennedy
"Sommes-nous censés partir en guerre simplement parce qu'un homme - le président - prend une série de décisions unilatérales qui nous mettent dans une boîte, une boîte qui rend la guerre, dans une plus large mesure, inévitable ?" - John Kerry
"Il ne fait aucun doute qu'en ce qui concerne l'Irak, nous avons un problème réel et croissant. Mais je crois aussi que nous avons le temps de traiter ce problème d'une manière qui isole Saddam et n'isole pas les États-Unis d'Amérique, qui fait du recours à la force la dernière option, et non la première. - Joe Biden
"Si nous devions attaquer l'Irak maintenant, seuls ou avec peu d'alliés, cela créerait un précédent qui pourrait revenir nous hanter. Ces derniers jours, la Russie a parlé d'une invasion de la Géorgie pour attaquer les rebelles tchétchènes. Nous avons déjà critiqué l'Inde pour son attaque préventive contre le Pakistan. Et que se passerait-il si la Chine percevait une menace en provenance de Taïwan ? Ainsi, malgré tout son attrait, une attaque unilatérale devrait être exclue" - Hillary Clinton
"Le désarmement de l'Irak de Saddam Hussein est nécessaire et vital pour la sécurité de l'Amérique, du golfe Persique et du Moyen-Orient, cela ne fait aucun doute. Mais je reste très préoccupé par le fait que certains membres de l'administration cherchent à utiliser une autorisation pour lancer une attaque unilatérale et préventive contre l'Irak. Je pense que ce serait une terrible erreur". - Diane Feinstein
"J'ai vu le tribut que la guerre peut prélever sur nos troupes et sur les membres sur le champ de bataille. La meilleure façon de soutenir les troupes est de ne jamais les envoyer à la guerre. Ensuite, s'ils partent en guerre, il faut s'assurer que cela en vaut la peine. C'est la deuxième meilleure façon de soutenir les troupes, afin qu'elles n'aient pas à s'inquiéter de l'accueil qu'elles recevront à leur retour". - Max Cleland

Les sénateurs démocrates Ted Kennedy, John Kerry, Joe Biden, Hillary Clinton, Diane Feinstein et Max Cleland se sont tous opposés à la décision du Président.
[1] Les photographies de cercueils militaires américains ont été censurées à l'époque.
[2] Après le 11 septembre, la CIA a fait l'objet de nombreuses critiques et Tenet a considéré qu'il était de son devoir de protéger l'agence. Pour ce faire, il s'est rapproché du président, ce qui ne me surprendrait pas si cela avait une incidence sur sa gestion des renseignements irakiens.
[3] Tous les renseignements sur les armes biologiques étaient des rumeurs de seconde main.
[4] Les stocks non comptabilisés constituaient probablement la meilleure preuve que Saddam les possédait encore, si l'on peut appeler "preuve" l'absence de preuve.
[5] Les tubes d'aluminium et le yellow cake (qui est totalement ignoré par l'ITTL) étaient les seules preuves que Saddam essayait de fabriquer des armes nucléaires, à l'exception de certains sites qui, selon le ministère de la défense, pourraient être utilisés pour des centrifugeuses.
[6] Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup n'y ont pas cru.
[7] La grande différence est que le mouvement en faveur de la guerre et le chauvinisme sont nettement moins présents dans notre chronologie.
[8] Le New York Times et le Washington Post ont si mal couvert l'événement qu'ils se sont excusés en 2004. La guerre contre le terrorisme et le 11 septembre ont sérieusement affecté l'objectivité des journalistes.
[9] Tenet a fameusement qualifié les preuves de "slam dunk". Puisque le 11 septembre a été un échec à ne pas prendre les informations au sérieux, la guerre en Irak a été un échec à amplifier les renseignements
[10] Bush, comme la plupart des gens, pensait qu'il y avait des armes de destruction massive, mais ce n'était pas sa principale motivation pour poursuivre Saddam. Les armes de destruction massive semblaient juste être la motivation la plus évidente.
[11) Sans un veto ferme de Chirac, le processus de l'ONU n'est pas exclu. De plus, il n'y a pas de francophobie aux Etats-Unis ni de frites de la liberté.
[12] Powell n'a cessé de répéter que son discours à l'ONU était une tache dans son dossier, il reste plus prudent et la Maison Blanche a besoin de sauver les apparences.
[13] Je dispose d'un décompte rudimentaire des votes si quelqu'un souhaite savoir comment certains sénateurs auraient voté.
1]
Le cercueil d'un soldat américain ramené aux États-Unis
Les cercueils contenant deux Américains décédés ont été renvoyés aux États-Unis en juillet 2003. Cette sombre scène a constitué un moment macabre et curieux de l'histoire. De l'extérieur, on pouvait croire que le monde s'était éloigné du bord de la falaise. L'appel du président George Bush à la diplomatie et aux négociations, la lettre de Saddam Hussein acceptant les pourparlers avec l'ONU et la fin des bombardements américains dans le centre de l'Irak, tout cela a culminé avec la réadmission des inspecteurs en désarmement de l'ONU. C'était comme si un coup d'État diplomatique avait eu lieu, que toutes les manœuvres et les stratégies avaient peut-être réussi et que les États-Unis avaient remis l'Irak dans sa boîte, pour reprendre l'expression de Colin Powell. Mais les célébrations sont restées discrètes à la Maison Blanche, et tout le monde pouvait encore entendre le battement régulier des tambours de guerre.
Alors que le pouvoir exécutif continuait à faire pression sur les membres du Congrès, les délégués internationaux et le grand public sur la possibilité (et la nécessité potentielle) d'un nouveau conflit, le secrétaire d'État Rumsfeld a déclaré : "Depuis la guerre du Golfe persique, l'Irak a accepté une série d'engagements de l'ONU et n'a pas respecté chacun d'entre eux ; je ne vois pas quelle sera la différence aujourd'hui". Ou, comme l'a dit le secrétaire de presse Ari Fleischer, "leurs paroles changent après un mois d'attaques, et leur armée a été décimée, mais leurs actions ne changent pas". Même avant le retour officiel des inspecteurs en Irak, la route était semée d'embûches : les destructions causées par l'opération américaine "Desert Badger" comprenaient le bombardement d'éventuels sites de production ou de stockage d'armes de destruction massive, ce qui laissait supposer que si de telles installations avaient existé, elles étaient déjà ensevelies sous des centaines de tonnes de décombres. Washington craignait, en public comme en privé, qu'un long délai ne repousse considérablement le calendrier militaire et ne donne à Saddam Hussein la possibilité de tromper les inspecteurs ou de s'immiscer dans les inspections, ou encore de mieux se préparer à un conflit avec les États-Unis, tandis que l'Irak craignait que des inspections de longue haleine ne soient utilisées pour espionner le régime ou s'immiscer dans ses affaires.
Malheureusement pour les deux, l'inspecteur en chef Hans Blix s'est dit convaincu que les inspections complètes pourraient prendre jusqu'à un an : "Nous avons des centaines de sites à visiter et de nombreux entretiens à mener, c'est un processus qui ne prendra pas fin dans un court laps de temps".
(à gauche) Hans Blix, chef des inspecteurs en désarmement (à droite) inspecteurs en désarmement de l'ONU
Parallèlement aux affirmations et aux rapports sur les méfaits du gouvernement irakien, Rumsfeld a annoncé l'envoi de milliers de marines au Koweït pour de prétendus exercices d'entraînement de routine.
Toutefois, le nombre de marines envoyés (près de 7 000) aurait triplé par rapport à l'année précédente, ce qui a suscité une couverture médiatique indiquant que les États-Unis se préparaient peut-être à la guerre. Lorsque le président Bush a obtenu sa première résolution de l'ONU et que les inspecteurs sont retournés en Irak, il s'est à nouveau attaché à convaincre le Congrès d'adopter une résolution donnant au président l'autorité nécessaire pour entreprendre une action militaire en cas de besoin. Bien que la résolution de l'ONU ait facilité la tâche du Congrès, elle restait controversée pour la plupart des démocrates, qui étaient sceptiques quant aux affirmations de la Maison Blanche selon lesquelles une résolution était destinée à des objectifs purement diplomatiques et non militaires, ainsi qu'aux affirmations concernant les capacités de l'Irak en matière d'armes de destruction massive (ADM). Nombre d'entre eux ont insisté pour voir les preuves par eux-mêmes avant de décider d'accorder ou non l'autorisation au président. Les agences de renseignement américaines étaient réticentes à fournir de telles informations en raison d'un conflit interne sur la solidité de ces renseignements.
Lorsque la commission sénatoriale du renseignement a demandé au directeur de la CIA, George Tenet, de lui fournir une évaluation de la CIA, il a refusé de le faire. Le sénateur Bob Graham, président de la commission, a été stupéfait : "Cela allait être l'un des votes les plus importants depuis longtemps, nous ne voulions pas voler à l'aveuglette, nous avons dit clairement que nous ne pouvions pas voter si nous ne savions pas dans quoi nous nous engagions".
Le président avait besoin d'obtenir des votes, il savait que s'il ne parvenait pas à rallier le Congrès à sa cause, cela perturberait gravement toute coalition et nuirait à tout effort de guerre potentiel, même s'il était certain qu'en tant que président, il pouvait agir seul, il était déterminé à faire en sorte qu'il n'ait pas à le faire, et il a commencé à faire personnellement pression sur les sénateurs et le public pour qu'ils aillent dans son sens sur cette question. "Si vous voulez maintenir la paix, vous devez avoir l'autorisation d'utiliser la force. Mais c'est - ce sera - c'est une chance pour le Congrès d'indiquer son soutien. C'est l'occasion pour le Congrès de dire qu'il soutient la capacité de l'administration à maintenir la paix. C'est de cela qu'il s'agit". Alors que le ton du président était toujours celui d'un diplomate en chef soutenant qu'une résolution de force donnerait aux États-Unis une plus grande liberté dans les négociations, d'autres membres de l'administration se sont montrés plus directs dans leur persuasion, le vice-président Cheney, lors d'un discours devant un groupe de réflexion conservateur, s'est dit sceptique à l'égard de toute proposition de l'ONU : "Il s'agit d'une menace émergente. Et nous aimerions avoir le soutien de la communauté internationale et du Congrès pour aller de l'avant. Toute suggestion selon laquelle il suffirait de faire revenir les inspecteurs en Irak pour que nos soucis disparaissent est erronée ... Le retour des inspecteurs n'apporterait aucune garantie quant au respect des résolutions de l'ONU ... nous ne pouvons pas remettre Saddam dans sa boîte".
Le président Bush et le vice-président Cheney
Les efforts de l'administration ont permis de rallier la grande majorité des républicains, même ceux qui avaient des doutes étaient prêts à faire confiance à la Maison Blanche et à soutenir une vaste résolution contre l'Irak, mais les démocrates restaient généralement opposés à cette idée, à moins qu'on ne leur présente des preuves. Après trois semaines de négociations, la Maison Blanche a finalement cédé et Tenet a accepté de présenter à la commission du renseignement une évaluation des renseignements nationaux (NIE) sur les armes de destruction massive de l'Irak. C'était la mission que George Tenet redoutait, lui qui était un chef de la CIA passionné, désireux de combler le fossé entre le président et la communauté du renseignement (une relation parfois conflictuelle). Il considérait son rôle comme celui d'un bureaucrate serviable, chargé d'aider le président d'un point de vue neutre. Il s'en est bien acquitté, parvenant à conserver son poste depuis l'administration Clinton jusqu'à celle de Bush, un miracle dans ce Washington. Cela lui a valu mépris et louanges : ce que certains considéraient comme un béni-oui-oui du président, il le considérait comme la "chaîne de commandement". Mais Tenet prenait progressivement conscience du nouveau rôle que la Maison-Blanche était en train de se tailler, et de ce que le bureau du vice-président et le ministère de la Défense attendaient de lui : ils voulaient promouvoir des renseignements spécifiques, éventuellement erronés, pour soutenir leur politique sur l'Irak.
John Brennan, alors adjoint de Tenet, a expliqué plus tard sa propre frustration : "En répondant aux demandes de la Colline concernant ce rapport national de renseignement dans un délai très court et un calendrier très serré pour faire quelque chose d'aussi important, on craignait que le renseignement ne soit présenté comme une justification de la guerre. ...". La Maison Blanche a mis la CIA dans une position où elle pouvait finir par embarrasser l'administration, l'agence ou les deux, car la vérité est que la CIA ne disposait que de très peu d'informations solides sur l'Irak à partir de 1998. Ce dont elle disposait était un mélange d'informations peu fiables, non confirmées ou inintelligibles. Cela aurait été clair pour quiconque aurait pu lire un tel rapport. Cela ne satisferait pas non plus la Maison Blanche ou le Congrès. Il a dû faire des choix difficiles, mais il a finalement décidé d'éliminer autant de renseignements douteux que possible pour le bien de l'agence[2].
L'estimation nationale du renseignement a laissé beaucoup de choses de côté : il n'a pas été fait mention de la manière dont une invasion américaine devrait se dérouler ni des conséquences possibles d'une invasion, Tenet ayant déclaré que ces questions dépassaient largement le champ d'action des agences de renseignement. Il n'a pas non plus été question d'armes biologiques, la CIA n'ayant pas été en mesure de corroborer les affirmations selon lesquelles l'Irak poursuivait son programme[3]. En ce qui concernait les armes chimiques, les preuves les plus solides étaient les stocks non comptabilisés de gaz moutarde, VX et sarin, ainsi que des milliers d'obus contenant des agents chimiques connus pour avoir été utilisés lors de la guerre Irak-Iran et du génocide kurde, et la CIA disposait de renseignements provenant de sources multiples selon lesquels Saddam cherchait à poursuivre les programmes chimiques et entretenait des liens avec des scientifiques irakiens spécialisés dans les armes chimiques[4]. [En ce qui concerne l'armement nucléaire, quelques pistes laissaient entendre que l'Irak avait tenté d'acheter des milliers de tubes d'aluminium susceptibles d'être utilisés pour des centrifugeuses nucléaires, mais le rapport montrait qu'il était plus probable qu'ils soient utilisés pour des missiles[5], il ne fixait pas de calendrier pour son programme nucléaire actuel, mais estimait que si rien n'était fait, l'Irak pourrait obtenir une arme nucléaire d'ici la fin de la décennie.
La NEI a conclu que le régime de Saddam maintenait un programme rudimentaire d'armes de destruction massive et n'avait pas rendu compte de toutes ses armes de destruction massive, contrairement aux résolutions de l'ONU, que l'Irak était probablement en possession d'armes chimiques et entretenait des scientifiques spécialisés dans l'armement, que ces armes pourraient être utilisées sur le champ de bataille, mais probablement pas dans le cadre d'une première frappe. Le NEI s'est montré particulièrement critique à l'égard des théories de Cheney sur les relations entre l'Irak et le terrorisme international, montrant qu'il n'avait pas été en mesure d'imputer au régime irakien le financement ou l'entraînement de terroristes, ce que le vice-président a pris comme une attaque personnelle, Cheney commentant plus tard le NEI et Tenet en le qualifiant de "peu sérieux et déshonorant ... ne voit-il pas ce que nous voyons ?
George Tenet, directeur de la CIA
Le rapport a été communiqué aux membres du Congrès. Pour lire le rapport, les membres du Congrès ont dû le lire dans une petite pièce, seuls pour des raisons de sécurité, mais certains ont critiqué cette mesure comme étant une tactique visant à dissuader les membres du Congrès de lire l'ensemble du document[6]. Le sénateur Graham, qui a demandé le rapport, a déclaré plus tard qu'il comprenait pourquoi la CIA avait hésité à le remettre : "Je pense que [Tenet] savait ce que c'était, c'était de la poudre aux yeux, il n'y avait rien de fondamentalement différent de ce qui existait auparavant". Le sénateur John McCain a déclaré qu'il n'y avait désormais "aucune place pour le doute" quant à la possession par Saddam d'armes de destruction massive, et le sénateur démocrate John Edwards (un vote clé pour le président) a déclaré que "les armes de destruction massive de Saddam constituaient une menace claire pour les alliés de l'Amérique". Mais Robert Byrd, le sénateur démocrate modéré de Virginie occidentale, a vu le contraire : "Il n'y a pas de nécessité ici, cela me dit que ce serait une guerre de choix".
Le président du Sénat, Tom Daschle, faisait partie des démocrates qui n'étaient pas impressionnés par les renseignements, déclarant que "ce rapport montrait qu'une étude plus approfondie était nécessaire", mais Daschle craignait en privé que l'obstruction d'une résolution de guerre ne se retourne contre eux, car la Maison Blanche ferait du foin politique pour avoir bloqué un projet de loi sur la sécurité nationale ; dans ce cas, plusieurs démocrates pourraient se joindre au président pour soutenir le projet et éviter cette association.
Au lieu de cela, M. Daschle a opté pour une troisième option entre le soutien et l'obstruction, une solution bipartisane. Développée par les sénateurs démocrate Joe Biden du Delaware et républicain Richard Lugar de l'Indiana, elle proposait une résolution en deux parties. Cette résolution en deux parties autoriserait le président à recourir à la force pour obtenir le démantèlement des armes de destruction massive de l'Irak, et non de l'Irak dans son ensemble, sous réserve de l'approbation du Conseil de sécurité des Nations unies. Si le président n'était pas en mesure d'obtenir l'approbation de l'ONU, il serait renvoyé au Congrès qui voterait la deuxième partie de la résolution pour autoriser le président à agir unilatéralement. Il s'agissait d'un projet de loi fourre-tout, qui couvrait ceux qui se concentraient sur la sécurité nationale, le désir d'obtenir un soutien international et de ne pas donner au président un "chèque en blanc", et qui a donc reçu le soutien de la direction démocrate. Le plan avait des détracteurs à gauche, des puristes de la paix qui insistaient pour voter contre la guerre à tout prix. Mais Biden a présenté le plan à ces démocrates de la manière suivante : "Si nous n'avons pas d'alternative, ils obtiendront les votes pour leur résolution". Le projet de loi Biden-Lugar a commencé à attirer le soutien de certains démocrates et républicains réticents et représentait une réelle menace pour la stratégie de la Maison Blanche.
Bush, qui voulait à tout prix faire échouer le projet de loi, s'est empressé de convaincre les dirigeants républicains en leur disant qu'il n'y avait "aucun sens à ce que le Congrès envoie une résolution plus faible" et que cela risquait de lui "lier les mains". Biden a répliqué aux critiques en déclarant : "Ce projet de loi se concentre sur notre principale préoccupation, les armes de destruction massive, et tous ceux qui affirment qu'il s'agit d'un pinaillage ou d'un geste symbolique sont tout simplement malhonnêtes". Lors d'une réunion avec Powell et Rice, le président Bush a subi les pressions des deux intéressés, qui ont fait valoir que le projet de loi Biden-Lugar lui permettrait d'atteindre ses objectifs. Powell a souligné que la stratégie américaine contre l'Irak consistait toujours à obtenir un soutien mondial et Rice a rencontré personnellement Biden et Lugar pour travailler sur la formulation du projet de loi afin qu'il corresponde mieux aux besoins de la Maison-Blanche. La proposition a suscité de vives tensions au sein de l'exécutif : pour les faucons, il constituait un recul considérable qui limiterait considérablement le recours à la force par l'administration (d'une manière que certains ont jugée inconstitutionnelle), même si aucune résolution ne valait mieux que cela.
(de gauche à droite) Colin Powell, secrétaire d'État, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale, Joe Biden et Richard Lugar, sénateurs.
Son chef de cabinet a poussé le président à rencontrer personnellement les sénateurs pour leur faire part de ses préoccupations, à savoir que toute résolution devait s'étendre à l'ensemble de l'Irak. "Je comprends qu'il y ait des désaccords, mais l'Irak est une menace et ne rien faire n'est pas une option, [Saddam Hussein] représente la plus grande menace pour les États-Unis, il veut une bombe nucléaire pour détruire Israël", a répondu Daschle, "Je pense que nous sommes préoccupés par le soutien, nous avons besoin que ces préoccupations soient prises en compte", Gephardt a acquiescé : "Nous sommes d'accord avec votre évaluation de Saddam Hussein, mais s'il ne s'agit pas d'armes de destruction massive, nous ne pouvons tout simplement pas le voir". Certains sénateurs se sont inquiétés de la capacité de l'armée américaine, Carl Levin, président de la commission des forces armées, a déclaré avoir reçu de "profondes inquiétudes" de la part d'officiers, notamment en ce qui concernait l'utilisation d'armes chimiques par Saddam, son cantonnement dans la "forteresse de Bagdad" ou une éventuelle insurrection baasiste post-Saddam. Le président a répliqué : "Ce serait bien qu'ils me fassent part de leurs préoccupations à moi plutôt qu'à un membre du Sénat". Lorsque les républicains du Congrès lui ont demandé de se concentrer davantage sur les violations des droits de l'homme en Irak, le président s'est montré émotif : "Je suis bien conscient, vous savez, ce type a essayé de tuer mon père !"
Certaines tentatives pour convaincre le Congrès ont échoué. Le secrétaire d'État Rumsfeld aurait fait un exposé antagoniste, à la limite du non-sens, d'une heure sur la menace de Saddam, se caricaturant lui-même en expliquant que "nous savons qu'il y a des choses que nous savons, nous savons qu'il y a des choses que nous ne savons pas", ce qui a joué en sa défaveur et n'a convaincu que certains démocrates de la circonspection de la Maison-Blanche, La sénatrice Feinstein, membre de la commission du renseignement, aurait conclu du briefing qu'"il n'y a pas de nouvelle preuve de la capacité nucléaire de Saddam" et qu'elle ne serait pas disposée à entrer en guerre, rejointe dans cette critique par plusieurs républicains.
"Nous voulons être avec vous", a finalement déclaré Don Nickles, sénateur de l'Oklahoma, à Rumsfeld. " Mais vous ne nous en donnez pas assez ". et d'autres tentatives de convaincre sont apparues comme trop musclées, comme le témoignage saisissant du Dr Bruce Ivins, expert en anthrax, sur le danger d'une attaque biologique contre les États-Unis, présenté au Congrès, qui a été critiqué pour son alarmisme et qui n'a pas réussi à convaincre ou à paniquer les Américains.
Le Congrès est resté bloqué sur la rédaction de la résolution jusqu'au mois d'août. Colin Powell et Condoleezza Rice ont travaillé d'arrache-pied pour modifier la résolution démocrate. Powell a mis le doigt sur le problème en déclarant que la menace d'une action unilatérale devait être présente : "nous devons défier [Saddam], espérons-le avec une résolution forte du Congrès, avec une résolution forte de l'ONU, pour le forcer à changer ses habitudes, à changer le comportement de ce régime, ou bien le régime devra être changé". Les républicains ont réussi à modifier le projet de loi Biden-Lugar pour soutenir une autorisation générale de recours à la force contre l'Irak dans l'attente du soutien des Nations unies, ce qui, en cas d'échec, déclencherait un second vote du Congrès pour autoriser une action unilatérale. Alors que le calendrier du président s'écoulait, le Congrès a voté une semaine plus tard, le dernier jour avant les vacances d'été, et a adopté la "Résolution d'autorisation de recours à la force militaire contre l'Irak" de 2003 ou "Résolution conjointe autorisant le recours aux forces armées des États-Unis conformément à l'action du Conseil de sécurité des Nations unies", à une large majorité : 82 voix au Sénat et 319 voix à la Chambre des représentants. Une fois de plus, la balle était dans le camp des Nations unies.
Tout au long de la crise du désarmement irakien, les sondages d'opinion ont beaucoup fluctué. Dès le début de l'opération Desert Badger, la cote de popularité du président Bush a augmenté de 10 points pour atteindre le milieu des 50 %, et une large majorité, les 3/4 des Américains, ont approuvé la campagne de bombardements. Mais l'approbation d'une invasion à plus grande échelle était plus délicate à cerner. Depuis 1992, les Américains étaient divisés sur la question d'une invasion visant à éliminer Saddam, la plupart des sondages oscillant entre 48 et 52 % de soutien à une guerre. L'opinion des Américains a évolué une fois que d'importantes mises en garde ont été ajoutées : s'il s'agissait d'une guerre longue ou si le nombre élevé de victimes évoquait des souvenirs du Viêt Nam, le soutien a chuté de façon spectaculaire et un tiers des Américains pensaient que l'appel sous les drapeaux serait rétabli dans un tel cas de figure. La plupart des Américains soutenaient les inspections en désarmement de l'ONU, mais restaient incertains quant à leur valeur réelle. 70 % d'entre eux pensaient que les États-Unis devraient attendre la fin des inspections. La moitié des Américains pensaient que Saddam avait des armes de destruction massive, mais la plupart d'entre eux, plus de 60 %, estimaient que l'administration n'en avait pas apporté la preuve. Au fur et à mesure que la bataille sur les résolutions du Conseil de sécurité et du Congrès s'éternisait, le soutien à la guerre a régulièrement diminué pour se situer entre 42% et 47% (ces chiffres ont encore baissé de 7% sans le soutien de l'ONU et de 8% sans l'approbation du Congrès). Au cours de cette période, la cote de popularité de Bush s'est stabilisée autour de 50 %.
L'opinion polarisée du pays a commencé à se refléter dans le public. Alors qu'il n'y avait qu'un seul manifestant devant la Maison Blanche le jour du début des frappes, et des centaines devant le siège des Nations unies à New York, un mouvement anti-guerre largement populaire s'est développé pendant quatre mois, entre juillet et septembre, lentement mais sûrement, avec quelques milliers de personnes à Washington ici, et quelques milliers à Chicago là, une opposition vocale s'est développée. Le mouvement n'était pas seulement national, le Royaume-Uni s'est rapidement doté d'un tel mouvement, aidé par l'opposition d'arrière-ban du parti travailliste au pouvoir, qui s'opposait à l'aide apportée aux États-Unis dans une guerre. Ces manifestations et marches ont pris de l'ampleur, atteignant parfois des centaines de milliers de personnes, tandis que les images des Américains combattant dans le Golfe et les discours du président Bush commençaient à disparaître des écrans de télévision, remplacés par des manifestations (dont certains se sont plaints qu'elles donnaient un poids excessif à la minorité protestataire). Très vite, les Américains se sont également divisés entre colombes et faucons[7].
Grandes manifestations à Washington, Chicago et Londres
La critique d'une guerre potentielle a été davantage mise en avant par l'opposition "professionnelle", en particulier par d'anciens inspecteurs en désarmement, des généraux, des diplomates et des hommes politiques. Ces personnalités de premier plan ont évoqué l'idée que l'administration déformait les faits ou ont déclaré qu'une guerre en Irak serait beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient. Scott Ritter, l'ancien responsable des inspections d'armement avant 1998, a déclaré que les armes irakiennes avaient été détruites à 95 % après la guerre du Golfe et que ce qui restait serait désormais totalement inutilisable. L'officier Brent Scowcroft (conseiller à la sécurité nationale de Bush père) a déclaré qu'une invasion américaine pourrait transformer le Moyen-Orient en un grand conflit israélo-palestinien, et l'ancien chef du commandement central Anthony Zinni a déclaré que l'Irak était loin d'être une priorité pour la défense de l'Amérique. L'ancien agent spécial du FBI, John P. O'Neill, a déclaré qu'une invasion de l'Irak aiderait considérablement les groupes terroristes anti-américains. Al Gore, désormais candidat à l'élection présidentielle, a également attaqué ouvertement la politique de Bush pour ses excès : "Mais regardez les différences entre la résolution votée en 1991 et celle que cette administration propose au Congrès de voter en 2002. Les circonstances sont vraiment complètement différentes".
Cette opposition s'est également manifestée au sein de l'administration : des dizaines de fuites ont montré une Maison Blanche qui se démenait pour agir et ont fait état de la désapprobation des militaires quant à la planification d'une telle opération et au manque de préparation ; des critiques assez explicites ont été formulées à l'encontre de Rumsfeld, selon lesquelles il sous-préparait massivement les forces américaines et a fait état d'un manque de moral dans les rangs des forces américaines.
Les médias ont réagi différemment : la presse écrite s'est montrée beaucoup plus ouvertement critique que la télévision, en particulier les chaînes câblées, mais la couverture, surtout lorsque le mouvement anti-guerre a pris de l'ampleur, a divisé les principales chaînes câblées. MSNBC, la chaîne la plus à gauche, a présenté d'éminents critiques anti-guerre tels que Phil Donahue, CNN a été la plus neutre et FOX a clairement soutenu la guerre et s'est montrée particulièrement critique à l'égard des manifestants pacifistes. Les critiques de la presse écrite à l'égard de la Maison Blanche et de ses sources de renseignement pouvaient être accablantes, notamment en ce qui concernait le Congrès national irakien en exil, accusé d'avoir fourni des informations trompeuses ou infondées à l'administration Bush et au Congrès lors de ses témoignages. Le scandale a également éclaboussé plusieurs partisans de la guerre en Irak qui défendaient le leader du CNI, Ahmed Chalabi, comme le secrétaire adjoint à la défense, Paul Wolfowitz, en exposant notamment les dossiers du département d'État qui le déclaraient "fraudeur condamné". Le célèbre journaliste du Washington Post, Bob Woodward, a écrit un article très critique qui démontait la thèse de la Maison Blanche sur les armes de destruction massive, simplement intitulé "Where is the smoking gun ?
Les intellectuels et chroniqueurs américains ont vivement débattu des positions pro-guerre et anti-guerre et de la moralité de l'interventionnisme. La libérale Arianna Huffington a critiqué la position pro-guerre en demandant : "Je me demande comment les gens répondraient à la question de savoir combien de housses mortuaires américaines ils sont prêts à accepter pour se débarrasser de Saddam Hussein", s'opposant à Christopher Hitchens : "Dans ces conditions, il n'y a aucune circonstance dans laquelle une intervention militaire en Irak pourrait être justifiée. Quelqu'un pourrait être tué. Mais encore une fois, un homme si profondément engagé dans le mouvement Habitat pour l'humanité pourrait se demander de quel genre d'habitat il s'agit, où les civils sont utilisés comme boucliers humains"[8].
Les opposants à la guerre en Irak, (de gauche à droite) l'ancien inspecteur en désarmement Scott Ritter, le général Anthony Zinni, l'ancien vice-président Al Gore, le journaliste Bob Woodward et la chroniqueuse Arianna Huffington.
Personne ne savait exactement ce qu'il était possible de faire sur le plan diplomatique pendant que les inspections se poursuivaient, mais pour satisfaire à l'exigence du Congrès concernant la deuxième résolution, il fallait essayer. L'administration a donc monté son dossier. Une réunion dans le bureau ovale a été organisée pour permettre à la CIA de présenter ses preuves au président. Bush, Rice, Card et Cheney étaient présents et ont présenté un diaporama de toutes les violations présumées par l'Irak des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris le programme de drones de Saddam, les missiles restants, les armes chimiques non comptabilisées et les rapports selon lesquels Saddam tenait toujours des réunions avec des scientifiques nucléaires. A la fin de la présentation, il était clair que le président n'était pas convaincu : "Bien essayé, mais je ne pense pas que le public puisse comprendre". Il s'est tourné vers Tenet et lui a demandé : "On m'a fourni toutes les preuves concernant les armes de destruction massive et c'est le mieux que nous ayons ?". Tenet, qui a assisté à la présentation de la CIA, répond cordialement : "Voilà ce que nous avons, c'est à prendre ou à laisser"[9]. Le président réfléchit un instant : "Il faut encore beaucoup de travail", puis il ajoute : "Mais ne l'étirez pas, je ne veux pas qu'on l'étire, contentez-vous des faits"[10].
Si vendre le dossier à la Maison Blanche était difficile, l'U.N.S.C. était à un autre niveau. Powell travaillait jour et nuit pour négocier avec les autres membres du Conseil afin d'obtenir leur vote. Certains considéraient déjà qu'il s'agissait d'une cause perdue, Cheney qualifiait le Conseil d'"entreprise d'inspection" et n'appréciait pas du tout d'être pris en otage par le Congrès. Mais Powell s'est fortement engagé à obtenir le soutien des Nations unies, qu'il considérait comme essentiel pour légitimer toute action militaire et aider un éventuel Irak post-Saddam.
Le Premier ministre Blair, partisan de longue date de la destitution de Saddam Hussein, était confronté à une descente considérable au sein de son propre parti et espérait un mandat des Nations unies pour consolider son soutien. Il en va de même pour le deuxième allié le plus solide des États-Unis à ce jour, l'Australie, dont le premier ministre Kim Beazley a déclaré à Bush qu'il ne pourrait pas participer à un conflit sans le soutien des Nations unies, confiant que son propre parti pourrait le démettre de ses fonctions. Le Premier ministre italien, M. Berlusconi, a également hésité à soutenir un vote de l'ONU à la suite d'une forte opposition du Parlement et de l'opinion publique.
L'administration s'est efforcée d'obtenir un soutien en faveur d'une résolution militaire. Powell pensait pouvoir réunir les neuf voix nécessaires : le Mexique, l'Espagne, l'Allemagne, la Bulgarie, le Cameroun, la Guinée et l'Angola, associés aux membres permanents que sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, constitueraient la majorité, mais la question se posait de savoir si les autres membres permanents, la France, la Russie ou la Chine, opposeraient leur veto à la décision. Les trois pays ont fermement soutenu la poursuite des inspections, la Chine a exhorté à "utiliser tous les moyens possibles pour éviter la guerre", la Russie a souligné les déclarations de Blix affirmant que les inspections fonctionnaient, "il y a un mouvement dans la bonne direction", et la France a maintenu une ligne ferme pour donner aux inspections ce qu'elles méritaient, le ministre des affaires étrangères Hubert Vedrine (un critique connu de l'hégémonie américaine qui a popularisé le terme d'hyperpuissance) a déclaré "il est dans l'intérêt de tous que l'Irak soit autorisé à voir la lumière au bout du tunnel" donnant à l'Irak la possibilité de se conformer à la décision. Bien qu'aucun ne l'ait explicité[11], il est apparu clairement qu'un effort immédiat en faveur d'une résolution serait probablement voué à l'échec.
Le Premier ministre britannique Tony Blair, le Premier ministre australien Kim Beazley et le Premier ministre italien Silvio Berlusconi.
Un mois après le début des négociations à l'ONU, le président s'est senti frustré : "Il trompe les inspecteurs, il trompe l'ONU et il trompe le monde, je l'ai déjà dit et je le répète, si Saddam Hussein n'est pas traduit en justice par la communauté internationale, les États-Unis doivent être prêts à agir unilatéralement". Il était furieux d'apprendre que les inspecteurs étaient menés par le bout du nez par des gardes irakiens souriants : "Bien sûr qu'ils ne trouvaient rien, Saddam Hussein le cachait !" Hans Blix a remis son premier rapport le 27 août, détaillant la recherche d'armes en Irak. Le thème était que l'Irak s'était montré peu enthousiaste à l'égard des inspections, leur permettant un accès total à tous les sites, bien qu'il y ait eu des rapports d'intimidation et que certains Irakiens ne se soient pas soumis à des entretiens, mais la conclusion était relativement positive, Blix rapportant également qu'aucune ADM n'avait été trouvée. Saddam a également fait une apparition publique, déclarant qu'il autorisait les inspecteurs à entrer dans le pays afin de contrecarrer les affirmations des États-Unis. Certains à la Maison Blanche ont pris la confiance grandissante de Saddam pour une insulte et ont blâmé publiquement Blix et l'ONU. Le secrétaire de presse Fleischer a qualifié le rapport d'insignifiant et s'est moqué de l'équipe chargée de l'armement : "Le problème avec les armes cachées, c'est qu'on ne peut pas voir leur fumée".
L'administration n'est parvenue à convaincre aucun des membres permanents - ni la France, ni la Russie, ni la Chine ne voulaient concéder une intervention pendant la durée des inspections - et plusieurs autres membres non permanents ont commencé à hésiter, le Cameroun s'est rangé derrière la France, le président mexicain Vincente Fox a laissé entendre que son pays pourrait s'abstenir et le chancelier allemand Stoiber (qui avait besoin de maintenir une alliance avec les libéraux centristes) a commencé à prôner la modération. La Maison Blanche a commencé à s'inquiéter du calendrier des opérations militaires qui pourraient débuter en novembre, et a poussé Powell à conclure aux Nations Unies afin de pouvoir retourner au Congrès et dire que les Nations Unies refusaient d'agir. Mais Powell avait du mal à abandonner la voie diplomatique, il reconnaissait qu'il n'y avait pas de preuve irréfutable, et même s'il partageait l'enthousiasme pour "se débarrasser de ce salaud de Saddam", il voyait bien que les choses n'allaient pas bien, que Rumsfeld envoyait beaucoup trop peu de troupes et sous-estimait grandement le niveau de résistance auquel elles étaient susceptibles d'être confrontées, que l'opinion publique n'était pas unie derrière eux et qu'il y avait trop peu d'alliés à leurs côtés. Powell ne cessait d'être confronté aux doutes des militaires et des diplomates et commençait à se lasser de devoir les rassurer en permanence. Le bureau du vice-président et le ministère de la défense lui demandaient à présent de présenter des renseignements manifestement erronés: un projet de discours émanant du bureau de Cheney contenait des informations déjà réfutées.
Il avait acquis une grande influence politique en tant que secrétaire d'État, et son code de soldat l'obligeait à ne pas trahir le président, ce qui aurait été un acte de déloyauté inimaginable. Avec la plus grande déférence possible, il a demandé au président ce qu'il attendait de lui aux Nations unies. Il a passé en revue les différentes options possibles et, sans jamais critiquer, il a demandé si la diplomatie était toujours d'actualité. Il a réaffirmé qu'il soutiendrait le président quelle que soit sa décision, mais il a laissé au président son opinion claire : "si vous envoyez des jeunes hommes et des jeunes femmes au péril de leur vie, vous devez avoir un objectif politique clair"[12].
Le chancelier allemand Edmund Stoiber, le président mexicain Vincente Fox et le secrétaire d'État Powell à l'ONU.
Le président se trouvait dans une impasse : le commandement central avait repoussé de novembre à décembre la date de début de l'action militaire, la Turquie, la Jordanie et l'Arabie saoudite refusaient l'utilisation de leur territoire pour une invasion terrestre, et les Nations unies n'étaient pas encore parvenues à s'entendre. Le président savait également qu'il se trouvait en eaux troubles dans son pays, les démocrates disposant désormais des voix nécessaires pour faire obstruction à une résolution de guerre (le décompte actuel était de 47 voix pour le non au Sénat[13]). Plusieurs facteurs entraient en ligne de compte : le mouvement anti-guerre grandissant, le manque d'alliés solides, les inspections d'armement en cours dont certains disaient qu'elles ne devaient pas être interrompues (un processus qui pourrait prendre des mois comme l'avait prédit Blix), l'absence de décision ferme du Conseil de sécurité, ainsi que l'élection présidentielle de 2004 qui prenait de plus en plus d'ampleur et donnait à beaucoup de gens une bonne raison de s'opposer à l'administration. Mais la décision a été prise pour lui lorsque le leader du Sénat, M. Daschle, a déclaré : "Ce n'est pas parce que le président a lamentablement échoué sur le plan diplomatique que les États-Unis doivent entrer en guerre. Se précipiter dans une guerre sans se préoccuper suffisamment des ramifications d'une action unilatérale, avec une très petite coalition, sans un soutien suffisant, serait prématuré ... cette guerre n'est pas inévitable".
Le président pourrait tenter de forcer la main du Sénat en proposant un vote pour que les démocrates signent leur refus, mais lorsque quelques démocrates de premier plan ont fait part de leurs critiques, il est apparu clairement que les lignes de combat étaient tracées et que, sauf changement de circonstances, une résolution du Congrès n'était pas à l'ordre du jour, les tambours de guerre semblaient s'estomper.
Si nous permettons au président Bush de commencer une guerre sans l'approbation du Congrès, cela nous hantera pendant des années, nous ne pouvons pas partir en guerre simplement parce que le président fixe une date limite irréaliste" - Ted Kennedy
"Sommes-nous censés partir en guerre simplement parce qu'un homme - le président - prend une série de décisions unilatérales qui nous mettent dans une boîte, une boîte qui rend la guerre, dans une plus large mesure, inévitable ?" - John Kerry
"Il ne fait aucun doute qu'en ce qui concerne l'Irak, nous avons un problème réel et croissant. Mais je crois aussi que nous avons le temps de traiter ce problème d'une manière qui isole Saddam et n'isole pas les États-Unis d'Amérique, qui fait du recours à la force la dernière option, et non la première. - Joe Biden
"Si nous devions attaquer l'Irak maintenant, seuls ou avec peu d'alliés, cela créerait un précédent qui pourrait revenir nous hanter. Ces derniers jours, la Russie a parlé d'une invasion de la Géorgie pour attaquer les rebelles tchétchènes. Nous avons déjà critiqué l'Inde pour son attaque préventive contre le Pakistan. Et que se passerait-il si la Chine percevait une menace en provenance de Taïwan ? Ainsi, malgré tout son attrait, une attaque unilatérale devrait être exclue" - Hillary Clinton
"Le désarmement de l'Irak de Saddam Hussein est nécessaire et vital pour la sécurité de l'Amérique, du golfe Persique et du Moyen-Orient, cela ne fait aucun doute. Mais je reste très préoccupé par le fait que certains membres de l'administration cherchent à utiliser une autorisation pour lancer une attaque unilatérale et préventive contre l'Irak. Je pense que ce serait une terrible erreur". - Diane Feinstein
"J'ai vu le tribut que la guerre peut prélever sur nos troupes et sur les membres sur le champ de bataille. La meilleure façon de soutenir les troupes est de ne jamais les envoyer à la guerre. Ensuite, s'ils partent en guerre, il faut s'assurer que cela en vaut la peine. C'est la deuxième meilleure façon de soutenir les troupes, afin qu'elles n'aient pas à s'inquiéter de l'accueil qu'elles recevront à leur retour". - Max Cleland
Les sénateurs démocrates Ted Kennedy, John Kerry, Joe Biden, Hillary Clinton, Diane Feinstein et Max Cleland se sont tous opposés à la décision du Président.
[1] Les photographies de cercueils militaires américains ont été censurées à l'époque.
[2] Après le 11 septembre, la CIA a fait l'objet de nombreuses critiques et Tenet a considéré qu'il était de son devoir de protéger l'agence. Pour ce faire, il s'est rapproché du président, ce qui ne me surprendrait pas si cela avait une incidence sur sa gestion des renseignements irakiens.
[3] Tous les renseignements sur les armes biologiques étaient des rumeurs de seconde main.
[4] Les stocks non comptabilisés constituaient probablement la meilleure preuve que Saddam les possédait encore, si l'on peut appeler "preuve" l'absence de preuve.
[5] Les tubes d'aluminium et le yellow cake (qui est totalement ignoré par l'ITTL) étaient les seules preuves que Saddam essayait de fabriquer des armes nucléaires, à l'exception de certains sites qui, selon le ministère de la défense, pourraient être utilisés pour des centrifugeuses.
[6] Comme on pouvait s'y attendre, beaucoup n'y ont pas cru.
[7] La grande différence est que le mouvement en faveur de la guerre et le chauvinisme sont nettement moins présents dans notre chronologie.
[8] Le New York Times et le Washington Post ont si mal couvert l'événement qu'ils se sont excusés en 2004. La guerre contre le terrorisme et le 11 septembre ont sérieusement affecté l'objectivité des journalistes.
[9] Tenet a fameusement qualifié les preuves de "slam dunk". Puisque le 11 septembre a été un échec à ne pas prendre les informations au sérieux, la guerre en Irak a été un échec à amplifier les renseignements
[10] Bush, comme la plupart des gens, pensait qu'il y avait des armes de destruction massive, mais ce n'était pas sa principale motivation pour poursuivre Saddam. Les armes de destruction massive semblaient juste être la motivation la plus évidente.
[11) Sans un veto ferme de Chirac, le processus de l'ONU n'est pas exclu. De plus, il n'y a pas de francophobie aux Etats-Unis ni de frites de la liberté.
[12] Powell n'a cessé de répéter que son discours à l'ONU était une tache dans son dossier, il reste plus prudent et la Maison Blanche a besoin de sauver les apparences.
[13] Je dispose d'un décompte rudimentaire des votes si quelqu'un souhaite savoir comment certains sénateurs auraient voté.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 25: Justice

Explosions et coups de feu secouent le complexe militaire américain dans la capitale saoudienne
Par l'Associated Press
23 septembre 2003
RIYADH, Arabie Saoudite - Le jour de la fête nationale de l'Arabie Saoudite, des assaillants ont pénétré dans un complexe des forces américaines et alliées de la coalition et ont fait exploser plusieurs camions et voitures piégés, dans le complexe du village d'Eskan, situé juste à l'extérieur de Riyad, la capitale du Royaume saoudien, qui abritait du personnel militaire américain et d'autres forces de la coalition. Les bombes et les tirs ont fait au moins 18 morts et plus de 200 blessés, selon un responsable hospitalier.
Plus d'une centaine d'Américains auraient été grièvement blessés et le ministère de la défense s'attend à ce que le bilan s'alourdisse au fur et à mesure que les recherches se poursuivent dans les décombres. Les attaquants ont pu pénétrer dans le complexe à bord de véhicules équipés d'explosifs avant de prendre d'assaut plusieurs immeubles d'habitation à l'aide de ces véhicules et de coups de feu avant de faire exploser les explosifs présents à l'intérieur de deux camions et d'une voiture, provoquant plusieurs grands cratères qui ont entraîné la destruction de deux bâtiments et en ont endommagé de nombreux autres.
Tous les morts et les blessés étaient américains, selon les responsables du Pentagone, mais le gouvernement saoudien a déclaré que certains des blessés étaient d'autres nationalités, notamment britanniques.
"Nous ne savons pas combien de personnes sont blessées, mais nous en avons reçu plus de 200 et leur nombre ne cesse d'augmenter", a déclaré par téléphone à l'Associated Press un responsable de l'hôpital de la Garde nationale de Riyad, sans s'identifier. "Nous sommes complets maintenant, il n'y a plus de place pour d'autres victimes."
De la fumée s'élève encore dans le ciel nocturne depuis les ruines du complexe fortement clôturé et gardé, situé juste à côté d'une base aérienne gérée par les États-Unis, tandis que des hélicoptères tournoient au-dessus de la zone, balayant le sol à l'aide d'un projecteur à la recherche d'autres assaillants potentiels. Des centaines de militaires américains, de policiers saoudiens et de membres de la garde nationale saoudienne bouclent la zone, tandis que des ambulances arrivent en urgence.
Le complexe héberge plus de 2 000 soldats américains et a récemment accueilli le siège du Commandement central des États-Unis, qui a commandé l'opération Desert Badger, la mission militaire menée par les forces américaines et britanniques pour frapper des cibles dans l'Irak voisin.
Les autorités américaines se sont déclarées préoccupées par la possibilité de nouvelles attaques, et le département d'État a ordonné le départ d'Arabie saoudite de tout le personnel américain non essentiel et des membres de leur famille. "Nous sommes très préoccupés par la possibilité de nouvelles attaques", a déclaré un responsable américain. Il n'a pas voulu être plus précis.
Le président Bush a déclaré que l'attentat "avait été très bien planifié" et s'est engagé à traduire les auteurs en justice. "Les États-Unis trouveront les assassins et ils apprendront ce que signifie la justice américaine", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé dans l'Indiana.
L'explosion semble être la pire attaque terroriste contre des Américains au Moyen-Orient depuis l'attentat à la bombe contre le personnel militaire américain dans le complexe d'appartements des tours de Khobar, également en Arabie saoudite, en 1996, qui avait fait 19 morts. L'attentat est survenu à un moment de grande tension au Moyen-Orient, concernant à la fois les inspections d'armes en cours en Irak et les négociations en cours entre Israël et la Palestine.
Les responsables du ministère de la défense à Washington ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas connaître avec certitude le groupe responsable de l'attaque, mais les responsables saoudiens ont semblé rejeter la responsabilité sur le réseau terroriste Al-Qaïda, l'organisation terroriste officiellement dirigée par l'exilé saoudien Oussama ben Laden qui a été tué par une frappe aérienne des États-Unis il y a cinq ans. Le directeur du FBI, Robert Mueller, a déclaré que "ce qu'il faut retenir de la nuit dernière, c'est qu'Al-Qaïda et d'autres réseaux terroristes sont toujours là et veulent toujours nous frapper". Al-Qaïda s'oppose au gouvernement saoudien et à la présence de l'armée américaine dans le pays.

Le président George W. Bush s'adresse au public après l'attentat du village d'Eskan.
L'attaque terroriste en Arabie saoudite s'est produite à un moment de fortes tensions au Moyen-Orient, alors que les États-Unis se préparaient à affronter l'Irak, voisin de l'Arabie saoudite, et son dictateur Saddam Hussein. Immédiatement après, certains étaient prêts à croire le pire de Saddam et le soupçonnaient d'avoir perpétré l'attaque contre les troupes américaines. Certains responsables de la Maison Blanche étaient prêts à partager cette opinion, eux qui cherchaient un lien entre l'Irak et le terrorisme. Toutefois, les services de police saoudiens et américains ont rapidement jeté un froid sur ces soupçons et rejeté la responsabilité sur le réseau terroriste Al-Qaida. Les Saoudiens ont affirmé avoir déjà démantelé de nombreuses cellules d'Al-Qaida en Arabie saoudite et il était de notoriété publique qu'au cours des trois dernières années, une insurrection de faible ampleur couvait dans le pays, sous la forme d'attentats à la bombe et de meurtres occasionnels de touristes, de fonctionnaires et d'hommes d'affaires occidentaux. Mais l'attentat d'Eskan Village s'est distingué comme le plus meurtrier à ce jour. Les autorités américaines savaient pertinemment que plusieurs réseaux terroristes anti-américains avaient des liens avec le Royaume, notamment avec des mécènes et des sympathisants riches et puissants.
Al-Qaida est né de la colère contre la présence américaine en Arabie saoudite, pays qui abrite les deux lieux les plus sacrés de l'islam. Oussama ben Laden, le fondateur du groupe, avait fait de l'expulsion des forces américaines de la péninsule arabique son objectif principal. Cette thèse a été reprise par les dirigeants ultérieurs d'Al-Qaida et d'autres groupes dissidents. Le royaume saoudien a toléré les sentiments anti-américains et un nombre croissant d'analystes américains de la politique étrangère ont critiqué le lien inquiétant entre la richesse saoudienne et les attaques terroristes et ont noté le nombre de jeunes Saoudiens qui ont participé à des activités militantes mondiales, comme ceux qui ont été arrêtés dans le New Jersey en 2002. Le royaume s'est efforcé de nier l'existence d'une telle menace terroriste ou d'un lien avec des groupes terroristes dans l'espoir d'éviter l'opprobre associé à l'aveu d'une insurrection anti-occidentale et de ne pas imposer une répression potentiellement déstabilisante à ces groupes.
Le FBI a été dépêché sur place pour corroborer les affirmations du gouvernement saoudien. Les précédents attentats perpétrés dans la région ont toujours été difficiles à déterminer avec précision, les réseaux s'entrecroisant et travaillant parfois en conflit les uns avec les autres. L'Iran, l'Irak et la Syrie, entre autres pays, ont été soupçonnés d'aider les extrémistes saoudiens à déstabiliser le royaume, mais aucune preuve irréfutable n'a été trouvée. L'enquête du FBI sur l'attentat a fait plusieurs révélations : l'attentat avait été intimement planifié et les assaillants ont pu franchir les défenses du complexe parce qu'ils étaient habillés comme des gardes nationaux saoudiens, ce qui a fait craindre que des militants aient pénétré dans les rangs supérieurs de l'armée saoudienne. L'enquête a également révélé que plus d'une douzaine d'hommes ont pris part à l'attaque et que des preuves ADN ont permis de relier certains auteurs à Al-Qaida ou à des groupes militants similaires, mais les efforts déployés pour les relier à des groupes irakiens ou à d'autres groupes étatiques sont restés vains. Le niveau de complexité et d'organisation du complot était une marque de fabrique d'Al-Qaida. D'autres critiques ont été formulées à l'encontre du gouvernement saoudien, qui a été perçu comme un État protégeant l'implication éventuelle de son propre pays.
Bien qu'ils aient arrêté une douzaine de personnes impliquées, ils ont refusé d'enquêter sur d'éventuels liens avec l'extrémisme au sein des forces saoudiennes et le gouvernement n'a voulu extrader aucun d'entre eux vers les États-Unis pour qu'ils y soient jugés (les résultats des procès menés par les Saoudiens n'ont pas été rendus publics par la suite). Quelles que soient les conclusions des autorités saoudiennes ou du FBI, le lien avec Al-Qaida semblait définitivement confirmé lorsque, deux semaines plus tard, le groupe a publié des vidéos d'éloges funèbres de plusieurs militants décédés et s'est attribué le mérite de l'attentat dans une vidéo mettant en scène Saad ben Laden, l'un des nombreux fils de l'ancien chef d'Al-Qaida, qui reprenait les sentiments de son père en qualifiant le royaume d'"esclave des Juifs et des Américains" et en disant que l'attentat était "tout ce qu'ils méritaient".

Mohammed Atef, chef d'Al-Qaida, aux côtés de Saad Ben Laden
L'attentat en Arabie Saoudite et l'engagement public du président à traduire les assassins en justice ont obligé l'administration à réagir de manière visible. Le FBI, l'Arabie saoudite et de nombreuses autres agences de renseignement à travers le monde avaient rejeté toute la responsabilité sur Al-Qaida, malgré les efforts continus de certains responsables de la Maison Blanche pour maintenir l'attention du gouvernement sur l'Irak (ces groupes comprenaient différentes factions des dirigeants saoudiens qui étaient favorables à une invasion américaine de l'Irak), mais la cassette des aveux les a largement réduits au silence, même Cheney et Rumsfeld s'en sont remis à l'avis des agences selon lequel il fallait agir contre Al-Qaida, ne serait-ce que parce que la cassette avait nargué/menacé l'administration.
Le président espérait s'éloigner de ce qu'il considérait comme la politique de Clinton, qui ne faisait pas grand-chose, interrompue par des frappes aériennes occasionnelles, et qu'il qualifiait de "chasse aux mouches". Il considérait que frapper uniquement les agents d'Al-Qaida était une politique inefficace, que les États-Unis ne pouvaient pas se contenter de s'en prendre à des terroristes individuels, qu'ils devaient frapper l'organisation et punir les pays et les groupes responsables de les avoir aidés, afin de mettre les terroristes fermement au pied du mur au lieu de se contenter de réagir à chaque attaque, et Bush voulait inclure la possibilité de frapper les talibans dans le cadre de toute réponse américaine, les fondamentalistes islamiques qui contrôlaient la majeure partie de l'Afghanistan et accueillaient les nombreux groupes djihadistes présents dans le pays, dont Al-Qaida. Cette stratégie présidentielle était controversée, car aucune enquête officielle n'avait permis d'établir que les actions d'Al-Qaida étaient dirigées par les talibans et les confronter publiquement pouvait provoquer une réaction brutale. Les talibans bénéficiaient du soutien de l'ensemble du monde musulman, y compris de certains alliés des États-Unis dans le Golfe, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le principal soutien des talibans était son voisin nucléaire, le Pakistan, d'où provenaient des milliers de volontaires, dont des agents des services de renseignement, qui aidaient activement le régime taliban.
Les précédentes frappes afghanes menées par Clinton en 1998 avaient tué des fonctionnaires pakistanais, le fait de diriger désormais les attaques contre les talibans en particulier pourrait tuer des dizaines de Pakistanais. La CIA craignait que cela ne provoque des troubles contre les Américains au Pakistan et n'en incite d'autres à rejoindre des groupes militants. Pour que les frappes soient efficaces en Afghanistan, il faudrait qu'elles traversent l'espace aérien pakistanais et qu'elles soient notifiées à l'avance pour éviter que les Pakistanais n'essaient d'abattre les missiles ou les avions américains, ce qui permettrait aux services de renseignements pakistanais d'informer les talibans de l'imminence des frappes, réduisant ainsi considérablement leur capacité à tuer des cibles de grande valeur.
Le président Bush a néanmoins exigé une réponse plus ferme et a demandé au département d'État d'approcher le président pakistanais Musharraf pour lui proposer de cesser de soutenir les talibans et, en échange, de favoriser de meilleures relations entre les deux pays. Musharraf s'était jusqu'à présent montré réticent à réduire le soutien aux talibans, préférant poursuivre sa politique de soutien aux talibans afin d'empêcher la formation d'un Afghanistan plus aligné sur l'Inde. Mais Musharraf ne pouvait pas nier l'énorme opportunité qui se présentait à lui.
Après la guerre du Cachemire de 2002, le général Musharraf a connu un niveau de popularité politique sans précédent au Pakistan depuis sa création et il a déjà utilisé ce capital politique pour rompre le pain avec les États-Unis, en aidant à la répression des groupes terroristes anti-américains au Pakistan et en chassant du pays les terroristes les plus ciblés (bien que de nombreux Américains faucons aient considéré ces mesures comme tièdes).
Les élections générales qui ont suivi au Pakistan ont été un triomphe pour le nouveau parti politique de Musharraf, qui a facilement battu les partis d'opposition de ses rivaux en exil, Nawaz Sharif et Benazir Butto[1], remportant 46 % des voix et donnant aux partis qui lui étaient favorables une large majorité. Pour légitimer davantage son règne, il a transféré certains pouvoirs exécutifs au Premier ministre afin de se présenter comme le dirigeant civil légitime du pays. Musharraf était conscient de la fragilité du système politique de son pays, de la nécessité de trouver un équilibre entre les préoccupations de sécurité régionale et le soutien interne aux talibans, mais il avait aussi ses propres objectifs de libéralisation et de croissance de l'économie pakistanaise, principalement en stimulant l'investissement. Un rapprochement à l'égard de l'Occident pourrait justement permettre d'atteindre cet objectif. Musharraf a donc conclu un accord avec les États-Unis pour permettre l'utilisation de son espace aérien pour des frappes militaires contre Al-Qaeda et certains affiliés des Talibans, mais a refusé de soutenir les efforts qui contribueraient à un changement de régime.

Les partisans de Musharraf dans la rue
Le président s'est montré satisfait de l'accord et a rapidement approuvé une mission visant à mener une vaste série de frappes militaires contre Al-Qaida en Afghanistan, ainsi que des frappes limitées contre les bases militaires et les installations d'entraînement des talibans, mais surtout pas contre les dirigeants talibans. La mission, baptisée "Justice infinie", a été menée à bien le 12 novembre 2003 de manière spectaculaire. Les frappes ont commencé au cœur de la nuit et ont été sensiblement plus importantes que celles de 1998, afin de montrer que le président actuel était plus concerné que son prédécesseur. Des jets supersoniques ont décollé des porte-avions américains en mer. Des bombardiers B-2 sont venus d'aussi loin que la Californie et des missiles de croisière ont été tirés depuis des sous-marins américains. Tous avaient pour mission d'éliminer les camps d'entraînement des terroristes et certains campements militaires des talibans.
Le président a fait cette annonce depuis la salle du conseil des ministres : "Sur mon ordre, l'armée américaine a entamé des frappes contre des camps d'entraînement terroristes ainsi que contre certaines installations militaires en Afghanistan utilisées pour aider ces groupes terroristes. Ces actions soigneusement ciblées visent à empêcher l'utilisation de l'Afghanistan comme base d'opérations terroristes... En détruisant les camps et les installations, nous ferons en sorte qu'il soit plus difficile pour le réseau terroriste de former de nouvelles recrues et de coordonner ses plans diaboliques... La récente attaque contre des soldats américains a été planifiée et ordonnée par ces groupes et ils en paieront le prix".
Pendant 18 heures, 30 cibles, dont des camps d'entraînement, des bases aériennes et des garnisons, ont été frappées dans tout l'Afghanistan, dans une grande démonstration de la puissance brute de la plus grande puissance militaire du monde. Des images d'explosions floues ont été diffusées par les réseaux de télévision depuis les montagnes afghanes. Lorsqu'on lui a demandé si l'administration avait atteint son objectif, le secrétaire à la défense, M. Rumsfeld, s'est félicité de la mission : "elle a été couronnée de succès, toutes les cibles ont été touchées et tous nos avions sont revenus sains et saufs". Le puissant tir de barrage a été jugé beaucoup plus efficace pour détruire les camps et les bases que les précédentes frappes de missiles de croisière en raison de la puissance de feu et de la précision accrues, mais pour ce qui est d'atteindre des cibles de premier plan et des chefs terroristes comme Khalid Sheik Mohammed, Abu Zubaydah, Muhammed Atef et Saaf Bin Laden, ils ont tous échappé à la mort. Peut-être les organisations terroristes s'attendaient-elles à des frappes et s'étaient-elles repliées sur elles-mêmes, ou peut-être avaient-elles été informées, mais quoi qu'il en soit, les groupes ont échappé au sort de leur premier émir et n'ont subi qu'un minimum de pertes. Les frappes contre les bases aériennes et les garnisons militaires des talibans ont eu beaucoup plus de succès, puisqu'elles ont permis de détruire ou de mettre hors service des bases aériennes dans le nord et autour de la capitale, Kaboul, ainsi que de détruire la moitié de la force aérienne des talibans, faisant environ 300 victimes parmi les militants.

(De gauche à droite) Bombardier B-2 en vol, avion décollant d'un porte-avions et lancement de missiles de croisière

Carte des frappes en Afghanistan
La réaction mondiale aux frappes a été une fois de plus mitigée. Sur le plan intérieur, les frappes ont reçu un soutien uniforme de la part des dirigeants des deux partis, même si les démocrates doutaient de la position de l'administration sur l'Irak. Ils ont salué l'engagement du président en faveur de la justice en Afghanistan, utilisant parfois un langage chargé : "Il s'agit d'une action justifiée, bien planifiée et responsable du président, et je l'en félicite", a déclaré Bob Graham, l'un des principaux démocrates et l'un des plus fervents critiques de la politique irakienne. Dans une déclaration commune, les dirigeants démocrates ont affirmé que "l'Amérique se devait de réagir et nous soutenons cette opération". Même le leader du Sénat, M. Daschle, qui faisait obstruction à la résolution de guerre du président sur l'Irak, a fait preuve de déférence à l'égard du président, tout en veillant à ne pas lui laisser les coudées franches : "Cette mission bénéficie d'un soutien bipartisan évident et d'un raisonnement clair ... nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les militaires américains". Au niveau mondial, la réaction a été celle, prévisible, des alliés traditionnels de l'Amérique, tandis que les nations musulmanes et les groupes islamiques, ainsi que les autres grandes puissances que sont la Russie et la Chine, se sont opposés à ce qu'ils ont appelé une réaction préventive, et une nouvelle journée de manifestations anti-américaines a éclaté dans le monde islamique.
L'attaque du village d'Eskan et l'opération Infinite Justice qui a suivi ont encore compliqué la politique interne de la Maison Blanche, où tous les personnages clés examinaient les perspectives d'une action militaire dans un deuxième pays et évaluaient les options pour faire face à la crise du désarmement irakien. L'équipe de Hans Blix a continué à rechercher en Irak des armes interdites par l'ONU. Dans un second rapport, Blix a détaillé ses efforts, notant que l'Irak devenait de plus en plus belliqueux, ce qui ralentissait le rythme des inspections. La Maison Blanche a qualifié cette situation de "dernière partie de leur jeu de dupes" et a vu dans la lenteur des inspections une tentative de désintérêt de la part de la communauté internationale. Blix a précisé que l'Irak s'était montré plus ouvert lors des entretiens et, après quelques allers-retours sur les missiles irakiens, l'Irak a accepté en principe de détruire les missiles mais a déclaré ne pas savoir comment s'y prendre, un parfait exemple de ce que Blix a appelé une "conformité peu enthousiaste" (l'Irak a peu après procédé à la destruction des missiles).

Sculptures de cire de George Bush, Colin Powell et Saddam Hussein
Mais pour la Maison Blanche, les questions relatives au respect des règles par Saddam n'étaient qu'une note de bas de page, la question n'était plus de savoir s'il fallait agir, mais comment et quand. Malheureusement, plusieurs obstacles se sont dressés sur la route de l'administration. Les inspections en cours sous la direction de Blix devraient être interrompues si les États-Unis frappaient l'Irak, inspections qui gagnaient du terrain et bénéficiaient du soutien de l'opinion publique en dépit des récriminations de Blix et des États-Unis. Les États-Unis ne disposeraient que d'une petite coalition pour une action militaire à grande échelle. Seuls les Britanniques pourraient se joindre à eux pour une invasion immédiate, avec le soutien éventuel des forces spéciales d'un autre pays européen. Si une action militaire devait être lancée, le calendrier devenait difficile à gérer. Les troupes étaient introduites au Koweït à un rythme lent afin de ne pas éveiller les soupçons, mais il y avait un désaccord considérable entre le secrétaire à la défense Rumsfeld et l'état-major général sur le nombre de troupes nécessaires pour une opération militaire suffisamment rapide, Le nouveau calendrier de Rumsfeld prévoyait que les troupes seraient prêtes à partir à la mi-novembre pour une attaque éclair sur Bagdad (un calendrier encore retardé par l'attaque d'Eskan), mais les généraux voulaient plus de troupes et une phase de campagne aérienne dédiée, semblable à celle de la guerre du Golfe de 1991, pour détruire les forces irakiennes avant les opérations terrestres, ce qui repousserait l'invasion au moins jusqu'à la nouvelle année.
Enfin, la question de la victoire se posait. Tout le monde était certain que les Etats-Unis écraseraient l'armée irakienne, mais le niveau de résistance auquel ils seraient confrontés faisait l'objet de vifs débats, depuis le tableau idyllique défendu par les faucons, selon lequel les forces américaines seraient accueillies par des fleurs dans les rues, jusqu'aux préparatifs apocalyptiques effectués par l'armée, selon lesquels les forces américaines seraient confrontées à des barrages d'armes chimiques et feraient le siège de ville en ville. Le Congrès avait refusé de donner le feu vert au président et l'opinion publique était généralement opposée à une invasion - environ 30 à 40 % y étaient favorables dans les circonstances actuelles, mais l'équipe Bush était persuadée que ce chiffre changerait si l'action commençait. Mais il était impensable de ne rien faire et de permettre à Saddam d'aller jusqu'au bout de sa course.
Le président a tout à fait le droit d'ordonner une opération militaire sans l'autorisation du Congrès, comme l'ont fait Clinton, son père et Reagan. L'invasion de la Grenade, du Panama et d'Haïti étaient des opérations rapides dans les Caraïbes, l'arrière-cour de l'Amérique. Même lors de la guerre du Golfe, où le président H.W. Bush a menacé d'entrer en guerre sans le soutien du Congrès, il disposait de l'autorité de l'ONU pour soutenir la légalité de ses actions. Bush Jr disposait de quelques échappatoires juridiques, la loi de libération de l'Irak ou la résolution originale de 1991, voire l'approbation récente de l'action américaine dans Desert Badger, pouvaient s'appliquer à une opération de plus grande envergure. Cheney a souligné que le président avait eu recours à la force armée plus de 200 fois et que le Congrès n'avait approuvé la guerre que cinq fois, mais Bush savait que les conséquences politiques pourraient être graves, en particulier si certaines des estimations les plus pessimistes concernant les pertes américaines se produisaient au cours d'une année électorale, Certains démocrates ont utilisé des termes très durs : "Si le président agit contre la volonté du Congrès et du peuple américain, il sera destitué par le Congrès", a déclaré Daniel Inouye (le sénateur qui a perdu un bras pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était un fervent opposant à une guerre contre l'Irak), L'opposition du Congrès s'est concentrée sur les enquêtes concernant les renseignements erronés utilisés par l'équipe du secrétaire d'État adjoint Paul Wolfowitz et les éventuelles fuites de renseignements visant à obtenir un soutien en faveur d'une guerre, et des accusations ont même été lancées sur Internet selon lesquelles l'administration Bush aurait délibérément abattu les pilotes américains dans le cadre d'une attaque sous faux drapeau. L'action militaire serait certainement d'une ampleur inégalée depuis la guerre du Viêt Nam et, quelle que soit l'issue de la journée, les États-Unis se retrouveraient à occuper un pays de la taille de la France et la règle de Powell, paraphrasée par la régle de la poterie, selon laquelle "si on la casse, on l'achète", resterait en suspens. La situation serait d'autant plus délicate que c'est son père qui avait fixé la norme pour l'obtention de l'autorisation du Congrès. Le président devait prendre une décision, soit se conformer à la non-décision du Congrès, soit procéder à une manœuvre unilatérale pour conduire la nation à la guerre.
Saddam, désarmé ou non, était une menace, un ennemi juré de l'Amérique, il menaçait ses voisins, payait des terroristes palestiniens et tirait sur nos avions. Il défiait effrontément les sanctions et l'ONU et dirigeait son peuple d'une main de fer brutale et trempée de sang, qu'il ait ou non des armes de destruction massive dans le passé. D'une manière ou d'une autre, nous devions faire face à la menace irakienne. Cheney et Rumsfeld ont insisté sur l'urgence en disant que le fait d'attendre permettrait à Saddam de mieux se préparer et pourrait saper le moral des forces américaines, mais il y avait des divergences importantes au sein de l'administration, de nombreux secrétaires d'État, dont Powell, et le secrétaire d'État aux finances: Paul O'Neil et l'état-major était divisé sur la décision ainsi que sur l'hostilité croissante du Congrès et l'opposition de l'opinion publique. Le président avait même été poussé par sa famille qui, bien sûr, le soutenait mais avait exprimé des craintes concernant une guerre (Bush s'est souvenu d'un moment gênant lorsqu'il a regardé 13 jours avec sa famille, un film rappelant les efforts de l'administration Kennedy pour éviter une guerre avec l'Union soviétique), même son père, qui donnait rarement des conseils sans qu'on les lui demande, pour ne pas être condescendant, lui avait dit d'être prudent dans sa ligne de conduite.
Tout le monde pouvait constater que le président se trouvait dans une situation délicate et qu'il était contraint de reconsidérer la voie à suivre. À plusieurs reprises, il a demandé au général Tommy Franks quelle était la date la plus tardive possible pour le début d'une action militaire, ce à quoi Franks a répondu : "Monsieur le Président, nous pouvons y aller à tout moment, mais nous préférerions y aller avant février". L'emploi du temps du président était plus serré que jamais, entre la campagne, la législation et les réunions sur l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et l'Afghanistan, il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Le président s'est rendu au Royaume-Uni pour une visite d'État à la suite de l'opération "Justice infinie", un voyage qui a été assombri par les milliers de manifestants pacifiques qui se sont opposés à l'opération. Lors d'une conversation franche avec Blair, chacun a évoqué ses problèmes politiques. Au Royaume-Uni, le parti conservateur commençait à remettre en question la politique du Premier ministre à l'égard de l'Irak et, bien que le Premier ministre ait rassuré Bush en lui disant qu'il le soutenait à 100 %, il était clair qu'il y avait un effort croissant pour freiner la machine de guerre.

Conférence de presse de Bush et Blair lors de la visite d'État de Bush au Royaume-Uni
De retour à la Maison Blanche le 22 novembre, il était certain d'avoir le pouvoir d'agir et encore plus certain que le monde le remercierait de l'avoir fait. Mais le président restait bloqué : lancer une action militaire maintenant, perturber le processus de l'ONU brûlerait trop de ponts et, bien que Bush ait essayé d'ignorer les ramifications politiques, il n'aimait pas l'image d'une guerre pendant une année électorale. Il s'est rappelé qu'un survivant de l'holocauste lui avait dit qu'en tant que président, il avait l'obligation morale d'agir. Et à tous ceux qui protestaient et aux législateurs qui affirmaient que leur opposition à la guerre était motivée par le souci des droits de l'homme, le recours à la force pour éliminer un homme qui gazait les Kurdes et massacrait les chiites à l'aide d'hélicoptères de combat ne posait aucun problème au président. L'élimination d'un tel homme ferait certainement avancer la cause des droits de l'homme et, en tant que président, il chercherait à obtenir un changement de régime en Irak. Mais il n'était pas convaincu qu'une invasion était la seule méthode pour y parvenir. Le mécontentement de Powell, Rice, Card et Rove ainsi que des hauts responsables militaires quant aux implications politiques et militaires du lancement d'une invasion dans ces circonstances, ces préoccupations étaient réelles et ne pouvaient pas être mises de côté facilement.
Rummy et Dick seraient frustrés, mais Bush a reconnu que la balle avait été sérieusement perdue, que les renseignements et l'argument des armes de destruction massive qu'ils avaient utilisé avec insistance pour justifier la guerre n'étaient tout simplement pas assez solides pour justifier à eux seuls une guerre aux yeux du public américain, que l'argument n'était pas gagnant et que Bush ne pouvait tout simplement plus en entendre davantage. Le président s'est adressé à ses adjoints et leur a dit que, bien qu'il n'ait pas retiré la guerre de la table, une invasion militaire de grande envergure de l'Irak n'était pas à l'ordre du jour dans l'immédiat. Les faucons étaient consternés, car pour eux, la légitimité américaine était en jeu, ils clignaient des yeux face à la tromperie de Saddam et risquaient de le payer cher. Le président les a rassurés en leur disant que les États-Unis s'étaient engagés à faire respecter la résolution de l'ONU et qu'ils ne manqueraient pas à leur parole, et qu'ils ne laisseraient pas non plus Saddam s'en tirer en s'engageant à continuer à soutenir un changement de régime en Irak[2].
Les coups de sabre allaient se poursuivre, mais les plans de guerre seraient pour l'instant mis en veilleuse, un important contingent de troupes resterait au Koweït et en Arabie Saoudite (près de 40 000) et les agences de renseignement et les équipes de la CIA redoubleraient d'efforts dans leurs opérations en Irak. L'administration était à cheval sur deux lignes de pensée : elle avait réussi à faire face à Saddam Hussein en soutenant l'ONU par les armes, même s'il représentait toujours une menace matérielle pour les États-Unis et qu'il fallait le démettre de ses fonctions. Une chose était sûre, Saddam y voyait sa victoire : "L'Irak a triomphé des ennemis de la nation (arabe) et de ses ennemis qui n'ont pas réussi à détruire notre peuple par leurs mensonges", a-t-il déclaré.

Peinture murale de Saddam Hussein
...
Au cours des trois dernières années, les États-Unis ont apporté leur soutien aux opposants aux talibans dans le cadre du programme secret de la CIA, l'opération Mercury. Les États-Unis ont fourni des armes, des camions, des hélicoptères, de la nourriture, du matériel médical et des conseillers militaires aux forces anti-talibans de l'Alliance du Nord dirigée par Ahmad Shah Massoud. Ces efforts ont été couronnés de succès et ont pris de l'ampleur. Les forces de Massoud se sont développées grâce à l'aide et à l'afflux de migrants en provenance de l'Afghanistan contrôlé par les talibans, ainsi qu'à l'argent fourni, qui a permis de gagner le soutien des seigneurs de guerre afghans locaux. Bien que l'administration Bush ait convenu avec le Pakistan que son objectif n'était pas un changement de régime, les résultats de l'aide et des bombardements parlaient d'eux-mêmes. La destruction des installations aériennes et des garnisons militaires des talibans dans le nord a permis à Massoud de passer à l'offensive là où ses troupes détenaient de solides avantages sur le champ de bataille. Grâce à des conseillers militaires clandestins, les forces de Massoud se sont préparées à lancer une attaque pour reprendre des territoires et s'emparer des bastions talibans dans le nord de l'Afghanistan. L'Amérique a augmenté l'aide envoyée à l'Alliance du Nord dans le cadre de l'opération Mercure et, parallèlement aux conseillers, la CIA a envoyé des paramilitaires pour aider l'Alliance du Nord et éventuellement localiser, tuer ou capturer les chefs terroristes qui avaient échappé à la mort lors des frappes. Le président a secrètement autorisé l'envoi de troupes sur le terrain en Afghanistan.
La première preuve de la supériorité de l'armée de Masoud est apparue lorsque ses forces ont lancé une attaque après le début du Ramadan sur Kunduz, une grande ville de 300 000 habitants qui permettait aux talibans de contrôler l'aide internationale transitant par le Tadjikistan et qui est devenue l'un des plus grands bastions des talibans avec une présence estimée à 15 000 combattants, dont une forte minorité de combattants étrangers, Les forces de l'Alliance du Nord, profitant de leur supériorité aérienne désormais incontestée (son aéroport et ses garnisons étant l'un de ceux détruits par les Américains) ont assiégé la ville. Les dirigeants de l'Alliance du Nord ont proposé de négocier une reddition, mais les talibans ont rejeté la demande, leur chef, le mollah Omar, ayant donné l'ordre de ne pas se rendre, appelant ses partisans à "choisir la mort plutôt que de se soumettre aux fascistes". "La bataille pour l'Afghanistan se poursuivait, plus sanglante que jamais.

Forces de l'Alliance du Nord (à gauche) Forces des Talibans (à droite)
[1] Le parti islamiste ne se forme pas.
[2] Le 11 septembre a changé Bush et l'a fait passer d'un "conservateur compatissant" à un idéaliste néoconservateur. Certains ont parlé d'une transformation religieuse. ITTL : il déteste Saddam mais n'a pas le zèle nécessaire pour envahir l'Irak afin de l'éliminer.
Explosions et coups de feu secouent le complexe militaire américain dans la capitale saoudienne
Par l'Associated Press
23 septembre 2003
RIYADH, Arabie Saoudite - Le jour de la fête nationale de l'Arabie Saoudite, des assaillants ont pénétré dans un complexe des forces américaines et alliées de la coalition et ont fait exploser plusieurs camions et voitures piégés, dans le complexe du village d'Eskan, situé juste à l'extérieur de Riyad, la capitale du Royaume saoudien, qui abritait du personnel militaire américain et d'autres forces de la coalition. Les bombes et les tirs ont fait au moins 18 morts et plus de 200 blessés, selon un responsable hospitalier.
Plus d'une centaine d'Américains auraient été grièvement blessés et le ministère de la défense s'attend à ce que le bilan s'alourdisse au fur et à mesure que les recherches se poursuivent dans les décombres. Les attaquants ont pu pénétrer dans le complexe à bord de véhicules équipés d'explosifs avant de prendre d'assaut plusieurs immeubles d'habitation à l'aide de ces véhicules et de coups de feu avant de faire exploser les explosifs présents à l'intérieur de deux camions et d'une voiture, provoquant plusieurs grands cratères qui ont entraîné la destruction de deux bâtiments et en ont endommagé de nombreux autres.
Tous les morts et les blessés étaient américains, selon les responsables du Pentagone, mais le gouvernement saoudien a déclaré que certains des blessés étaient d'autres nationalités, notamment britanniques.
"Nous ne savons pas combien de personnes sont blessées, mais nous en avons reçu plus de 200 et leur nombre ne cesse d'augmenter", a déclaré par téléphone à l'Associated Press un responsable de l'hôpital de la Garde nationale de Riyad, sans s'identifier. "Nous sommes complets maintenant, il n'y a plus de place pour d'autres victimes."
De la fumée s'élève encore dans le ciel nocturne depuis les ruines du complexe fortement clôturé et gardé, situé juste à côté d'une base aérienne gérée par les États-Unis, tandis que des hélicoptères tournoient au-dessus de la zone, balayant le sol à l'aide d'un projecteur à la recherche d'autres assaillants potentiels. Des centaines de militaires américains, de policiers saoudiens et de membres de la garde nationale saoudienne bouclent la zone, tandis que des ambulances arrivent en urgence.
Le complexe héberge plus de 2 000 soldats américains et a récemment accueilli le siège du Commandement central des États-Unis, qui a commandé l'opération Desert Badger, la mission militaire menée par les forces américaines et britanniques pour frapper des cibles dans l'Irak voisin.
Les autorités américaines se sont déclarées préoccupées par la possibilité de nouvelles attaques, et le département d'État a ordonné le départ d'Arabie saoudite de tout le personnel américain non essentiel et des membres de leur famille. "Nous sommes très préoccupés par la possibilité de nouvelles attaques", a déclaré un responsable américain. Il n'a pas voulu être plus précis.
Le président Bush a déclaré que l'attentat "avait été très bien planifié" et s'est engagé à traduire les auteurs en justice. "Les États-Unis trouveront les assassins et ils apprendront ce que signifie la justice américaine", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé dans l'Indiana.
L'explosion semble être la pire attaque terroriste contre des Américains au Moyen-Orient depuis l'attentat à la bombe contre le personnel militaire américain dans le complexe d'appartements des tours de Khobar, également en Arabie saoudite, en 1996, qui avait fait 19 morts. L'attentat est survenu à un moment de grande tension au Moyen-Orient, concernant à la fois les inspections d'armes en cours en Irak et les négociations en cours entre Israël et la Palestine.
Les responsables du ministère de la défense à Washington ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas connaître avec certitude le groupe responsable de l'attaque, mais les responsables saoudiens ont semblé rejeter la responsabilité sur le réseau terroriste Al-Qaïda, l'organisation terroriste officiellement dirigée par l'exilé saoudien Oussama ben Laden qui a été tué par une frappe aérienne des États-Unis il y a cinq ans. Le directeur du FBI, Robert Mueller, a déclaré que "ce qu'il faut retenir de la nuit dernière, c'est qu'Al-Qaïda et d'autres réseaux terroristes sont toujours là et veulent toujours nous frapper". Al-Qaïda s'oppose au gouvernement saoudien et à la présence de l'armée américaine dans le pays.
Le président George W. Bush s'adresse au public après l'attentat du village d'Eskan.
L'attaque terroriste en Arabie saoudite s'est produite à un moment de fortes tensions au Moyen-Orient, alors que les États-Unis se préparaient à affronter l'Irak, voisin de l'Arabie saoudite, et son dictateur Saddam Hussein. Immédiatement après, certains étaient prêts à croire le pire de Saddam et le soupçonnaient d'avoir perpétré l'attaque contre les troupes américaines. Certains responsables de la Maison Blanche étaient prêts à partager cette opinion, eux qui cherchaient un lien entre l'Irak et le terrorisme. Toutefois, les services de police saoudiens et américains ont rapidement jeté un froid sur ces soupçons et rejeté la responsabilité sur le réseau terroriste Al-Qaida. Les Saoudiens ont affirmé avoir déjà démantelé de nombreuses cellules d'Al-Qaida en Arabie saoudite et il était de notoriété publique qu'au cours des trois dernières années, une insurrection de faible ampleur couvait dans le pays, sous la forme d'attentats à la bombe et de meurtres occasionnels de touristes, de fonctionnaires et d'hommes d'affaires occidentaux. Mais l'attentat d'Eskan Village s'est distingué comme le plus meurtrier à ce jour. Les autorités américaines savaient pertinemment que plusieurs réseaux terroristes anti-américains avaient des liens avec le Royaume, notamment avec des mécènes et des sympathisants riches et puissants.
Al-Qaida est né de la colère contre la présence américaine en Arabie saoudite, pays qui abrite les deux lieux les plus sacrés de l'islam. Oussama ben Laden, le fondateur du groupe, avait fait de l'expulsion des forces américaines de la péninsule arabique son objectif principal. Cette thèse a été reprise par les dirigeants ultérieurs d'Al-Qaida et d'autres groupes dissidents. Le royaume saoudien a toléré les sentiments anti-américains et un nombre croissant d'analystes américains de la politique étrangère ont critiqué le lien inquiétant entre la richesse saoudienne et les attaques terroristes et ont noté le nombre de jeunes Saoudiens qui ont participé à des activités militantes mondiales, comme ceux qui ont été arrêtés dans le New Jersey en 2002. Le royaume s'est efforcé de nier l'existence d'une telle menace terroriste ou d'un lien avec des groupes terroristes dans l'espoir d'éviter l'opprobre associé à l'aveu d'une insurrection anti-occidentale et de ne pas imposer une répression potentiellement déstabilisante à ces groupes.
Le FBI a été dépêché sur place pour corroborer les affirmations du gouvernement saoudien. Les précédents attentats perpétrés dans la région ont toujours été difficiles à déterminer avec précision, les réseaux s'entrecroisant et travaillant parfois en conflit les uns avec les autres. L'Iran, l'Irak et la Syrie, entre autres pays, ont été soupçonnés d'aider les extrémistes saoudiens à déstabiliser le royaume, mais aucune preuve irréfutable n'a été trouvée. L'enquête du FBI sur l'attentat a fait plusieurs révélations : l'attentat avait été intimement planifié et les assaillants ont pu franchir les défenses du complexe parce qu'ils étaient habillés comme des gardes nationaux saoudiens, ce qui a fait craindre que des militants aient pénétré dans les rangs supérieurs de l'armée saoudienne. L'enquête a également révélé que plus d'une douzaine d'hommes ont pris part à l'attaque et que des preuves ADN ont permis de relier certains auteurs à Al-Qaida ou à des groupes militants similaires, mais les efforts déployés pour les relier à des groupes irakiens ou à d'autres groupes étatiques sont restés vains. Le niveau de complexité et d'organisation du complot était une marque de fabrique d'Al-Qaida. D'autres critiques ont été formulées à l'encontre du gouvernement saoudien, qui a été perçu comme un État protégeant l'implication éventuelle de son propre pays.
Bien qu'ils aient arrêté une douzaine de personnes impliquées, ils ont refusé d'enquêter sur d'éventuels liens avec l'extrémisme au sein des forces saoudiennes et le gouvernement n'a voulu extrader aucun d'entre eux vers les États-Unis pour qu'ils y soient jugés (les résultats des procès menés par les Saoudiens n'ont pas été rendus publics par la suite). Quelles que soient les conclusions des autorités saoudiennes ou du FBI, le lien avec Al-Qaida semblait définitivement confirmé lorsque, deux semaines plus tard, le groupe a publié des vidéos d'éloges funèbres de plusieurs militants décédés et s'est attribué le mérite de l'attentat dans une vidéo mettant en scène Saad ben Laden, l'un des nombreux fils de l'ancien chef d'Al-Qaida, qui reprenait les sentiments de son père en qualifiant le royaume d'"esclave des Juifs et des Américains" et en disant que l'attentat était "tout ce qu'ils méritaient".
Mohammed Atef, chef d'Al-Qaida, aux côtés de Saad Ben Laden
L'attentat en Arabie Saoudite et l'engagement public du président à traduire les assassins en justice ont obligé l'administration à réagir de manière visible. Le FBI, l'Arabie saoudite et de nombreuses autres agences de renseignement à travers le monde avaient rejeté toute la responsabilité sur Al-Qaida, malgré les efforts continus de certains responsables de la Maison Blanche pour maintenir l'attention du gouvernement sur l'Irak (ces groupes comprenaient différentes factions des dirigeants saoudiens qui étaient favorables à une invasion américaine de l'Irak), mais la cassette des aveux les a largement réduits au silence, même Cheney et Rumsfeld s'en sont remis à l'avis des agences selon lequel il fallait agir contre Al-Qaida, ne serait-ce que parce que la cassette avait nargué/menacé l'administration.
Le président espérait s'éloigner de ce qu'il considérait comme la politique de Clinton, qui ne faisait pas grand-chose, interrompue par des frappes aériennes occasionnelles, et qu'il qualifiait de "chasse aux mouches". Il considérait que frapper uniquement les agents d'Al-Qaida était une politique inefficace, que les États-Unis ne pouvaient pas se contenter de s'en prendre à des terroristes individuels, qu'ils devaient frapper l'organisation et punir les pays et les groupes responsables de les avoir aidés, afin de mettre les terroristes fermement au pied du mur au lieu de se contenter de réagir à chaque attaque, et Bush voulait inclure la possibilité de frapper les talibans dans le cadre de toute réponse américaine, les fondamentalistes islamiques qui contrôlaient la majeure partie de l'Afghanistan et accueillaient les nombreux groupes djihadistes présents dans le pays, dont Al-Qaida. Cette stratégie présidentielle était controversée, car aucune enquête officielle n'avait permis d'établir que les actions d'Al-Qaida étaient dirigées par les talibans et les confronter publiquement pouvait provoquer une réaction brutale. Les talibans bénéficiaient du soutien de l'ensemble du monde musulman, y compris de certains alliés des États-Unis dans le Golfe, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le principal soutien des talibans était son voisin nucléaire, le Pakistan, d'où provenaient des milliers de volontaires, dont des agents des services de renseignement, qui aidaient activement le régime taliban.
Les précédentes frappes afghanes menées par Clinton en 1998 avaient tué des fonctionnaires pakistanais, le fait de diriger désormais les attaques contre les talibans en particulier pourrait tuer des dizaines de Pakistanais. La CIA craignait que cela ne provoque des troubles contre les Américains au Pakistan et n'en incite d'autres à rejoindre des groupes militants. Pour que les frappes soient efficaces en Afghanistan, il faudrait qu'elles traversent l'espace aérien pakistanais et qu'elles soient notifiées à l'avance pour éviter que les Pakistanais n'essaient d'abattre les missiles ou les avions américains, ce qui permettrait aux services de renseignements pakistanais d'informer les talibans de l'imminence des frappes, réduisant ainsi considérablement leur capacité à tuer des cibles de grande valeur.
Le président Bush a néanmoins exigé une réponse plus ferme et a demandé au département d'État d'approcher le président pakistanais Musharraf pour lui proposer de cesser de soutenir les talibans et, en échange, de favoriser de meilleures relations entre les deux pays. Musharraf s'était jusqu'à présent montré réticent à réduire le soutien aux talibans, préférant poursuivre sa politique de soutien aux talibans afin d'empêcher la formation d'un Afghanistan plus aligné sur l'Inde. Mais Musharraf ne pouvait pas nier l'énorme opportunité qui se présentait à lui.
Après la guerre du Cachemire de 2002, le général Musharraf a connu un niveau de popularité politique sans précédent au Pakistan depuis sa création et il a déjà utilisé ce capital politique pour rompre le pain avec les États-Unis, en aidant à la répression des groupes terroristes anti-américains au Pakistan et en chassant du pays les terroristes les plus ciblés (bien que de nombreux Américains faucons aient considéré ces mesures comme tièdes).
Les élections générales qui ont suivi au Pakistan ont été un triomphe pour le nouveau parti politique de Musharraf, qui a facilement battu les partis d'opposition de ses rivaux en exil, Nawaz Sharif et Benazir Butto[1], remportant 46 % des voix et donnant aux partis qui lui étaient favorables une large majorité. Pour légitimer davantage son règne, il a transféré certains pouvoirs exécutifs au Premier ministre afin de se présenter comme le dirigeant civil légitime du pays. Musharraf était conscient de la fragilité du système politique de son pays, de la nécessité de trouver un équilibre entre les préoccupations de sécurité régionale et le soutien interne aux talibans, mais il avait aussi ses propres objectifs de libéralisation et de croissance de l'économie pakistanaise, principalement en stimulant l'investissement. Un rapprochement à l'égard de l'Occident pourrait justement permettre d'atteindre cet objectif. Musharraf a donc conclu un accord avec les États-Unis pour permettre l'utilisation de son espace aérien pour des frappes militaires contre Al-Qaeda et certains affiliés des Talibans, mais a refusé de soutenir les efforts qui contribueraient à un changement de régime.
Les partisans de Musharraf dans la rue
Le président s'est montré satisfait de l'accord et a rapidement approuvé une mission visant à mener une vaste série de frappes militaires contre Al-Qaida en Afghanistan, ainsi que des frappes limitées contre les bases militaires et les installations d'entraînement des talibans, mais surtout pas contre les dirigeants talibans. La mission, baptisée "Justice infinie", a été menée à bien le 12 novembre 2003 de manière spectaculaire. Les frappes ont commencé au cœur de la nuit et ont été sensiblement plus importantes que celles de 1998, afin de montrer que le président actuel était plus concerné que son prédécesseur. Des jets supersoniques ont décollé des porte-avions américains en mer. Des bombardiers B-2 sont venus d'aussi loin que la Californie et des missiles de croisière ont été tirés depuis des sous-marins américains. Tous avaient pour mission d'éliminer les camps d'entraînement des terroristes et certains campements militaires des talibans.
Le président a fait cette annonce depuis la salle du conseil des ministres : "Sur mon ordre, l'armée américaine a entamé des frappes contre des camps d'entraînement terroristes ainsi que contre certaines installations militaires en Afghanistan utilisées pour aider ces groupes terroristes. Ces actions soigneusement ciblées visent à empêcher l'utilisation de l'Afghanistan comme base d'opérations terroristes... En détruisant les camps et les installations, nous ferons en sorte qu'il soit plus difficile pour le réseau terroriste de former de nouvelles recrues et de coordonner ses plans diaboliques... La récente attaque contre des soldats américains a été planifiée et ordonnée par ces groupes et ils en paieront le prix".
Pendant 18 heures, 30 cibles, dont des camps d'entraînement, des bases aériennes et des garnisons, ont été frappées dans tout l'Afghanistan, dans une grande démonstration de la puissance brute de la plus grande puissance militaire du monde. Des images d'explosions floues ont été diffusées par les réseaux de télévision depuis les montagnes afghanes. Lorsqu'on lui a demandé si l'administration avait atteint son objectif, le secrétaire à la défense, M. Rumsfeld, s'est félicité de la mission : "elle a été couronnée de succès, toutes les cibles ont été touchées et tous nos avions sont revenus sains et saufs". Le puissant tir de barrage a été jugé beaucoup plus efficace pour détruire les camps et les bases que les précédentes frappes de missiles de croisière en raison de la puissance de feu et de la précision accrues, mais pour ce qui est d'atteindre des cibles de premier plan et des chefs terroristes comme Khalid Sheik Mohammed, Abu Zubaydah, Muhammed Atef et Saaf Bin Laden, ils ont tous échappé à la mort. Peut-être les organisations terroristes s'attendaient-elles à des frappes et s'étaient-elles repliées sur elles-mêmes, ou peut-être avaient-elles été informées, mais quoi qu'il en soit, les groupes ont échappé au sort de leur premier émir et n'ont subi qu'un minimum de pertes. Les frappes contre les bases aériennes et les garnisons militaires des talibans ont eu beaucoup plus de succès, puisqu'elles ont permis de détruire ou de mettre hors service des bases aériennes dans le nord et autour de la capitale, Kaboul, ainsi que de détruire la moitié de la force aérienne des talibans, faisant environ 300 victimes parmi les militants.
(De gauche à droite) Bombardier B-2 en vol, avion décollant d'un porte-avions et lancement de missiles de croisière
Carte des frappes en Afghanistan
La réaction mondiale aux frappes a été une fois de plus mitigée. Sur le plan intérieur, les frappes ont reçu un soutien uniforme de la part des dirigeants des deux partis, même si les démocrates doutaient de la position de l'administration sur l'Irak. Ils ont salué l'engagement du président en faveur de la justice en Afghanistan, utilisant parfois un langage chargé : "Il s'agit d'une action justifiée, bien planifiée et responsable du président, et je l'en félicite", a déclaré Bob Graham, l'un des principaux démocrates et l'un des plus fervents critiques de la politique irakienne. Dans une déclaration commune, les dirigeants démocrates ont affirmé que "l'Amérique se devait de réagir et nous soutenons cette opération". Même le leader du Sénat, M. Daschle, qui faisait obstruction à la résolution de guerre du président sur l'Irak, a fait preuve de déférence à l'égard du président, tout en veillant à ne pas lui laisser les coudées franches : "Cette mission bénéficie d'un soutien bipartisan évident et d'un raisonnement clair ... nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les militaires américains". Au niveau mondial, la réaction a été celle, prévisible, des alliés traditionnels de l'Amérique, tandis que les nations musulmanes et les groupes islamiques, ainsi que les autres grandes puissances que sont la Russie et la Chine, se sont opposés à ce qu'ils ont appelé une réaction préventive, et une nouvelle journée de manifestations anti-américaines a éclaté dans le monde islamique.
L'attaque du village d'Eskan et l'opération Infinite Justice qui a suivi ont encore compliqué la politique interne de la Maison Blanche, où tous les personnages clés examinaient les perspectives d'une action militaire dans un deuxième pays et évaluaient les options pour faire face à la crise du désarmement irakien. L'équipe de Hans Blix a continué à rechercher en Irak des armes interdites par l'ONU. Dans un second rapport, Blix a détaillé ses efforts, notant que l'Irak devenait de plus en plus belliqueux, ce qui ralentissait le rythme des inspections. La Maison Blanche a qualifié cette situation de "dernière partie de leur jeu de dupes" et a vu dans la lenteur des inspections une tentative de désintérêt de la part de la communauté internationale. Blix a précisé que l'Irak s'était montré plus ouvert lors des entretiens et, après quelques allers-retours sur les missiles irakiens, l'Irak a accepté en principe de détruire les missiles mais a déclaré ne pas savoir comment s'y prendre, un parfait exemple de ce que Blix a appelé une "conformité peu enthousiaste" (l'Irak a peu après procédé à la destruction des missiles).
Sculptures de cire de George Bush, Colin Powell et Saddam Hussein
Mais pour la Maison Blanche, les questions relatives au respect des règles par Saddam n'étaient qu'une note de bas de page, la question n'était plus de savoir s'il fallait agir, mais comment et quand. Malheureusement, plusieurs obstacles se sont dressés sur la route de l'administration. Les inspections en cours sous la direction de Blix devraient être interrompues si les États-Unis frappaient l'Irak, inspections qui gagnaient du terrain et bénéficiaient du soutien de l'opinion publique en dépit des récriminations de Blix et des États-Unis. Les États-Unis ne disposeraient que d'une petite coalition pour une action militaire à grande échelle. Seuls les Britanniques pourraient se joindre à eux pour une invasion immédiate, avec le soutien éventuel des forces spéciales d'un autre pays européen. Si une action militaire devait être lancée, le calendrier devenait difficile à gérer. Les troupes étaient introduites au Koweït à un rythme lent afin de ne pas éveiller les soupçons, mais il y avait un désaccord considérable entre le secrétaire à la défense Rumsfeld et l'état-major général sur le nombre de troupes nécessaires pour une opération militaire suffisamment rapide, Le nouveau calendrier de Rumsfeld prévoyait que les troupes seraient prêtes à partir à la mi-novembre pour une attaque éclair sur Bagdad (un calendrier encore retardé par l'attaque d'Eskan), mais les généraux voulaient plus de troupes et une phase de campagne aérienne dédiée, semblable à celle de la guerre du Golfe de 1991, pour détruire les forces irakiennes avant les opérations terrestres, ce qui repousserait l'invasion au moins jusqu'à la nouvelle année.
Enfin, la question de la victoire se posait. Tout le monde était certain que les Etats-Unis écraseraient l'armée irakienne, mais le niveau de résistance auquel ils seraient confrontés faisait l'objet de vifs débats, depuis le tableau idyllique défendu par les faucons, selon lequel les forces américaines seraient accueillies par des fleurs dans les rues, jusqu'aux préparatifs apocalyptiques effectués par l'armée, selon lesquels les forces américaines seraient confrontées à des barrages d'armes chimiques et feraient le siège de ville en ville. Le Congrès avait refusé de donner le feu vert au président et l'opinion publique était généralement opposée à une invasion - environ 30 à 40 % y étaient favorables dans les circonstances actuelles, mais l'équipe Bush était persuadée que ce chiffre changerait si l'action commençait. Mais il était impensable de ne rien faire et de permettre à Saddam d'aller jusqu'au bout de sa course.
Le président a tout à fait le droit d'ordonner une opération militaire sans l'autorisation du Congrès, comme l'ont fait Clinton, son père et Reagan. L'invasion de la Grenade, du Panama et d'Haïti étaient des opérations rapides dans les Caraïbes, l'arrière-cour de l'Amérique. Même lors de la guerre du Golfe, où le président H.W. Bush a menacé d'entrer en guerre sans le soutien du Congrès, il disposait de l'autorité de l'ONU pour soutenir la légalité de ses actions. Bush Jr disposait de quelques échappatoires juridiques, la loi de libération de l'Irak ou la résolution originale de 1991, voire l'approbation récente de l'action américaine dans Desert Badger, pouvaient s'appliquer à une opération de plus grande envergure. Cheney a souligné que le président avait eu recours à la force armée plus de 200 fois et que le Congrès n'avait approuvé la guerre que cinq fois, mais Bush savait que les conséquences politiques pourraient être graves, en particulier si certaines des estimations les plus pessimistes concernant les pertes américaines se produisaient au cours d'une année électorale, Certains démocrates ont utilisé des termes très durs : "Si le président agit contre la volonté du Congrès et du peuple américain, il sera destitué par le Congrès", a déclaré Daniel Inouye (le sénateur qui a perdu un bras pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était un fervent opposant à une guerre contre l'Irak), L'opposition du Congrès s'est concentrée sur les enquêtes concernant les renseignements erronés utilisés par l'équipe du secrétaire d'État adjoint Paul Wolfowitz et les éventuelles fuites de renseignements visant à obtenir un soutien en faveur d'une guerre, et des accusations ont même été lancées sur Internet selon lesquelles l'administration Bush aurait délibérément abattu les pilotes américains dans le cadre d'une attaque sous faux drapeau. L'action militaire serait certainement d'une ampleur inégalée depuis la guerre du Viêt Nam et, quelle que soit l'issue de la journée, les États-Unis se retrouveraient à occuper un pays de la taille de la France et la règle de Powell, paraphrasée par la régle de la poterie, selon laquelle "si on la casse, on l'achète", resterait en suspens. La situation serait d'autant plus délicate que c'est son père qui avait fixé la norme pour l'obtention de l'autorisation du Congrès. Le président devait prendre une décision, soit se conformer à la non-décision du Congrès, soit procéder à une manœuvre unilatérale pour conduire la nation à la guerre.
Saddam, désarmé ou non, était une menace, un ennemi juré de l'Amérique, il menaçait ses voisins, payait des terroristes palestiniens et tirait sur nos avions. Il défiait effrontément les sanctions et l'ONU et dirigeait son peuple d'une main de fer brutale et trempée de sang, qu'il ait ou non des armes de destruction massive dans le passé. D'une manière ou d'une autre, nous devions faire face à la menace irakienne. Cheney et Rumsfeld ont insisté sur l'urgence en disant que le fait d'attendre permettrait à Saddam de mieux se préparer et pourrait saper le moral des forces américaines, mais il y avait des divergences importantes au sein de l'administration, de nombreux secrétaires d'État, dont Powell, et le secrétaire d'État aux finances: Paul O'Neil et l'état-major était divisé sur la décision ainsi que sur l'hostilité croissante du Congrès et l'opposition de l'opinion publique. Le président avait même été poussé par sa famille qui, bien sûr, le soutenait mais avait exprimé des craintes concernant une guerre (Bush s'est souvenu d'un moment gênant lorsqu'il a regardé 13 jours avec sa famille, un film rappelant les efforts de l'administration Kennedy pour éviter une guerre avec l'Union soviétique), même son père, qui donnait rarement des conseils sans qu'on les lui demande, pour ne pas être condescendant, lui avait dit d'être prudent dans sa ligne de conduite.
Tout le monde pouvait constater que le président se trouvait dans une situation délicate et qu'il était contraint de reconsidérer la voie à suivre. À plusieurs reprises, il a demandé au général Tommy Franks quelle était la date la plus tardive possible pour le début d'une action militaire, ce à quoi Franks a répondu : "Monsieur le Président, nous pouvons y aller à tout moment, mais nous préférerions y aller avant février". L'emploi du temps du président était plus serré que jamais, entre la campagne, la législation et les réunions sur l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et l'Afghanistan, il n'y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Le président s'est rendu au Royaume-Uni pour une visite d'État à la suite de l'opération "Justice infinie", un voyage qui a été assombri par les milliers de manifestants pacifiques qui se sont opposés à l'opération. Lors d'une conversation franche avec Blair, chacun a évoqué ses problèmes politiques. Au Royaume-Uni, le parti conservateur commençait à remettre en question la politique du Premier ministre à l'égard de l'Irak et, bien que le Premier ministre ait rassuré Bush en lui disant qu'il le soutenait à 100 %, il était clair qu'il y avait un effort croissant pour freiner la machine de guerre.
Conférence de presse de Bush et Blair lors de la visite d'État de Bush au Royaume-Uni
De retour à la Maison Blanche le 22 novembre, il était certain d'avoir le pouvoir d'agir et encore plus certain que le monde le remercierait de l'avoir fait. Mais le président restait bloqué : lancer une action militaire maintenant, perturber le processus de l'ONU brûlerait trop de ponts et, bien que Bush ait essayé d'ignorer les ramifications politiques, il n'aimait pas l'image d'une guerre pendant une année électorale. Il s'est rappelé qu'un survivant de l'holocauste lui avait dit qu'en tant que président, il avait l'obligation morale d'agir. Et à tous ceux qui protestaient et aux législateurs qui affirmaient que leur opposition à la guerre était motivée par le souci des droits de l'homme, le recours à la force pour éliminer un homme qui gazait les Kurdes et massacrait les chiites à l'aide d'hélicoptères de combat ne posait aucun problème au président. L'élimination d'un tel homme ferait certainement avancer la cause des droits de l'homme et, en tant que président, il chercherait à obtenir un changement de régime en Irak. Mais il n'était pas convaincu qu'une invasion était la seule méthode pour y parvenir. Le mécontentement de Powell, Rice, Card et Rove ainsi que des hauts responsables militaires quant aux implications politiques et militaires du lancement d'une invasion dans ces circonstances, ces préoccupations étaient réelles et ne pouvaient pas être mises de côté facilement.
Rummy et Dick seraient frustrés, mais Bush a reconnu que la balle avait été sérieusement perdue, que les renseignements et l'argument des armes de destruction massive qu'ils avaient utilisé avec insistance pour justifier la guerre n'étaient tout simplement pas assez solides pour justifier à eux seuls une guerre aux yeux du public américain, que l'argument n'était pas gagnant et que Bush ne pouvait tout simplement plus en entendre davantage. Le président s'est adressé à ses adjoints et leur a dit que, bien qu'il n'ait pas retiré la guerre de la table, une invasion militaire de grande envergure de l'Irak n'était pas à l'ordre du jour dans l'immédiat. Les faucons étaient consternés, car pour eux, la légitimité américaine était en jeu, ils clignaient des yeux face à la tromperie de Saddam et risquaient de le payer cher. Le président les a rassurés en leur disant que les États-Unis s'étaient engagés à faire respecter la résolution de l'ONU et qu'ils ne manqueraient pas à leur parole, et qu'ils ne laisseraient pas non plus Saddam s'en tirer en s'engageant à continuer à soutenir un changement de régime en Irak[2].
Les coups de sabre allaient se poursuivre, mais les plans de guerre seraient pour l'instant mis en veilleuse, un important contingent de troupes resterait au Koweït et en Arabie Saoudite (près de 40 000) et les agences de renseignement et les équipes de la CIA redoubleraient d'efforts dans leurs opérations en Irak. L'administration était à cheval sur deux lignes de pensée : elle avait réussi à faire face à Saddam Hussein en soutenant l'ONU par les armes, même s'il représentait toujours une menace matérielle pour les États-Unis et qu'il fallait le démettre de ses fonctions. Une chose était sûre, Saddam y voyait sa victoire : "L'Irak a triomphé des ennemis de la nation (arabe) et de ses ennemis qui n'ont pas réussi à détruire notre peuple par leurs mensonges", a-t-il déclaré.
Peinture murale de Saddam Hussein
...
Au cours des trois dernières années, les États-Unis ont apporté leur soutien aux opposants aux talibans dans le cadre du programme secret de la CIA, l'opération Mercury. Les États-Unis ont fourni des armes, des camions, des hélicoptères, de la nourriture, du matériel médical et des conseillers militaires aux forces anti-talibans de l'Alliance du Nord dirigée par Ahmad Shah Massoud. Ces efforts ont été couronnés de succès et ont pris de l'ampleur. Les forces de Massoud se sont développées grâce à l'aide et à l'afflux de migrants en provenance de l'Afghanistan contrôlé par les talibans, ainsi qu'à l'argent fourni, qui a permis de gagner le soutien des seigneurs de guerre afghans locaux. Bien que l'administration Bush ait convenu avec le Pakistan que son objectif n'était pas un changement de régime, les résultats de l'aide et des bombardements parlaient d'eux-mêmes. La destruction des installations aériennes et des garnisons militaires des talibans dans le nord a permis à Massoud de passer à l'offensive là où ses troupes détenaient de solides avantages sur le champ de bataille. Grâce à des conseillers militaires clandestins, les forces de Massoud se sont préparées à lancer une attaque pour reprendre des territoires et s'emparer des bastions talibans dans le nord de l'Afghanistan. L'Amérique a augmenté l'aide envoyée à l'Alliance du Nord dans le cadre de l'opération Mercure et, parallèlement aux conseillers, la CIA a envoyé des paramilitaires pour aider l'Alliance du Nord et éventuellement localiser, tuer ou capturer les chefs terroristes qui avaient échappé à la mort lors des frappes. Le président a secrètement autorisé l'envoi de troupes sur le terrain en Afghanistan.
La première preuve de la supériorité de l'armée de Masoud est apparue lorsque ses forces ont lancé une attaque après le début du Ramadan sur Kunduz, une grande ville de 300 000 habitants qui permettait aux talibans de contrôler l'aide internationale transitant par le Tadjikistan et qui est devenue l'un des plus grands bastions des talibans avec une présence estimée à 15 000 combattants, dont une forte minorité de combattants étrangers, Les forces de l'Alliance du Nord, profitant de leur supériorité aérienne désormais incontestée (son aéroport et ses garnisons étant l'un de ceux détruits par les Américains) ont assiégé la ville. Les dirigeants de l'Alliance du Nord ont proposé de négocier une reddition, mais les talibans ont rejeté la demande, leur chef, le mollah Omar, ayant donné l'ordre de ne pas se rendre, appelant ses partisans à "choisir la mort plutôt que de se soumettre aux fascistes". "La bataille pour l'Afghanistan se poursuivait, plus sanglante que jamais.
Forces de l'Alliance du Nord (à gauche) Forces des Talibans (à droite)
[1] Le parti islamiste ne se forme pas.
[2] Le 11 septembre a changé Bush et l'a fait passer d'un "conservateur compatissant" à un idéaliste néoconservateur. Certains ont parlé d'une transformation religieuse. ITTL : il déteste Saddam mais n'a pas le zèle nécessaire pour envahir l'Irak afin de l'éliminer.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 26: Seulement en Californie.

37e gouverneur de Californie Gray Davis
En 2002, à l'issue d'une longue et âpre campagne électorale, Gray Davis a été réélu gouverneur de Californie face à l'homme d'affaires républicain Bill Simon. La campagne de Gray Davis a surmonté l'apathie généralisée des électeurs de l'État et les faibles taux de participation dans les bureaux de vote. La victoire du gouverneur sortant n'était pas vraiment une surprise dans le climat électoral favorable aux démocrates de 2002 dans cet État à tendance libérale, mais la déception dans les urnes entre le choix de Davis, embourbé dans un scandale de "pay for play", et celui de Simon, inexpérimenté et entrepreneur faisant l'objet d'une enquête pour fraude, a fortement diminué le taux de participation des électeurs. Au lendemain de cette victoire à la Pyrrhus, le Golden State a connu des montagnes russes politiques sans précédent.
Le second mandat de M. Davis a été assombri dès le départ par une série de problèmes qui pesaient sur lui. La crise énergétique californienne, qui s'est déroulée entre 2000 et 2001, a été de loin le plus grand frein à la popularité de Davis. La Californie, pourtant grand exportateur d'énergie, a commencé à souffrir d'énormes hausses de prix et de coupures d'électricité. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence et, pour résoudre la crise, a commencé à acheter de l'électricité à des prix exorbitants, contribuant ainsi à la crise simultanée de l'endettement de la Californie, créée par le krach des "dot com" qui avait alimenté le boom économique de l'État dans les années 90, ainsi que par les programmes gouvernementaux et les réductions d'impôts de Davis. La cause de la crise énergétique a été attribuée à une seule entreprise, le grand E, Enron. Avant son krach historique, l'un des nombreux stratagèmes d'Enron consistait à manipuler le marché californien de l'énergie. Enron, ainsi que d'autres entreprises du secteur de l'énergie, s'efforçaient de restreindre délibérément la production d'énergie de l'État, ce qui a entraîné des pannes d'électricité et des hausses de prix. La manipulation du marché, la déréglementation et la privatisation qui prévalaient avant l'arrivée de Davis (et dont Enron s'était fait le champion), ainsi que le retard pris par le gouverneur pour faire face à la crise, ont considérablement multiplié les dégâts et les retombées politiques pour Davis.
La deuxième décision qui a fait de M. Davis un titulaire polarisé et réellement impopulaire a été la solution qu'il a apportée à la crise de la dette mentionnée plus haut, à savoir l'augmentation des impôts. Désireux d'augmenter les recettes de l'État, le gouverneur a pris des mesures unilatérales pour augmenter les frais d'immatriculation des véhicules, dont le montant moyen a triplé, passant de 70 à 210 dollars. M. Davis a déclaré que cette taxe était nécessaire pour entretenir les routes : "Sans cette augmentation, nous serions confrontés à une grave situation d'urgence en matière de sécurité publique", mais son explication n'a pas suffi à certains : "L'État n'a pas droit à cet argent", a déclaré le sénateur Tom McClintock lors d'une conférence de presse. Tom McClintock s'est adressé aux journalistes dans le hall du bureau du procureur général, où il a déposé des propositions d'initiatives visant à ramener le taux d'imposition à 1 dollar ou à l'abolir complètement. "Ils enfreignent la loi en s'en emparant". La crise des jumelles et l'augmentation des taxes ont fait chuter la popularité de Davis à un niveau très bas de 26 %, six mois seulement après sa réélection.
Ce mécontentement populaire s'est accompagné de la loi californienne sur le rappel, qui permet aux électeurs de révoquer un représentant élu à la suite d'une pétition. Davis a même fait face à une pétition en 1999, mais la colère s'est toujours éteinte avant que le nombre requis de signatures ne soit atteint. Mais aujourd'hui, Davis a frustré la majorité des groupes conservateurs de l'État, en bloquant les efforts visant à promulguer des lois plus strictes sur l'immigration et à mettre en œuvre des lois sur le contrôle des armes à feu. Une initiative visant à révoquer le gouverneur a été soutenue par des élus républicains, dont le représentant Darrell Issa, qui a fait don de millions de dollars au mouvement, et les signatures ont afflué : "Gray Davis est aussi populaire que le SRAS à l'heure actuelle en Californie", a déclaré un collaborateur de M. Issa. "Il n'y aura pas de problème pour obtenir les signatures dont nous avons besoin". M. Davis a également essuyé des critiques sur sa gauche, qui le percevait comme un modéré corrompu et soumis aux intérêts des entreprises, ce qui expliquait sa lenteur à résoudre la crise énergétique. Pour eux, il s'agissait d'un "médian dont la grande vision politique commence et se termine par le désir de n'offenser personne, surtout pas ceux qui ont un chéquier", a déclaré la célèbre éditorialiste libérale Arianna Huffington.
Les opposants à la révocation ont tenté de détourner la responsabilité de la crise de Davis : il n'a pas créé la bulle Internet ni déréglementé le marché de l'énergie, c'est la faute de l'ancien gouverneur républicain et des dirigeants d'Enron, accusant l'ensemble de la campagne de révocation d'être une tentative de la part de certains républicains de destituer Davis de façon antidémocratique, la sénatrice Feinstein a apporté son soutien au gouverneur : "Une révocation ne produira rien de positif pour l'État de Californie". Le gouverneur Davis a quant à lui fait de son mieux pour rester à l'écart de toute cette affaire, estimant que le fait d'honorer la pétition ne ferait qu'attiser les flammes du mécontentement. La campagne bien organisée a pris son envol et a franchi le seuil requis, c'était une certitude, et une élection de rappel était en cours en Californie.

Militants pour et contre la révocation
Ce qui a suivi a été décrit dans les manchettes comme une "risée", un "carnaval" ou un "cirque". La barrière d'entrée pour un candidat à la révocation était beaucoup plus basse que pour une élection normale - il suffisait de quelques milliers de dollars pour être candidat. Le système des primaires serait entièrement ignoré, ce qui signifiait que le jour de l'élection, les électeurs voteraient simultanément sur la révocation ou non de Davis et sur le choix de son remplaçant. Le champ s'est rapidement rempli de centaines de remplaçants potentiels de Davis, certains crédibles, d'autres ridicules.
Le premier candidat à se manifester a été le représentant Darrell Issa, qui a financé la campagne et qui a ensuite dû faire face à de lourdes accusations selon lesquelles il avait financé l'ensemble de la campagne dans le seul but de se frayer un chemin jusqu'à la fonction. C'est la seule vraie question". Comme l'a dit un Californien. D'autres républicains se sont rapidement lancés dans la course : le sénateur Tom McClintock, un conservateur convaincu qui a régulièrement défié le gouverneur, et l'homme d'affaires républicain et commissaire de base-ball Peter Ueberroth ont mené une campagne d'outsider en promettant de sauver la Californie comme il avait sauvé les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.
En outre, l'ancien rival de Davis, Bill Simon, s'est également lancé dans la course. Le candidat qui a fait le plus parler de lui est l'ancien maire de Los Angeles, Richard Riordan, qui a perdu la campagne des primaires en 2002 à cause des publicités offensives de Davis visant à favoriser les candidats plus conservateurs pour les élections générales. Riordan était un républicain modéré bénéficiant du soutien implicite de responsables républicains, y compris de relations à la Maison Blanche, qui espéraient qu'un républicain centriste, favorable à l'avortement et aux droits des homosexuels, serait le mieux à même de battre Davis. La campagne des primaires de l'année précédente l'avait fait passer pour un RINO (Republican in name only), qui entretenait des relations étroites avec des démocrates, dont l'ancien président Clinton et le sénateur Feinstein, et qui avait également été sali par une relation suspecte avec Enron. Riordan a reçu très tôt le soutien d'un ami et voisin, le célèbre acteur républicain Arnold Schwarzenegger, qui avait été courtisé pour se présenter au poste de gouverneur, mais qui a invoqué des engagements cinématographiques antérieurs (une suite au film True Lies de 1994). Lors de l'émission Tonight Show avec Jay Leno, il a déclaré : "Je sais que les habitants de la Californie veulent une meilleure direction, ils veulent une grande direction". "Peu importe que vous soyez démocrate ou républicain, jeune ou vieux, nous voulons du changement et Riordan peut nous apporter ce changement... nous devons dire hasta la vista à Gray Davis".

Les républicains qui se sont lancés dans la course, (de gauche à droite) Peter Ueberroth, Darell Issa, Richard Riordan, Tom McClintock, Bill Simons.
Les efforts de M. Davis pour éviter le rappel en l'ignorant ont échoué et sont même allés à l'encontre de certains conseils des dirigeants démocrates, qui étaient conscients de son manque de popularité. Conscients qu'en cas de succès de l'opération de révocation, ils se retrouveraient avec un gouverneur républicain, ils étaient divisés sur la stratégie à adopter. Certains voulaient s'appuyer sur la procédure de destitution et proposer au sénateur Feinstein (l'homme politique le plus populaire de l'État) de se présenter comme remplaçant, mais elle a repoussé ces efforts et encouragé les démocrates à faire front commun contre la procédure de destitution. "Après avoir longuement réfléchi à ce rappel, à ses implications pour l'avenir et à sa nature malavisée, j'ai décidé de ne pas inscrire mon nom sur le bulletin de vote... Nous sommes unis contre le rappel du gouverneur Davis et nous demandons instamment à tous les candidats démocrates potentiels de ne pas se présenter sur le bulletin de rappel".
Peut-être le lieutenant-gouverneur Cruz Bustamante, qui entretenait des relations glaciales avec le gouverneur, avait-il depuis lors exclu de se présenter en déclarant qu'il soutenait le gouverneur à 100 % (Bustamante a déclaré plus tard qu'il avait envisagé de se présenter, mais qu'il avait repoussé l'idée lorsque les sondages ont penché en faveur de Davis). Il existait d'autres options que Feinstein ou Bustamante : la représentante Loretta Sanchez bénéficiait du soutien du parti au niveau national et avait lancé publiquement l'appel suivant : "Le rappel n'est pas une bonne chose. Mais en tant que démocrates, notre obligation est de veiller au bien-être de notre État, ce qui est encore plus important que notre devoir de défendre notre gouverneur". Ce qui implique qu'un démocrate devrait intervenir et se proposer si aucun ne le faisait. Malgré l'impopularité de Gray, la question du rappel n'était toujours pas tranchée et les sondages plaçaient Gray en tête avec un écart de 3 à 5 %. Le rebondissement de Davis a effrayé certains démocrates qui n'ont pas voulu se lancer dans la course, notamment la sénatrice Barbara Boxer, qui a qualifié la révocation de "blague pas drôle".
En fin de compte, seul un démocrate élu a annoncé qu'il se présenterait, le commissaire aux assurances de l'État, John Garamendi, qui s'était déjà présenté deux fois au poste de gouverneur, mais qui n'a jamais déposé de dossier et qui a publiquement annulé sa candidature deux jours plus tard seulement (probablement à la suite d'une conversation musclée). Les démocrates avaient fait le tour de la question, mais ils ont réussi à maintenir l'unité du parti face aux républicains, ouvrant ainsi la porte à des candidats moins conventionnels. [1]

Démocrates éminents qui ne sont pas entrés dans la course (de gauche à droite). John Garamendi, Barbara Boxer, Dianne Feinstein, Cruz Bustamante, Loretta Sanchez.
Deux candidats se sont présentés pour représenter l'opposition libérale sur le bulletin de vote, le parti vert était représenté par Peter Camejo, un socialiste démocratique avoué (il se décrivait comme une pastèque, verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur). Il s'était présenté comme candidat au poste de gouverneur en 2002 et avait obtenu 5 % (le plus grand taux de participation d'un tiers depuis le parti de la Prohibition) et était arrivé en deuxième position devant les républicains dans plusieurs zones métropolitaines de Californie. Camejo et les Verts ont soutenu le rappel dès le début et ont essayé de se présenter comme l'opposition de gauche raisonnable à Gray Davis et ont adopté un ton plus modéré. Camejo pensait qu'en l'absence d'un candidat démocrate dans la course, c'était l'occasion rêvée pour un troisième parti de se lancer dans la course. Il y avait aussi l'autre candidate de gauche, l'écrivain, chroniqueuse et mondaine Arianna Huffington.
De conservatrice anti-Clinton (et ex-femme d'un ancien membre républicain du Congrès), elle était devenue une libérale anti-Bush qui avait soutenu les démocrates l'année précédente. Sa campagne a été curieuse : elle s'est présentée comme faisant ce que les démocrates traditionnels avaient refusé de faire, à savoir placer une opposition aux républicains sur le bulletin de vote, et a lancé une attaque contre les républicains : "Rien n'est plus risible que d'entendre les républicains qui se présentent blâmer l'irresponsabilité fiscale de Gray Davis pour tout ce qui concerne l'État, tout en ignorant l'orgie d'irresponsabilité fiscale qui se déroule à Washington sous la présidence de George W. Bush et du Congrès ... Ma campagne s'est déroulée sous le signe de l'ouverture et de la transparence. Mes amis démocrates ont raison : ce rappel est mené par une secte aigrie de fanatiques de droite qui ont fait une overdose de Kool-Aid sur les réductions d'impôts". Puis il y a eu les autres candidats, dont le baron du porno Larry Flynt qui s'est présenté comme un "colporteur de cochonneries qui se soucie des autres" et l'actrice porno Mary Carey qui a promis que "je peux vous promettre que tous les Californiens seront souriants et satisfaits de mon travail". Quant au comique Gallagher, il a mené une campagne de fond avec son slogan "Enfin, un gouverneur avec lequel on peut se saouler".

(En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre) Peter Camejo, Arianna Huffington, Leo Gallagher, Larry Flynt, Marey Carey
Le spectacle a attiré l'attention nationale, une course de 90 jours (beaucoup plus courte que n'importe quel cycle électoral américain normal), la course effrénée des candidats pour entrer dans la course, et le nombre même de candidats, ont fait que l'élection a généré sa propre économie, la chaîne Game Show a même lancé une émission intitulée "Qui veut être gouverneur de Californie" mettant en scène certains des candidats les plus ridicules. Et les données des sondages sur les candidats ont constamment changé. Les remplaçants potentiels de Davis étaient limités dans le montant des dons qu'ils pouvaient obtenir (21 000 dollars maximum par donateur), contrairement à Davis qui était illimité, ce qui favorisait les candidats disposant d'une fortune privée tels que Darell Issa, Bill Simons, Peter Ueberroth ou Arianna Huffington (ou même Flynt, qui a brièvement obtenu 3 %).
Le parti républicain a commencé à exhorter tous les candidats à s'écarter de son chemin, mais nombre d'entre eux se sont montrés trop têtus pour changer d'avis, Après une semaine de campagne, Bill Simons, qui avait battu Riordan lors des primaires républicaines de 2002, est meurtri par les allégations de fraude et l'idée qu'il avait déjà raté son coup : "Il y a trop de républicains dans cette course, et les habitants de notre État ne peuvent tout simplement pas prendre le risque de voir se perpétuer l'héritage de Gray Davis. Pour ces raisons, je pense qu'il est sage de se retirer". Cependant, il n'a pas soutenu Riordan, ce qui a permis à l'opposition plus conservatrice de Riordan de s'installer.
Le député Issa, qui a gagné des millions dans le secteur des alarmes automobiles, a fait une entrée fracassante en dépensant des millions pour attaquer Davis afin de se présenter comme le candidat républicain incontestable pour avoir soutenu la pétition de révocation bien avant Riordan et pour avoir présenté son programme au public. Il n'était pas non plus un orateur particulièrement doué, ce qui l'a amené à s'écarter du sujet, notamment lors d'un moment gênant où il a soulevé la question israélo-palestinienne avec des journalistes, et il a voté de manière conservatrice sur les armes à feu et le droit à l'avortement. McClintock, le candidat conservateur sur le plan fiscal, avec beaucoup moins de bagages que Riordan ou Issa, est arrivé en troisième position, à seulement quelques pour cent de Issa. Il a attiré ceux qui n'aimaient pas Issa par principe et a tiré le meilleur parti du retrait de Simon : "Nous avons un élan, notre message se construit et se répand dans toute la Californie", tandis qu'Ueberroth a également tenu bon : "Je suis le candidat qui maintiendra les emplois en Californie, il n'y a pas de meilleur candidat que moi". L'absence d'un candidat démocrate solide a peut-être joué un rôle dans l'état d'esprit des républicains, qui ont refusé de se retirer de la course s'il était impossible de jouer les trouble-fêtes.
Les candidats les plus en vue de la gauche, Huffington et Camejo, ont largement profité de l'absence d'un candidat démocrate officiel, avec respectivement 9 et 4 % des voix au début de la course. Les deux candidats ont accusé M. Davis et les républicains en lice d'être tous deux responsables des difficultés financières et économiques actuelles de l'État. Camejo - "La différence entre Davis et les Républicains est que Davis se dit démocrate" Huffington - "La dernière chose que la Californie peut se permettre est un gouverneur républicain qui réduira les programmes de dépenses et perpétuera les politiques désastreuses de Pete Wilson qui, franchement, ont été largement suivies par Gray Davis", Les deux candidats ont coopéré dans leur campagne et les faits ont montré que leurs arguments étaient perçus par le public. En effet, Mme Huffington a lancé une campagne publicitaire et un site web pour recueillir des dons, ce qui lui a permis de devancer les candidats républicains de moindre importance, et elle a eu accès aux chaînes de télévision et aux stations de radio nationales et locales pour faire passer son programme de lutte contre la corruption.
Les candidats se sont retrouvés pour le premier des cinq débats, six candidats majeurs se sont joints à eux, sans compter Riordan qui, en tête, avait l'intention de rester au-dessus de la mêlée et de ne pas plonger dans ce que les médias appelaient moins un cirque, et maintenant simplement une foire aux monstres. M. Davis a pris la parole lors d'une réunion séparée, au cours de laquelle il s'est engagé à faire un meilleur travail et à rester "en contact avec les électeurs". Les candidats se sont distingués à travers le spectre politique sur l'immigration et les lois sur les armes à feu. Pour sa part, M. Riordan a tenté de se définir comme le gouverneur qui attend dans les coulisses et de se forger une image non partisane, tout comme la campagne de M. Davis a utilisé les mêmes publicités qu'il y a un an pour dépeindre l'ensemble de la liste républicaine comme des conservateurs de Bush se préparant à faire reculer les politiques libérales de l'État.
Huffington et Camejo ont lancé leur campagne anti-corruption contre Davis, Riordan et Issa en soulignant les millions donnés à la campagne de Davis dans le passé par des groupes commerciaux : "Ce n'est rien d'autre que de la corruption légalisée, une fois que vous acceptez de l'argent de leur part, il y a un compromis". Davis a répondu en s'en prenant aux conservateurs et à Huffington en plaisantant sur leurs valeurs et son accent : "Nous avons besoin d'un gouverneur qui représente les valeurs de cet Etat et qui peut le prononcer". Le commentaire s'est retourné contre lui, Huffington, une immigrante grecque, l'ayant pris au sérieux : "Ce que Davis a dit est une insulte aux 9 millions de Californiens qui ne sont pas nés dans ce pays". M. Davis a été critiqué de toutes parts, y compris par les sénateurs démocrates de l'État qui se sont joints aux républicains pour demander des excuses, ce qu'il a fait.
Les hauts et les bas de l'élection ont resserré la course, la campagne de Davis pour le NON semblant élargir son avance tandis que les espoirs de Riordan s'effondraient en raison d'une campagne peu enthousiaste qui peinait à suivre le rythme rapide de l'élection. Issa et Riordan ont tenté de pousser l'autre à se retirer de la course en affirmant que les querelles intestines entre républicains nuisaient aux chances de rappel. McClintock, le favori des conservateurs de base, a répondu catégoriquement : "Je ne me bats pas contre des moulins à vent, il faut de la persévérance pour obtenir quoi que ce soit", Issa a envisagé de se retirer de la course avant de changer d'avis après avoir bénéficié d'un regain d'attention de la part des médias grâce à ses performances lors des débats, et après être devenu la cible d'une campagne de diffamation menée par des groupes militants pro-israéliens en raison de son héritage moyen-oriental et de ses opinions sur la question israélo-palestinienne (son bureau et son domicile ont été évacués à la suite d'une alerte à la bombe), et il est remonté à quelques points derrière Riordan.
Alors que les chances de Davis se réduisaient à mesure que l'élection approchait (son avance de 7 points était tombée à 4), le champ républicain se rétrécissait et la campagne du NON peinait à trouver un message percutant. Les démocrates ont commencé à craindre que leur stratégie d'union n'aboutisse à un gouverneur très conservateur, et beaucoup ont commencé à accorder un soutien implicite à la campagne Huffington, comme une sorte de solution de repli et comme un moyen d'inciter les électeurs susceptibles de voter NON à se rendre dans les bureaux de vote. Barbara Boxer a déclaré : "Nous ne voulons pas de Riordan ou d'Issa comme gouverneur et les démocrates, après avoir voté contre la révocation, devraient envisager de présenter un autre candidat à l'élection" ou, comme l'a dit un membre de son équipe, "Nous avons besoin d'un taux de participation élevé si nous voulons obtenir un mandat fort pour gouverner". La campagne de Mme Huffington, qui avait éclipsé celle de M. Camejo, du parti vert, a pris de l'ampleur en tant qu'outsider progressiste et a bénéficié de l'appui de célébrités, du soutien d'étudiants de base et de dons nationaux. Pour leur part, les conservateurs ont attaqué Huffington pour ses anciennes opinions conservatrices, notamment en matière d'immigration, mais ils ont également souligné que Riordan n'avait pas de politique d'immigration définie et qu'Issa et McClintock semblaient trop conservateurs pour l'État.

Les candidats Huffington, Riordan et Issa en campagne électorale
Dans les derniers jours de l'élection, une course folle s'est ensuivie, des centaines de milliers de Californiens se sont inscrits pour voter, dont beaucoup pour la première fois, et les candidats se sont empressés de se coiffer les uns les autres au poteau. Camejo, à la suite d'une alliance informelle, s'est retiré et a soutenu Huffington, la qualifiant de "meilleure occasion de changer les choses" (bien que Camejo ait déjà été inscrit sur le bulletin de vote). Ueberroth s'est également retiré, n'obtenant que 3 % des voix (soit un peu moins que Camejo), en tant que seul autre candidat modéré dans la course. Riordan a tenté de se présenter comme un modéré sain sur le plan fiscal, en mettant en avant ses huit années en tant que maire et en cherchant à rallier suffisamment de démocrates et de républicains centristes pour battre les autres candidats, mais son soutien de la base républicaine a chuté de façon spectaculaire et Issa a commencé à suivre la même tendance que lui, ce qui a constitué un retournement de situation spectaculaire.
L'ascension de Mme Huffington en tant que candidate de premier plan dans la campagne de rappel a conduit certains républicains à l'attaquer pour hypocrisie, car elle a mené une campagne qui visait "les grosses sociétés qui s'en sortent en ne payant pas leur juste part d'impôts". Alors que ses propres impôts montraient qu'elle n'avait payé que 771 dollars d'impôts sur le revenu. Huffington a affirmé que cela était dû à la fluctuation de ses revenus en raison de la vente de livres et de pertes d'entreprises, ainsi qu'à l'argent qu'elle a payé en impôts fonciers, et a rejeté la faute sur Riordan, qu'elle a appelé "M. Intérêt particulier" et a tenté de lier directement sa candidature à Enron par le biais des dons qu'il avait reçus et d'une réunion privée entre des républicains, dont Riordan, et l'ancien PDG d'Enron, Kenneth Lay, pour déréglementer davantage le marché de l'énergie en Californie ; Riordan a nié toute irrégularité.
À l'approche du jour du scrutin, l'incertitude quant à l'identité du remplaçant potentiel a semblé faire pencher la balance du côté de M. Davis, puisque le soutien à la révocation est tombé à environ 45 % et que sa cote de popularité est remontée après avoir atteint son niveau le plus bas au cours de l'été, peut-être en raison de la saison particulièrement meurtrière des incendies de forêt qui s'est installée. Les sondages réalisés auprès des candidats ont placé Riordan et Issa aux alentours de 30 %, tandis que Huffington se situait à 24 %.
Cependant, Davis, la Californie et le monde entier ont été choqués par la tournure des événements.
Avec un taux de participation extrêmement élevé dans tout l'État, la course a été serrée, mais les électeurs ont finalement décidé de révoquer Gray Davis. Pour la première fois dans l'histoire de l'État, le deuxième processus de révocation d'un gouverneur américain a été couronné de succès, avec une marge de 1,23 %, soit environ 97 000 voix. Les Californiens, fatigués des factures d'énergie élevées, des pannes d'électricité, des déficits et des augmentations d'impôts, ont voté pour un changement de direction. M. Davis, qui se présentait comme ayant "une expérience que l'argent ne peut pas acheter", a été contraint d'admettre que cette expérience n'était pas suffisante pour le public. "Les électeurs ont été bons avec moi, en m'élisant deux fois gouverneur, me permettant de servir 35 millions de personnes", a déclaré M. Davis sur CNN. "Je leur suis très reconnaissant, très reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée d'essayer de faire avancer l'État, et quel que soit leur jugement ce soir, je l'accepterai."
Mais la question de savoir qui remplacerait Davis était d'une certaine manière plus importante, le vote républicain s'étant réparti entre trois candidats. Arianna Stassinopoulos Huffington, écrivaine, mondaine et personnalité médiatique d'origine grecque, a été élue première femme gouverneur de Californie, l'État le plus peuplé du pays, battant les sondages avec une marge de 5 points pour devancer ses rivaux républicains. Mme Huffington, qui a mené une campagne discrète en faveur de réformes progressistes, a obtenu 29,9 % des voix. Elle a annoncé sa campagne d'outsider lors de l'émission de Larry King, en s'appuyant sur un mouvement populaire, sur l'attention des médias nationaux et locaux et sur une alliance stratégique de groupes de gauche pour remporter le scrutin. Je sais que je ne serai pas un gouverneur conventionnel", a-t-elle déclaré dans le discours qui a suivi sa victoire, "mais nous ne vivons pas une époque conventionnelle... Merci beaucoup à tous les habitants de la Californie d'avoir envoyé un message : l'argent ne peut pas acheter le pouvoir".
L'élection du 7 octobre a été le point culminant de l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire politique des États-Unis. L'ironie de la destitution n'a pas échappé à beaucoup ; le Washington Post l'a qualifiée de "destitution aux conséquences inattendues", car les efforts déployés par les républicains conservateurs purs et durs ont abouti à la destitution d'un démocrate modéré et à l'élection d'un démocrate progressiste. De nombreux facteurs ont dû être réunis pour qu'un gouverneur soit élu avec moins d'un tiers des voix : l'impopularité historique de Davis, l'incapacité du parti démocrate à présenter un candidat officiel, le désarroi des républicains à trouver un candidat solide, le taux de participation record favorisé par des événements locaux et nationaux (cela s'est produit au plus fort du mouvement anti-guerre). Les retombées seront considérables et mettront fin aux carrières politiques de Davis et Riordan, titans de la politique californienne, et propulseront la nouvelle venue Huffington, dont l'ascension a été qualifiée de "plus grande ascension d'un Grec depuis Icare".

Gray Davis cède à la suite de la révocation

2003 California Recall WikiBox

38e gouverneur de Californie Arianna Huffington
[1] dans notre chronologie Schwarzenneger a changé les perspectives de la course, son entrée dans la course a fait de lui le candidat républicain évident et la plupart des démocrates étaient certains que Davis était grillé.
37e gouverneur de Californie Gray Davis
En 2002, à l'issue d'une longue et âpre campagne électorale, Gray Davis a été réélu gouverneur de Californie face à l'homme d'affaires républicain Bill Simon. La campagne de Gray Davis a surmonté l'apathie généralisée des électeurs de l'État et les faibles taux de participation dans les bureaux de vote. La victoire du gouverneur sortant n'était pas vraiment une surprise dans le climat électoral favorable aux démocrates de 2002 dans cet État à tendance libérale, mais la déception dans les urnes entre le choix de Davis, embourbé dans un scandale de "pay for play", et celui de Simon, inexpérimenté et entrepreneur faisant l'objet d'une enquête pour fraude, a fortement diminué le taux de participation des électeurs. Au lendemain de cette victoire à la Pyrrhus, le Golden State a connu des montagnes russes politiques sans précédent.
Le second mandat de M. Davis a été assombri dès le départ par une série de problèmes qui pesaient sur lui. La crise énergétique californienne, qui s'est déroulée entre 2000 et 2001, a été de loin le plus grand frein à la popularité de Davis. La Californie, pourtant grand exportateur d'énergie, a commencé à souffrir d'énormes hausses de prix et de coupures d'électricité. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence et, pour résoudre la crise, a commencé à acheter de l'électricité à des prix exorbitants, contribuant ainsi à la crise simultanée de l'endettement de la Californie, créée par le krach des "dot com" qui avait alimenté le boom économique de l'État dans les années 90, ainsi que par les programmes gouvernementaux et les réductions d'impôts de Davis. La cause de la crise énergétique a été attribuée à une seule entreprise, le grand E, Enron. Avant son krach historique, l'un des nombreux stratagèmes d'Enron consistait à manipuler le marché californien de l'énergie. Enron, ainsi que d'autres entreprises du secteur de l'énergie, s'efforçaient de restreindre délibérément la production d'énergie de l'État, ce qui a entraîné des pannes d'électricité et des hausses de prix. La manipulation du marché, la déréglementation et la privatisation qui prévalaient avant l'arrivée de Davis (et dont Enron s'était fait le champion), ainsi que le retard pris par le gouverneur pour faire face à la crise, ont considérablement multiplié les dégâts et les retombées politiques pour Davis.
La deuxième décision qui a fait de M. Davis un titulaire polarisé et réellement impopulaire a été la solution qu'il a apportée à la crise de la dette mentionnée plus haut, à savoir l'augmentation des impôts. Désireux d'augmenter les recettes de l'État, le gouverneur a pris des mesures unilatérales pour augmenter les frais d'immatriculation des véhicules, dont le montant moyen a triplé, passant de 70 à 210 dollars. M. Davis a déclaré que cette taxe était nécessaire pour entretenir les routes : "Sans cette augmentation, nous serions confrontés à une grave situation d'urgence en matière de sécurité publique", mais son explication n'a pas suffi à certains : "L'État n'a pas droit à cet argent", a déclaré le sénateur Tom McClintock lors d'une conférence de presse. Tom McClintock s'est adressé aux journalistes dans le hall du bureau du procureur général, où il a déposé des propositions d'initiatives visant à ramener le taux d'imposition à 1 dollar ou à l'abolir complètement. "Ils enfreignent la loi en s'en emparant". La crise des jumelles et l'augmentation des taxes ont fait chuter la popularité de Davis à un niveau très bas de 26 %, six mois seulement après sa réélection.
Ce mécontentement populaire s'est accompagné de la loi californienne sur le rappel, qui permet aux électeurs de révoquer un représentant élu à la suite d'une pétition. Davis a même fait face à une pétition en 1999, mais la colère s'est toujours éteinte avant que le nombre requis de signatures ne soit atteint. Mais aujourd'hui, Davis a frustré la majorité des groupes conservateurs de l'État, en bloquant les efforts visant à promulguer des lois plus strictes sur l'immigration et à mettre en œuvre des lois sur le contrôle des armes à feu. Une initiative visant à révoquer le gouverneur a été soutenue par des élus républicains, dont le représentant Darrell Issa, qui a fait don de millions de dollars au mouvement, et les signatures ont afflué : "Gray Davis est aussi populaire que le SRAS à l'heure actuelle en Californie", a déclaré un collaborateur de M. Issa. "Il n'y aura pas de problème pour obtenir les signatures dont nous avons besoin". M. Davis a également essuyé des critiques sur sa gauche, qui le percevait comme un modéré corrompu et soumis aux intérêts des entreprises, ce qui expliquait sa lenteur à résoudre la crise énergétique. Pour eux, il s'agissait d'un "médian dont la grande vision politique commence et se termine par le désir de n'offenser personne, surtout pas ceux qui ont un chéquier", a déclaré la célèbre éditorialiste libérale Arianna Huffington.
Les opposants à la révocation ont tenté de détourner la responsabilité de la crise de Davis : il n'a pas créé la bulle Internet ni déréglementé le marché de l'énergie, c'est la faute de l'ancien gouverneur républicain et des dirigeants d'Enron, accusant l'ensemble de la campagne de révocation d'être une tentative de la part de certains républicains de destituer Davis de façon antidémocratique, la sénatrice Feinstein a apporté son soutien au gouverneur : "Une révocation ne produira rien de positif pour l'État de Californie". Le gouverneur Davis a quant à lui fait de son mieux pour rester à l'écart de toute cette affaire, estimant que le fait d'honorer la pétition ne ferait qu'attiser les flammes du mécontentement. La campagne bien organisée a pris son envol et a franchi le seuil requis, c'était une certitude, et une élection de rappel était en cours en Californie.
Militants pour et contre la révocation
Ce qui a suivi a été décrit dans les manchettes comme une "risée", un "carnaval" ou un "cirque". La barrière d'entrée pour un candidat à la révocation était beaucoup plus basse que pour une élection normale - il suffisait de quelques milliers de dollars pour être candidat. Le système des primaires serait entièrement ignoré, ce qui signifiait que le jour de l'élection, les électeurs voteraient simultanément sur la révocation ou non de Davis et sur le choix de son remplaçant. Le champ s'est rapidement rempli de centaines de remplaçants potentiels de Davis, certains crédibles, d'autres ridicules.
Le premier candidat à se manifester a été le représentant Darrell Issa, qui a financé la campagne et qui a ensuite dû faire face à de lourdes accusations selon lesquelles il avait financé l'ensemble de la campagne dans le seul but de se frayer un chemin jusqu'à la fonction. C'est la seule vraie question". Comme l'a dit un Californien. D'autres républicains se sont rapidement lancés dans la course : le sénateur Tom McClintock, un conservateur convaincu qui a régulièrement défié le gouverneur, et l'homme d'affaires républicain et commissaire de base-ball Peter Ueberroth ont mené une campagne d'outsider en promettant de sauver la Californie comme il avait sauvé les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.
En outre, l'ancien rival de Davis, Bill Simon, s'est également lancé dans la course. Le candidat qui a fait le plus parler de lui est l'ancien maire de Los Angeles, Richard Riordan, qui a perdu la campagne des primaires en 2002 à cause des publicités offensives de Davis visant à favoriser les candidats plus conservateurs pour les élections générales. Riordan était un républicain modéré bénéficiant du soutien implicite de responsables républicains, y compris de relations à la Maison Blanche, qui espéraient qu'un républicain centriste, favorable à l'avortement et aux droits des homosexuels, serait le mieux à même de battre Davis. La campagne des primaires de l'année précédente l'avait fait passer pour un RINO (Republican in name only), qui entretenait des relations étroites avec des démocrates, dont l'ancien président Clinton et le sénateur Feinstein, et qui avait également été sali par une relation suspecte avec Enron. Riordan a reçu très tôt le soutien d'un ami et voisin, le célèbre acteur républicain Arnold Schwarzenegger, qui avait été courtisé pour se présenter au poste de gouverneur, mais qui a invoqué des engagements cinématographiques antérieurs (une suite au film True Lies de 1994). Lors de l'émission Tonight Show avec Jay Leno, il a déclaré : "Je sais que les habitants de la Californie veulent une meilleure direction, ils veulent une grande direction". "Peu importe que vous soyez démocrate ou républicain, jeune ou vieux, nous voulons du changement et Riordan peut nous apporter ce changement... nous devons dire hasta la vista à Gray Davis".
Les républicains qui se sont lancés dans la course, (de gauche à droite) Peter Ueberroth, Darell Issa, Richard Riordan, Tom McClintock, Bill Simons.
Les efforts de M. Davis pour éviter le rappel en l'ignorant ont échoué et sont même allés à l'encontre de certains conseils des dirigeants démocrates, qui étaient conscients de son manque de popularité. Conscients qu'en cas de succès de l'opération de révocation, ils se retrouveraient avec un gouverneur républicain, ils étaient divisés sur la stratégie à adopter. Certains voulaient s'appuyer sur la procédure de destitution et proposer au sénateur Feinstein (l'homme politique le plus populaire de l'État) de se présenter comme remplaçant, mais elle a repoussé ces efforts et encouragé les démocrates à faire front commun contre la procédure de destitution. "Après avoir longuement réfléchi à ce rappel, à ses implications pour l'avenir et à sa nature malavisée, j'ai décidé de ne pas inscrire mon nom sur le bulletin de vote... Nous sommes unis contre le rappel du gouverneur Davis et nous demandons instamment à tous les candidats démocrates potentiels de ne pas se présenter sur le bulletin de rappel".
Peut-être le lieutenant-gouverneur Cruz Bustamante, qui entretenait des relations glaciales avec le gouverneur, avait-il depuis lors exclu de se présenter en déclarant qu'il soutenait le gouverneur à 100 % (Bustamante a déclaré plus tard qu'il avait envisagé de se présenter, mais qu'il avait repoussé l'idée lorsque les sondages ont penché en faveur de Davis). Il existait d'autres options que Feinstein ou Bustamante : la représentante Loretta Sanchez bénéficiait du soutien du parti au niveau national et avait lancé publiquement l'appel suivant : "Le rappel n'est pas une bonne chose. Mais en tant que démocrates, notre obligation est de veiller au bien-être de notre État, ce qui est encore plus important que notre devoir de défendre notre gouverneur". Ce qui implique qu'un démocrate devrait intervenir et se proposer si aucun ne le faisait. Malgré l'impopularité de Gray, la question du rappel n'était toujours pas tranchée et les sondages plaçaient Gray en tête avec un écart de 3 à 5 %. Le rebondissement de Davis a effrayé certains démocrates qui n'ont pas voulu se lancer dans la course, notamment la sénatrice Barbara Boxer, qui a qualifié la révocation de "blague pas drôle".
En fin de compte, seul un démocrate élu a annoncé qu'il se présenterait, le commissaire aux assurances de l'État, John Garamendi, qui s'était déjà présenté deux fois au poste de gouverneur, mais qui n'a jamais déposé de dossier et qui a publiquement annulé sa candidature deux jours plus tard seulement (probablement à la suite d'une conversation musclée). Les démocrates avaient fait le tour de la question, mais ils ont réussi à maintenir l'unité du parti face aux républicains, ouvrant ainsi la porte à des candidats moins conventionnels. [1]
Démocrates éminents qui ne sont pas entrés dans la course (de gauche à droite). John Garamendi, Barbara Boxer, Dianne Feinstein, Cruz Bustamante, Loretta Sanchez.
Deux candidats se sont présentés pour représenter l'opposition libérale sur le bulletin de vote, le parti vert était représenté par Peter Camejo, un socialiste démocratique avoué (il se décrivait comme une pastèque, verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur). Il s'était présenté comme candidat au poste de gouverneur en 2002 et avait obtenu 5 % (le plus grand taux de participation d'un tiers depuis le parti de la Prohibition) et était arrivé en deuxième position devant les républicains dans plusieurs zones métropolitaines de Californie. Camejo et les Verts ont soutenu le rappel dès le début et ont essayé de se présenter comme l'opposition de gauche raisonnable à Gray Davis et ont adopté un ton plus modéré. Camejo pensait qu'en l'absence d'un candidat démocrate dans la course, c'était l'occasion rêvée pour un troisième parti de se lancer dans la course. Il y avait aussi l'autre candidate de gauche, l'écrivain, chroniqueuse et mondaine Arianna Huffington.
De conservatrice anti-Clinton (et ex-femme d'un ancien membre républicain du Congrès), elle était devenue une libérale anti-Bush qui avait soutenu les démocrates l'année précédente. Sa campagne a été curieuse : elle s'est présentée comme faisant ce que les démocrates traditionnels avaient refusé de faire, à savoir placer une opposition aux républicains sur le bulletin de vote, et a lancé une attaque contre les républicains : "Rien n'est plus risible que d'entendre les républicains qui se présentent blâmer l'irresponsabilité fiscale de Gray Davis pour tout ce qui concerne l'État, tout en ignorant l'orgie d'irresponsabilité fiscale qui se déroule à Washington sous la présidence de George W. Bush et du Congrès ... Ma campagne s'est déroulée sous le signe de l'ouverture et de la transparence. Mes amis démocrates ont raison : ce rappel est mené par une secte aigrie de fanatiques de droite qui ont fait une overdose de Kool-Aid sur les réductions d'impôts". Puis il y a eu les autres candidats, dont le baron du porno Larry Flynt qui s'est présenté comme un "colporteur de cochonneries qui se soucie des autres" et l'actrice porno Mary Carey qui a promis que "je peux vous promettre que tous les Californiens seront souriants et satisfaits de mon travail". Quant au comique Gallagher, il a mené une campagne de fond avec son slogan "Enfin, un gouverneur avec lequel on peut se saouler".
(En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre) Peter Camejo, Arianna Huffington, Leo Gallagher, Larry Flynt, Marey Carey
Le spectacle a attiré l'attention nationale, une course de 90 jours (beaucoup plus courte que n'importe quel cycle électoral américain normal), la course effrénée des candidats pour entrer dans la course, et le nombre même de candidats, ont fait que l'élection a généré sa propre économie, la chaîne Game Show a même lancé une émission intitulée "Qui veut être gouverneur de Californie" mettant en scène certains des candidats les plus ridicules. Et les données des sondages sur les candidats ont constamment changé. Les remplaçants potentiels de Davis étaient limités dans le montant des dons qu'ils pouvaient obtenir (21 000 dollars maximum par donateur), contrairement à Davis qui était illimité, ce qui favorisait les candidats disposant d'une fortune privée tels que Darell Issa, Bill Simons, Peter Ueberroth ou Arianna Huffington (ou même Flynt, qui a brièvement obtenu 3 %).
Le parti républicain a commencé à exhorter tous les candidats à s'écarter de son chemin, mais nombre d'entre eux se sont montrés trop têtus pour changer d'avis, Après une semaine de campagne, Bill Simons, qui avait battu Riordan lors des primaires républicaines de 2002, est meurtri par les allégations de fraude et l'idée qu'il avait déjà raté son coup : "Il y a trop de républicains dans cette course, et les habitants de notre État ne peuvent tout simplement pas prendre le risque de voir se perpétuer l'héritage de Gray Davis. Pour ces raisons, je pense qu'il est sage de se retirer". Cependant, il n'a pas soutenu Riordan, ce qui a permis à l'opposition plus conservatrice de Riordan de s'installer.
Le député Issa, qui a gagné des millions dans le secteur des alarmes automobiles, a fait une entrée fracassante en dépensant des millions pour attaquer Davis afin de se présenter comme le candidat républicain incontestable pour avoir soutenu la pétition de révocation bien avant Riordan et pour avoir présenté son programme au public. Il n'était pas non plus un orateur particulièrement doué, ce qui l'a amené à s'écarter du sujet, notamment lors d'un moment gênant où il a soulevé la question israélo-palestinienne avec des journalistes, et il a voté de manière conservatrice sur les armes à feu et le droit à l'avortement. McClintock, le candidat conservateur sur le plan fiscal, avec beaucoup moins de bagages que Riordan ou Issa, est arrivé en troisième position, à seulement quelques pour cent de Issa. Il a attiré ceux qui n'aimaient pas Issa par principe et a tiré le meilleur parti du retrait de Simon : "Nous avons un élan, notre message se construit et se répand dans toute la Californie", tandis qu'Ueberroth a également tenu bon : "Je suis le candidat qui maintiendra les emplois en Californie, il n'y a pas de meilleur candidat que moi". L'absence d'un candidat démocrate solide a peut-être joué un rôle dans l'état d'esprit des républicains, qui ont refusé de se retirer de la course s'il était impossible de jouer les trouble-fêtes.
Les candidats les plus en vue de la gauche, Huffington et Camejo, ont largement profité de l'absence d'un candidat démocrate officiel, avec respectivement 9 et 4 % des voix au début de la course. Les deux candidats ont accusé M. Davis et les républicains en lice d'être tous deux responsables des difficultés financières et économiques actuelles de l'État. Camejo - "La différence entre Davis et les Républicains est que Davis se dit démocrate" Huffington - "La dernière chose que la Californie peut se permettre est un gouverneur républicain qui réduira les programmes de dépenses et perpétuera les politiques désastreuses de Pete Wilson qui, franchement, ont été largement suivies par Gray Davis", Les deux candidats ont coopéré dans leur campagne et les faits ont montré que leurs arguments étaient perçus par le public. En effet, Mme Huffington a lancé une campagne publicitaire et un site web pour recueillir des dons, ce qui lui a permis de devancer les candidats républicains de moindre importance, et elle a eu accès aux chaînes de télévision et aux stations de radio nationales et locales pour faire passer son programme de lutte contre la corruption.
Les candidats se sont retrouvés pour le premier des cinq débats, six candidats majeurs se sont joints à eux, sans compter Riordan qui, en tête, avait l'intention de rester au-dessus de la mêlée et de ne pas plonger dans ce que les médias appelaient moins un cirque, et maintenant simplement une foire aux monstres. M. Davis a pris la parole lors d'une réunion séparée, au cours de laquelle il s'est engagé à faire un meilleur travail et à rester "en contact avec les électeurs". Les candidats se sont distingués à travers le spectre politique sur l'immigration et les lois sur les armes à feu. Pour sa part, M. Riordan a tenté de se définir comme le gouverneur qui attend dans les coulisses et de se forger une image non partisane, tout comme la campagne de M. Davis a utilisé les mêmes publicités qu'il y a un an pour dépeindre l'ensemble de la liste républicaine comme des conservateurs de Bush se préparant à faire reculer les politiques libérales de l'État.
Huffington et Camejo ont lancé leur campagne anti-corruption contre Davis, Riordan et Issa en soulignant les millions donnés à la campagne de Davis dans le passé par des groupes commerciaux : "Ce n'est rien d'autre que de la corruption légalisée, une fois que vous acceptez de l'argent de leur part, il y a un compromis". Davis a répondu en s'en prenant aux conservateurs et à Huffington en plaisantant sur leurs valeurs et son accent : "Nous avons besoin d'un gouverneur qui représente les valeurs de cet Etat et qui peut le prononcer". Le commentaire s'est retourné contre lui, Huffington, une immigrante grecque, l'ayant pris au sérieux : "Ce que Davis a dit est une insulte aux 9 millions de Californiens qui ne sont pas nés dans ce pays". M. Davis a été critiqué de toutes parts, y compris par les sénateurs démocrates de l'État qui se sont joints aux républicains pour demander des excuses, ce qu'il a fait.
Les hauts et les bas de l'élection ont resserré la course, la campagne de Davis pour le NON semblant élargir son avance tandis que les espoirs de Riordan s'effondraient en raison d'une campagne peu enthousiaste qui peinait à suivre le rythme rapide de l'élection. Issa et Riordan ont tenté de pousser l'autre à se retirer de la course en affirmant que les querelles intestines entre républicains nuisaient aux chances de rappel. McClintock, le favori des conservateurs de base, a répondu catégoriquement : "Je ne me bats pas contre des moulins à vent, il faut de la persévérance pour obtenir quoi que ce soit", Issa a envisagé de se retirer de la course avant de changer d'avis après avoir bénéficié d'un regain d'attention de la part des médias grâce à ses performances lors des débats, et après être devenu la cible d'une campagne de diffamation menée par des groupes militants pro-israéliens en raison de son héritage moyen-oriental et de ses opinions sur la question israélo-palestinienne (son bureau et son domicile ont été évacués à la suite d'une alerte à la bombe), et il est remonté à quelques points derrière Riordan.
Alors que les chances de Davis se réduisaient à mesure que l'élection approchait (son avance de 7 points était tombée à 4), le champ républicain se rétrécissait et la campagne du NON peinait à trouver un message percutant. Les démocrates ont commencé à craindre que leur stratégie d'union n'aboutisse à un gouverneur très conservateur, et beaucoup ont commencé à accorder un soutien implicite à la campagne Huffington, comme une sorte de solution de repli et comme un moyen d'inciter les électeurs susceptibles de voter NON à se rendre dans les bureaux de vote. Barbara Boxer a déclaré : "Nous ne voulons pas de Riordan ou d'Issa comme gouverneur et les démocrates, après avoir voté contre la révocation, devraient envisager de présenter un autre candidat à l'élection" ou, comme l'a dit un membre de son équipe, "Nous avons besoin d'un taux de participation élevé si nous voulons obtenir un mandat fort pour gouverner". La campagne de Mme Huffington, qui avait éclipsé celle de M. Camejo, du parti vert, a pris de l'ampleur en tant qu'outsider progressiste et a bénéficié de l'appui de célébrités, du soutien d'étudiants de base et de dons nationaux. Pour leur part, les conservateurs ont attaqué Huffington pour ses anciennes opinions conservatrices, notamment en matière d'immigration, mais ils ont également souligné que Riordan n'avait pas de politique d'immigration définie et qu'Issa et McClintock semblaient trop conservateurs pour l'État.
Les candidats Huffington, Riordan et Issa en campagne électorale
Dans les derniers jours de l'élection, une course folle s'est ensuivie, des centaines de milliers de Californiens se sont inscrits pour voter, dont beaucoup pour la première fois, et les candidats se sont empressés de se coiffer les uns les autres au poteau. Camejo, à la suite d'une alliance informelle, s'est retiré et a soutenu Huffington, la qualifiant de "meilleure occasion de changer les choses" (bien que Camejo ait déjà été inscrit sur le bulletin de vote). Ueberroth s'est également retiré, n'obtenant que 3 % des voix (soit un peu moins que Camejo), en tant que seul autre candidat modéré dans la course. Riordan a tenté de se présenter comme un modéré sain sur le plan fiscal, en mettant en avant ses huit années en tant que maire et en cherchant à rallier suffisamment de démocrates et de républicains centristes pour battre les autres candidats, mais son soutien de la base républicaine a chuté de façon spectaculaire et Issa a commencé à suivre la même tendance que lui, ce qui a constitué un retournement de situation spectaculaire.
L'ascension de Mme Huffington en tant que candidate de premier plan dans la campagne de rappel a conduit certains républicains à l'attaquer pour hypocrisie, car elle a mené une campagne qui visait "les grosses sociétés qui s'en sortent en ne payant pas leur juste part d'impôts". Alors que ses propres impôts montraient qu'elle n'avait payé que 771 dollars d'impôts sur le revenu. Huffington a affirmé que cela était dû à la fluctuation de ses revenus en raison de la vente de livres et de pertes d'entreprises, ainsi qu'à l'argent qu'elle a payé en impôts fonciers, et a rejeté la faute sur Riordan, qu'elle a appelé "M. Intérêt particulier" et a tenté de lier directement sa candidature à Enron par le biais des dons qu'il avait reçus et d'une réunion privée entre des républicains, dont Riordan, et l'ancien PDG d'Enron, Kenneth Lay, pour déréglementer davantage le marché de l'énergie en Californie ; Riordan a nié toute irrégularité.
À l'approche du jour du scrutin, l'incertitude quant à l'identité du remplaçant potentiel a semblé faire pencher la balance du côté de M. Davis, puisque le soutien à la révocation est tombé à environ 45 % et que sa cote de popularité est remontée après avoir atteint son niveau le plus bas au cours de l'été, peut-être en raison de la saison particulièrement meurtrière des incendies de forêt qui s'est installée. Les sondages réalisés auprès des candidats ont placé Riordan et Issa aux alentours de 30 %, tandis que Huffington se situait à 24 %.
Cependant, Davis, la Californie et le monde entier ont été choqués par la tournure des événements.
Avec un taux de participation extrêmement élevé dans tout l'État, la course a été serrée, mais les électeurs ont finalement décidé de révoquer Gray Davis. Pour la première fois dans l'histoire de l'État, le deuxième processus de révocation d'un gouverneur américain a été couronné de succès, avec une marge de 1,23 %, soit environ 97 000 voix. Les Californiens, fatigués des factures d'énergie élevées, des pannes d'électricité, des déficits et des augmentations d'impôts, ont voté pour un changement de direction. M. Davis, qui se présentait comme ayant "une expérience que l'argent ne peut pas acheter", a été contraint d'admettre que cette expérience n'était pas suffisante pour le public. "Les électeurs ont été bons avec moi, en m'élisant deux fois gouverneur, me permettant de servir 35 millions de personnes", a déclaré M. Davis sur CNN. "Je leur suis très reconnaissant, très reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée d'essayer de faire avancer l'État, et quel que soit leur jugement ce soir, je l'accepterai."
Mais la question de savoir qui remplacerait Davis était d'une certaine manière plus importante, le vote républicain s'étant réparti entre trois candidats. Arianna Stassinopoulos Huffington, écrivaine, mondaine et personnalité médiatique d'origine grecque, a été élue première femme gouverneur de Californie, l'État le plus peuplé du pays, battant les sondages avec une marge de 5 points pour devancer ses rivaux républicains. Mme Huffington, qui a mené une campagne discrète en faveur de réformes progressistes, a obtenu 29,9 % des voix. Elle a annoncé sa campagne d'outsider lors de l'émission de Larry King, en s'appuyant sur un mouvement populaire, sur l'attention des médias nationaux et locaux et sur une alliance stratégique de groupes de gauche pour remporter le scrutin. Je sais que je ne serai pas un gouverneur conventionnel", a-t-elle déclaré dans le discours qui a suivi sa victoire, "mais nous ne vivons pas une époque conventionnelle... Merci beaucoup à tous les habitants de la Californie d'avoir envoyé un message : l'argent ne peut pas acheter le pouvoir".
L'élection du 7 octobre a été le point culminant de l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire politique des États-Unis. L'ironie de la destitution n'a pas échappé à beaucoup ; le Washington Post l'a qualifiée de "destitution aux conséquences inattendues", car les efforts déployés par les républicains conservateurs purs et durs ont abouti à la destitution d'un démocrate modéré et à l'élection d'un démocrate progressiste. De nombreux facteurs ont dû être réunis pour qu'un gouverneur soit élu avec moins d'un tiers des voix : l'impopularité historique de Davis, l'incapacité du parti démocrate à présenter un candidat officiel, le désarroi des républicains à trouver un candidat solide, le taux de participation record favorisé par des événements locaux et nationaux (cela s'est produit au plus fort du mouvement anti-guerre). Les retombées seront considérables et mettront fin aux carrières politiques de Davis et Riordan, titans de la politique californienne, et propulseront la nouvelle venue Huffington, dont l'ascension a été qualifiée de "plus grande ascension d'un Grec depuis Icare".
Gray Davis cède à la suite de la révocation
2003 California Recall WikiBox
38e gouverneur de Californie Arianna Huffington
[1] dans notre chronologie Schwarzenneger a changé les perspectives de la course, son entrée dans la course a fait de lui le candidat républicain évident et la plupart des démocrates étaient certains que Davis était grillé.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 27: Assez!
Géorgie

Président de la Géorgie, Edouard Chevardnadze
Edouard Chevardnadze, ancien secrétaire du parti communiste géorgien et ancien ministre des affaires étrangères de l'Union soviétique. Il était autrefois le champion des réformateurs libéraux bolcheviques, devancé seulement par Gorbatchev, mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Edouard est retourné chez lui, dans la nouvelle République indépendante de Géorgie où, après quelques bousculades sanglantes, il a consolidé son pouvoir dans le jeune pays. Confronté à la fois à des mouvements de résistance pro-russes dans le nord et à une insurrection islamique dans la Tchétchénie voisine, Edouard a conduit la Géorgie vers une alliance avec l'Ouest.
Son règne a été contesté, des alliés de ses ennemis politiques ont tenté de l'assassiner à trois reprises, l'économie a beaucoup souffert de la dissolution de l'Union soviétique et la criminalité et la corruption ont été endémiques, perpétuées par les copains politiques d'Edouard. Chevardnadze s'est enrichi, lui et sa famille, à tel point que la Géorgie a été classée parmi les nations les plus corrompues du monde. En l'espace de dix ans, Chevardnadze a transformé un espoir sincère en un mépris bouillonnant. Les personnes qui croyaient qu'Edouard sortirait la nation de son passé soviétique délabré et l'amènerait vers un avenir prospère, se sont vues rabrouées et ont reçu des leçons sur la manière de se serrer la ceinture, tandis que le gouvernement pillait les caisses de l'Etat.
Ses 30 années de règne lui pesaient en 2003, il avait déjà été accusé de fraude électorale avant d'être réélu 3 ans plus tôt, et l'opinion publique n'avait fait que se retourner contre lui, son gouvernement subissant des défections en raison d'allégations de corruption et de manœuvres autoritaires. L'ancien ministre de la justice Mikheil Saakashvili a commencé à défier le gouvernement depuis l'opposition et le reste du parti politique de Chevardnadze s'est apparemment effondré, entraînant dans sa chute l'emprise du président sur le pouvoir. Le gouvernement géorgien était de plus en plus influencé par les groupes de pression qui opéraient dans le pays avec peu de restrictions, dont beaucoup poussaient le président à se retirer volontairement, ce à quoi Édouard a résisté, si bien que les ONG ont commencé à craindre qu'il ne se retire jamais et ont soutenu une action non violente pour provoquer le scénario serbe, des manifestations massives pour forcer Chevardnadze à démissionner. Cette opposition s'est reflétée dans les médias libres qui se sont montrés très critiques et ont ouvertement soutenu les groupes d'opposition. Le gouvernement a tenté de réprimer l'indépendance des médias, notamment lors d'un incident traumatisant au cours duquel un journaliste enquêtant sur la corruption du gouvernement a été assassiné, suivi d'une descente au siège des médias pour évasion fiscale présumée, ce qui a déclenché des protestations généralisées et contraint le président à limoger son cabinet, un événement qui a gravement ébranlé ses piliers de soutien.
Le gouvernement de Chevardnadze était de plus en plus isolé non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger, où des émissaires de l'administration Bush ont commencé à appeler à une transition ordonnée vers la démocratie et les prêts et l'aide étrangers ont commencé à diminuer alors que certains ont même commencé à accorder un soutien financier à des groupes pro-démocratiques en Géorgie.
Lors des élections de 2003, alors que l'on s'attendait à ce que Chevardnadze perde le pouvoir, l'administration Bush a envoyé des observateurs pour encourager le gouvernement à échanger le pouvoir de manière équitable et libre. Mais peu après l'ouverture des bureaux de vote, des rapports ont fait état de violences, d'intimidation des électeurs, de bourrage d'urnes et de purges des listes électorales à un point tel que même les dirigeants de l'opposition et parfois des quartiers entiers se sont retrouvés dans l'impossibilité de voter. Je pense que certains membres du gouvernement ne voulaient pas que ces élections se déroulent dans l'ordre parce qu'ils savaient qu'ils les perdraient", a déclaré un analyste électoral. Malgré le doigt sur la balance, le gouvernement a tout de même perdu la moitié de ses voix et les observateurs électoraux ont confirmé les allégations de truquage : "Ces élections n'ont malheureusement pas suffi à renforcer la crédibilité du processus électoral ou démocratique", et l'opposition a noté la disparité entre les sondages de sortie des urnes et les résultats définitifs, qui ont doublé le soutien apporté au gouvernement.
La désobéissance civile a commencé immédiatement, exigeant un nouveau scrutin et la démission immédiate de Chevardnadze. Ces actions se sont rapidement multipliées dans les rues, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de personnes manifestant toutes contre l'élection entachée d'irrégularités. Chevardnadze a lancé un avertissement, affirmant que les manifestants risquaient une guerre civile, et a menacé de déployer des soldats dans les rues de Tbilissi, une menace qu'il a mise à exécution. Cependant, lorsque les manifestants ont affronté les soldats, ils ont commencé à leur distribuer des roses, et ces derniers ont refusé de réprimer les manifestants. "Les gens embrassaient les policiers et les militaires, c'était vraiment spectaculaire", a déclaré Giorgi Kandelaki, un étudiant de 21 ans.
" Et bien sûr, les roses que les gens avaient avec eux, que Misha portait avec lui dans la salle du parlement, c'est à ce moment-là que les gens ont dit qu'il s'agissait d'une révolution des roses ". Le chef de l'opposition, Misha (Mikhail Saakashvili), a conduit un contingent de manifestants jusqu'au bâtiment du parlement pour en réclamer son ouverture. La foule de partisans a alors forcé l'entrée du bâtiment, obligeant le président à l'évacuer par crainte pour sa sécurité. Une fois à l'intérieur, les manifestants ont de nouveau lancé des appels à la démission du président.
Alors que le président était évacué par la porte arrière en direct à la télévision et que les manifestants contrôlaient l'hémicycle, il semblait que la "révolution des roses" était achevée et que le pouvoir avait changé de mains. Quelques jours plus tard, en échange de sa sécurité, Chevardnadze démissionne et, dans un curieux moment de l'histoire, souhaite bonne chance à son successeur : "Il faut faire plus que des discours, mais je lui souhaite chance et succès". De nouvelles élections ont été programmées, et c'est sans surprise que l'homme qui a mené la marche sur le parlement, Mikhaïl Saakachvili, s'est présenté pratiquement sans opposition et a remporté une ultra-majorité des voix, 96 %, avec un taux de participation élevé
Personne n'a été blessé et aucune goutte de sang n'a été versée, car les Géorgiens se sont débarrassés de leur ancien réformateur communiste devenu dirigeant kleptocrate en échange d'un dirigeant libéral explicitement pro-occidental, mais d'énormes problèmes subsistaient : la situation économique, les relations avec la Russie et la question non résolue du séparatisme dans les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, les accusations d'aide aux militants tchétchènes, les dirigeants régionaux indisciplinés et les reliquats des gouvernements antérieurs. L'avenir de la Géorgie restait incertain.

(Haut) Président de la Géorgie, Misha Saakashvili
Drapeau de la Géorgie (1990-2004), Drapeau de la Géorgie après 2004
Soudan

Président du Soudan Omar al-Bashir
Une nation souffrant d'un terrible conflit sectaire entre le nord et le sud, qui, en 30 ans, a détruit plus de 2 millions de vies par les balles, les bombes, les maladies et les famines. La majeure partie du pays a connu des souffrances indicibles en vivant dans une nation économiquement isolée et démunie. Au milieu de la guerre ethnique entre le nord et le sud, une deuxième guerre a éclaté dans la région occidentale du Darfour. À bout de souffle, le gouvernement soudanais a décidé d'armer les milices arabes pour mener une campagne anti-insurrectionnelle sanglante et, ce faisant, des milliers d'innocents ont été chassés de chez eux, battus, torturés et tués. Le Soudan n'a pas réussi à rembourser ses emprunts ni à mettre en œuvre les réformes économiques promises, ce qui l'a exclu du grand système financier, et son adhésion aux djihadistes anti-américains lui a fait perdre encore plus d'alliés. La monnaie a continué à perdre de la valeur et l'inflation a atteint 150 %, tandis que le président et ses conseillers continuaient à donner la priorité à l'escalade des menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays, alors que ses contraintes économiques le conduisaient à l'insolvabilité[1].
Le dictateur militaire Al-Bashir se trouvait dans une impasse et tentait désespérément de mettre un terme à l'un ou l'autre des conflits. Il a repris les négociations de paix avec les rebelles du sud et autorisé les représailles brutales au Darfour, notamment en accordant notoirement un soutien aérien pour écraser les insurgés. Ni l'une ni l'autre n'ont semblé apporter une solution immédiate à ses problèmes, les négociateurs sudistes estimant qu'ils ne recevaient pas de garanties territoriales ou de sécurité suffisantes, et M. Bashir lui-même estimant que l'armée soudanaise n'était pas encore vaincue et ne devait pas se retirer des territoires qu'elle détenait. L'insurrection au Darfour a également continué à s'intensifier, sans être freinée par les tactiques sanglantes des milices, et n'a fait qu'accroître l'infamie de Bashir dans le monde.

Rebelle du Darfour
Malgré les efforts de M. Bashir pour présenter le conflit du Darfour comme une simple escarmouche et dépeindre la réaction mondiale comme une persécution de la foi islamique du Soudan, la sphère internationale en a pris note et a rapidement condamné M. Bashir pour les actions de son pays. Les Nations unies ont publié un rapport détaillant les meurtres, les viols et l'incendie et le pillage systématiques de villages entiers. Elles ont déclaré que la situation était une catastrophe humanitaire, estimant que 1,5 million de civils étaient actuellement affectés par la situation et restaient hors de portée de l'aide. La communauté internationale a qualifié la campagne de "terre brûlée", de nettoyage ethnique explicite et de l'une des pires crises humanitaires au monde. Les voisins du Soudan sont devenus de plus en plus hostiles au régime et ont commencé à soutenir les opérations de maintien de la paix, afin de contenir toute extension potentielle du conflit. Des pétitions ont commencé à être adressées aux Nations unies pour demander un cessez-le-feu et l'arrêt de l'aide aux groupes paramilitaires, et un débat public sur la question de savoir si les actions constituaient un génocide a commencé à s'animer.
Aux États-Unis, l'administration Bush était réticente à qualifier l'action de génocide, car cette terminologie impliquait qu'une action militaire était nécessaire. Cette position était en rupture avec les républicains conservateurs préoccupés par la minorité chrétienne du Soudan, qui se sont unis aux démocrates pour qualifier l'action de génocide. Le sénateur démocrate et candidat à la présidence John Kerry a appelé à une action internationale : "Le monde n'a pas agi au Rwanda, à notre éternelle honte. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un autre point de crise, cette fois au Soudan. La région du Darfour, à l'ouest du Soudan, exige une attention et une action immédiates de la part du monde". L'administration Bush a qualifié ces actions de déplorables et a réitéré sa demande que M. Bashir reprenne les négociations et cesse de soutenir les militants, laissant entendre qu'elle pourrait demander un mandat des Nations unies pour résoudre la crise : "Notre administration cherchera toutes les solutions pour mettre fin à cette persécution et à cette atrocité au Soudan".
La pression internationale croissante, les campagnes militaires et le déclin de l'économie ont placé le président Bashir dans une situation de plus en plus isolée, alors que la communauté internationale débattait des moyens de contraindre Bashir à respecter la loi, les acteurs soudanais ont saisi l'occasion pour agir en premier. Le 29 mars 2004, des centaines de soldats sont entrés dans Khartoum, la capitale du Soudan, à bord de chars, de camions et à cheval. Un mélange de militaires réguliers et de paramilitaires a perpétré un coup d'État contre le président Bashir, s'emparant des bâtiments gouvernementaux et arrêtant plusieurs membres du gouvernement, y compris le président lui-même, suivi d'un message diffusé à la télévision et à la radio d'État par le secrétaire général du parti national islamique au pouvoir et principal conseiller du président aujourd'hui déchu, le docteur Hassan Al-Turabi. Turabi a expliqué que le président Bashir devait être renversé dans l'intérêt du "salut national". Ils ont justifié leurs actions en lançant une série d'allégations selon lesquelles Bashir faisait délibérément échouer les négociations de paix et se livrait à un nettoyage ethnique et à un génocide, avant de promettre que le pays s'engagerait à devenir une démocratie islamique constitutionnelle sous un régime civil légitime.
Bien que les comploteurs se soient parés de ces justifications morales, le monde extérieur n'avait pas l'espoir d'un retournement de situation. Turabi était un allié de longue date du président Bashir et était soupçonné d'être le cerveau de certaines des politiques les plus odieuses du régime. Les histoires de désaccord entre les deux hommes remontaient à plusieurs années et les rumeurs selon lesquelles le président tenterait de purger les islamistes purs et durs circulaient depuis cinq ans ; il était plus probable que Turabi ait profité de l'indignation mondiale et du mécontentement au sein de la faction ministérielle et militaire de Bashir pour orchestrer un coup d'État de palais plutôt qu'une révolution pro-démocratique.
Turabi a annoncé qu'il dirigerait un nouveau conseil de transition (comprenant plusieurs alliés de Bashir) avant un vote du Congrès et une élection d'urgence (que son parti et lui-même ont facilement remportée). Pour Turabi, ce coup d'État représentait l'aboutissement d'une quête de 40 ans visant à diriger le Soudan et à y achever la révolution islamique. N'étant plus soumis à un dictateur, il n'aurait plus besoin de faire preuve de modération, ayant joué un rôle clé dans de nombreux coups d'État au fil des ans et ayant fait des allers-retours dans les allées du pouvoir pendant des dizaines d'années, Longtemps présenté comme le maître des marionnettes de la politique soudanaise qui a orchestré son islamisation, il était désormais le chef de ce qui allait devenir la République islamique du Soudan. Quant à Bashir lui-même, il a été épargné par un destin sanglant et, une fois déposé, il a pu s'exiler en Arabie Saoudite.

(en haut) Président du Soudan Hassan al-Turabi
Drapeau de la République du Soudan 1970-2004, Drapeau de la République islamique du Soudan après 2004
Tchétchénie

Président de la Russie, Vladimir Poutine
Après la sanglante année 2002 marquée par l'insurrection tchétchène, le Kremlin espérait que le conflit commencerait à s'apaiser, surtout après les deux attaques terroristes massives de l'année : le siège du théâtre de Moscou, qui a frappé le cœur de la Russie et attiré les regards du monde entier en raison de son ampleur, et qui a fait prendre conscience de la guerre à de nombreux Russes, puis les nombreux attentats au camion piégé dans la capitale tchétchène Grozny, qui ont détruit le gouvernement de collaboration soutenu par la Russie et tué le président par intérim de l'époque et allié clé de la Russie, Akhmad Kadyrov. Sa mort a laissé un vide de pouvoir que le Kremlin devait rapidement combler pour mettre en œuvre ses plans de pacification du territoire. Cependant, la Tchétchénie était un dangereux mélange de loyautés croisées, entre les administrateurs bureaucratiques d'origine russe, les alliés du défunt Kadyrov, composés d'anciens séparatistes tchétchènes devenus complices du Kremlin, et la branche anti-Kadyrov des loyalistes russes de longue date. Chaque camp était le mieux représentée par le ministre des finances d'origine russe Sergey Abramov, qui est devenu le nouveau président par intérim de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, le fils du président décédé et le chef de facto de l'important groupe paramilitaire des Kadyrovsky, et le vétéran soviétique d'origine kazakhe Alu Alkhanov, qui avait soutenu les Russes en Tchétchénie depuis 1996 et qui était maintenant à la tête de la police tchétchène.
Un trio chaotique. Abramov considérait que son rôle était d'assurer la sécurité de la Tchétchénie et de reconstruire ses infrastructures. Mais la tâche s'annonçait ardue, compte tenu de la lutte pour le pouvoir, d'une insurrection incessante et des diktats/exigences de plus en plus sévères de Moscou.

(de gauche à droite) Sergey Abramov, Alu Alkhanov, Ramzan Kadyrov
Le monde entier a eu les yeux rivés sur ce conflit lorsqu'au début de l'année, le 3 janvier 2003, dix militants islamiques (pour la plupart des Algériens et des Marocains) sont entrés en France avec de faux passeports et ont attaqué l'ambassade de Russie à Paris. Ils étaient armés de pistolets, de grenades à gaz et de deux gilets-suicide supposés. Ils ont engagé une brève fusillade avec la police française et la sécurité russe avant d'entrer dans l'ambassade. L'ambassade était bien défendue, entourée de grilles et à l'épreuve des balles, ce qui a rendu la situation encore plus difficile lorsque les assaillants ont réussi à prendre le contrôle du bâtiment ainsi que 15 otages en inondant le bâtiment de gaz lacrymogène. Le chef de la cellule, Menad Benchellali, a exigé que la Russie se retire de la Tchétchénie et a menacé de faire exploser une arme chimique qu'il avait lui-même confectionnée si la police pénétrait dans le bâtiment[2].
La fusillade initiale et la menace "explosive" ont incité le gouvernement français à agir. Le gouvernement du président Jospin a été pris au dépourvu par l'attaque, étant donné que la police se concentrait principalement sur les extrémistes d'extrême-droite en pleine émergence sérieusement irrités par la victoire électorale de Jospin et son passé trotskiste, il a marché sur un fil en tant que président socialiste de la France en essayant de modérer le parti socialiste de certaines de ses tendances plus gauchistes (comme Blair au Royaume-Uni), notamment en adoptant une approche sévère à l'égard de la criminalité et en réorientant la politique étrangère française pour qu'elle soit plus conciliante envers l'Occident.
La menace extraordinaire que représentait le siège de l'ambassade a poussé les Français à tenter de négocier avec les assaillants, mais ils se sont trouvés dans l'impasse, n'étant pas en mesure de modifier la politique militaire de la Russie. Les pourparlers ont duré plusieurs jours et les militants se sont vu proposer de nombreuses options pour libérer les otages en échange d'une fuite vers un pays tiers ou même du paiement d'une rançon. Cependant, les assaillants étaient des idéologues déterminés et considérés comme probablement suicidaires. Après 13 jours de négociations infructueuses, le gouvernement a donné son accord pour que la Gendarmerie fasse une incursion dans l'ambassade. Au cours d'une fusillade spectaculaire retransmise à la télévision, la gendarmerie a écrasé l'ambassade sous un déluge de balles, tandis que les commandos ont lancé un assaut à partir d'hélicoptères, sauvant tous les otages, tuant trois assaillants et capturant les autres. Les gilets-suicide se sont révélés inopérants et la prétendue bombe à la ricine totalement inventée. Le président Jospin a félicité la police pour ses efforts dans une déclaration : "Le président exprime sa profonde gratitude aux forces armées françaises et à tous les services de l'État qui ont permis une solution rapide et pacifique à cette prise d'otages".

(à gauche) Hélicoptère de la gendarmerie française, (à droite) Ambassade de Russie à Paris
Le Kremlin cherchait à annexer pleinement et officiellement la Tchétchénie à la Fédération de Russie, mais ces plans ont été remis en question par la bataille pour le contrôle politique de Grozny, ainsi que par la poursuite des attaques terroristes, qui ont parfois rendu indiscernables les batailles militaires et politiques. Un attentat contre le cortège du président par intérim Abramov a jeté la suspicion sur les Kadyrovsky et les insurgés nationalistes, et un certain nombre d'assassinats ont tué des commandants russes, ce qui a éveillé les soupçons sur les milices pro-russes. Les forces russes ont été lâchées pour maintenir l'ordre dans le pays et se sont montrées très méfiantes et promptes à tirer les premières sur les Tchétchènes, quelle que soit leur allégeance, ce qui a donné lieu à des échanges de tirs entre les forces russes et les collaborateurs tchétchènes et à des attentats suicides continus contre les convois de troupes et les hôpitaux militaires qui ont fait grimper le nombre de victimes parmi les forces russes. Toutefois, à entendre les responsables russes, la guerre était terminée et le niveau de terreur était tout à fait normal.
Les observateurs occidentaux ont présenté un tableau plus sombre, décrivant une insurrection à peine contenue, des forces d'occupation brutales et des dirigeants davantage en guerre contre eux-mêmes. Lorsque le gouvernement russe a tenté d'organiser des élections présidentielles pour mettre un terme aux factions, la situation n'a fait qu'empirer : Abramov a survécu de justesse à une deuxième tentative d'assassinat lorsqu'une grenade a attaqué son entourage, ce qui l'a conduit à se retirer complètement de la scène publique et à diriger la Tchétchénie de l'extérieur, retardant ainsi définitivement les élections.
En réponse aux difficultés rencontrées, le Kremlin s'est emporté, accusant à nouveau l'Occident de sympathiser avec ses ennemis. Pendant le siège de l'ambassade, la Russie a exigé du gouvernement français qu'il mette fin aux négociations et qu'il extrade ensuite les combattants vers la Russie, ce que la France a refusé de faire. Le président Poutine s'est montré impénitent, définissant son ennemi comme des "criminels génocidaires" en cheville avec des terroristes internationaux pour atteindre leur objectif de nuire à la Russie, et s'est engagé à pacifier la Tchétchénie : "Nous terminerons certainement cette tâche. Les habitants de la Tchétchénie finiront par mener une vie normale et civilisée". La Russie a transformé la région en zone d'ombre pour les médias, afin de dissuader les journalistes de dénoncer les crimes de guerre russes présumés. Le président Bush a même proposé sa médiation en Tchétchénie : "Notre position en Tchétchénie est de trouver une solution pacifique [...] et pour cela, il faut que Vladimir Poutine abandonne l'approche actuelle. Les terroristes et les assassins doivent répondre de leurs actes, mais bombarder des réfugiés (en référence à une attaque signalée) est une erreur". La brutalité et le secret ont commencé à creuser un fossé entre la Russie et les autres pays occidentaux. Un ancien ministre russe a résumé la situation en disant que "le sang et la boue de la guerre de Tchétchénie ont laissé leur marque sur l'ensemble de sa présidence et, dans une certaine mesure, sur la nouvelle Fédération de Russie".
Aucune partie n'a montré de signes de soumission à l'autre, Shamil Basayev, le chef rebelle tchétchène non repenti, s'est attribué le mérite des attentats suicides en Russie, dont un spectaculaire à l'intérieur de la Douma de Moscou, juste en face du Kremlin, un incident qui a transformé tout Moscou en ville occupée, alors que la police et l'armée fouillaient chaque recoin de la métropole à la recherche d'autres poseurs de bombes. M. Basayev a réitéré son intention de perpétrer d'autres attentats encore plus effroyables : "La lutte contre nous se poursuit sans aucune règle, nous ne sommes donc liés par aucune obligation envers qui que ce soit et nous nous battrons de la manière que nous jugeons commode et nécessaire, jusqu'à ce qu'ils apprennent [...]".

(en haut) chef de l'insurrection tchétchène Shamil Basayev
(à gauche) Drapeau de la République tchétchène soutenue par la Russie, (à droite) Drapeau de la République tchétchène d'Ichkérie en exil
[1] ATL Le Soudan est de plus en plus isolé en raison de son association continue avec des groupes djihadistes, ce qui prolonge la guerre dans le sud et nuit davantage à son économie.
[2] La police française a bel et bien trouvé une cellule qui préparait un attentat similaire.
Géorgie
Président de la Géorgie, Edouard Chevardnadze
Edouard Chevardnadze, ancien secrétaire du parti communiste géorgien et ancien ministre des affaires étrangères de l'Union soviétique. Il était autrefois le champion des réformateurs libéraux bolcheviques, devancé seulement par Gorbatchev, mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Edouard est retourné chez lui, dans la nouvelle République indépendante de Géorgie où, après quelques bousculades sanglantes, il a consolidé son pouvoir dans le jeune pays. Confronté à la fois à des mouvements de résistance pro-russes dans le nord et à une insurrection islamique dans la Tchétchénie voisine, Edouard a conduit la Géorgie vers une alliance avec l'Ouest.
Son règne a été contesté, des alliés de ses ennemis politiques ont tenté de l'assassiner à trois reprises, l'économie a beaucoup souffert de la dissolution de l'Union soviétique et la criminalité et la corruption ont été endémiques, perpétuées par les copains politiques d'Edouard. Chevardnadze s'est enrichi, lui et sa famille, à tel point que la Géorgie a été classée parmi les nations les plus corrompues du monde. En l'espace de dix ans, Chevardnadze a transformé un espoir sincère en un mépris bouillonnant. Les personnes qui croyaient qu'Edouard sortirait la nation de son passé soviétique délabré et l'amènerait vers un avenir prospère, se sont vues rabrouées et ont reçu des leçons sur la manière de se serrer la ceinture, tandis que le gouvernement pillait les caisses de l'Etat.
Ses 30 années de règne lui pesaient en 2003, il avait déjà été accusé de fraude électorale avant d'être réélu 3 ans plus tôt, et l'opinion publique n'avait fait que se retourner contre lui, son gouvernement subissant des défections en raison d'allégations de corruption et de manœuvres autoritaires. L'ancien ministre de la justice Mikheil Saakashvili a commencé à défier le gouvernement depuis l'opposition et le reste du parti politique de Chevardnadze s'est apparemment effondré, entraînant dans sa chute l'emprise du président sur le pouvoir. Le gouvernement géorgien était de plus en plus influencé par les groupes de pression qui opéraient dans le pays avec peu de restrictions, dont beaucoup poussaient le président à se retirer volontairement, ce à quoi Édouard a résisté, si bien que les ONG ont commencé à craindre qu'il ne se retire jamais et ont soutenu une action non violente pour provoquer le scénario serbe, des manifestations massives pour forcer Chevardnadze à démissionner. Cette opposition s'est reflétée dans les médias libres qui se sont montrés très critiques et ont ouvertement soutenu les groupes d'opposition. Le gouvernement a tenté de réprimer l'indépendance des médias, notamment lors d'un incident traumatisant au cours duquel un journaliste enquêtant sur la corruption du gouvernement a été assassiné, suivi d'une descente au siège des médias pour évasion fiscale présumée, ce qui a déclenché des protestations généralisées et contraint le président à limoger son cabinet, un événement qui a gravement ébranlé ses piliers de soutien.
Le gouvernement de Chevardnadze était de plus en plus isolé non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger, où des émissaires de l'administration Bush ont commencé à appeler à une transition ordonnée vers la démocratie et les prêts et l'aide étrangers ont commencé à diminuer alors que certains ont même commencé à accorder un soutien financier à des groupes pro-démocratiques en Géorgie.
Lors des élections de 2003, alors que l'on s'attendait à ce que Chevardnadze perde le pouvoir, l'administration Bush a envoyé des observateurs pour encourager le gouvernement à échanger le pouvoir de manière équitable et libre. Mais peu après l'ouverture des bureaux de vote, des rapports ont fait état de violences, d'intimidation des électeurs, de bourrage d'urnes et de purges des listes électorales à un point tel que même les dirigeants de l'opposition et parfois des quartiers entiers se sont retrouvés dans l'impossibilité de voter. Je pense que certains membres du gouvernement ne voulaient pas que ces élections se déroulent dans l'ordre parce qu'ils savaient qu'ils les perdraient", a déclaré un analyste électoral. Malgré le doigt sur la balance, le gouvernement a tout de même perdu la moitié de ses voix et les observateurs électoraux ont confirmé les allégations de truquage : "Ces élections n'ont malheureusement pas suffi à renforcer la crédibilité du processus électoral ou démocratique", et l'opposition a noté la disparité entre les sondages de sortie des urnes et les résultats définitifs, qui ont doublé le soutien apporté au gouvernement.
La désobéissance civile a commencé immédiatement, exigeant un nouveau scrutin et la démission immédiate de Chevardnadze. Ces actions se sont rapidement multipliées dans les rues, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de personnes manifestant toutes contre l'élection entachée d'irrégularités. Chevardnadze a lancé un avertissement, affirmant que les manifestants risquaient une guerre civile, et a menacé de déployer des soldats dans les rues de Tbilissi, une menace qu'il a mise à exécution. Cependant, lorsque les manifestants ont affronté les soldats, ils ont commencé à leur distribuer des roses, et ces derniers ont refusé de réprimer les manifestants. "Les gens embrassaient les policiers et les militaires, c'était vraiment spectaculaire", a déclaré Giorgi Kandelaki, un étudiant de 21 ans.
" Et bien sûr, les roses que les gens avaient avec eux, que Misha portait avec lui dans la salle du parlement, c'est à ce moment-là que les gens ont dit qu'il s'agissait d'une révolution des roses ". Le chef de l'opposition, Misha (Mikhail Saakashvili), a conduit un contingent de manifestants jusqu'au bâtiment du parlement pour en réclamer son ouverture. La foule de partisans a alors forcé l'entrée du bâtiment, obligeant le président à l'évacuer par crainte pour sa sécurité. Une fois à l'intérieur, les manifestants ont de nouveau lancé des appels à la démission du président.
Alors que le président était évacué par la porte arrière en direct à la télévision et que les manifestants contrôlaient l'hémicycle, il semblait que la "révolution des roses" était achevée et que le pouvoir avait changé de mains. Quelques jours plus tard, en échange de sa sécurité, Chevardnadze démissionne et, dans un curieux moment de l'histoire, souhaite bonne chance à son successeur : "Il faut faire plus que des discours, mais je lui souhaite chance et succès". De nouvelles élections ont été programmées, et c'est sans surprise que l'homme qui a mené la marche sur le parlement, Mikhaïl Saakachvili, s'est présenté pratiquement sans opposition et a remporté une ultra-majorité des voix, 96 %, avec un taux de participation élevé
Personne n'a été blessé et aucune goutte de sang n'a été versée, car les Géorgiens se sont débarrassés de leur ancien réformateur communiste devenu dirigeant kleptocrate en échange d'un dirigeant libéral explicitement pro-occidental, mais d'énormes problèmes subsistaient : la situation économique, les relations avec la Russie et la question non résolue du séparatisme dans les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, les accusations d'aide aux militants tchétchènes, les dirigeants régionaux indisciplinés et les reliquats des gouvernements antérieurs. L'avenir de la Géorgie restait incertain.
(Haut) Président de la Géorgie, Misha Saakashvili
Drapeau de la Géorgie (1990-2004), Drapeau de la Géorgie après 2004
Soudan
Président du Soudan Omar al-Bashir
Une nation souffrant d'un terrible conflit sectaire entre le nord et le sud, qui, en 30 ans, a détruit plus de 2 millions de vies par les balles, les bombes, les maladies et les famines. La majeure partie du pays a connu des souffrances indicibles en vivant dans une nation économiquement isolée et démunie. Au milieu de la guerre ethnique entre le nord et le sud, une deuxième guerre a éclaté dans la région occidentale du Darfour. À bout de souffle, le gouvernement soudanais a décidé d'armer les milices arabes pour mener une campagne anti-insurrectionnelle sanglante et, ce faisant, des milliers d'innocents ont été chassés de chez eux, battus, torturés et tués. Le Soudan n'a pas réussi à rembourser ses emprunts ni à mettre en œuvre les réformes économiques promises, ce qui l'a exclu du grand système financier, et son adhésion aux djihadistes anti-américains lui a fait perdre encore plus d'alliés. La monnaie a continué à perdre de la valeur et l'inflation a atteint 150 %, tandis que le président et ses conseillers continuaient à donner la priorité à l'escalade des menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays, alors que ses contraintes économiques le conduisaient à l'insolvabilité[1].
Le dictateur militaire Al-Bashir se trouvait dans une impasse et tentait désespérément de mettre un terme à l'un ou l'autre des conflits. Il a repris les négociations de paix avec les rebelles du sud et autorisé les représailles brutales au Darfour, notamment en accordant notoirement un soutien aérien pour écraser les insurgés. Ni l'une ni l'autre n'ont semblé apporter une solution immédiate à ses problèmes, les négociateurs sudistes estimant qu'ils ne recevaient pas de garanties territoriales ou de sécurité suffisantes, et M. Bashir lui-même estimant que l'armée soudanaise n'était pas encore vaincue et ne devait pas se retirer des territoires qu'elle détenait. L'insurrection au Darfour a également continué à s'intensifier, sans être freinée par les tactiques sanglantes des milices, et n'a fait qu'accroître l'infamie de Bashir dans le monde.
Rebelle du Darfour
Malgré les efforts de M. Bashir pour présenter le conflit du Darfour comme une simple escarmouche et dépeindre la réaction mondiale comme une persécution de la foi islamique du Soudan, la sphère internationale en a pris note et a rapidement condamné M. Bashir pour les actions de son pays. Les Nations unies ont publié un rapport détaillant les meurtres, les viols et l'incendie et le pillage systématiques de villages entiers. Elles ont déclaré que la situation était une catastrophe humanitaire, estimant que 1,5 million de civils étaient actuellement affectés par la situation et restaient hors de portée de l'aide. La communauté internationale a qualifié la campagne de "terre brûlée", de nettoyage ethnique explicite et de l'une des pires crises humanitaires au monde. Les voisins du Soudan sont devenus de plus en plus hostiles au régime et ont commencé à soutenir les opérations de maintien de la paix, afin de contenir toute extension potentielle du conflit. Des pétitions ont commencé à être adressées aux Nations unies pour demander un cessez-le-feu et l'arrêt de l'aide aux groupes paramilitaires, et un débat public sur la question de savoir si les actions constituaient un génocide a commencé à s'animer.
Aux États-Unis, l'administration Bush était réticente à qualifier l'action de génocide, car cette terminologie impliquait qu'une action militaire était nécessaire. Cette position était en rupture avec les républicains conservateurs préoccupés par la minorité chrétienne du Soudan, qui se sont unis aux démocrates pour qualifier l'action de génocide. Le sénateur démocrate et candidat à la présidence John Kerry a appelé à une action internationale : "Le monde n'a pas agi au Rwanda, à notre éternelle honte. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un autre point de crise, cette fois au Soudan. La région du Darfour, à l'ouest du Soudan, exige une attention et une action immédiates de la part du monde". L'administration Bush a qualifié ces actions de déplorables et a réitéré sa demande que M. Bashir reprenne les négociations et cesse de soutenir les militants, laissant entendre qu'elle pourrait demander un mandat des Nations unies pour résoudre la crise : "Notre administration cherchera toutes les solutions pour mettre fin à cette persécution et à cette atrocité au Soudan".
La pression internationale croissante, les campagnes militaires et le déclin de l'économie ont placé le président Bashir dans une situation de plus en plus isolée, alors que la communauté internationale débattait des moyens de contraindre Bashir à respecter la loi, les acteurs soudanais ont saisi l'occasion pour agir en premier. Le 29 mars 2004, des centaines de soldats sont entrés dans Khartoum, la capitale du Soudan, à bord de chars, de camions et à cheval. Un mélange de militaires réguliers et de paramilitaires a perpétré un coup d'État contre le président Bashir, s'emparant des bâtiments gouvernementaux et arrêtant plusieurs membres du gouvernement, y compris le président lui-même, suivi d'un message diffusé à la télévision et à la radio d'État par le secrétaire général du parti national islamique au pouvoir et principal conseiller du président aujourd'hui déchu, le docteur Hassan Al-Turabi. Turabi a expliqué que le président Bashir devait être renversé dans l'intérêt du "salut national". Ils ont justifié leurs actions en lançant une série d'allégations selon lesquelles Bashir faisait délibérément échouer les négociations de paix et se livrait à un nettoyage ethnique et à un génocide, avant de promettre que le pays s'engagerait à devenir une démocratie islamique constitutionnelle sous un régime civil légitime.
Bien que les comploteurs se soient parés de ces justifications morales, le monde extérieur n'avait pas l'espoir d'un retournement de situation. Turabi était un allié de longue date du président Bashir et était soupçonné d'être le cerveau de certaines des politiques les plus odieuses du régime. Les histoires de désaccord entre les deux hommes remontaient à plusieurs années et les rumeurs selon lesquelles le président tenterait de purger les islamistes purs et durs circulaient depuis cinq ans ; il était plus probable que Turabi ait profité de l'indignation mondiale et du mécontentement au sein de la faction ministérielle et militaire de Bashir pour orchestrer un coup d'État de palais plutôt qu'une révolution pro-démocratique.
Turabi a annoncé qu'il dirigerait un nouveau conseil de transition (comprenant plusieurs alliés de Bashir) avant un vote du Congrès et une élection d'urgence (que son parti et lui-même ont facilement remportée). Pour Turabi, ce coup d'État représentait l'aboutissement d'une quête de 40 ans visant à diriger le Soudan et à y achever la révolution islamique. N'étant plus soumis à un dictateur, il n'aurait plus besoin de faire preuve de modération, ayant joué un rôle clé dans de nombreux coups d'État au fil des ans et ayant fait des allers-retours dans les allées du pouvoir pendant des dizaines d'années, Longtemps présenté comme le maître des marionnettes de la politique soudanaise qui a orchestré son islamisation, il était désormais le chef de ce qui allait devenir la République islamique du Soudan. Quant à Bashir lui-même, il a été épargné par un destin sanglant et, une fois déposé, il a pu s'exiler en Arabie Saoudite.
(en haut) Président du Soudan Hassan al-Turabi
Drapeau de la République du Soudan 1970-2004, Drapeau de la République islamique du Soudan après 2004
Tchétchénie
Président de la Russie, Vladimir Poutine
Après la sanglante année 2002 marquée par l'insurrection tchétchène, le Kremlin espérait que le conflit commencerait à s'apaiser, surtout après les deux attaques terroristes massives de l'année : le siège du théâtre de Moscou, qui a frappé le cœur de la Russie et attiré les regards du monde entier en raison de son ampleur, et qui a fait prendre conscience de la guerre à de nombreux Russes, puis les nombreux attentats au camion piégé dans la capitale tchétchène Grozny, qui ont détruit le gouvernement de collaboration soutenu par la Russie et tué le président par intérim de l'époque et allié clé de la Russie, Akhmad Kadyrov. Sa mort a laissé un vide de pouvoir que le Kremlin devait rapidement combler pour mettre en œuvre ses plans de pacification du territoire. Cependant, la Tchétchénie était un dangereux mélange de loyautés croisées, entre les administrateurs bureaucratiques d'origine russe, les alliés du défunt Kadyrov, composés d'anciens séparatistes tchétchènes devenus complices du Kremlin, et la branche anti-Kadyrov des loyalistes russes de longue date. Chaque camp était le mieux représentée par le ministre des finances d'origine russe Sergey Abramov, qui est devenu le nouveau président par intérim de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, le fils du président décédé et le chef de facto de l'important groupe paramilitaire des Kadyrovsky, et le vétéran soviétique d'origine kazakhe Alu Alkhanov, qui avait soutenu les Russes en Tchétchénie depuis 1996 et qui était maintenant à la tête de la police tchétchène.
Un trio chaotique. Abramov considérait que son rôle était d'assurer la sécurité de la Tchétchénie et de reconstruire ses infrastructures. Mais la tâche s'annonçait ardue, compte tenu de la lutte pour le pouvoir, d'une insurrection incessante et des diktats/exigences de plus en plus sévères de Moscou.
(de gauche à droite) Sergey Abramov, Alu Alkhanov, Ramzan Kadyrov
Le monde entier a eu les yeux rivés sur ce conflit lorsqu'au début de l'année, le 3 janvier 2003, dix militants islamiques (pour la plupart des Algériens et des Marocains) sont entrés en France avec de faux passeports et ont attaqué l'ambassade de Russie à Paris. Ils étaient armés de pistolets, de grenades à gaz et de deux gilets-suicide supposés. Ils ont engagé une brève fusillade avec la police française et la sécurité russe avant d'entrer dans l'ambassade. L'ambassade était bien défendue, entourée de grilles et à l'épreuve des balles, ce qui a rendu la situation encore plus difficile lorsque les assaillants ont réussi à prendre le contrôle du bâtiment ainsi que 15 otages en inondant le bâtiment de gaz lacrymogène. Le chef de la cellule, Menad Benchellali, a exigé que la Russie se retire de la Tchétchénie et a menacé de faire exploser une arme chimique qu'il avait lui-même confectionnée si la police pénétrait dans le bâtiment[2].
La fusillade initiale et la menace "explosive" ont incité le gouvernement français à agir. Le gouvernement du président Jospin a été pris au dépourvu par l'attaque, étant donné que la police se concentrait principalement sur les extrémistes d'extrême-droite en pleine émergence sérieusement irrités par la victoire électorale de Jospin et son passé trotskiste, il a marché sur un fil en tant que président socialiste de la France en essayant de modérer le parti socialiste de certaines de ses tendances plus gauchistes (comme Blair au Royaume-Uni), notamment en adoptant une approche sévère à l'égard de la criminalité et en réorientant la politique étrangère française pour qu'elle soit plus conciliante envers l'Occident.
La menace extraordinaire que représentait le siège de l'ambassade a poussé les Français à tenter de négocier avec les assaillants, mais ils se sont trouvés dans l'impasse, n'étant pas en mesure de modifier la politique militaire de la Russie. Les pourparlers ont duré plusieurs jours et les militants se sont vu proposer de nombreuses options pour libérer les otages en échange d'une fuite vers un pays tiers ou même du paiement d'une rançon. Cependant, les assaillants étaient des idéologues déterminés et considérés comme probablement suicidaires. Après 13 jours de négociations infructueuses, le gouvernement a donné son accord pour que la Gendarmerie fasse une incursion dans l'ambassade. Au cours d'une fusillade spectaculaire retransmise à la télévision, la gendarmerie a écrasé l'ambassade sous un déluge de balles, tandis que les commandos ont lancé un assaut à partir d'hélicoptères, sauvant tous les otages, tuant trois assaillants et capturant les autres. Les gilets-suicide se sont révélés inopérants et la prétendue bombe à la ricine totalement inventée. Le président Jospin a félicité la police pour ses efforts dans une déclaration : "Le président exprime sa profonde gratitude aux forces armées françaises et à tous les services de l'État qui ont permis une solution rapide et pacifique à cette prise d'otages".
(à gauche) Hélicoptère de la gendarmerie française, (à droite) Ambassade de Russie à Paris
Le Kremlin cherchait à annexer pleinement et officiellement la Tchétchénie à la Fédération de Russie, mais ces plans ont été remis en question par la bataille pour le contrôle politique de Grozny, ainsi que par la poursuite des attaques terroristes, qui ont parfois rendu indiscernables les batailles militaires et politiques. Un attentat contre le cortège du président par intérim Abramov a jeté la suspicion sur les Kadyrovsky et les insurgés nationalistes, et un certain nombre d'assassinats ont tué des commandants russes, ce qui a éveillé les soupçons sur les milices pro-russes. Les forces russes ont été lâchées pour maintenir l'ordre dans le pays et se sont montrées très méfiantes et promptes à tirer les premières sur les Tchétchènes, quelle que soit leur allégeance, ce qui a donné lieu à des échanges de tirs entre les forces russes et les collaborateurs tchétchènes et à des attentats suicides continus contre les convois de troupes et les hôpitaux militaires qui ont fait grimper le nombre de victimes parmi les forces russes. Toutefois, à entendre les responsables russes, la guerre était terminée et le niveau de terreur était tout à fait normal.
Les observateurs occidentaux ont présenté un tableau plus sombre, décrivant une insurrection à peine contenue, des forces d'occupation brutales et des dirigeants davantage en guerre contre eux-mêmes. Lorsque le gouvernement russe a tenté d'organiser des élections présidentielles pour mettre un terme aux factions, la situation n'a fait qu'empirer : Abramov a survécu de justesse à une deuxième tentative d'assassinat lorsqu'une grenade a attaqué son entourage, ce qui l'a conduit à se retirer complètement de la scène publique et à diriger la Tchétchénie de l'extérieur, retardant ainsi définitivement les élections.
En réponse aux difficultés rencontrées, le Kremlin s'est emporté, accusant à nouveau l'Occident de sympathiser avec ses ennemis. Pendant le siège de l'ambassade, la Russie a exigé du gouvernement français qu'il mette fin aux négociations et qu'il extrade ensuite les combattants vers la Russie, ce que la France a refusé de faire. Le président Poutine s'est montré impénitent, définissant son ennemi comme des "criminels génocidaires" en cheville avec des terroristes internationaux pour atteindre leur objectif de nuire à la Russie, et s'est engagé à pacifier la Tchétchénie : "Nous terminerons certainement cette tâche. Les habitants de la Tchétchénie finiront par mener une vie normale et civilisée". La Russie a transformé la région en zone d'ombre pour les médias, afin de dissuader les journalistes de dénoncer les crimes de guerre russes présumés. Le président Bush a même proposé sa médiation en Tchétchénie : "Notre position en Tchétchénie est de trouver une solution pacifique [...] et pour cela, il faut que Vladimir Poutine abandonne l'approche actuelle. Les terroristes et les assassins doivent répondre de leurs actes, mais bombarder des réfugiés (en référence à une attaque signalée) est une erreur". La brutalité et le secret ont commencé à creuser un fossé entre la Russie et les autres pays occidentaux. Un ancien ministre russe a résumé la situation en disant que "le sang et la boue de la guerre de Tchétchénie ont laissé leur marque sur l'ensemble de sa présidence et, dans une certaine mesure, sur la nouvelle Fédération de Russie".
Aucune partie n'a montré de signes de soumission à l'autre, Shamil Basayev, le chef rebelle tchétchène non repenti, s'est attribué le mérite des attentats suicides en Russie, dont un spectaculaire à l'intérieur de la Douma de Moscou, juste en face du Kremlin, un incident qui a transformé tout Moscou en ville occupée, alors que la police et l'armée fouillaient chaque recoin de la métropole à la recherche d'autres poseurs de bombes. M. Basayev a réitéré son intention de perpétrer d'autres attentats encore plus effroyables : "La lutte contre nous se poursuit sans aucune règle, nous ne sommes donc liés par aucune obligation envers qui que ce soit et nous nous battrons de la manière que nous jugeons commode et nécessaire, jusqu'à ce qu'ils apprennent [...]".
(en haut) chef de l'insurrection tchétchène Shamil Basayev
(à gauche) Drapeau de la République tchétchène soutenue par la Russie, (à droite) Drapeau de la République tchétchène d'Ichkérie en exil
[1] ATL Le Soudan est de plus en plus isolé en raison de son association continue avec des groupes djihadistes, ce qui prolonge la guerre dans le sud et nuit davantage à son économie.
[2] La police française a bel et bien trouvé une cellule qui préparait un attentat similaire.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 28: "Where is Love?" un état de la culture en 2003
ANDERSON COOPER, PRÉSENTATEUR CNN : Le 20e anniversaire des MTV Music Awards s'est déroulé hier soir. Et comme chaque année, le grand vainqueur était - eh bien, vraiment, qui s'en soucie. Comme le rapporte Jeanne Moos de CNN, cette année, le grand gagnant a été chaque gars ou fille qui s'est déjà dit : "Et si... ?".
JEANNE MOOS, CORRESPONDANTE DE CNN : Le baiser qui a commencé sur les lèvres de Madonna et de Britney Spear a fini par être dans tous les esprits, voici quelques-unes des nombreuses réactions.
FEMME NON IDENTIFIEE : C'était méchant.
HOMME NON IDENTIFIÉ : C'était sexy.
FEMME NON IDENTIFIÉE : Je pense que c'était malade.
HOMME UNIDENTIFIÉ : Je trouve que ça va très bien ensemble.
HOMME NON IDENTIFIÉ : C'est du grand n'importe quoi. J'ai adoré.
FEMME UNIDENTIFIEE : Madonna ... de retour à ses habitudes bisexuelles.
HOMME UNIDENTIFIE : Ne trouvez-vous pas ironique que des femmes s'embrassent sur scène presque le même jour que l'on retire les Dix Commandements de la cour, dans le sud ?
De retour au studio
MOOS : A moins qu'il ne s'agisse de trois superstars féminines, c'est un baiser qui n'est pas prêt de disparaître avec le vent.
COOPER : Parfois, un baiser n'est qu'un baiser
En 2003, des millions de téléspectateurs qui regardaient les MTV Video Music Awards ont eu droit à un spectacle plus important que ce à quoi ils s'attendaient. Pendant l'interprétation de sa nouvelle chanson, Madonna a embrassé l'une des célébrités avec lesquelles elle chantait sur scène, la star de la pop Britney Spears. Ce moment a choqué de nombreux téléspectateurs et a fait la une des journaux du monde entier. Ce moment très médiatisé a été favorisé par le fait que les deux artistes étaient au sommet de leur gloire, reconnues comme étant la musicienne la mieux payée et la deuxième musicienne la mieux payée de l'année, et qu'elles avaient toutes deux brièvement joué des rôles au cinéma, respectivement dans James Bond et dans sa parodie Austin Powers. Les deux artistes ont également sorti les albums Outrageous et Hollywood, poursuivant ainsi leur domination culturelle[1]. [1]

Madonna embrasse Britney Spears aux MTV Awards
Les 10 albums les plus vendus de l'année aux États-Unis
Get Rich or Die Tryin' - 50 Cent
Justified - Justin Timberlake
Stripped - Christina Aguilera
Number Ones - Michael Jackson
Meteora - Linkin Park
Dangerously in Love - Beyoncé
Fallen - Evanescence
Outrageous - Britney Spears
Hollywood - Madonna
Speakerboxxx/The Love Below - Outkast[2]
Passage au cinéma. La trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson s'est achevée de manière triomphale et a été acclamée par la critique et le public. La conversion du tome mythique de Tolkien en film a été une entreprise extraordinaire pour le studio de production, les équipes chargées des effets visuels et le pays de Nouvelle-Zélande, qui a servi de toile de fond au royaume fantastique de la Terre du Milieu pendant trois ans. Son accueil grandiose a balayé le box-office et les cérémonies de remise de prix. Il est devenu le film le plus rentable de l'année (comme son prédécesseur en 2002) et le deuxième film le plus rentable de tous les temps. D'autres suites ont balayé le box-office en 2003 avec une série de superproductions telles que X-Men 2, Terminator 3 : Le réveil des machines, Charlies Angels 2 Full throttle, deux suites distinctes de Matrix (Matrix Reloaded et Matrix Revolutions) et Gump & Co, la suite du film Forrest Gump primé en 1994, avec Tom Hanks dans le rôle du célèbre Gump.

(De gauche à droite) Sorties 2003, Le seigneur des anneaux, le retour du roi, X Men 2, et Gump & Co
Gump & Co suit Forrest et son fils "Little Forrest" Gump Jr (interprété par Haley Joel Osmond) et détaille la vie trépidante des Gump en Amérique dans les années 1980 et 1990. Parmi leurs péripéties, citons la perte de contrôle de la Bubba Gump Shrimp Company, les rencontres avec les Reagan, les Clinton et les Bush, l'invention du New Coke, la révélation de l'affaire Iran Contra, l'incitation de Ross Perot à se présenter à l'élection présidentielle et la couverture de la guerre du Golfe. Bien que le film ait bien marché au box-office et que les critiques aient loué le duo d'acteurs Hanks et Osmond pour l'adorable relation père-fils à l'écran, les critiques ont noté que le film avait moins de cœur que l'original et qu'il était plus axé sur les références culturelles (comme la rencontre avec John Hinkley Junior ou le nettoyage de la marée noire de l'Exxon Valdez) que sur la narration de sa propre histoire, et qu'il n'a pas eu autant de succès que l'original auprès des critiques, du public ou des cérémonies de remise de prix[3].
Il est peut-être injuste que cette nouvelle production soit à ce point étouffée par la réputation de son prédécesseur d'il y a près de dix ans. En adhérant si étroitement à la structure exacte de son original et à l'intrigue décousue de son texte, Zemeckis ne fait que reprendre les références et les répliques déjà rendues célèbres, ce qui est difficile à ne pas reconnaître. Mais l'utilisation abondante de références et de répliques déjà rendues célèbres empêche Zemeckis de faire des comparaisons, en montrant clairement que ce qui est proposé ici n'est pas aussi original que le film de 1994, mais simplement un épilogue maladroitement long, aidé par la performance attachante de Hanks et d'Osmond. Le film ne fonctionne tout simplement pas, il manque de force narrative, de cœur, et est tiré vers le bas par le simple poids de ce qui l'a précédé.
- Barry McIlheney, Empire
L'année a également été bonne pour les films historiques (et navals), tels que l'épopée napoléonienne Master and Commander avec Russell Crow, l'aventure Disney Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp et l'épopée de la guerre de Sécession Cold Mountain. Bill Murray et Dianne Keating ont remporté le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour leurs rôles dans Lost in Translation et Somethings Gotta Give.
Le quatrième film de Quentin Tarantino, La Mariée, devait sortir en 2003, et comme le veut Tarantino, la tendance devait être un mélange stylisé et sanglant de western spaghetti, de drame japonais et de films d'arts martiaux chinois, avec l'actrice Uma Thurman dans le rôle de la Mariée. Mais un désastre a définitivement interrompu la production lorsque l'actrice principale a été grièvement blessée dans un accident de voiture, la voiture qu'elle conduisait s'étant retournée pendant le tournage d'une scène. Elle a dû subir une opération chirurgicale d'urgence et le réalisateur Tarantino, ainsi que Miramax Films, ont fait l'objet d'une enquête pénale et civile pour manque de sécurité sur le plateau de tournage. Bien que le film soit presque terminé, le litige a retardé la sortie du film [4].

Matériel promotionnel inédit de la Mariée
Certains avaient prédit que l'année 2003 verrait la mort lente de la téléréalité. Cette prophétie ne s'est pas réalisée grâce aux frasques des Osbournes, de Paris Hilton et de Joe Millionaire, l'émission qui suivait un groupe de femmes célibataires, en compétition pour l'affection d'un célibataire faussement présenté comme millionnaire. L'année 2003 a également vu la fin de Buffy the Vampire Slayer et de Dawson's Creek, et le début d'une comédie acclamée, Arrested Development, d'un feuilleton de plage à l'eau de rose, The O.C., et de bien d'autres choses encore. En ce qui concerne les récompenses, les séries habituelles ont été récompensées, comme The Sopranos, The Shield et The West Wing (cette saison suit l'administration Bartlet pendant sa tumultueuse campagne de réélection, où il rencontre de nombreux candidats à la vice-présidence, finit par soutenir l'ambitieux jeune sudiste Richard "Dick" Owens (Christian Slater) et gagne de justesse sa réélection après un recomptage dans le Michigan, le président est confronté à d'autres problèmes comme un coup d'État au Salvador ou un affrontement avec une milice dans le Colorado)[5]. Les drames habituels ont reçu des éloges et des nominations, notamment James Gandolfini et Edie Falco, les acteurs principaux des Sopranos, qui ont été nommés et ont remporté les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice aux Emmys.
Les prix du sportif et de la sportive de l'année 2003 ont été décernés à l'Américain Lance Armstrong, qui a remporté son cinquième Tour de France consécutif, et à la joueuse de tennis Serena Williams, qui a remporté son quatrième titre consécutif du Grand Chelem à l'Open d'Australie, achevant ainsi son "Chelem de Serena", tandis que chez les hommes, Roger Federer a remporté le titre du Grand Chelem à Wimbledon. La Coupe du monde de rugby, organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'est achevée par une finale palpitante entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Alors que le score est de 17-17, une séance de tirs au but donne la victoire aux All Blacks de Nouvelle-Zélande[6]. Au chapitre des controverses, la superstar de la NBA Kobe Bryant a été arrêtée dans le cadre d'une enquête sur une accusation d'agression sexuelle déposée par une employée d'hôtel de 19 ans ; Bryant a admis avoir eu une relation sexuelle avec son accusatrice, mais a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une relation consensuelle. L'affaire est rapidement devenue un cirque médiatique, avec des parallèles avec l'affaire O.J. Simpson et un parallèle racial. Elle s'est poursuivie pendant un an, conduisant de nombreuses marques à se dissocier de Kobe, notamment McDonald's et Coca-Cola. S'il est reconnu coupable du seul chef d'accusation, M. Bryant risquerait quatre ans de prison ou une mise à l'épreuve et une surveillance dans le cadre d'un programme de traitement des délinquants sexuels qui pourrait durer de 20 ans à la perpétuité.

(A gauche) Leon MacDonald avec le coup de pied gagnant de la coupe du monde, (A droite) Kobe Bryant assiste à l'audience.
La Maison Blanche a abordé la question sensible de l'avortement, et plus particulièrement celle de l'"avortement par naissance partielle", une forme d'interruption tardive de la grossesse. Le terme "naissance partielle" a été inventé par des groupes anti-avortement/pro-vie pour décrire une procédure consistant à retirer le fœtus de l'utérus par le canal de naissance. La question avait été soulevée par les républicains qui avaient adopté des lois interdisant la procédure dans les années 1990, lois qui avaient ensuite été rejetées par le président démocrate Bill Clinton, qui avait qualifié la procédure de nécessité tragique "une décision qui pourrait sauver la vie, qui pourrait certainement sauver la santé, mais qui reste tragique, d'avoir recours au type de procédure d'avortement qui serait interdit par la loi HR 1833". Mais la question est restée controversée et les deux candidats de l'époque, Bush et Gore, étaient favorables à une certaine forme d'interdiction, mais n'étaient pas d'accord sur les exceptions spécifiques : "Je m'engage à me battre pour l'interdiction des avortements par naissance partielle". affirmait Bush lors de sa campagne électorale. Une fois qu'il est devenu président, le mouvement pro-vie a cherché à tenir ses promesses. Les groupes pro-choix ont cependant affirmé que l'attaque des conservateurs n'était qu'une des nombreuses attaques contre l'avortement en général.
Une fois à la Maison Blanche, Bush a soutenu la législation sur l'interdiction et, malgré la perte de la majorité à la Chambre et au Sénat, les démocrates conservateurs étaient prêts à soutenir le projet de loi. La bataille a été serrée, mais les républicains ont obtenu suffisamment de voix pour vaincre l'obstruction et ont adopté la mesure par 60 voix contre 40. Le président a signé le projet de loi entouré d'opposants à l'avortement qui l'acclamaient. Interdisant totalement la procédure, Bush a déclaré que le pays "devait à ses enfants un accueil différent et meilleur". Mais la loi est rapidement entrée dans une zone grise sur le plan juridique, les tribunaux ayant contesté sa constitutionnalité au motif qu'elle enfreignait le droit à l'avortement consacré par l'arrêt Roe V Wade de la Cour suprême, et certains hommes politiques ont fait une évaluation brutale de la loi, Howard Dean, ancien gouverneur du Vermont, se déclarant "scandalisé que le président Bush ait décidé qu'il était qualifié pour pratiquer la médecine". Et certains experts ont prédit des problèmes politiques pour le président. "Plus les pro-vie s'approchent du cœur de Roe v. Wade, plus les retombées politiques seront importantes". a déclaré un sondeur.

Le président George Bush signe le projet de loi interdisant l'avortement par naissance partielle.
La deuxième grande bataille culturelle qui a éclaté a été celle du droit au mariage pour les homosexuels. La question a pris une ampleur considérable lorsque les conservateurs ont commencé à se rallier à un mouvement visant à interdire le mariage gay au niveau fédéral, voire à modifier la Constitution pour définir le mariage, et que le président Bush a exprimé son soutien à la "codification du mariage aux États-Unis comme étant l'union d'un homme et d'une femme". Mais le mouvement pour les droits des homosexuels a remporté sa plus grande victoire lorsque, la même année, la Cour du Massachusetts a statué dans l'affaire Goodridge v. Department of Public Health que les couples de même sexe avaient le droit de se marier, autorisant pour la première fois le mariage homosexuel aux États-Unis (par opposition aux lois sur les unions civiles en vigueur à Washington, en Californie et dans le Vermont), Californie et Vermont), le gouverneur du Massachusetts, Shannon O'Brien (D), a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à la décision du tribunal : "Le tribunal a pris sa décision et je ne vois aucune raison de m'y opposer, je ne perdrai pas de temps à poursuivre l'amour", renonçant ainsi à toute contestation juridique et devenant le premier État du pays à légaliser effectivement le mariage homosexuel.

Les défenseurs des droits des homosexuels font la fête à Boston
Le projet international de recherche sur le génome humain s'est achevé, avec deux ans d'avance sur le calendrier prévu, par la cartographie et le séquençage de tous les gènes du génome humain. La Yougoslavie se dissout officiellement en une union libre de la Serbie et du Monténégro et le célèbre seigneur de guerre et président du Liberia, Charles Taylor, refuse de démissionner avant d'être délogé du pouvoir par les chefs rebelles environnants, les forces ouest-africaines et l'intervention des marines américains dans le cadre de l'opération Shining Express, qui s'est soldée par la débandade de l'armée libérienne et l'arrestation de Charles Taylor[7].

De gauche à droite) Couverture d'un magazine sur le projet du génome humain, Charles Taylor en état d'arrestation, dissolution de la Yougoslavie.
https://youtu.be/R4KKe6ICRgM
Vidéo Youtube sur la fin de la présidence de Taylor
[1] La réaction la plus claire au 11 septembre et à la guerre contre le terrorisme a été un changement brusque de ton de la part de beaucoup de musiciens et d'artistes, qui sont devenus plus sombres ou plus sérieux. Madonna a opéré un virage anti-guerre et Spears s'est complètement détachée de la pop pour adolescents. Cette évolution est en revanche ici plus progressive.
[2] la musique optimiste est plus populaire
[3] Gump & Co, le livre a été écrit par l'auteur à moitié par cupidité et à moitié par dépit, et aurait probablement beaucoup divergé lors de l'adaptation à l'écran, mais j'en ai gardé les grandes lignes.
[4] Est-ce une coïncidence si les trois films de Tarantino qui ont suivi 2001 étaient entièrement axés sur la vengeance ? L'accident est basé sur un incident réel.
[5] The West Wing s'est ensuite concentré sur la politique étrangère et le terrorisme. ici la série se concentre sur les problèmes des années 90 et la réélection de Bartlett est plus difficile.
[La Coupe du monde de rugby s'est déroulée uniquement en Australie en raison de différends politiques qui ont été passés à la moulinette.
[7] dans notre univers Taylor a démissionné et s'est exilé pendant plusieurs années, mais ici il tente de faire face au bluff de la communauté internationale.
ANDERSON COOPER, PRÉSENTATEUR CNN : Le 20e anniversaire des MTV Music Awards s'est déroulé hier soir. Et comme chaque année, le grand vainqueur était - eh bien, vraiment, qui s'en soucie. Comme le rapporte Jeanne Moos de CNN, cette année, le grand gagnant a été chaque gars ou fille qui s'est déjà dit : "Et si... ?".
JEANNE MOOS, CORRESPONDANTE DE CNN : Le baiser qui a commencé sur les lèvres de Madonna et de Britney Spear a fini par être dans tous les esprits, voici quelques-unes des nombreuses réactions.
FEMME NON IDENTIFIEE : C'était méchant.
HOMME NON IDENTIFIÉ : C'était sexy.
FEMME NON IDENTIFIÉE : Je pense que c'était malade.
HOMME UNIDENTIFIÉ : Je trouve que ça va très bien ensemble.
HOMME NON IDENTIFIÉ : C'est du grand n'importe quoi. J'ai adoré.
FEMME UNIDENTIFIEE : Madonna ... de retour à ses habitudes bisexuelles.
HOMME UNIDENTIFIE : Ne trouvez-vous pas ironique que des femmes s'embrassent sur scène presque le même jour que l'on retire les Dix Commandements de la cour, dans le sud ?
De retour au studio
MOOS : A moins qu'il ne s'agisse de trois superstars féminines, c'est un baiser qui n'est pas prêt de disparaître avec le vent.
COOPER : Parfois, un baiser n'est qu'un baiser
En 2003, des millions de téléspectateurs qui regardaient les MTV Video Music Awards ont eu droit à un spectacle plus important que ce à quoi ils s'attendaient. Pendant l'interprétation de sa nouvelle chanson, Madonna a embrassé l'une des célébrités avec lesquelles elle chantait sur scène, la star de la pop Britney Spears. Ce moment a choqué de nombreux téléspectateurs et a fait la une des journaux du monde entier. Ce moment très médiatisé a été favorisé par le fait que les deux artistes étaient au sommet de leur gloire, reconnues comme étant la musicienne la mieux payée et la deuxième musicienne la mieux payée de l'année, et qu'elles avaient toutes deux brièvement joué des rôles au cinéma, respectivement dans James Bond et dans sa parodie Austin Powers. Les deux artistes ont également sorti les albums Outrageous et Hollywood, poursuivant ainsi leur domination culturelle[1]. [1]
Madonna embrasse Britney Spears aux MTV Awards
Les 10 albums les plus vendus de l'année aux États-Unis
Get Rich or Die Tryin' - 50 Cent
Justified - Justin Timberlake
Stripped - Christina Aguilera
Number Ones - Michael Jackson
Meteora - Linkin Park
Dangerously in Love - Beyoncé
Fallen - Evanescence
Outrageous - Britney Spears
Hollywood - Madonna
Speakerboxxx/The Love Below - Outkast[2]
Passage au cinéma. La trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson s'est achevée de manière triomphale et a été acclamée par la critique et le public. La conversion du tome mythique de Tolkien en film a été une entreprise extraordinaire pour le studio de production, les équipes chargées des effets visuels et le pays de Nouvelle-Zélande, qui a servi de toile de fond au royaume fantastique de la Terre du Milieu pendant trois ans. Son accueil grandiose a balayé le box-office et les cérémonies de remise de prix. Il est devenu le film le plus rentable de l'année (comme son prédécesseur en 2002) et le deuxième film le plus rentable de tous les temps. D'autres suites ont balayé le box-office en 2003 avec une série de superproductions telles que X-Men 2, Terminator 3 : Le réveil des machines, Charlies Angels 2 Full throttle, deux suites distinctes de Matrix (Matrix Reloaded et Matrix Revolutions) et Gump & Co, la suite du film Forrest Gump primé en 1994, avec Tom Hanks dans le rôle du célèbre Gump.
(De gauche à droite) Sorties 2003, Le seigneur des anneaux, le retour du roi, X Men 2, et Gump & Co
Gump & Co suit Forrest et son fils "Little Forrest" Gump Jr (interprété par Haley Joel Osmond) et détaille la vie trépidante des Gump en Amérique dans les années 1980 et 1990. Parmi leurs péripéties, citons la perte de contrôle de la Bubba Gump Shrimp Company, les rencontres avec les Reagan, les Clinton et les Bush, l'invention du New Coke, la révélation de l'affaire Iran Contra, l'incitation de Ross Perot à se présenter à l'élection présidentielle et la couverture de la guerre du Golfe. Bien que le film ait bien marché au box-office et que les critiques aient loué le duo d'acteurs Hanks et Osmond pour l'adorable relation père-fils à l'écran, les critiques ont noté que le film avait moins de cœur que l'original et qu'il était plus axé sur les références culturelles (comme la rencontre avec John Hinkley Junior ou le nettoyage de la marée noire de l'Exxon Valdez) que sur la narration de sa propre histoire, et qu'il n'a pas eu autant de succès que l'original auprès des critiques, du public ou des cérémonies de remise de prix[3].
Il est peut-être injuste que cette nouvelle production soit à ce point étouffée par la réputation de son prédécesseur d'il y a près de dix ans. En adhérant si étroitement à la structure exacte de son original et à l'intrigue décousue de son texte, Zemeckis ne fait que reprendre les références et les répliques déjà rendues célèbres, ce qui est difficile à ne pas reconnaître. Mais l'utilisation abondante de références et de répliques déjà rendues célèbres empêche Zemeckis de faire des comparaisons, en montrant clairement que ce qui est proposé ici n'est pas aussi original que le film de 1994, mais simplement un épilogue maladroitement long, aidé par la performance attachante de Hanks et d'Osmond. Le film ne fonctionne tout simplement pas, il manque de force narrative, de cœur, et est tiré vers le bas par le simple poids de ce qui l'a précédé.
- Barry McIlheney, Empire
L'année a également été bonne pour les films historiques (et navals), tels que l'épopée napoléonienne Master and Commander avec Russell Crow, l'aventure Disney Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp et l'épopée de la guerre de Sécession Cold Mountain. Bill Murray et Dianne Keating ont remporté le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour leurs rôles dans Lost in Translation et Somethings Gotta Give.
Le quatrième film de Quentin Tarantino, La Mariée, devait sortir en 2003, et comme le veut Tarantino, la tendance devait être un mélange stylisé et sanglant de western spaghetti, de drame japonais et de films d'arts martiaux chinois, avec l'actrice Uma Thurman dans le rôle de la Mariée. Mais un désastre a définitivement interrompu la production lorsque l'actrice principale a été grièvement blessée dans un accident de voiture, la voiture qu'elle conduisait s'étant retournée pendant le tournage d'une scène. Elle a dû subir une opération chirurgicale d'urgence et le réalisateur Tarantino, ainsi que Miramax Films, ont fait l'objet d'une enquête pénale et civile pour manque de sécurité sur le plateau de tournage. Bien que le film soit presque terminé, le litige a retardé la sortie du film [4].
Matériel promotionnel inédit de la Mariée
Certains avaient prédit que l'année 2003 verrait la mort lente de la téléréalité. Cette prophétie ne s'est pas réalisée grâce aux frasques des Osbournes, de Paris Hilton et de Joe Millionaire, l'émission qui suivait un groupe de femmes célibataires, en compétition pour l'affection d'un célibataire faussement présenté comme millionnaire. L'année 2003 a également vu la fin de Buffy the Vampire Slayer et de Dawson's Creek, et le début d'une comédie acclamée, Arrested Development, d'un feuilleton de plage à l'eau de rose, The O.C., et de bien d'autres choses encore. En ce qui concerne les récompenses, les séries habituelles ont été récompensées, comme The Sopranos, The Shield et The West Wing (cette saison suit l'administration Bartlet pendant sa tumultueuse campagne de réélection, où il rencontre de nombreux candidats à la vice-présidence, finit par soutenir l'ambitieux jeune sudiste Richard "Dick" Owens (Christian Slater) et gagne de justesse sa réélection après un recomptage dans le Michigan, le président est confronté à d'autres problèmes comme un coup d'État au Salvador ou un affrontement avec une milice dans le Colorado)[5]. Les drames habituels ont reçu des éloges et des nominations, notamment James Gandolfini et Edie Falco, les acteurs principaux des Sopranos, qui ont été nommés et ont remporté les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice aux Emmys.
Les prix du sportif et de la sportive de l'année 2003 ont été décernés à l'Américain Lance Armstrong, qui a remporté son cinquième Tour de France consécutif, et à la joueuse de tennis Serena Williams, qui a remporté son quatrième titre consécutif du Grand Chelem à l'Open d'Australie, achevant ainsi son "Chelem de Serena", tandis que chez les hommes, Roger Federer a remporté le titre du Grand Chelem à Wimbledon. La Coupe du monde de rugby, organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'est achevée par une finale palpitante entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Alors que le score est de 17-17, une séance de tirs au but donne la victoire aux All Blacks de Nouvelle-Zélande[6]. Au chapitre des controverses, la superstar de la NBA Kobe Bryant a été arrêtée dans le cadre d'une enquête sur une accusation d'agression sexuelle déposée par une employée d'hôtel de 19 ans ; Bryant a admis avoir eu une relation sexuelle avec son accusatrice, mais a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une relation consensuelle. L'affaire est rapidement devenue un cirque médiatique, avec des parallèles avec l'affaire O.J. Simpson et un parallèle racial. Elle s'est poursuivie pendant un an, conduisant de nombreuses marques à se dissocier de Kobe, notamment McDonald's et Coca-Cola. S'il est reconnu coupable du seul chef d'accusation, M. Bryant risquerait quatre ans de prison ou une mise à l'épreuve et une surveillance dans le cadre d'un programme de traitement des délinquants sexuels qui pourrait durer de 20 ans à la perpétuité.
(A gauche) Leon MacDonald avec le coup de pied gagnant de la coupe du monde, (A droite) Kobe Bryant assiste à l'audience.
La Maison Blanche a abordé la question sensible de l'avortement, et plus particulièrement celle de l'"avortement par naissance partielle", une forme d'interruption tardive de la grossesse. Le terme "naissance partielle" a été inventé par des groupes anti-avortement/pro-vie pour décrire une procédure consistant à retirer le fœtus de l'utérus par le canal de naissance. La question avait été soulevée par les républicains qui avaient adopté des lois interdisant la procédure dans les années 1990, lois qui avaient ensuite été rejetées par le président démocrate Bill Clinton, qui avait qualifié la procédure de nécessité tragique "une décision qui pourrait sauver la vie, qui pourrait certainement sauver la santé, mais qui reste tragique, d'avoir recours au type de procédure d'avortement qui serait interdit par la loi HR 1833". Mais la question est restée controversée et les deux candidats de l'époque, Bush et Gore, étaient favorables à une certaine forme d'interdiction, mais n'étaient pas d'accord sur les exceptions spécifiques : "Je m'engage à me battre pour l'interdiction des avortements par naissance partielle". affirmait Bush lors de sa campagne électorale. Une fois qu'il est devenu président, le mouvement pro-vie a cherché à tenir ses promesses. Les groupes pro-choix ont cependant affirmé que l'attaque des conservateurs n'était qu'une des nombreuses attaques contre l'avortement en général.
Une fois à la Maison Blanche, Bush a soutenu la législation sur l'interdiction et, malgré la perte de la majorité à la Chambre et au Sénat, les démocrates conservateurs étaient prêts à soutenir le projet de loi. La bataille a été serrée, mais les républicains ont obtenu suffisamment de voix pour vaincre l'obstruction et ont adopté la mesure par 60 voix contre 40. Le président a signé le projet de loi entouré d'opposants à l'avortement qui l'acclamaient. Interdisant totalement la procédure, Bush a déclaré que le pays "devait à ses enfants un accueil différent et meilleur". Mais la loi est rapidement entrée dans une zone grise sur le plan juridique, les tribunaux ayant contesté sa constitutionnalité au motif qu'elle enfreignait le droit à l'avortement consacré par l'arrêt Roe V Wade de la Cour suprême, et certains hommes politiques ont fait une évaluation brutale de la loi, Howard Dean, ancien gouverneur du Vermont, se déclarant "scandalisé que le président Bush ait décidé qu'il était qualifié pour pratiquer la médecine". Et certains experts ont prédit des problèmes politiques pour le président. "Plus les pro-vie s'approchent du cœur de Roe v. Wade, plus les retombées politiques seront importantes". a déclaré un sondeur.
Le président George Bush signe le projet de loi interdisant l'avortement par naissance partielle.
La deuxième grande bataille culturelle qui a éclaté a été celle du droit au mariage pour les homosexuels. La question a pris une ampleur considérable lorsque les conservateurs ont commencé à se rallier à un mouvement visant à interdire le mariage gay au niveau fédéral, voire à modifier la Constitution pour définir le mariage, et que le président Bush a exprimé son soutien à la "codification du mariage aux États-Unis comme étant l'union d'un homme et d'une femme". Mais le mouvement pour les droits des homosexuels a remporté sa plus grande victoire lorsque, la même année, la Cour du Massachusetts a statué dans l'affaire Goodridge v. Department of Public Health que les couples de même sexe avaient le droit de se marier, autorisant pour la première fois le mariage homosexuel aux États-Unis (par opposition aux lois sur les unions civiles en vigueur à Washington, en Californie et dans le Vermont), Californie et Vermont), le gouverneur du Massachusetts, Shannon O'Brien (D), a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à la décision du tribunal : "Le tribunal a pris sa décision et je ne vois aucune raison de m'y opposer, je ne perdrai pas de temps à poursuivre l'amour", renonçant ainsi à toute contestation juridique et devenant le premier État du pays à légaliser effectivement le mariage homosexuel.
Les défenseurs des droits des homosexuels font la fête à Boston
Le projet international de recherche sur le génome humain s'est achevé, avec deux ans d'avance sur le calendrier prévu, par la cartographie et le séquençage de tous les gènes du génome humain. La Yougoslavie se dissout officiellement en une union libre de la Serbie et du Monténégro et le célèbre seigneur de guerre et président du Liberia, Charles Taylor, refuse de démissionner avant d'être délogé du pouvoir par les chefs rebelles environnants, les forces ouest-africaines et l'intervention des marines américains dans le cadre de l'opération Shining Express, qui s'est soldée par la débandade de l'armée libérienne et l'arrestation de Charles Taylor[7].
De gauche à droite) Couverture d'un magazine sur le projet du génome humain, Charles Taylor en état d'arrestation, dissolution de la Yougoslavie.
https://youtu.be/R4KKe6ICRgM
Vidéo Youtube sur la fin de la présidence de Taylor
[1] La réaction la plus claire au 11 septembre et à la guerre contre le terrorisme a été un changement brusque de ton de la part de beaucoup de musiciens et d'artistes, qui sont devenus plus sombres ou plus sérieux. Madonna a opéré un virage anti-guerre et Spears s'est complètement détachée de la pop pour adolescents. Cette évolution est en revanche ici plus progressive.
[2] la musique optimiste est plus populaire
[3] Gump & Co, le livre a été écrit par l'auteur à moitié par cupidité et à moitié par dépit, et aurait probablement beaucoup divergé lors de l'adaptation à l'écran, mais j'en ai gardé les grandes lignes.
[4] Est-ce une coïncidence si les trois films de Tarantino qui ont suivi 2001 étaient entièrement axés sur la vengeance ? L'accident est basé sur un incident réel.
[5] The West Wing s'est ensuite concentré sur la politique étrangère et le terrorisme. ici la série se concentre sur les problèmes des années 90 et la réélection de Bartlett est plus difficile.
[La Coupe du monde de rugby s'est déroulée uniquement en Australie en raison de différends politiques qui ont été passés à la moulinette.
[7] dans notre univers Taylor a démissionné et s'est exilé pendant plusieurs années, mais ici il tente de faire face au bluff de la communauté internationale.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Demain, exceptionnellement pour m'excuser de mon retard, je posterais deux chapitres 

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 29: Seconde pensée


Gore lance sa campagne présidentielle
Se dit prêt pour une revanche en 2004
Jeudi 13 mars 2003, Publié : 18 h 26 EST (23 h 26 GMT)
CARTHAGE, Tennessee (All Politics, 13 mars) -- L'ancien vice-président et ancien candidat démocrate à la présidence Al Gore a officiellement lancé une campagne pour la présidence. Dans son État d'origine, le même endroit où il a lancé sa candidature il y a 4 ans, Gore a promis de faire de la confiance des Américains dans le gouvernement la pièce maîtresse de ses efforts pour récupérer la nomination du parti démocrate et remporter la présidence.
La question de la candidature de Gore était une question en suspens depuis la fin de l'élection de 2000 que Gore a concédée au président Bush, perdant de justesse malgré une marge très mince dans l'état de basculement qu'est Floride, ce qui avait nécessité un rappel, cette question a été réglée en faveur de Bush par la Cour suprême à la majorité de 5 contre 4. Gore avait toutefois été plus populaire que tout autre candidat démocrate. Il maintient actuellement un soutien national, y compris une base solide qui s'empressent de souligner qu'il a déjà remporté le vote populaire et sont suspects à l'égard la décision de la Cour suprême rédigée, rappellent-ils, par des juges nommés par les républicains. Les spéculations sur la candidature potentielle de Gore ont flotté depuis, augmentant chaque fois qu'il a fait une apparition, en particulier en tant qu'opposant aux politiques économiques, étrangères et environnementales de George Bush.
"Ce pays a besoin d'un vrai leadership moral, d'une véritable expérience et d'une autorité non corrompue pour diriger, cette campagne sera dure, plus dure que la précédente, mais je suis prêt à servir, aujourd'hui je vous annonce que, je suis bien candidat à la présidence des États-Unis"
"Ce n'est pas un débat sur le passé, je suis ici pour me concentrer sur l'avenir, c'est une campagne sur la vision et sur le manque de vision du président"
L'annonce de Gore a été accueillie avec le soutien de démocrates de haut niveau, dont l'ancien président Bill Clinton "Al Gore est le meilleur vice-président que l'Amérique ait jamais eu et il est toujours le meilleur candidat pour parler au nom des familles de travailleurs américains et apporter une différence positive à notre pays" et son épouse, la sénatrice Hillary Clinton, D- New York "L'énergie et les idées d'Al Gores sont exactement ce dont le pays a besoin pour apporter une contribution précieuse à notre pays". Le sénateur du Connecticut, Joe Lieberman, qui avait également soutenu Gore en 2000, et qui s'était engagé à ne pas participer à la course si Gore le faisait, a déclaré "Il a un leadership extraordinaire, je le connais depuis 20 ans maintenant et j'étais fier de servir sur un ticket présidentiel avec lui" Il a refusé de commenter s'il serait prêt à servir à nouveau sur le billet.
L'annonce de Gore fait suite à des semaines de déclarations publiques et d'apparitions publiques au cours desquelles il a souvent critiqué l'administration Bush et parlé de la direction qu'il estime que le pays devrait prendre. Cependant, bien qu'il soit le favori général pour la nomination, contrairement à 2000, lorsque Gore n'a fait face qu'à une opposition symbolique de la part de quelques non-conformistes du parti, sa défaite a laissé de nombreux démocrates déçus et beaucoup ont cherché un autre candidat qui pourrait avoir une meilleure chance de gagner le soutien suffisant pour vaincre Bush.
Le sénateur du Massachusetts John Kerry est un candidat potentiel qui a formé un comité présidentiel, il a toujours été interrogé comme deuxième choix des démocrates et a fait des apparitions de style campagne et a courtisé le soutien et l'argent pour une campagne.
L'ancien gouverneur du Vermont, Howard Dean, a déjà annoncé sa candidature dans le but de donner un élan à sa longue course. Et d'autres grands démocrates envisagent de lancer leurs propres campagnes, notamment le président de la Chambre Dick Gephardt, le chef du Sénat Tom Daschle et le sénateur de Caroline du Sud John Edwards.
L'annonce d'Al Gore a confirmé à la fois les attentes, les espoirs et les craintes de nombreux démocrates. Sa candidature était suspectée depuis longtemps, il était le candidat évident depuis la décision controversée de la Cour suprême qui a arrêté prématurément le recomptage en Floride, un recomptage qui, selon la plupart des démocrates, aurait remis l'État et donc l'élection à Gore, une majorité d'Américains continuant de penser que le président Bush n'avait pas été légitimement élu président, et il est bien connu que Gore a remporté le vote populaire par plus de 500 000 voix. Bien que trop de démocrates soient prompts à souligner les défauts évidents de la campagne de Gore, une victoire de 5 points s'était transformée en égalité virtuelle. Peut-être que si Gore n'avait pas mis à l'écart le toujours populaire président Clinton, peut-être s'il n'avait pas choisi le modéré Joe Lieberman comme colistier, ou s'il avait eu une meilleure performance moins guindée dans les débats, fait campagne plus fort ou attaqué plus fort, peut être aurait-t'-il transformé ce demi-échec en victoire, chacune de ces petites erreurs directes empêchant Gore d'entrer au 1600 Pennsylvania Avenue.
Ces démocrates pourraient-ils vraiment faire confiance à Gore pour mieux agir cette fois, contre un président en exercice ; Il y avait suffisamment d'électeurs assez désespérés pour revenir au XXe siècle et laisser tomber Bush, certains n'étaient pas convaincus de la capacité de Gore à faire mieux une seconde fois.
Le principal rival qui a fait surface était le sénateur du Massachusetts John Kerry, qui était déjà candidat à la présidence avant Gore et ses propres annonces de campagne officielles cet été. Kerry est devenu l'un des opposants virulents de Bush au Sénat et avait une expérience approfondie du gouvernement remontant à son activisme contre la guerre du Vietnam ainsi qu'un bon accès aux fonds de campagne. Kerry avait concentré sa campagne sur des attaque contre Bush pour sa mauvaise politique économique et étrangère, avec en sous fond un taux de chômage persistant et pour avoir nui à la réputation des États-Unis sur la scène mondiale. "Chaque jour de cette campagne, je défierai George Bush d'avoir fondamentalement conduit notre pays dans la mauvaise direction." Kerry a fait appel au centre du Parti démocrate qui voulait avant tout vaincre Bush et abandonner Gore.
Le troisième candidat majeur à se lancer dans la course était le chef du Sénat, le sénateur du Dakota du Sud, Tom Daschle, qui a annoncé sa participation juste après Gore de sa ville natale d'Aberdeen, dans le Dakota du Sud : « Bien que ma passion réside actuellement au Sénat, je suis prêt à transmettre cette passion à la présidence. ”. Peut-être au-dessus de tous les autres, Daschle avait pris le président à partie le plus au fil des ans, devenant le visage de l'opposition démocrate en organisant des obstructions contre la législation républicaine, y compris la bataille féroce sur la résolution irakienne du Congrès, il était devenu persona non grata par la Maison Blanche. en raison de sa farouche opposition, le nommant le «chef de l'obstruction» et certaines attaques particulièrement vicieuses l'ont accusé d'aider le dictateur irakien Saddam Hussein. Démocrate du cœur, il a eu des politiques modérées sur certaines questions sociales, il a soutenu l'interruption partiel des grossesses et s'est opposé à certaines mesures de contrôle des armes à feu, il été placé pour très bien performer dans l'Iowa, le premier État à voter compte tenu de la géographie de l'État et de ses liens avec le parti démocrate.

Candidats : le sénateur Kerry, l'ancien vice-président Gore et le chef de la majorité au Sénat Daschle
Sous les trois premiers, il y avait les candidats outsiders, l'ancien gouverneur du Vermont Howard Dean et le sénateur de Caroline du Sud John Edwards. Dean avait été le premier à se lancer dans la course et il s'est présenté comme un populiste féroce et un progressiste fiscalement conservateur, qui était incroyablement critique à l'égard de la politique de Bush. Il a soutenu un système de santé universel ainsi qu'un budget équilibré. Bien que les commentateurs aient été certains que sa campagne serait vouée à l'échec, étant donné son faible nombre de sondages, il a pu générer un public ardent parmi les jeunes et les électeurs en ligne et a développé une campagne sans précédent utilisant Internet pour attirer un grand nombre de dons, il a également adopté la ligne la plus ferme contre l'administration Bush tout au long de la crise du désarmement irakien accusant le président de désinformer le Congrès afin de se procurer l'autorité du Congrès « Où est la menace immédiate ! Le président ne peut pas nous en dire et nos communautés du renseignement non plus. » Sa campagne agressive et flashy a suscité l'attention des médias et des foules, mais la campagne a commencé à se heurter à des problèmes d'argent, des mois avant le début des primaires démocrates.
Le sénateur John Edwards a été le dernier des principaux acteurs à se lancer dans la course, comme Dean, la campagne d'Edward avait un ton populiste, en tant que sénateur de première année de la Caroline du Nord, il a attaqué les politiques de Bush comme ne profitant qu'aux riches et laissant la classe ouvrière derrière. "Nous méritons un président proche de notre peuple, pas des lobbyistes, un président qui les entend quand ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce qu'ils s'occupent d'un enfant ou simplement parce que la simple lutte pour joindre les deux bouts ne leur laisse pas de temps pour autre chose.''. Contrairement à Dean, il n'a pas évoqué la politique étrangère (il avait été l'un des démocrates qui ont soutenu le président en Irak) et est resté concentré sur l'économie en se présentant devant une usine fermée de Caroline du Nord. De plus, contrairement à Dean, Edwards avait des soutien au sein de parti du type de ceux qui voulaient reproduire la victoire de Clinton en faisant la promotion d'un politicien charismatique au visage frais avec l'énergie du sud et une sensation de sel de la terre par opposition à l'un des anciens visages du parti.

Candidats : l'ancien gouverneur Dean et le sénateur Edwards
Les autres candidats étaient le militant afro-américain des droits civiques Al Sharpton, l'ancienne sénatrice de l'Illinois Carol Moseley Braun (la première femme noire élue au Sénat américain) et le membre du Congrès de l'Ohio Dennis Kucinich.
Sharpton a largement mené une campagne axée sur les problèmes sociaux, comme il l'a dit, pour empêcher le parti démocrate de s'éloigner des idées progressistes, notamment en menaçant de se présenter sur un ticket tiers si les démocrates n'adoptaient pas des attitudes plus libérales envers l'action positive, les soins de santé, la criminalité. la justice et la réforme électorale. Il avait généré un nombre important de partisans au cours de ses décennies d'activisme et d'arrestations importantes pour avoir manifesté. Il a déclaré que le parti démocrate ne peut pas gagner la Maison Blanche l'année prochaine "à moins qu'il n'élargisse sa base, à moins qu'il n'aille chercher ceux qui ont été mécontents". La campagne de Moseley Brauns a commencé par un simple argumentaire "Il est temps de retirer le signe "réservé aux hommes" de la porte de la Maison Blanche", elle a placé les soins de santé à payeur unique comme son problème de fond, mais a eu du mal à attirer beaucoup d'attention, soulevant peu de fonds et certains soupçonnaient que la campagne n'était qu'un effort pour racheter son image ou pour séparer le vote noir de la campagne Sharpton.
Kucinich, la finale des candidats s'est présentée à gauche du parti démocrate et avait le soutien du Parti vert et de l'ancien candidat présidentiel Ralph Nader, il a également approuvé les soins de santé à payeur unique, l'anti-libre-échange et l'élimination des frais de scolarité, sa campagne a été résolument de gauche, soutenant ouvertement le mariage homosexuel et les droits à l'avortement, sa campagne chimérique n'a pas attiré beaucoup de soutien.

Candidats : le représentant Kucinich, le militant des droits civiques Al Sharpton et l'ancienne sénatrice Carol Moseley Braun
Le principal démocrate qui devait se présenter, mais qui ne l'a finalement pas fait, était le président de la Chambre, Dick Gephardt, qui a annoncé qu'il ne solliciterait pas l'investiture à la présidence et qu'il essaierait finalement d'aider le parti démocrate de la Chambre, de s'opposer au président Bush et finalement garder le contrôle de la Chambre des représentants. "Mon travail sera de rester à la Chambre et de voir à travers une victoire démocrate là-bas, et d'aider quel que soit le candidat éventuel". Sa campagne aurait été considérée comme assurée en raison de sa notoriété, de sa tentative précédente et de son soutien dans l'Iowa. Il aurait pu être profondément engagé dans la course mais l'entrée de Gore, Kerry et Daschle l'en a dissuadé.
Parmi les autres personnes qui ont refusé de se présenter, citons la sénatrice Hillary Clinton, la première première dame à occuper un poste électif, qui s'est engagée à remplir son mandat au Sénat. « J'ai l'intention d'être le meilleur sénateur possible. C'est ce que je veux faire », a déclaré Clinton. Parmi les autres qui ont refusé, citons le sénateur de Floride Bob Graham, un modéré qui avait été régulièrement considéré pour la vice-présidence et le sénateur du Delaware Joe Biden qui envisageait de participer à la course mais pensait que le peloton était déjà trop plein.
Avec les candidats dans la course, la longue marche a commencé, la course d'Al Gore l'a placé devant ses adversaires grâce à sa reconnaissance de nom et à son expérience, suivi de Kerry, Daschle, Edwards puis Dean avec le reste se bousculant au dernier échelon. Les candidats se sont affrontés pour attaquer le président Bush afin de se démarquer parmi le peloton, démontant le programme économique du président et tout au long de l'été, alors que les candidats commençaient leurs campagnes officielles, la chaleur commençait à monter. La crise du désarmement irakien a interrompu le cycle de campagne et mis la politique étrangère au premier plan, Gore s'est opposé totalement à l'idée d'une guerre avec l'Irak sans l'approbation de l'ONU ou une menace imminente, et a déclaré que l'ensemble du processus remettait en question la diplomatie du président. il devrait avant tout faire avancer un programme de paix : "j'ai travaillé avec les nations du monde sous le président Clinton pour créer l'accord du Vendredi saint en Irlande du Nord, nous avons utilisé une diplomatie vigoureuse et nos militaires pour mettre fin au nettoyage ethnique en Bosnie et au Kosovo et nous avons travaillé pour apaiser les tensions et renforcer les liens des États-Unis avec nos anciens ennemis, ce que je vois de la Maison Blanche est plutôt un effort pour manipuler les faits et déformer la vérité dans la poursuite d'un agenda politique ».
Dean aussi était ouvertement opposé à l'intervention et a également profité de l'occasion pour frapper l'establishment en tant que seul candidat entièrement à l'extérieur du "système", il a lancé de larges critiques anti-Bush étant le seul candidat qui abrogerait complètement toutes les baisses d'impôts de Bush. Les attaques de Dean contre les initiés de Washington lui ont donné un avantage dans les premiers débats sur les candidats et ses attaques cinglantes l'ont sorti de la catégorie des non-espoirs, et il a brièvement culminé à la 3e place, mais ses efforts pour transformer une base de fervents soi-disant "Deaniacs" dans un mouvement à part entière sont tombés au point mort alors que la crise irakienne s'estompait lentement du public, et ses dons de campagne ont commencé à trébucher, avant de finir à une faible 5e place dans les sondages.
La campagne de Gore a également rencontré quelques problèmes, l'avance de Gore commençait à se réduire, malgré la reconnaissance universelle de son nom, il avait deux taches sur son dossier, sa défaite en 2000 et sa composition politique. Aucun démocrate ne voulait répéter les élections de 2000 et renommer Gore semblait un moyen assuré de le faire "Gore a perdu cette élection", a déclaré un membre du personnel du parti démocrate anonyme "il a perdu ces débats, il a perdu cette campagne au profit de Bush" quand on a demandé aux démocrates ce facteur le plus important pour eux dans un candidat, la principale réponse était de battre Bush. Ensuite, c'était le caractère de Gore, le sudiste centriste calme n'a pas fait de lui le candidat le plus excitant sur la piste, la plupart des journalistes se sont souvent plaints d'être sur une piste toute tracée avec Gore, cette campagne devait être différente.
Gore aurait dit à son personnel de campagne "la dernière fois je me suis concentré trop sur les sondages et la tactique, cette fois-ci j'y mets mon cœur et ma vision, laissez les dès tomber là où ils peuvent ». Il a adopté un ton plus agressif, parfois même moqueur, critiquant le manque de principes et les faibles compétences de leadership de Bush, les attaques lui ont permis de maintenir son avance jusqu'en 2003 et il a reçu un coup de pouce lorsque Dean, citant un manque de financement, a abandonné et a approuvé Gore "Si Al Gore était président, le pays ne serait pas dans la situation où il se trouve aujourd'hui, avec son jugement et son bon sens, notre pays aura à nouveau un leadership fort et stable ».

Howard Dean soutient Al Gore
Les dès semblaient tomber en place pour que Gore rejoue sa victoire en primaire de 2000, avec ses trois autres adversaires Kerry, Daschle et Edwards en compétition pour la deuxième place. La campagne de Kerry malgré les sondages initiaux qui le montraient en train de mener une lutte acharnée contre Gore et d'avoir un taux d'approbation et une sympathie plus élevés que Gore, a eu du mal à se distinguer et à gagner des dons, ce qui l'a conduit à financer sa campagne avec les fonds de sa famille et à rudoyer régulièrement le personnel de campagne, il a commencé à tout parir dans une victoire dans l'Iowa et le New Hampshire et s'est présenté comme le candidat le mieux à même de vaincre Bush en se surnommant lui même "The Real Deal".
Daschle était dans le même bateau que Kerry, celui de cuex qui avait bien besoin du caucus de l'Iowa pour maintenir leur campagne, pour créer l'élan nécessaire pour les faire avancer. Daschle s'est présenté comme le meilleur législateur parmi les candidats, le mieux à même de franchir les lignes politiques pour faire avancer les choses tout en renversant la situation présentant Bush comme l'obstructionniste qui avait empêché la relance économique, la réforme du financement des campagnes ou l'expansion de l'assurance-maladie.
Mais Daschle a souffert de critiques constantes de la droite plus fortes que tout autre candidat en raison de ses attaques très médiatisées contre la politique étrangère de Bush. Daschle espérait qu'il serait le candidat le mieux placé pour faire appel aux modérés et vaincre Bush sur les questions de fiscalité, mais Daschle a commencé à pagayer, se battant dur sur les ondes. Il est devenu clair que le message de Daschle ne prenait pas racine, toujours en difficulté dans le peloton dans l'Iowa, Daschle a doublé et a tout misé sur l'état.
La campagne de John Edwards s'est mieux comportée, considérée comme une étoile montante du parti démocrate, un politicien fait pour la télévision et une sorte de chouchou des médias, beaucoup s'attendaient à ce qu'il se présente à la présidence à une date ultérieure en 2008 ou 2012, mais Edwards a surpris la classe politique avec une course précoce en 2004. Sa campagne était initialement petite et a été regroupée en queue de peloton, mais son message était différent de tous les autres candidats au lieu d'essayer de frapper Bush, Edwards s'est concentré sur l'économie, le prix des médicaments d'ordonnance et la création d'emplois. Edwards a rattrapé les sondages alors que Dean a dépassé son apogée et Daschle a reculé à l'échelle nationale ainsi Edwards est entré à la 3e place.
La plupart des critiques adressées à Edwards étaient son inexpérience, vu son premier mandat de sénateur par rapport aux vétérans Gore et Kerry, Edwards avait construit un solide fonds de financement qu'il dépensait pour la publicité dans l'Iowa et le New Hampshire, axé uniquement sur l'économie et a préféré resté à l'écart des attaques alors que Gore, Kerry et Daschle s'en prenaient à la politique irakienne de Bush.
Edwards adopta un ton largement d'accord avec le président « Les États-Unis doivent être prêts à agir avec autant d'alliés que possible pour faire face à cette menace". Edwards avait toujours du mal à vaincre l'un des favoris démocrates et n'a pas réussi à les précéder nulle part, mais il a quand même décidé de miser gros et a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour une réélection en Caroline du Nord, sa campagne s'est concentrée sur son message positif et certains soupçonnait qu'il ne se présentait plus à la présidence et qu'il était plus en lice pour la vice-présidence ou un rôle dans une future administration démocrate en rehaussant son profil avec son message populiste, les critiques ont noté qu'Edwards n'avait pas voté de façon spectaculaire en décalage avec Kerry ou Daschle mais Edwards a renforcé son message économique "Il y a un candidat qui se réveillera chaque matin en pensant à vous" s'adressant aux ouvriers d'usine "celui qui soutient non seulement le libre-échange mais le commerce équitable".
Au cours des dernières semaines de la campagne avant le vote, il est devenu clair qu'une course à trois chevaux avait émergé, alors que le soutien de Daschle se réduisait à un chiffre, la campagne Gore a également perdu son avance en raison de l'injection d'argent et d'énergie de Kerry et Edwards dans l'État de l'Iowa, la campagne d'Edwards a été considérablement aidée par quelques soutiens majeurs, dont le sénateur de l'Iowa Tom Harkin (un éminent partisan de Gore en 2000) et le Des Moines Register, le plus grand journal de l'État, le qualifiant de « meilleur candidat non seulement pour vaincre Bush, mais pour apporter un changement positif et une nouvelle énergie à l'Amérique ». Il y a eu de nombreux débats entre les candidats démocrates et certains des moments les plus notables comprenaient des débats sur les accords de libre-échange, la sécurité nationale et les questions de réductions d'impôts de Bush qui ont largement placé le sénateur Edwards en face de Kerry et de Gore, mais dont le contexte était globalement positif.

(De gauche à droite) Al Gore, John Edwards, John Kerry et Tom Daschle faisant campagne dans l'Iowa
Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour le premier test clé de la saison des élections présidentielles : les caucus de l'Iowa. Le champ des espoirs démocrates a changé avec le résultat, ce qui semblait être une victoire fulgurante pour le camp de Gore quelques semaines auparavant s'est progressivement glissé dans une lutte serrée entre Gore, Kerry, Daschle et Edwards avec des sondages favorisant Edwards puis Gore puis Kerry puis Daschle , la principale raison du dérapage de Gore était que les électeurs reconsidéraient son éligibilité. "Je pensais qu'il allait être la seule chance que nous ayons de sortir Bush de là", a déclaré un membre du caucus. Mais maintenant, dit-elle, "je ne suis plus sûre qu'il soit le meilleur pour l'affronter".
Caucus démocrate de l'Iowa 2004
Le sénateur John Edwards de Caroline du Nord a remporté le caucus de l'Iowa lundi, le catapultant au premier rang des candidats à la présidentielle qui, il y a quelques semaines à peine, devait se classer 4e du concours. Sa victoire a considérablement ébranlé le statut de favori de Gore, le poussant à la troisième place. "Ce soir, nous avons lancé un mouvement pour changer ce pays qui va balayer l'Amérique", a déclaré Edwards, pratiquement étourdi, célébrant sa victoire à Des Moines "Il y a seulement 2 semaines, je ne l'aurais jamais cru", "D'autres candidats ont dépensé plus, ils avaient des organisations pré-construites alors que nous étions le petit moteur qui pouvait ».
Le sénateur John Kerry du Massachusetts est arrivé deuxième, une course qu'il a qualifiée d '«élément clé de sa campagne» et qui le maintiendra probablement dans la compétition. Sa solide performance menaçait d'humilier M. Gore qui a mené tous les sondages nationaux pendant plus d'un an et s'attendait jusqu'à récemment à une première ou deuxième place dans l'État.
Jubilation d'Edwards par rapport aux supporters plus taciturnes de Gore "Je ne suis pas déçu, car ce n'est que le début, on a pris un coup mais je peux vous garantir que je ne suis pas sorti". les soutiens de Gore ont souligné son fort soutien national et sa force dans les États du sud plus tard dans le concours.
Le sénateur Daschle du Dakota du Sud a terminé 4e, une performance dévastatrice qui a conduit le sénateur à mettre fin à sa candidature à la présidence, "Ma campagne pour l'investiture est peut-être terminée mais je n'arrêterai pas de me battre pour chaque Américain" félicitant ses rivaux et apportant son soutien au candidat éventuel.
La campagne de l'Iowa a rapidement transformé l'élection en une course à trois avant la primaire du New Hampshire, électrisant la campagne d'Edwards, gardant la campagne de Kerry en haleine et portant un coup à la campagne de Gore qui faisait face à de grandes attentes compte tenu de son statut de favori. Le temps dira si Edwards pourrait capitaliser sur l'élan que l'Iowa lui a offert.

Caucus présidentiel démocrate de l'Iowa 2004

(Dans le sens des aiguilles d'une montre) John Edwards célèbre, Al et Tipper Gore, John et Teresa Kerry
En mettant l'accent sur les démocrates, la Maison Blanche s'est mise au travail pour construire sa propre équipe de réélection de Bush Cheney, prête à affronter celui des démocrates qui l'aurait emporté, la plupart s'attendaient à ce que Gore soit le vainqueur et la direction républicaine salivait d'avance à l'idée d'un match revanche, ne voyant que l'avantage d'affronter Gore déjà vaincu, avec l'avantage du titulaire de leur côté, même si le président n'était pas très populaire à travers le pays (ses approbations au milieu des 40pour cent), il espérait que des mois de luttes intestines démocrates laisseraient Bush apparaître comme le candidat le plus fort.
C'est ce qui a rendu l'équipe Bush encore plus furieuse lorsque le sénateur républicain du Rhode Island, Lincoln Chafee, l'un des républicains modérés qui avaient constamment défié le président dans un langage fougueux, a posé le gant et a déclaré qu'il avait l'intention de lancer un défi principal au président. . Pendant la crise du désarmement irakien, Chafee avait déclaré qu'il était préoccupé par la direction et la direction du parti républicain et qu'il ne pourrait pas soutenir le président à l'avenir, déterminé à envoyer un message, il s'est fait candidat à l'investiture républicaine de 2004 en commençant par la primaire républicaine du New Hampshire.
Son annonce a été faite lors d'une conférence de presse depuis le New Hampshire, Chafee a expliqué pourquoi il s'opposait au président "Le parti républicain est censé être un grand parti, mais ce président divise le parti". Il a cité la politique fiscale du président, gonflant le déficit de la nation, ignorant les préoccupations environnementales, les opinions sociales extrêmement conservatrices et une politique étrangère dangereuse, toutes des opinions qui, selon Chafee, ont brisé les promesses que le candidat de l'époque, Bush, avait faites dans sa campagne présidentielle. Sa déclaration a certainement eu moins de flash que la plupart des autres, le sénateur assez habituellement silencieux fit toutefois sensation avec sa proclamation publique défiant le président et ses attaques ouvertes contre les échecs législatifs. "Depuis le premier jour, ce président a ignoré une grande partie du pays tout en espérant la loyauté, j'en suis venu à la conclusion que je ne pouvais plus soutenir ce président et que je devais au président de le dire publiquement et de ne pas me cacher... Aujourd'hui, j'entre officiellement dans la course à l'investiture républicaine à la présidence parce que nous devons montrer qu'il reste encore beaucoup à faire pour résoudre nos problèmes, le président s'est qualifié d'unificateur, pas de diviseur, il a promis que sa politique étrangère serait humble, pas arrogante et qu'il réglementerait les pollueurs, ces promesses ont toutes été rompues, ce n'est tout simplement pas une administration à laquelle on peut faire confiance ».
La course pourrait constituer une menace sérieuse pour l'administration Bush, bien qu'ils aient une immense confiance que Chafee n'occuperait pas la Maison Blanche dans cet univers, ou à vrai dire, dans n'importe quel univers, tous les analystes étaient conscients de l'impact qu'un défi de cette taille avait sur un président en exercice. Truman, Johnson, Ford et Carter en ont tous fait face, ce qui les a obligés soit à se retirer de la course, soit à perdre les élections, personne n'était plus conscient de la menace que le président lui-même s'est rappelé avoir rassuré son père sur le fait que la candidature de Pat Buchanan en 92 n'était pas une menace, pour en subir les conséquences après.
L'annonce de Chafee a forcé la campagne Bush-Cheney à s'emballer et le programme du président s'est rempli de plus d'arrêts de campagne déterminés à étouffer la campagne Chafee à ses débuts, cherchant l'enthousiasme pour l'administration, chantant les louanges de la reprise de l'économie, applaudissant l'impact de ses coupes d'impôts (celles auxquelles Chafee s'est opposé) "Certaines personnes peuvent dire que cet argent n'est pas suffisant pour les gens, enfin peut-être pour ceux qui gagnent de l'argent, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup et cela fait une différence", a déclaré Bush dans un message arrangé à la hâte.
Si vous vous étiez arrêtez-vous à Concord, New Hampshire, vous airez vu que le "trésor de guerre" de Bush s'était rapidement enflammé, bombardant l'état de publicités, il y a 4 ans l'équipe Bush avait négligé le New Hampshire une erreur potentiellement fatale qui avait permis à John McCain de devenir une menace sérieuse, aujourd'hui il n'y aurait pas une telle erreur, les supporters se sont mobilisés et une campagne appelée Chafee le `numéro un RINO '' (républicain de nom seulement, numéro 1) ou le " plus gros cul du parti républicain'' a permis d'y stabiliser Bush.
Les sondages semblaient montrer que les efforts des équipes de Bush fonctionnaient alors que Bush gagnait une avance de 63% - 18% de plus que Chafee.

(À gauche) George Bush fait campagne dans le New Hampshire, (à droite) Lincoln Chafee annonce sa campagne primaire.
Gore lance sa campagne présidentielle
Se dit prêt pour une revanche en 2004
Jeudi 13 mars 2003, Publié : 18 h 26 EST (23 h 26 GMT)
CARTHAGE, Tennessee (All Politics, 13 mars) -- L'ancien vice-président et ancien candidat démocrate à la présidence Al Gore a officiellement lancé une campagne pour la présidence. Dans son État d'origine, le même endroit où il a lancé sa candidature il y a 4 ans, Gore a promis de faire de la confiance des Américains dans le gouvernement la pièce maîtresse de ses efforts pour récupérer la nomination du parti démocrate et remporter la présidence.
La question de la candidature de Gore était une question en suspens depuis la fin de l'élection de 2000 que Gore a concédée au président Bush, perdant de justesse malgré une marge très mince dans l'état de basculement qu'est Floride, ce qui avait nécessité un rappel, cette question a été réglée en faveur de Bush par la Cour suprême à la majorité de 5 contre 4. Gore avait toutefois été plus populaire que tout autre candidat démocrate. Il maintient actuellement un soutien national, y compris une base solide qui s'empressent de souligner qu'il a déjà remporté le vote populaire et sont suspects à l'égard la décision de la Cour suprême rédigée, rappellent-ils, par des juges nommés par les républicains. Les spéculations sur la candidature potentielle de Gore ont flotté depuis, augmentant chaque fois qu'il a fait une apparition, en particulier en tant qu'opposant aux politiques économiques, étrangères et environnementales de George Bush.
"Ce pays a besoin d'un vrai leadership moral, d'une véritable expérience et d'une autorité non corrompue pour diriger, cette campagne sera dure, plus dure que la précédente, mais je suis prêt à servir, aujourd'hui je vous annonce que, je suis bien candidat à la présidence des États-Unis"
"Ce n'est pas un débat sur le passé, je suis ici pour me concentrer sur l'avenir, c'est une campagne sur la vision et sur le manque de vision du président"
L'annonce de Gore a été accueillie avec le soutien de démocrates de haut niveau, dont l'ancien président Bill Clinton "Al Gore est le meilleur vice-président que l'Amérique ait jamais eu et il est toujours le meilleur candidat pour parler au nom des familles de travailleurs américains et apporter une différence positive à notre pays" et son épouse, la sénatrice Hillary Clinton, D- New York "L'énergie et les idées d'Al Gores sont exactement ce dont le pays a besoin pour apporter une contribution précieuse à notre pays". Le sénateur du Connecticut, Joe Lieberman, qui avait également soutenu Gore en 2000, et qui s'était engagé à ne pas participer à la course si Gore le faisait, a déclaré "Il a un leadership extraordinaire, je le connais depuis 20 ans maintenant et j'étais fier de servir sur un ticket présidentiel avec lui" Il a refusé de commenter s'il serait prêt à servir à nouveau sur le billet.
L'annonce de Gore fait suite à des semaines de déclarations publiques et d'apparitions publiques au cours desquelles il a souvent critiqué l'administration Bush et parlé de la direction qu'il estime que le pays devrait prendre. Cependant, bien qu'il soit le favori général pour la nomination, contrairement à 2000, lorsque Gore n'a fait face qu'à une opposition symbolique de la part de quelques non-conformistes du parti, sa défaite a laissé de nombreux démocrates déçus et beaucoup ont cherché un autre candidat qui pourrait avoir une meilleure chance de gagner le soutien suffisant pour vaincre Bush.
Le sénateur du Massachusetts John Kerry est un candidat potentiel qui a formé un comité présidentiel, il a toujours été interrogé comme deuxième choix des démocrates et a fait des apparitions de style campagne et a courtisé le soutien et l'argent pour une campagne.
L'ancien gouverneur du Vermont, Howard Dean, a déjà annoncé sa candidature dans le but de donner un élan à sa longue course. Et d'autres grands démocrates envisagent de lancer leurs propres campagnes, notamment le président de la Chambre Dick Gephardt, le chef du Sénat Tom Daschle et le sénateur de Caroline du Sud John Edwards.
L'annonce d'Al Gore a confirmé à la fois les attentes, les espoirs et les craintes de nombreux démocrates. Sa candidature était suspectée depuis longtemps, il était le candidat évident depuis la décision controversée de la Cour suprême qui a arrêté prématurément le recomptage en Floride, un recomptage qui, selon la plupart des démocrates, aurait remis l'État et donc l'élection à Gore, une majorité d'Américains continuant de penser que le président Bush n'avait pas été légitimement élu président, et il est bien connu que Gore a remporté le vote populaire par plus de 500 000 voix. Bien que trop de démocrates soient prompts à souligner les défauts évidents de la campagne de Gore, une victoire de 5 points s'était transformée en égalité virtuelle. Peut-être que si Gore n'avait pas mis à l'écart le toujours populaire président Clinton, peut-être s'il n'avait pas choisi le modéré Joe Lieberman comme colistier, ou s'il avait eu une meilleure performance moins guindée dans les débats, fait campagne plus fort ou attaqué plus fort, peut être aurait-t'-il transformé ce demi-échec en victoire, chacune de ces petites erreurs directes empêchant Gore d'entrer au 1600 Pennsylvania Avenue.
Ces démocrates pourraient-ils vraiment faire confiance à Gore pour mieux agir cette fois, contre un président en exercice ; Il y avait suffisamment d'électeurs assez désespérés pour revenir au XXe siècle et laisser tomber Bush, certains n'étaient pas convaincus de la capacité de Gore à faire mieux une seconde fois.
Le principal rival qui a fait surface était le sénateur du Massachusetts John Kerry, qui était déjà candidat à la présidence avant Gore et ses propres annonces de campagne officielles cet été. Kerry est devenu l'un des opposants virulents de Bush au Sénat et avait une expérience approfondie du gouvernement remontant à son activisme contre la guerre du Vietnam ainsi qu'un bon accès aux fonds de campagne. Kerry avait concentré sa campagne sur des attaque contre Bush pour sa mauvaise politique économique et étrangère, avec en sous fond un taux de chômage persistant et pour avoir nui à la réputation des États-Unis sur la scène mondiale. "Chaque jour de cette campagne, je défierai George Bush d'avoir fondamentalement conduit notre pays dans la mauvaise direction." Kerry a fait appel au centre du Parti démocrate qui voulait avant tout vaincre Bush et abandonner Gore.
Le troisième candidat majeur à se lancer dans la course était le chef du Sénat, le sénateur du Dakota du Sud, Tom Daschle, qui a annoncé sa participation juste après Gore de sa ville natale d'Aberdeen, dans le Dakota du Sud : « Bien que ma passion réside actuellement au Sénat, je suis prêt à transmettre cette passion à la présidence. ”. Peut-être au-dessus de tous les autres, Daschle avait pris le président à partie le plus au fil des ans, devenant le visage de l'opposition démocrate en organisant des obstructions contre la législation républicaine, y compris la bataille féroce sur la résolution irakienne du Congrès, il était devenu persona non grata par la Maison Blanche. en raison de sa farouche opposition, le nommant le «chef de l'obstruction» et certaines attaques particulièrement vicieuses l'ont accusé d'aider le dictateur irakien Saddam Hussein. Démocrate du cœur, il a eu des politiques modérées sur certaines questions sociales, il a soutenu l'interruption partiel des grossesses et s'est opposé à certaines mesures de contrôle des armes à feu, il été placé pour très bien performer dans l'Iowa, le premier État à voter compte tenu de la géographie de l'État et de ses liens avec le parti démocrate.
Candidats : le sénateur Kerry, l'ancien vice-président Gore et le chef de la majorité au Sénat Daschle
Sous les trois premiers, il y avait les candidats outsiders, l'ancien gouverneur du Vermont Howard Dean et le sénateur de Caroline du Sud John Edwards. Dean avait été le premier à se lancer dans la course et il s'est présenté comme un populiste féroce et un progressiste fiscalement conservateur, qui était incroyablement critique à l'égard de la politique de Bush. Il a soutenu un système de santé universel ainsi qu'un budget équilibré. Bien que les commentateurs aient été certains que sa campagne serait vouée à l'échec, étant donné son faible nombre de sondages, il a pu générer un public ardent parmi les jeunes et les électeurs en ligne et a développé une campagne sans précédent utilisant Internet pour attirer un grand nombre de dons, il a également adopté la ligne la plus ferme contre l'administration Bush tout au long de la crise du désarmement irakien accusant le président de désinformer le Congrès afin de se procurer l'autorité du Congrès « Où est la menace immédiate ! Le président ne peut pas nous en dire et nos communautés du renseignement non plus. » Sa campagne agressive et flashy a suscité l'attention des médias et des foules, mais la campagne a commencé à se heurter à des problèmes d'argent, des mois avant le début des primaires démocrates.
Le sénateur John Edwards a été le dernier des principaux acteurs à se lancer dans la course, comme Dean, la campagne d'Edward avait un ton populiste, en tant que sénateur de première année de la Caroline du Nord, il a attaqué les politiques de Bush comme ne profitant qu'aux riches et laissant la classe ouvrière derrière. "Nous méritons un président proche de notre peuple, pas des lobbyistes, un président qui les entend quand ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ont perdu leur emploi ou parce qu'ils s'occupent d'un enfant ou simplement parce que la simple lutte pour joindre les deux bouts ne leur laisse pas de temps pour autre chose.''. Contrairement à Dean, il n'a pas évoqué la politique étrangère (il avait été l'un des démocrates qui ont soutenu le président en Irak) et est resté concentré sur l'économie en se présentant devant une usine fermée de Caroline du Nord. De plus, contrairement à Dean, Edwards avait des soutien au sein de parti du type de ceux qui voulaient reproduire la victoire de Clinton en faisant la promotion d'un politicien charismatique au visage frais avec l'énergie du sud et une sensation de sel de la terre par opposition à l'un des anciens visages du parti.
Candidats : l'ancien gouverneur Dean et le sénateur Edwards
Les autres candidats étaient le militant afro-américain des droits civiques Al Sharpton, l'ancienne sénatrice de l'Illinois Carol Moseley Braun (la première femme noire élue au Sénat américain) et le membre du Congrès de l'Ohio Dennis Kucinich.
Sharpton a largement mené une campagne axée sur les problèmes sociaux, comme il l'a dit, pour empêcher le parti démocrate de s'éloigner des idées progressistes, notamment en menaçant de se présenter sur un ticket tiers si les démocrates n'adoptaient pas des attitudes plus libérales envers l'action positive, les soins de santé, la criminalité. la justice et la réforme électorale. Il avait généré un nombre important de partisans au cours de ses décennies d'activisme et d'arrestations importantes pour avoir manifesté. Il a déclaré que le parti démocrate ne peut pas gagner la Maison Blanche l'année prochaine "à moins qu'il n'élargisse sa base, à moins qu'il n'aille chercher ceux qui ont été mécontents". La campagne de Moseley Brauns a commencé par un simple argumentaire "Il est temps de retirer le signe "réservé aux hommes" de la porte de la Maison Blanche", elle a placé les soins de santé à payeur unique comme son problème de fond, mais a eu du mal à attirer beaucoup d'attention, soulevant peu de fonds et certains soupçonnaient que la campagne n'était qu'un effort pour racheter son image ou pour séparer le vote noir de la campagne Sharpton.
Kucinich, la finale des candidats s'est présentée à gauche du parti démocrate et avait le soutien du Parti vert et de l'ancien candidat présidentiel Ralph Nader, il a également approuvé les soins de santé à payeur unique, l'anti-libre-échange et l'élimination des frais de scolarité, sa campagne a été résolument de gauche, soutenant ouvertement le mariage homosexuel et les droits à l'avortement, sa campagne chimérique n'a pas attiré beaucoup de soutien.
Candidats : le représentant Kucinich, le militant des droits civiques Al Sharpton et l'ancienne sénatrice Carol Moseley Braun
Le principal démocrate qui devait se présenter, mais qui ne l'a finalement pas fait, était le président de la Chambre, Dick Gephardt, qui a annoncé qu'il ne solliciterait pas l'investiture à la présidence et qu'il essaierait finalement d'aider le parti démocrate de la Chambre, de s'opposer au président Bush et finalement garder le contrôle de la Chambre des représentants. "Mon travail sera de rester à la Chambre et de voir à travers une victoire démocrate là-bas, et d'aider quel que soit le candidat éventuel". Sa campagne aurait été considérée comme assurée en raison de sa notoriété, de sa tentative précédente et de son soutien dans l'Iowa. Il aurait pu être profondément engagé dans la course mais l'entrée de Gore, Kerry et Daschle l'en a dissuadé.
Parmi les autres personnes qui ont refusé de se présenter, citons la sénatrice Hillary Clinton, la première première dame à occuper un poste électif, qui s'est engagée à remplir son mandat au Sénat. « J'ai l'intention d'être le meilleur sénateur possible. C'est ce que je veux faire », a déclaré Clinton. Parmi les autres qui ont refusé, citons le sénateur de Floride Bob Graham, un modéré qui avait été régulièrement considéré pour la vice-présidence et le sénateur du Delaware Joe Biden qui envisageait de participer à la course mais pensait que le peloton était déjà trop plein.
Avec les candidats dans la course, la longue marche a commencé, la course d'Al Gore l'a placé devant ses adversaires grâce à sa reconnaissance de nom et à son expérience, suivi de Kerry, Daschle, Edwards puis Dean avec le reste se bousculant au dernier échelon. Les candidats se sont affrontés pour attaquer le président Bush afin de se démarquer parmi le peloton, démontant le programme économique du président et tout au long de l'été, alors que les candidats commençaient leurs campagnes officielles, la chaleur commençait à monter. La crise du désarmement irakien a interrompu le cycle de campagne et mis la politique étrangère au premier plan, Gore s'est opposé totalement à l'idée d'une guerre avec l'Irak sans l'approbation de l'ONU ou une menace imminente, et a déclaré que l'ensemble du processus remettait en question la diplomatie du président. il devrait avant tout faire avancer un programme de paix : "j'ai travaillé avec les nations du monde sous le président Clinton pour créer l'accord du Vendredi saint en Irlande du Nord, nous avons utilisé une diplomatie vigoureuse et nos militaires pour mettre fin au nettoyage ethnique en Bosnie et au Kosovo et nous avons travaillé pour apaiser les tensions et renforcer les liens des États-Unis avec nos anciens ennemis, ce que je vois de la Maison Blanche est plutôt un effort pour manipuler les faits et déformer la vérité dans la poursuite d'un agenda politique ».
Dean aussi était ouvertement opposé à l'intervention et a également profité de l'occasion pour frapper l'establishment en tant que seul candidat entièrement à l'extérieur du "système", il a lancé de larges critiques anti-Bush étant le seul candidat qui abrogerait complètement toutes les baisses d'impôts de Bush. Les attaques de Dean contre les initiés de Washington lui ont donné un avantage dans les premiers débats sur les candidats et ses attaques cinglantes l'ont sorti de la catégorie des non-espoirs, et il a brièvement culminé à la 3e place, mais ses efforts pour transformer une base de fervents soi-disant "Deaniacs" dans un mouvement à part entière sont tombés au point mort alors que la crise irakienne s'estompait lentement du public, et ses dons de campagne ont commencé à trébucher, avant de finir à une faible 5e place dans les sondages.
La campagne de Gore a également rencontré quelques problèmes, l'avance de Gore commençait à se réduire, malgré la reconnaissance universelle de son nom, il avait deux taches sur son dossier, sa défaite en 2000 et sa composition politique. Aucun démocrate ne voulait répéter les élections de 2000 et renommer Gore semblait un moyen assuré de le faire "Gore a perdu cette élection", a déclaré un membre du personnel du parti démocrate anonyme "il a perdu ces débats, il a perdu cette campagne au profit de Bush" quand on a demandé aux démocrates ce facteur le plus important pour eux dans un candidat, la principale réponse était de battre Bush. Ensuite, c'était le caractère de Gore, le sudiste centriste calme n'a pas fait de lui le candidat le plus excitant sur la piste, la plupart des journalistes se sont souvent plaints d'être sur une piste toute tracée avec Gore, cette campagne devait être différente.
Gore aurait dit à son personnel de campagne "la dernière fois je me suis concentré trop sur les sondages et la tactique, cette fois-ci j'y mets mon cœur et ma vision, laissez les dès tomber là où ils peuvent ». Il a adopté un ton plus agressif, parfois même moqueur, critiquant le manque de principes et les faibles compétences de leadership de Bush, les attaques lui ont permis de maintenir son avance jusqu'en 2003 et il a reçu un coup de pouce lorsque Dean, citant un manque de financement, a abandonné et a approuvé Gore "Si Al Gore était président, le pays ne serait pas dans la situation où il se trouve aujourd'hui, avec son jugement et son bon sens, notre pays aura à nouveau un leadership fort et stable ».
Howard Dean soutient Al Gore
Les dès semblaient tomber en place pour que Gore rejoue sa victoire en primaire de 2000, avec ses trois autres adversaires Kerry, Daschle et Edwards en compétition pour la deuxième place. La campagne de Kerry malgré les sondages initiaux qui le montraient en train de mener une lutte acharnée contre Gore et d'avoir un taux d'approbation et une sympathie plus élevés que Gore, a eu du mal à se distinguer et à gagner des dons, ce qui l'a conduit à financer sa campagne avec les fonds de sa famille et à rudoyer régulièrement le personnel de campagne, il a commencé à tout parir dans une victoire dans l'Iowa et le New Hampshire et s'est présenté comme le candidat le mieux à même de vaincre Bush en se surnommant lui même "The Real Deal".
Daschle était dans le même bateau que Kerry, celui de cuex qui avait bien besoin du caucus de l'Iowa pour maintenir leur campagne, pour créer l'élan nécessaire pour les faire avancer. Daschle s'est présenté comme le meilleur législateur parmi les candidats, le mieux à même de franchir les lignes politiques pour faire avancer les choses tout en renversant la situation présentant Bush comme l'obstructionniste qui avait empêché la relance économique, la réforme du financement des campagnes ou l'expansion de l'assurance-maladie.
Mais Daschle a souffert de critiques constantes de la droite plus fortes que tout autre candidat en raison de ses attaques très médiatisées contre la politique étrangère de Bush. Daschle espérait qu'il serait le candidat le mieux placé pour faire appel aux modérés et vaincre Bush sur les questions de fiscalité, mais Daschle a commencé à pagayer, se battant dur sur les ondes. Il est devenu clair que le message de Daschle ne prenait pas racine, toujours en difficulté dans le peloton dans l'Iowa, Daschle a doublé et a tout misé sur l'état.
La campagne de John Edwards s'est mieux comportée, considérée comme une étoile montante du parti démocrate, un politicien fait pour la télévision et une sorte de chouchou des médias, beaucoup s'attendaient à ce qu'il se présente à la présidence à une date ultérieure en 2008 ou 2012, mais Edwards a surpris la classe politique avec une course précoce en 2004. Sa campagne était initialement petite et a été regroupée en queue de peloton, mais son message était différent de tous les autres candidats au lieu d'essayer de frapper Bush, Edwards s'est concentré sur l'économie, le prix des médicaments d'ordonnance et la création d'emplois. Edwards a rattrapé les sondages alors que Dean a dépassé son apogée et Daschle a reculé à l'échelle nationale ainsi Edwards est entré à la 3e place.
La plupart des critiques adressées à Edwards étaient son inexpérience, vu son premier mandat de sénateur par rapport aux vétérans Gore et Kerry, Edwards avait construit un solide fonds de financement qu'il dépensait pour la publicité dans l'Iowa et le New Hampshire, axé uniquement sur l'économie et a préféré resté à l'écart des attaques alors que Gore, Kerry et Daschle s'en prenaient à la politique irakienne de Bush.
Edwards adopta un ton largement d'accord avec le président « Les États-Unis doivent être prêts à agir avec autant d'alliés que possible pour faire face à cette menace". Edwards avait toujours du mal à vaincre l'un des favoris démocrates et n'a pas réussi à les précéder nulle part, mais il a quand même décidé de miser gros et a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour une réélection en Caroline du Nord, sa campagne s'est concentrée sur son message positif et certains soupçonnait qu'il ne se présentait plus à la présidence et qu'il était plus en lice pour la vice-présidence ou un rôle dans une future administration démocrate en rehaussant son profil avec son message populiste, les critiques ont noté qu'Edwards n'avait pas voté de façon spectaculaire en décalage avec Kerry ou Daschle mais Edwards a renforcé son message économique "Il y a un candidat qui se réveillera chaque matin en pensant à vous" s'adressant aux ouvriers d'usine "celui qui soutient non seulement le libre-échange mais le commerce équitable".
Au cours des dernières semaines de la campagne avant le vote, il est devenu clair qu'une course à trois chevaux avait émergé, alors que le soutien de Daschle se réduisait à un chiffre, la campagne Gore a également perdu son avance en raison de l'injection d'argent et d'énergie de Kerry et Edwards dans l'État de l'Iowa, la campagne d'Edwards a été considérablement aidée par quelques soutiens majeurs, dont le sénateur de l'Iowa Tom Harkin (un éminent partisan de Gore en 2000) et le Des Moines Register, le plus grand journal de l'État, le qualifiant de « meilleur candidat non seulement pour vaincre Bush, mais pour apporter un changement positif et une nouvelle énergie à l'Amérique ». Il y a eu de nombreux débats entre les candidats démocrates et certains des moments les plus notables comprenaient des débats sur les accords de libre-échange, la sécurité nationale et les questions de réductions d'impôts de Bush qui ont largement placé le sénateur Edwards en face de Kerry et de Gore, mais dont le contexte était globalement positif.
(De gauche à droite) Al Gore, John Edwards, John Kerry et Tom Daschle faisant campagne dans l'Iowa
Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour le premier test clé de la saison des élections présidentielles : les caucus de l'Iowa. Le champ des espoirs démocrates a changé avec le résultat, ce qui semblait être une victoire fulgurante pour le camp de Gore quelques semaines auparavant s'est progressivement glissé dans une lutte serrée entre Gore, Kerry, Daschle et Edwards avec des sondages favorisant Edwards puis Gore puis Kerry puis Daschle , la principale raison du dérapage de Gore était que les électeurs reconsidéraient son éligibilité. "Je pensais qu'il allait être la seule chance que nous ayons de sortir Bush de là", a déclaré un membre du caucus. Mais maintenant, dit-elle, "je ne suis plus sûre qu'il soit le meilleur pour l'affronter".
Caucus démocrate de l'Iowa 2004
Le sénateur John Edwards de Caroline du Nord a remporté le caucus de l'Iowa lundi, le catapultant au premier rang des candidats à la présidentielle qui, il y a quelques semaines à peine, devait se classer 4e du concours. Sa victoire a considérablement ébranlé le statut de favori de Gore, le poussant à la troisième place. "Ce soir, nous avons lancé un mouvement pour changer ce pays qui va balayer l'Amérique", a déclaré Edwards, pratiquement étourdi, célébrant sa victoire à Des Moines "Il y a seulement 2 semaines, je ne l'aurais jamais cru", "D'autres candidats ont dépensé plus, ils avaient des organisations pré-construites alors que nous étions le petit moteur qui pouvait ».
Le sénateur John Kerry du Massachusetts est arrivé deuxième, une course qu'il a qualifiée d '«élément clé de sa campagne» et qui le maintiendra probablement dans la compétition. Sa solide performance menaçait d'humilier M. Gore qui a mené tous les sondages nationaux pendant plus d'un an et s'attendait jusqu'à récemment à une première ou deuxième place dans l'État.
Jubilation d'Edwards par rapport aux supporters plus taciturnes de Gore "Je ne suis pas déçu, car ce n'est que le début, on a pris un coup mais je peux vous garantir que je ne suis pas sorti". les soutiens de Gore ont souligné son fort soutien national et sa force dans les États du sud plus tard dans le concours.
Le sénateur Daschle du Dakota du Sud a terminé 4e, une performance dévastatrice qui a conduit le sénateur à mettre fin à sa candidature à la présidence, "Ma campagne pour l'investiture est peut-être terminée mais je n'arrêterai pas de me battre pour chaque Américain" félicitant ses rivaux et apportant son soutien au candidat éventuel.
La campagne de l'Iowa a rapidement transformé l'élection en une course à trois avant la primaire du New Hampshire, électrisant la campagne d'Edwards, gardant la campagne de Kerry en haleine et portant un coup à la campagne de Gore qui faisait face à de grandes attentes compte tenu de son statut de favori. Le temps dira si Edwards pourrait capitaliser sur l'élan que l'Iowa lui a offert.
Caucus présidentiel démocrate de l'Iowa 2004
(Dans le sens des aiguilles d'une montre) John Edwards célèbre, Al et Tipper Gore, John et Teresa Kerry
En mettant l'accent sur les démocrates, la Maison Blanche s'est mise au travail pour construire sa propre équipe de réélection de Bush Cheney, prête à affronter celui des démocrates qui l'aurait emporté, la plupart s'attendaient à ce que Gore soit le vainqueur et la direction républicaine salivait d'avance à l'idée d'un match revanche, ne voyant que l'avantage d'affronter Gore déjà vaincu, avec l'avantage du titulaire de leur côté, même si le président n'était pas très populaire à travers le pays (ses approbations au milieu des 40pour cent), il espérait que des mois de luttes intestines démocrates laisseraient Bush apparaître comme le candidat le plus fort.
C'est ce qui a rendu l'équipe Bush encore plus furieuse lorsque le sénateur républicain du Rhode Island, Lincoln Chafee, l'un des républicains modérés qui avaient constamment défié le président dans un langage fougueux, a posé le gant et a déclaré qu'il avait l'intention de lancer un défi principal au président. . Pendant la crise du désarmement irakien, Chafee avait déclaré qu'il était préoccupé par la direction et la direction du parti républicain et qu'il ne pourrait pas soutenir le président à l'avenir, déterminé à envoyer un message, il s'est fait candidat à l'investiture républicaine de 2004 en commençant par la primaire républicaine du New Hampshire.
Son annonce a été faite lors d'une conférence de presse depuis le New Hampshire, Chafee a expliqué pourquoi il s'opposait au président "Le parti républicain est censé être un grand parti, mais ce président divise le parti". Il a cité la politique fiscale du président, gonflant le déficit de la nation, ignorant les préoccupations environnementales, les opinions sociales extrêmement conservatrices et une politique étrangère dangereuse, toutes des opinions qui, selon Chafee, ont brisé les promesses que le candidat de l'époque, Bush, avait faites dans sa campagne présidentielle. Sa déclaration a certainement eu moins de flash que la plupart des autres, le sénateur assez habituellement silencieux fit toutefois sensation avec sa proclamation publique défiant le président et ses attaques ouvertes contre les échecs législatifs. "Depuis le premier jour, ce président a ignoré une grande partie du pays tout en espérant la loyauté, j'en suis venu à la conclusion que je ne pouvais plus soutenir ce président et que je devais au président de le dire publiquement et de ne pas me cacher... Aujourd'hui, j'entre officiellement dans la course à l'investiture républicaine à la présidence parce que nous devons montrer qu'il reste encore beaucoup à faire pour résoudre nos problèmes, le président s'est qualifié d'unificateur, pas de diviseur, il a promis que sa politique étrangère serait humble, pas arrogante et qu'il réglementerait les pollueurs, ces promesses ont toutes été rompues, ce n'est tout simplement pas une administration à laquelle on peut faire confiance ».
La course pourrait constituer une menace sérieuse pour l'administration Bush, bien qu'ils aient une immense confiance que Chafee n'occuperait pas la Maison Blanche dans cet univers, ou à vrai dire, dans n'importe quel univers, tous les analystes étaient conscients de l'impact qu'un défi de cette taille avait sur un président en exercice. Truman, Johnson, Ford et Carter en ont tous fait face, ce qui les a obligés soit à se retirer de la course, soit à perdre les élections, personne n'était plus conscient de la menace que le président lui-même s'est rappelé avoir rassuré son père sur le fait que la candidature de Pat Buchanan en 92 n'était pas une menace, pour en subir les conséquences après.
L'annonce de Chafee a forcé la campagne Bush-Cheney à s'emballer et le programme du président s'est rempli de plus d'arrêts de campagne déterminés à étouffer la campagne Chafee à ses débuts, cherchant l'enthousiasme pour l'administration, chantant les louanges de la reprise de l'économie, applaudissant l'impact de ses coupes d'impôts (celles auxquelles Chafee s'est opposé) "Certaines personnes peuvent dire que cet argent n'est pas suffisant pour les gens, enfin peut-être pour ceux qui gagnent de l'argent, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup et cela fait une différence", a déclaré Bush dans un message arrangé à la hâte.
Si vous vous étiez arrêtez-vous à Concord, New Hampshire, vous airez vu que le "trésor de guerre" de Bush s'était rapidement enflammé, bombardant l'état de publicités, il y a 4 ans l'équipe Bush avait négligé le New Hampshire une erreur potentiellement fatale qui avait permis à John McCain de devenir une menace sérieuse, aujourd'hui il n'y aurait pas une telle erreur, les supporters se sont mobilisés et une campagne appelée Chafee le `numéro un RINO '' (républicain de nom seulement, numéro 1) ou le " plus gros cul du parti républicain'' a permis d'y stabiliser Bush.
Les sondages semblaient montrer que les efforts des équipes de Bush fonctionnaient alors que Bush gagnait une avance de 63% - 18% de plus que Chafee.
(À gauche) George Bush fait campagne dans le New Hampshire, (à droite) Lincoln Chafee annonce sa campagne primaire.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 30: Retour à la case départ
Les retombées du caucus de l'Iowa étaient évidentes : il ne restait plus que trois candidats démocrates potentiels, l'ancien vice-président Al Gore, le sénateur du Massachusetts John Kerry et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards (le représentant de l'Ohio Dennis Kucinich et le révérend Al Sharpton sont restés dans la course mais n'ont jamais réussi à sortir de la marge dans les sondages). Tous les candidats avaient quelque chose à prouver lors des primaires du New Hampshire. Gore, qui était en tête des sondages au niveau national et dans l'État du New Hampshire depuis un an et demi, devait montrer qu'il était toujours le candidat présomptif des démocrates et que l'Iowa n'était qu'une exception pour sa campagne. Kerry devait prouver qu'il était toujours dans la course. Sa deuxième place dans l'Iowa a prouvé que sa campagne était viable, mais elle devait être renforcée par une meilleure performance dans le New Hampshire, une victoire lui donnerait l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Quant à Edwards, il devait profiter de l'élan donné par son triomphe dans l'Iowa pour prouver qu'il était un candidat solide à l'échelle nationale, et une victoire dans le New Hampshire le propulserait au premier rang.
Tout au long de l'année 2003, Gore a conservé une large avance sur ses adversaires dans le New Hampshire, 20% sur Kerry, son concurrent le plus proche, mais après le coup de théâtre de l'Iowa, il était clair que les démocrates reconsidéraient leurs options quant au choix de leur candidat. Gore a rapidement perdu du terrain, tombant à 11 points d'avance (il était à 36% suivi de Kerry à 25%), Edwards a gagné beaucoup de terrain grâce à sa victoire dans l'Iowa, doublant sa moyenne dans les sondages jusqu'à ce qu'il se retrouve juste derrière Kerry à 24%. Les gains de Kerry et d'Edward ont été attribués à l'énergie que les deux candidats ont déployée pour voyager et dépenser des fonds dans l'État, ainsi qu'au nouvel élan qui s'est dégagé de l'Iowa.
"Les gens se demandent maintenant si Gore n'a pas tout perdu", a déclaré un sondeur. "Les sondés recherchent un vainqueur. Et il n'y a rien de mieux que de gagner pour prouver que l'on est un battant".

Les trois principaux candidats démocrates : Al Gore, John Edwards et John Kerry.
Le camp Gore était clairement préoccupé par les données des sondages, l'équipe s'attendait depuis le début à un défi difficile dans l'État du granit et la défaite dans l'Iowa a fait chuter les attentes. Ce qui aurait pu être le moment où la campagne a remis de l'ordre dans l'ensemble du processus d'investiture, confirmant Gore comme le véritable leader et candidat, était désormais le plus grand défi qu'il avait à relever. Le sénateur Shaheen du New Hampshire a averti le camp Gore : "Vous ne pouvez pas vous présenter ici en vous basant sur la reconnaissance de votre nom" et a demandé à Gore de travailler davantage dans l'État. Gore avait appris cela il y a quatre ans lorsqu'il avait réussi à mettre à genoux la campagne de Bill Bradley en le battant d'un petit 4 %, ce qui avait mis fin aux chances de Bradley.
Gore a alors fait des heures supplémentaires pour changer son image de technocrate ennuyeux en combattant passionné et la compétition a commencé à devenir sanglante. Pour la première fois, Kerry et Edwards s'en sont pris à Gore, attaquant l'ancien vice-président là où cela faisait le plus mal, à savoir son éligibilité. " Avec tout le respect que je dois à l'ancien vice-président, notre parti a besoin d'un candidat capable de battre le président Bush ", a déclaré Kerry, tandis qu'Edwards ne cessait de répéter que " nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs qu'il y a quatre ans ". Al Gore a répliqué en accusant les deux hommes d'avoir rompu leur engagement de ne pas faire de campagne négative et a déclaré fièrement : "Pour autant que je sache, je suis le seul candidat dans cette course à avoir remporté le vote populaire au cours de trois campagnes nationales".
Les candidats se sont disputés les soutiens, et il semble que Kerry ait commencé à gagner quelques points à l'approche des primaires. Seul Nordiste et habitant de la Nouvelle-Angleterre à avoir une chance, Kerry a obtenu le soutien du Boston Globe, qui l'a qualifié de "meilleure chance de battre George Bush grâce au leadership et à l'expérience de John Kerry". Ce soutien a été suivi par celui de la ligue de la conservation, un soutien particulièrement douloureux pour la campagne de Gore. M. Gore a reçu le soutien des principaux démocrates du New Hampshire, qui ont loué son attachement aux valeurs du New Hampshire : "Il n'y a pas de plus grand ami de cet État qu'Al Gore", a déclaré le sénateur Shaheen, mais il n'a pas réussi à obtenir le soutien d'autres groupes écologistes qu'il avait gagnés en 2000 et qui étaient partagés entre Kerry et Gore. Malgré son rebondissement après l'Iowa, dans le New Hampshire, la campagne d'Edward est restée à la traîne et il s'est fortement appuyé sur son image d'outsider et sur sa fraîcheur en vantant son faible taux de désapprobation par rapport à Kerry ou à Gore.
Les trois candidats se disputaient l'appui précieux du sénateur Ted Kennedy, le pilier libéral. En 2000, Kennedy a flirté avec le soutien du rival de Gore et l'équipe de Gore a travaillé désespérément pour gagner Kennedy une seconde fois.
Mais Kennedy avait le choix, il était manifestement proche de son collègue sénateur du Massachusetts, John Kerry, et il était activement courtisé par lui et par le sénateur Edwards (dont Kennedy avait été le mentor au début de sa carrière de sénateur). Kennedy avait longtemps attendu avant de soutenir explicitement un candidat, déclarant qu'il soutiendrait "le candidat le plus fort le moment venu". À l'époque, on pensait généralement qu'il s'agissait d'un soutien passif à Gore, mais compte tenu de l'évolution de la situation politique, la question du soutien de Kennedy est restée en suspens.
Les candidats se sont affrontés lors d'un débat précédant les primaires du New Hampshire, au cours duquel les trois hommes de tête se sont lancés de sérieuses piques l'un à l'autre et au président Bush. Gore a été placé sur la sellette lors du débat et contraint de répondre de sa troisième place dans l'Iowa. Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait inspirer confiance aux électeurs démocrates en leur permettant de battre le président Bush lors d'une nouvelle confrontation, Gore a répondu : "Cette élection concerne la vie des gens, les conséquences de la présidence de Bush et la question de savoir s'il fournit le bon leadership, la bonne moralité et la bonne vision et, à l'heure actuelle, je pense qu'il est assez clair qu'il ne le fait pas ... Je peux apporter l'expérience nécessaire pour faire face à cette crise de confiance". Mais d'autres candidats étaient là pour douter des capacités de Gore, notamment Kucinich et Sharpton, toujours présents, qui se sont le plus attaqués à Gore. Sharpton - "Le vrai problème quand on fait de Gore le candidat, c'est qu'il a déjà perdu contre Bush, et qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse ramener suffisamment de gens dans le parti démocrate".
Ou encore Kucinich qui a cherché à saper l'expérience de Gore : "L'administration Clinton-Gore a gravement porté atteinte aux emplois et à l'industrie manufacturière américains grâce à l'ALENA et à l'Organisation mondiale du commerce, vous saviez que cela allait nuire aux travailleurs - et les sénateurs ici présents ont voté pour", ce qui a amené Gore à débattre des mérites du libre-échange avec Kucinich : "Contrairement à Dennis ou au président, je suis déterminé à construire nos alliances et à développer notre diplomatie économique". John Kerry s'est joint à ces attaques : "Nous pouvons déjà entendre les applaudissements de l'équipe Bush lorsqu'ils verront qu'ils peuvent à nouveau utiliser la tactique de 2000, nous devons faire en sorte qu'ils ne puissent plus utiliser cette tactique, nous devons faire mieux". Edwards, l'homme de la soirée, fort de sa victoire dans l'Iowa, s'est efforcé de séduire le New Hampshire, semblant réitérer sa promesse de ne pas attaquer lorsqu'il a répondu à une question sur son expérience : "Si les électeurs veulent quelqu'un qui fait de la politique depuis 20 ou 30 ans et qui a joué le jeu de Washington, ils ont le choix, mais je ne pense pas que le parti démocrate puisse se permettre d'être ce parti-là".
Les candidats ont défini leur politique lors du débat sur des questions brûlantes telles que les impôts, la gestion de la crise irakienne par le président, les soins de santé et le mariage homosexuel. Les candidats ont été unanimes à critiquer les réductions d'impôts de Bush, qui sont allées trop loin et doivent être annulées pour les riches : "Brit (le modérateur du débat) il y a quatre ans, on s'est moqué de moi parce que j'ai appelé la réduction d'impôts du président ce qu'elle est, un cadeau pour les 1 % d'Américains les plus fortunés".
Lorsqu'on lui a demandé comment il éviterait que la campagne de Bush ne le qualifie de démocrate de l'impôt et de la dépense, Kerry a déclaré avec assurance qu'il s'agissait d'un "combat que j'attends avec impatience et que nous gagnerons. Si George W. Bush veut se tenir à mes côtés et défendre l'augmentation des impôts pour les personnes qui gagnent plus de 200 000 dollars par an, c'est à lui de le faire". John Edwards a réaffirmé : "Nous devons nous concentrer sur la classe moyenne, en veillant à ce que les réductions d'impôts restent en place pour aider les familles de la classe moyenne, les aider à acheter une maison et à investir, et non les multimillionnaires qui ont des taux d'imposition inférieurs à ceux des enseignants ou des officiers de police".
Les choses se sont envenimées lorsque les candidats ont été interrogés sur leur opposition à la demande de Bush d'obtenir l'approbation du Congrès pour une action militaire en Irak, Edwards étant le seul démocrate sur scène à soutenir la demande de Bush : "J'ai toujours dit depuis le début que, d'après les preuves que j'ai vues, Saddam Hussein était une menace, J'ai eu des problèmes avec la formulation de la résolution, je ne voulais pas donner un chèque en blanc au président, mais il est clair que la diplomatie du président Bush a échoué, il n'a pas pu convaincre les Nations Unies, il n'a pas pu convaincre l'OTAN et c'est un échec de leadership".

Le débat démocrate du New Hampshire
Gore, un fervent opposant, a soigneusement expliqué son opposition et la manière dont il aurait procédé : "Le président et le vice-président ont enfreint toutes les règles en essayant de faire adopter à la hâte une résolution du Congrès. J'ai soutenu la résolution en 1991 lorsque George H. W. Bush a patiemment et habilement mis sur pied une large coalition internationale et je suis allé plus loin en m'opposant au départ précipité qui a permis à Saddam Hussein de renouveler son régime d'oppression, le président George W. Bush, en revanche, a politisé le processus en essayant de faire passer les démocrates pour des laxistes à l'égard de l'Irak. Ce que nous aurions dû faire, c'est présenter notre dossier aux Nations unies en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies, qui réserve aux États membres le droit d'agir en légitime défense [...]".
John Kerry s'est opposé le plus vigoureusement à l'administration Bush sur la question de la politique étrangère, qualifiant la politique de Bush d'"inepte et arrogante, comme tous les Américains, j'ai de graves inquiétudes, des craintes réelles et sérieuses concernant les armes et les intentions de Saddam Hussein, mais tout au long de la campagne, cette administration a déformé la vérité, elle a exagéré et même trompé, je crois et je sais par expérience que la guerre doit être un dernier recours, nous devons affronter le dictateur irakien, mais ce président a choisi la mauvaise façon de s'y prendre".
L'autre question était celle des droits des homosexuels, qui s'était considérablement réchauffée avec la légalisation effective du mariage gay dans le Massachusetts et le soutien croissant des républicains à une interdiction constitutionnelle de cette pratique. Tous les candidats se sont opposés à une interdiction constitutionnelle du mariage gay et tous trois ont soutenu l'abrogation de la loi "Don't ask don't tell" qui interdisait aux militaires ouvertement homosexuels de s'engager dans l'armée. D'une manière générale, les candidats s'accordent à dire que le mariage doit être laissé à l'appréciation des États. Edwards s'est prononcé en faveur d'un renforcement des droits des couples homosexuels, mais a déclaré que le pays n'était pas prêt pour le mariage gay. Pour marquer le contraste, il a déclaré que, contrairement à Gore, il ne soutenait pas la loi sur la défense du mariage (loi de 1996 qui interdisait au gouvernement fédéral de reconnaître le mariage gay).
M. Kerry a qualifié les efforts des républicains en vue d'une interdiction constitutionnelle de "mesquins" et d'"inconstitutionnels" et a défendu son État d'origine contre les attaques du président en matière d'abus judiciaire. "Contrairement au président, je ne trouve pas troublant que les législateurs aient statué comme ils l'ont fait, j'ai toujours combattu le dénigrement des homosexuels par les républicains pour ce qu'il est, une tentative à peine voilée de marquer des points en faisant des gays et des lesbiennes des Américains un bouc émissaire". Mais Kerry a eu du mal à répondre lorsqu'on l'a interrogé sur sa forte opposition à la loi sur la défense du mariage, revenant sur une remarque qu'il avait faite en qualifiant la loi d'inconstitutionnelle, tout en précisant qu'il ne voterait pas en faveur du projet de loi même s'il s'opposait toujours à la légalisation du mariage homosexuel.
Gore, qui, en tant que candidat quatre ans auparavant, avait réussi à courtiser la grande majorité des électeurs homosexuels, s'est montré le plus décalé des trois principaux candidats sur la question, refusant de mettre l'accent sur son soutien aux unions civiles plutôt qu'au mariage homosexuel. S'exprimant sur la décision du Massachusetts, il a déclaré qu'il existait "de nombreux types d'amour" et qu'il fallait "les honorer et les respecter", La réponse de M. Gore a surpris certains experts, car elle ressemblait davantage à une approbation explicite du mariage gay qu'à l'opinion que la plupart des démocrates (et M. Gore lui-même) avaient précédemment exprimée, à savoir qu'il était favorable au renforcement des unions civiles, mais pas au mariage lui-même, Après le débat, la campagne de Gore a publié une déclaration affirmant que la position du candidat n'avait pas changé, mais étant donné que le point de vue précédent de Gore incluait le soutien à la loi sur la défense du mariage, cette déclaration contredisait de manière flagrante ses propos lors du débat.
Outre les petites joutes entre les candidats, la nouvelle de la soirée a été les propos de Gore sur le mariage homosexuel. Les partisans et les opposants au mariage homosexuel se sont précipités sur les déclarations de Gore : "Nous applaudissons le vice-président Gore pour avoir fermement affirmé son soutien à l'égalité des mariages. C'est une position que certains qualifieraient encore de courageuse, mais qu'une nouvelle génération d'Américains qualifierait de sens commun", a déclaré un représentant des démocrates de Stonewall, qui ont ensuite soutenu Gore, et un représentant des républicains : "Al Gore se plie à l'extrême gauche et montre qu'il n'est pas en phase avec la grande majorité des Américains". La position d'Al Gore sur le mariage homosexuel est devenue le principal sujet de conversation à la suite du débat et à l'approche des primaires, trois jours plus tard seulement.
Le débat n'a pas ruiné l'avance de Gore dans les primaires du New Hampshire, mais celle-ci s'est considérablement amoindrie à mesure que les électeurs indécis se décidaient. Kerry a considérablement progressé dans la course, gagnant 5 points, à seulement quelques points de pourcentage de Gore, et à l'intérieur de la marge d'erreur. Alors que les électeurs du New Hampshire s'apprêtaient à voter pour la "première primaire du pays", les trois principaux candidats se sont efforcés de frapper à toutes les portes et d'embrasser tous les bébés dans l'hiver glacial du New Hampshire. Lors de leurs plaidoiries finales dans ce paysage glacial, les électeurs avaient deux préoccupations principales : l'électorat et l'économie. Beaucoup étaient encore indécis lors de leur marche vers les bureaux de vote, avec un bon nombre d'électeurs encore indécis ''Tout le monde pédale parce qu'ils veulent tous voter pour quelqu'un qui peut gagner, mais personne ne sait de qui il s'agit''.
Lors d'un meeting d'Edwards, une personne a déclaré : "Voulez-vous le gars qui passe bien à la télé ? Alors vous voulez Edwards. Celui qui parle bien, c'est Kerry. L'expérience ? Alors vous optez pour Gore. Ils ont tous des avantages et des défauts, il est donc difficile de savoir qui sera le plus fort face à Bush."

Les 3 candidats en campagne
Les primaires démocrates du New Hampshire
"Merci, New Hampshire, d'avoir fait de moi le Kerry du retour" : tels étaient les mots prononcés par le sénateur John Kerry dans un sourire radieux devant une foule de partisans. Avec 97 % des bureaux de vote, le sénateur du Massachusetts a été déclaré vainqueur des primaires très disputées du New Hampshire, devançant l'ancien vice-président Al Gore et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards. "J'ai passé toute ma vie à me battre pour ce que je pense être juste et contre les puissants intérêts particuliers, et je ne fais que commencer à me battre". a déclaré Kerry à ses partisans.
Il est arrivé en tête en partant de loin et a battu l'ancien vice-président de 5 %, ce qui a constitué un revirement spectaculaire par rapport à la situation qui prévalait il y a quelques semaines seulement, lorsque M. Gore détenait une avance à deux chiffres. La victoire de Kerry, associée à celle d'Edward dans l'Iowa, a bouleversé la course démocrate et a laissé la compétition sans tête de liste ferme, juste au moment où la compétition s'apprêtait à s'élargir la semaine prochaine.
La deuxième place de Gore a permis à l'ancien vice-président d'éviter un désastre en répétant sa troisième place, mais ce résultat était loin d'être celui qu'il préférait et cela a remis en question son statut de tête de liste, lui qui avait anticipé un combat plus difficile dans l'État au début de la course, mais avait réussi à maintenir une avance constante dans les sondages pendant la majeure partie de la course, pour être à nouveau battu sur la ligne d'arrivée. M. Gore s'est retrouvé à lutter pour la deuxième place avec le sénateur Edwards tout au long du dépouillement, mais il a fini par le devancer à la fin de la nuit. "Je tiens à remercier tous ceux qui se sont battus avec nous dans cet État. Mais laissez-moi vous dire que je continuerai à me battre pour les familles de travailleurs, et que je continuerai à défendre Medicare et Medicaid et les personnes défavorisées... Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Continuons à nous battre jusqu'à la Maison Blanche".
M. Edwards s'est montré optimiste, indiquant qu'il avait bien l'intention de poursuivre sa course à la présidence. "Nous allons assister à de grandes victoires le 3 février", a déclaré M. Edwards, en faisant référence aux prochaines élections. "Oui, c'est vrai. Après sa victoire dans l'Iowa, Edwards avait considérablement progressé dans les sondages. Dans certains cas, il était à égalité avec Gore, voire le dépassait pour la première fois dans la course, dans certains États.
Les résultats des primaires ont de nouveau contrarié Gore, bien qu'il soit entré dans la course avec des données favorables, les sondages de sortie des urnes ont révélé que de nombreux démocrates avaient basculé en faveur de Kerry très tard dans la journée, à quelques jours seulement de l'élection, ainsi qu'un grand nombre d'indépendants et quelques républicains qui ont voté lors des primaires ouvertes (peut-être parce que les primaires républicaines avaient lieu le même jour), et qui ont invoqué soit l'électabilité de Gore, soit son manque de popularité comme raison.
Avec l'Iowa et le New Hampshire dans le rétroviseur, la course devient nationale, les voitures et les bus sont remplacés par des avions alors que les trois principaux candidats se présentent en Caroline du Sud, au Missouri, au Delaware, en Oklahoma, au Nouveau Mexique, en Arizona et au Dakota du Nord, matraqués par l'Iowa et le New Hampshire, Gore doit se racheter rapidement tandis que Kerry et Edwards doivent prouver qu'ils peuvent gagner des voix à travers le pays, et les sondages se resserrant rapidement.
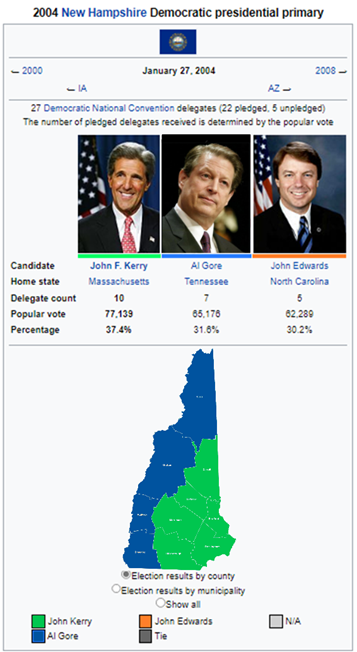
John Kerry, Al Gore et John Edwards fêtent leur première, deuxième et troisième place aux primaires du New Hampshire.
Les républicains ont organisé leurs propres primaires dans le New Hampshire le même soir. La course a été plus médiatisée que ne le devrait normalement la primaire d'un président sortant, grâce au défi lancé par le sénateur Lincoln Chafee, un républicain libéral. Le défi de Chafee n'était pas gagné d'avance, car bien que la popularité de Bush soit en baisse dans tout le pays, le parti républicain le soutenait dans l'ensemble. Bush avait irrité les deux bords de son parti, les néoconservateurs et les modérés, mais son conservatisme compatissant lui avait permis d'acquérir une base solide de soutien au sein du parti républicain ; il avait réduit les impôts, mais aussi financé les écoles. Il a rejeté la réforme du financement électoral et l'extension de Medicaid, et a adopté une politique étrangère plus ou moins expansive. Bien que décrié par Chafee comme ayant mis à l'écart ou ignoré les modérés du parti républicain, Bush a cherché à utiliser son défi pour montrer que le parti s'était unifié derrière lui.
Bien que le président n'ait pas fait ouvertement campagne contre M. Chafee, les wagons de la Maison Blanche ont rapidement tourné autour du New Hampshire. La campagne s'est rapidement efforcée d'obtenir le soutien des républicains modérés, comme l'ancien maire de New York, M. Giuliani, et le gouverneur Pataki, qui se sont ralliés à la cause du président. Pendant ces deux semaines dans le New Hampshire, l'élection présidentielle semblait déjà avoir commencé, car des camions entiers de volontaires républicains sont venus enterrer la candidature de Chafee. L'organisation militante de l'équipe Bush Cheney 04 était en pleine effervescence, déversant tout le sang, la sueur et l'argent qu'elle pouvait offrir.
Le vice-président Cheney a joué les gros bras à la place du président, avec le franc-parler qu'il est le seul à pouvoir tenir : "Les républicains libéraux comme Chafee, franchement, nous font plus de mal que de bien", a-t-il déclaré sous les acclamations des partisans républicains du New Hampshire. La campagne de M. Chafee ressemblait beaucoup à celle d'un magasin familial face à une grande chaîne de magasins. Sa campagne était principalement composée de lui-même, se débrouillant dans le New Hampshire, détestant la collecte de fonds, il s'est appuyé sur sa propre fortune et celle de ses amis et familles brahmanes de Nouvelle-Angleterre, bien que sa campagne ait reçu une somme décente de dons initiaux de la part de conservateurs libertaires ou anti-Bush, mais cela n'a pas duré.
Ses messages n'étaient pas toujours pertinents, bien que le thème de sa campagne ait été le "retour à un conservatisme de bon sens", il donnait fréquemment des conférences sur tous les détails de la politique, s'opposant au président et aux démocrates, faisant preuve d'un grand sens politique. Bien que quelque peu désordonné, ceux qui ont suivi sa campagne lui ont attribué le mérite d'avoir mené une campagne diligente dans l'État du granit, avec promptitude et politesse ; il n'allait pas devenir président, mais il n'allait certainement pas être en retard.
En fin de compte, Bush a remporté l'élection avec une majorité écrasante de 29 points, réduisant à néant la campagne de Chafee et mettant fin à tout élan qu'elle aurait pu prendre : "C'est une victoire solide et je suis reconnaissant", a déclaré le président. M. Chafee n'a recueilli que 16 % des voix et toute idée de poursuivre sa campagne a été rapidement abandonnée : "Alors que j'étais enthousiaste à l'idée de mener une campagne basée sur un conservatisme de bon sens, malheureusement, ma campagne pour la présidence prend fin aujourd'hui". Le président remportera l'investiture républicaine sans rencontrer d'opposition.

Le sénateur Lincoln Chafee concède
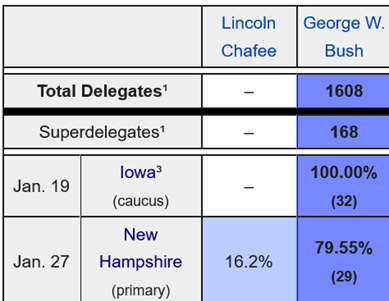
Extrait de la page Wikipédia sur les primaires républicaines de 2004

Président George W. Bush
Les retombées du caucus de l'Iowa étaient évidentes : il ne restait plus que trois candidats démocrates potentiels, l'ancien vice-président Al Gore, le sénateur du Massachusetts John Kerry et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards (le représentant de l'Ohio Dennis Kucinich et le révérend Al Sharpton sont restés dans la course mais n'ont jamais réussi à sortir de la marge dans les sondages). Tous les candidats avaient quelque chose à prouver lors des primaires du New Hampshire. Gore, qui était en tête des sondages au niveau national et dans l'État du New Hampshire depuis un an et demi, devait montrer qu'il était toujours le candidat présomptif des démocrates et que l'Iowa n'était qu'une exception pour sa campagne. Kerry devait prouver qu'il était toujours dans la course. Sa deuxième place dans l'Iowa a prouvé que sa campagne était viable, mais elle devait être renforcée par une meilleure performance dans le New Hampshire, une victoire lui donnerait l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Quant à Edwards, il devait profiter de l'élan donné par son triomphe dans l'Iowa pour prouver qu'il était un candidat solide à l'échelle nationale, et une victoire dans le New Hampshire le propulserait au premier rang.
Tout au long de l'année 2003, Gore a conservé une large avance sur ses adversaires dans le New Hampshire, 20% sur Kerry, son concurrent le plus proche, mais après le coup de théâtre de l'Iowa, il était clair que les démocrates reconsidéraient leurs options quant au choix de leur candidat. Gore a rapidement perdu du terrain, tombant à 11 points d'avance (il était à 36% suivi de Kerry à 25%), Edwards a gagné beaucoup de terrain grâce à sa victoire dans l'Iowa, doublant sa moyenne dans les sondages jusqu'à ce qu'il se retrouve juste derrière Kerry à 24%. Les gains de Kerry et d'Edward ont été attribués à l'énergie que les deux candidats ont déployée pour voyager et dépenser des fonds dans l'État, ainsi qu'au nouvel élan qui s'est dégagé de l'Iowa.
"Les gens se demandent maintenant si Gore n'a pas tout perdu", a déclaré un sondeur. "Les sondés recherchent un vainqueur. Et il n'y a rien de mieux que de gagner pour prouver que l'on est un battant".
Les trois principaux candidats démocrates : Al Gore, John Edwards et John Kerry.
Le camp Gore était clairement préoccupé par les données des sondages, l'équipe s'attendait depuis le début à un défi difficile dans l'État du granit et la défaite dans l'Iowa a fait chuter les attentes. Ce qui aurait pu être le moment où la campagne a remis de l'ordre dans l'ensemble du processus d'investiture, confirmant Gore comme le véritable leader et candidat, était désormais le plus grand défi qu'il avait à relever. Le sénateur Shaheen du New Hampshire a averti le camp Gore : "Vous ne pouvez pas vous présenter ici en vous basant sur la reconnaissance de votre nom" et a demandé à Gore de travailler davantage dans l'État. Gore avait appris cela il y a quatre ans lorsqu'il avait réussi à mettre à genoux la campagne de Bill Bradley en le battant d'un petit 4 %, ce qui avait mis fin aux chances de Bradley.
Gore a alors fait des heures supplémentaires pour changer son image de technocrate ennuyeux en combattant passionné et la compétition a commencé à devenir sanglante. Pour la première fois, Kerry et Edwards s'en sont pris à Gore, attaquant l'ancien vice-président là où cela faisait le plus mal, à savoir son éligibilité. " Avec tout le respect que je dois à l'ancien vice-président, notre parti a besoin d'un candidat capable de battre le président Bush ", a déclaré Kerry, tandis qu'Edwards ne cessait de répéter que " nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs qu'il y a quatre ans ". Al Gore a répliqué en accusant les deux hommes d'avoir rompu leur engagement de ne pas faire de campagne négative et a déclaré fièrement : "Pour autant que je sache, je suis le seul candidat dans cette course à avoir remporté le vote populaire au cours de trois campagnes nationales".
Les candidats se sont disputés les soutiens, et il semble que Kerry ait commencé à gagner quelques points à l'approche des primaires. Seul Nordiste et habitant de la Nouvelle-Angleterre à avoir une chance, Kerry a obtenu le soutien du Boston Globe, qui l'a qualifié de "meilleure chance de battre George Bush grâce au leadership et à l'expérience de John Kerry". Ce soutien a été suivi par celui de la ligue de la conservation, un soutien particulièrement douloureux pour la campagne de Gore. M. Gore a reçu le soutien des principaux démocrates du New Hampshire, qui ont loué son attachement aux valeurs du New Hampshire : "Il n'y a pas de plus grand ami de cet État qu'Al Gore", a déclaré le sénateur Shaheen, mais il n'a pas réussi à obtenir le soutien d'autres groupes écologistes qu'il avait gagnés en 2000 et qui étaient partagés entre Kerry et Gore. Malgré son rebondissement après l'Iowa, dans le New Hampshire, la campagne d'Edward est restée à la traîne et il s'est fortement appuyé sur son image d'outsider et sur sa fraîcheur en vantant son faible taux de désapprobation par rapport à Kerry ou à Gore.
Les trois candidats se disputaient l'appui précieux du sénateur Ted Kennedy, le pilier libéral. En 2000, Kennedy a flirté avec le soutien du rival de Gore et l'équipe de Gore a travaillé désespérément pour gagner Kennedy une seconde fois.
Mais Kennedy avait le choix, il était manifestement proche de son collègue sénateur du Massachusetts, John Kerry, et il était activement courtisé par lui et par le sénateur Edwards (dont Kennedy avait été le mentor au début de sa carrière de sénateur). Kennedy avait longtemps attendu avant de soutenir explicitement un candidat, déclarant qu'il soutiendrait "le candidat le plus fort le moment venu". À l'époque, on pensait généralement qu'il s'agissait d'un soutien passif à Gore, mais compte tenu de l'évolution de la situation politique, la question du soutien de Kennedy est restée en suspens.
Les candidats se sont affrontés lors d'un débat précédant les primaires du New Hampshire, au cours duquel les trois hommes de tête se sont lancés de sérieuses piques l'un à l'autre et au président Bush. Gore a été placé sur la sellette lors du débat et contraint de répondre de sa troisième place dans l'Iowa. Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait inspirer confiance aux électeurs démocrates en leur permettant de battre le président Bush lors d'une nouvelle confrontation, Gore a répondu : "Cette élection concerne la vie des gens, les conséquences de la présidence de Bush et la question de savoir s'il fournit le bon leadership, la bonne moralité et la bonne vision et, à l'heure actuelle, je pense qu'il est assez clair qu'il ne le fait pas ... Je peux apporter l'expérience nécessaire pour faire face à cette crise de confiance". Mais d'autres candidats étaient là pour douter des capacités de Gore, notamment Kucinich et Sharpton, toujours présents, qui se sont le plus attaqués à Gore. Sharpton - "Le vrai problème quand on fait de Gore le candidat, c'est qu'il a déjà perdu contre Bush, et qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse ramener suffisamment de gens dans le parti démocrate".
Ou encore Kucinich qui a cherché à saper l'expérience de Gore : "L'administration Clinton-Gore a gravement porté atteinte aux emplois et à l'industrie manufacturière américains grâce à l'ALENA et à l'Organisation mondiale du commerce, vous saviez que cela allait nuire aux travailleurs - et les sénateurs ici présents ont voté pour", ce qui a amené Gore à débattre des mérites du libre-échange avec Kucinich : "Contrairement à Dennis ou au président, je suis déterminé à construire nos alliances et à développer notre diplomatie économique". John Kerry s'est joint à ces attaques : "Nous pouvons déjà entendre les applaudissements de l'équipe Bush lorsqu'ils verront qu'ils peuvent à nouveau utiliser la tactique de 2000, nous devons faire en sorte qu'ils ne puissent plus utiliser cette tactique, nous devons faire mieux". Edwards, l'homme de la soirée, fort de sa victoire dans l'Iowa, s'est efforcé de séduire le New Hampshire, semblant réitérer sa promesse de ne pas attaquer lorsqu'il a répondu à une question sur son expérience : "Si les électeurs veulent quelqu'un qui fait de la politique depuis 20 ou 30 ans et qui a joué le jeu de Washington, ils ont le choix, mais je ne pense pas que le parti démocrate puisse se permettre d'être ce parti-là".
Les candidats ont défini leur politique lors du débat sur des questions brûlantes telles que les impôts, la gestion de la crise irakienne par le président, les soins de santé et le mariage homosexuel. Les candidats ont été unanimes à critiquer les réductions d'impôts de Bush, qui sont allées trop loin et doivent être annulées pour les riches : "Brit (le modérateur du débat) il y a quatre ans, on s'est moqué de moi parce que j'ai appelé la réduction d'impôts du président ce qu'elle est, un cadeau pour les 1 % d'Américains les plus fortunés".
Lorsqu'on lui a demandé comment il éviterait que la campagne de Bush ne le qualifie de démocrate de l'impôt et de la dépense, Kerry a déclaré avec assurance qu'il s'agissait d'un "combat que j'attends avec impatience et que nous gagnerons. Si George W. Bush veut se tenir à mes côtés et défendre l'augmentation des impôts pour les personnes qui gagnent plus de 200 000 dollars par an, c'est à lui de le faire". John Edwards a réaffirmé : "Nous devons nous concentrer sur la classe moyenne, en veillant à ce que les réductions d'impôts restent en place pour aider les familles de la classe moyenne, les aider à acheter une maison et à investir, et non les multimillionnaires qui ont des taux d'imposition inférieurs à ceux des enseignants ou des officiers de police".
Les choses se sont envenimées lorsque les candidats ont été interrogés sur leur opposition à la demande de Bush d'obtenir l'approbation du Congrès pour une action militaire en Irak, Edwards étant le seul démocrate sur scène à soutenir la demande de Bush : "J'ai toujours dit depuis le début que, d'après les preuves que j'ai vues, Saddam Hussein était une menace, J'ai eu des problèmes avec la formulation de la résolution, je ne voulais pas donner un chèque en blanc au président, mais il est clair que la diplomatie du président Bush a échoué, il n'a pas pu convaincre les Nations Unies, il n'a pas pu convaincre l'OTAN et c'est un échec de leadership".
Le débat démocrate du New Hampshire
Gore, un fervent opposant, a soigneusement expliqué son opposition et la manière dont il aurait procédé : "Le président et le vice-président ont enfreint toutes les règles en essayant de faire adopter à la hâte une résolution du Congrès. J'ai soutenu la résolution en 1991 lorsque George H. W. Bush a patiemment et habilement mis sur pied une large coalition internationale et je suis allé plus loin en m'opposant au départ précipité qui a permis à Saddam Hussein de renouveler son régime d'oppression, le président George W. Bush, en revanche, a politisé le processus en essayant de faire passer les démocrates pour des laxistes à l'égard de l'Irak. Ce que nous aurions dû faire, c'est présenter notre dossier aux Nations unies en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies, qui réserve aux États membres le droit d'agir en légitime défense [...]".
John Kerry s'est opposé le plus vigoureusement à l'administration Bush sur la question de la politique étrangère, qualifiant la politique de Bush d'"inepte et arrogante, comme tous les Américains, j'ai de graves inquiétudes, des craintes réelles et sérieuses concernant les armes et les intentions de Saddam Hussein, mais tout au long de la campagne, cette administration a déformé la vérité, elle a exagéré et même trompé, je crois et je sais par expérience que la guerre doit être un dernier recours, nous devons affronter le dictateur irakien, mais ce président a choisi la mauvaise façon de s'y prendre".
L'autre question était celle des droits des homosexuels, qui s'était considérablement réchauffée avec la légalisation effective du mariage gay dans le Massachusetts et le soutien croissant des républicains à une interdiction constitutionnelle de cette pratique. Tous les candidats se sont opposés à une interdiction constitutionnelle du mariage gay et tous trois ont soutenu l'abrogation de la loi "Don't ask don't tell" qui interdisait aux militaires ouvertement homosexuels de s'engager dans l'armée. D'une manière générale, les candidats s'accordent à dire que le mariage doit être laissé à l'appréciation des États. Edwards s'est prononcé en faveur d'un renforcement des droits des couples homosexuels, mais a déclaré que le pays n'était pas prêt pour le mariage gay. Pour marquer le contraste, il a déclaré que, contrairement à Gore, il ne soutenait pas la loi sur la défense du mariage (loi de 1996 qui interdisait au gouvernement fédéral de reconnaître le mariage gay).
M. Kerry a qualifié les efforts des républicains en vue d'une interdiction constitutionnelle de "mesquins" et d'"inconstitutionnels" et a défendu son État d'origine contre les attaques du président en matière d'abus judiciaire. "Contrairement au président, je ne trouve pas troublant que les législateurs aient statué comme ils l'ont fait, j'ai toujours combattu le dénigrement des homosexuels par les républicains pour ce qu'il est, une tentative à peine voilée de marquer des points en faisant des gays et des lesbiennes des Américains un bouc émissaire". Mais Kerry a eu du mal à répondre lorsqu'on l'a interrogé sur sa forte opposition à la loi sur la défense du mariage, revenant sur une remarque qu'il avait faite en qualifiant la loi d'inconstitutionnelle, tout en précisant qu'il ne voterait pas en faveur du projet de loi même s'il s'opposait toujours à la légalisation du mariage homosexuel.
Gore, qui, en tant que candidat quatre ans auparavant, avait réussi à courtiser la grande majorité des électeurs homosexuels, s'est montré le plus décalé des trois principaux candidats sur la question, refusant de mettre l'accent sur son soutien aux unions civiles plutôt qu'au mariage homosexuel. S'exprimant sur la décision du Massachusetts, il a déclaré qu'il existait "de nombreux types d'amour" et qu'il fallait "les honorer et les respecter", La réponse de M. Gore a surpris certains experts, car elle ressemblait davantage à une approbation explicite du mariage gay qu'à l'opinion que la plupart des démocrates (et M. Gore lui-même) avaient précédemment exprimée, à savoir qu'il était favorable au renforcement des unions civiles, mais pas au mariage lui-même, Après le débat, la campagne de Gore a publié une déclaration affirmant que la position du candidat n'avait pas changé, mais étant donné que le point de vue précédent de Gore incluait le soutien à la loi sur la défense du mariage, cette déclaration contredisait de manière flagrante ses propos lors du débat.
Outre les petites joutes entre les candidats, la nouvelle de la soirée a été les propos de Gore sur le mariage homosexuel. Les partisans et les opposants au mariage homosexuel se sont précipités sur les déclarations de Gore : "Nous applaudissons le vice-président Gore pour avoir fermement affirmé son soutien à l'égalité des mariages. C'est une position que certains qualifieraient encore de courageuse, mais qu'une nouvelle génération d'Américains qualifierait de sens commun", a déclaré un représentant des démocrates de Stonewall, qui ont ensuite soutenu Gore, et un représentant des républicains : "Al Gore se plie à l'extrême gauche et montre qu'il n'est pas en phase avec la grande majorité des Américains". La position d'Al Gore sur le mariage homosexuel est devenue le principal sujet de conversation à la suite du débat et à l'approche des primaires, trois jours plus tard seulement.
Le débat n'a pas ruiné l'avance de Gore dans les primaires du New Hampshire, mais celle-ci s'est considérablement amoindrie à mesure que les électeurs indécis se décidaient. Kerry a considérablement progressé dans la course, gagnant 5 points, à seulement quelques points de pourcentage de Gore, et à l'intérieur de la marge d'erreur. Alors que les électeurs du New Hampshire s'apprêtaient à voter pour la "première primaire du pays", les trois principaux candidats se sont efforcés de frapper à toutes les portes et d'embrasser tous les bébés dans l'hiver glacial du New Hampshire. Lors de leurs plaidoiries finales dans ce paysage glacial, les électeurs avaient deux préoccupations principales : l'électorat et l'économie. Beaucoup étaient encore indécis lors de leur marche vers les bureaux de vote, avec un bon nombre d'électeurs encore indécis ''Tout le monde pédale parce qu'ils veulent tous voter pour quelqu'un qui peut gagner, mais personne ne sait de qui il s'agit''.
Lors d'un meeting d'Edwards, une personne a déclaré : "Voulez-vous le gars qui passe bien à la télé ? Alors vous voulez Edwards. Celui qui parle bien, c'est Kerry. L'expérience ? Alors vous optez pour Gore. Ils ont tous des avantages et des défauts, il est donc difficile de savoir qui sera le plus fort face à Bush."
Les 3 candidats en campagne
Les primaires démocrates du New Hampshire
"Merci, New Hampshire, d'avoir fait de moi le Kerry du retour" : tels étaient les mots prononcés par le sénateur John Kerry dans un sourire radieux devant une foule de partisans. Avec 97 % des bureaux de vote, le sénateur du Massachusetts a été déclaré vainqueur des primaires très disputées du New Hampshire, devançant l'ancien vice-président Al Gore et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards. "J'ai passé toute ma vie à me battre pour ce que je pense être juste et contre les puissants intérêts particuliers, et je ne fais que commencer à me battre". a déclaré Kerry à ses partisans.
Il est arrivé en tête en partant de loin et a battu l'ancien vice-président de 5 %, ce qui a constitué un revirement spectaculaire par rapport à la situation qui prévalait il y a quelques semaines seulement, lorsque M. Gore détenait une avance à deux chiffres. La victoire de Kerry, associée à celle d'Edward dans l'Iowa, a bouleversé la course démocrate et a laissé la compétition sans tête de liste ferme, juste au moment où la compétition s'apprêtait à s'élargir la semaine prochaine.
La deuxième place de Gore a permis à l'ancien vice-président d'éviter un désastre en répétant sa troisième place, mais ce résultat était loin d'être celui qu'il préférait et cela a remis en question son statut de tête de liste, lui qui avait anticipé un combat plus difficile dans l'État au début de la course, mais avait réussi à maintenir une avance constante dans les sondages pendant la majeure partie de la course, pour être à nouveau battu sur la ligne d'arrivée. M. Gore s'est retrouvé à lutter pour la deuxième place avec le sénateur Edwards tout au long du dépouillement, mais il a fini par le devancer à la fin de la nuit. "Je tiens à remercier tous ceux qui se sont battus avec nous dans cet État. Mais laissez-moi vous dire que je continuerai à me battre pour les familles de travailleurs, et que je continuerai à défendre Medicare et Medicaid et les personnes défavorisées... Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Continuons à nous battre jusqu'à la Maison Blanche".
M. Edwards s'est montré optimiste, indiquant qu'il avait bien l'intention de poursuivre sa course à la présidence. "Nous allons assister à de grandes victoires le 3 février", a déclaré M. Edwards, en faisant référence aux prochaines élections. "Oui, c'est vrai. Après sa victoire dans l'Iowa, Edwards avait considérablement progressé dans les sondages. Dans certains cas, il était à égalité avec Gore, voire le dépassait pour la première fois dans la course, dans certains États.
Les résultats des primaires ont de nouveau contrarié Gore, bien qu'il soit entré dans la course avec des données favorables, les sondages de sortie des urnes ont révélé que de nombreux démocrates avaient basculé en faveur de Kerry très tard dans la journée, à quelques jours seulement de l'élection, ainsi qu'un grand nombre d'indépendants et quelques républicains qui ont voté lors des primaires ouvertes (peut-être parce que les primaires républicaines avaient lieu le même jour), et qui ont invoqué soit l'électabilité de Gore, soit son manque de popularité comme raison.
Avec l'Iowa et le New Hampshire dans le rétroviseur, la course devient nationale, les voitures et les bus sont remplacés par des avions alors que les trois principaux candidats se présentent en Caroline du Sud, au Missouri, au Delaware, en Oklahoma, au Nouveau Mexique, en Arizona et au Dakota du Nord, matraqués par l'Iowa et le New Hampshire, Gore doit se racheter rapidement tandis que Kerry et Edwards doivent prouver qu'ils peuvent gagner des voix à travers le pays, et les sondages se resserrant rapidement.
John Kerry, Al Gore et John Edwards fêtent leur première, deuxième et troisième place aux primaires du New Hampshire.
Les républicains ont organisé leurs propres primaires dans le New Hampshire le même soir. La course a été plus médiatisée que ne le devrait normalement la primaire d'un président sortant, grâce au défi lancé par le sénateur Lincoln Chafee, un républicain libéral. Le défi de Chafee n'était pas gagné d'avance, car bien que la popularité de Bush soit en baisse dans tout le pays, le parti républicain le soutenait dans l'ensemble. Bush avait irrité les deux bords de son parti, les néoconservateurs et les modérés, mais son conservatisme compatissant lui avait permis d'acquérir une base solide de soutien au sein du parti républicain ; il avait réduit les impôts, mais aussi financé les écoles. Il a rejeté la réforme du financement électoral et l'extension de Medicaid, et a adopté une politique étrangère plus ou moins expansive. Bien que décrié par Chafee comme ayant mis à l'écart ou ignoré les modérés du parti républicain, Bush a cherché à utiliser son défi pour montrer que le parti s'était unifié derrière lui.
Bien que le président n'ait pas fait ouvertement campagne contre M. Chafee, les wagons de la Maison Blanche ont rapidement tourné autour du New Hampshire. La campagne s'est rapidement efforcée d'obtenir le soutien des républicains modérés, comme l'ancien maire de New York, M. Giuliani, et le gouverneur Pataki, qui se sont ralliés à la cause du président. Pendant ces deux semaines dans le New Hampshire, l'élection présidentielle semblait déjà avoir commencé, car des camions entiers de volontaires républicains sont venus enterrer la candidature de Chafee. L'organisation militante de l'équipe Bush Cheney 04 était en pleine effervescence, déversant tout le sang, la sueur et l'argent qu'elle pouvait offrir.
Le vice-président Cheney a joué les gros bras à la place du président, avec le franc-parler qu'il est le seul à pouvoir tenir : "Les républicains libéraux comme Chafee, franchement, nous font plus de mal que de bien", a-t-il déclaré sous les acclamations des partisans républicains du New Hampshire. La campagne de M. Chafee ressemblait beaucoup à celle d'un magasin familial face à une grande chaîne de magasins. Sa campagne était principalement composée de lui-même, se débrouillant dans le New Hampshire, détestant la collecte de fonds, il s'est appuyé sur sa propre fortune et celle de ses amis et familles brahmanes de Nouvelle-Angleterre, bien que sa campagne ait reçu une somme décente de dons initiaux de la part de conservateurs libertaires ou anti-Bush, mais cela n'a pas duré.
Ses messages n'étaient pas toujours pertinents, bien que le thème de sa campagne ait été le "retour à un conservatisme de bon sens", il donnait fréquemment des conférences sur tous les détails de la politique, s'opposant au président et aux démocrates, faisant preuve d'un grand sens politique. Bien que quelque peu désordonné, ceux qui ont suivi sa campagne lui ont attribué le mérite d'avoir mené une campagne diligente dans l'État du granit, avec promptitude et politesse ; il n'allait pas devenir président, mais il n'allait certainement pas être en retard.
En fin de compte, Bush a remporté l'élection avec une majorité écrasante de 29 points, réduisant à néant la campagne de Chafee et mettant fin à tout élan qu'elle aurait pu prendre : "C'est une victoire solide et je suis reconnaissant", a déclaré le président. M. Chafee n'a recueilli que 16 % des voix et toute idée de poursuivre sa campagne a été rapidement abandonnée : "Alors que j'étais enthousiaste à l'idée de mener une campagne basée sur un conservatisme de bon sens, malheureusement, ma campagne pour la présidence prend fin aujourd'hui". Le président remportera l'investiture républicaine sans rencontrer d'opposition.
Le sénateur Lincoln Chafee concède
Extrait de la page Wikipédia sur les primaires républicaines de 2004
Président George W. Bush

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 31: Mini-Tuesday.
Le président s'est présenté devant le public pour son troisième discours sur l'état de l'Union. Contrairement aux précédents, il s'agissait d'un discours clairement conçu pour préfigurer sa propre campagne de réélection, mêlant des rappels de ses réalisations en tant que président, pilotant l'économie nationale vers la reprise, et guidant le pays vers de nouvelles perspectives à l'étranger, tout en cherchant à réduire les attaques de l'opposition contre son leadership. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir politique du pays jusqu'au discours, les primaires démocrates et républicaines n'ayant pas encore commencé, mais aussi les Nations Unies devant publier leur rapport final détaillant la fin des inspections d'armes en Irak, et résumant les conclusions des missions. Blix avait déjà annoncé en avant-première la conclusion du rapport, à savoir qu'aucune ADM n'avait été trouvée. Cette annonce a été à elle seule un coup dur pour l'administration, dont certains membres continuaient à croire qu'ils pourraient encore donner tort aux Nations unies et aux démocrates du Congrès, rétablir fermement la crédibilité de l'administration sur cette question et donner raison au commandant en chef. Mais l'administration se préparait régulièrement à se retirer de la question, et les discours de la Maison Blanche n'évoquaient plus les armes de destruction massive. Il en était de même pour l'attaché de presse de Bush, Ari Fleischer, qui a démissionné à Noël. Grand défenseur de la politique irakienne de l'administration, il avait été accusé de ne pas avoir été très honnête avec les journalistes sur cette question.
En ce qui concernait l'Irak, dans son discours sur l'état de l'Union, M. Bush avait déjà réorienté les objectifs de son administration dans ce pays, décrivant son approche comme étant jusqu'à présent couronnée de succès. "Grâce au leadership des États-Unis, le monde et les Nations unies ont commencé à s'attaquer à ces problèmes, mais nous savons tous qu'il reste encore beaucoup à faire. On ne peut pas faire confiance à Saddam Hussein pour qu'il se démilitarise lui-même de façon permanente, et la politique de cette administration reste de voir un Irak véritablement libre".
M. Bush a consacré l'essentiel de son temps à la politique intérieure, domaine dans lequel les sondages ont généralement montré qu'il était plus faible que n'importe lequel des principaux candidats démocrates. Il a joué les équilibristes républicains en s'engageant à faire preuve de compassion sur les questions économiques pour toucher les électeurs modérés et ceux qui changent d'avis, et en s'en tenant au conservatisme sur les questions sociales pour rallier la base républicaine. Il s'est engagé à protéger la famille américaine, les écoles et les institutions religieuses en tant que "piliers de la civilisation, qui doivent rester forts en Amérique". Il a promis de définir le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme et a juré de financer l'éducation à l'abstinence et le dépistage des drogues dans les écoles, deux outils qui, selon lui, "sauveraient la vie des enfants". Ces engagements ont été conçus par le conseiller politique Karl Rove pour cibler les groupes socialement conservateurs.
Le discours n'a pas apporté grand-chose en termes de nouvelle politique, mais il a surtout fait la promotion de son programme et a fustigé les démocrates pour l'avoir saboté ailleurs, s'engageant à opposer son veto à leurs efforts de socialisation de l'assurance-maladie et terminant par des mots qui ont rappelé son père : "Et ainsi, nous avançons ensemble, une nation qui s'élève". Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis".

Le président Bush prononçant l'état de l'Union en 2004
98%. Le rapport final de Hans Blix indiquait que 98 % des armes de destruction massive de l'Irak avaient été recensées puis détruites ou inutilisables. Le rapport était rédigé dans un langage typiquement diplomatique et faisait parfois l'éloge de l'administration américaine pour avoir déployé les forces américaines qui ont forcé l'Irak à se plier aux inspections internationales. Le rapport indiquait que les inspecteurs n'avaient pas été bloqués, bien qu'il décrivait de nombreuses tentatives d'intimidation de la part de l'Irak. Un nombre suffisant de membres du gouvernement irakien se sont soumis à des entretiens et des missiles illégaux ont été démolis. Mais après les recherches approfondies, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'armes de destruction massive et la quasi-totalité de l'ancien arsenal chimique de l'Irak a été retrouvée. Quant aux 2 % manquants, les inspecteurs étaient convaincus qu'ils étaient désormais chimiquement inertes et ne présentaient aucun danger sérieux.
La commission n'a trouvé aucune preuve de l'existence d'installations d'essai mobiles, de stocks de missiles, de laboratoires souterrains, de programmes illicites de drones, de cultures biologiques ou d'installations de raffinage de l'uranium. Cependant, M. Blix a laissé planer le doute dans son rapport : il a noté qu'il n'existait aucune preuve détaillée de la destruction des armes de destruction massive avant l'arrivée des inspecteurs, que l'Irak n'avait pas remis les dossiers ou ne s'était pas pleinement plié aux exigences des enquêteurs afin de prouver de manière absolue la destruction de ces armes. Contre toute attente, il n'y avait pas de réponse claire à apporter aux opposants à l'intervention, l'ONU avait fait son devoir et conclu qu'il n'était pas prouvé que l'Irak avait manqué à ses obligations en matière d'armement, mais elle avait refusé de prouver absolument son innocence, personne ne se sentait à l'aise pour qualifier l'Irak de Saddam de véridique, mais le récit détaillé et froid de Blix sur le processus de désarmement avait pris fin. Les spin doctors n'ont pas tardé à agir, les articles favorables à l'intervention soulignant le fait que l'Irak ne s'était pas pleinement conformé à ses obligations et n'avait pas prouvé la destruction des armes de destruction massive.
La conclusion des inspections signifiait que la question devait être renvoyée au Conseil de sécurité des Nations unies pour décider d'une intervention, mais c'était déjà un point discutable, l'élection de nouveaux membres du Conseil signifiait que deux votes d'équilibre, le Mexique et le Cameroun, avaient été remplacés par de solides non, le Brésil et l'Algérie. Les membres permanents, la France, la Russie et la Chine étaient également satisfaits du rapport de Blix, le président Jospin se déclarant "satisfait et soulagé par le rapport" et reconnaissant qu'"aucune action militaire n'est nécessaire", ce qui garantissait presque un veto. Le président Poutine a déclaré qu'il était heureux qu'une "solution politique ait été trouvée" et le ministre chinois des affaires étrangères, Li Zhaoxing, a déclaré : "Nous sommes heureux que la guerre ait été évitée". En février 2004, l'idée d'une intervention armée des États-Unis s'estompait dans l'esprit du public, qui se concentrait davantage sur la politique intérieure, et même les faucons semblaient avoir abandonné l'idée d'une invasion américaine unilatérale.

Hans Blix, inspecteur en désarmement de l'ONU
Mais la publication du rapport de l'ONU sur les armes en Irak a rouvert le débat politique dans les couloirs du Congrès américain et s'est fortement enflammé lorsque le président de la commission du renseignement du Sénat, Bob Graham (un critique fréquent de la politique irakienne de l'administration Bush), a annoncé que la commission allait entamer son propre examen des ADM irakiennes, ainsi que de la qualité du processus de renseignement des États-Unis. Cette annonce a particulièrement inquiété la Maison Blanche, la CIA, le ministère de la Défense et le département d'État, qui s'étaient mutuellement assuré que leurs évaluations des ADM irakiennes étaient correctes, avant d'être battus en brèche par les fuites, les rumeurs et les conversations officieuses qui mettaient en doute la position de l'administration. Les responsables républicains ont rapidement dénoncé l'enquête comme une attaque partisane : "Le sénateur Graham ressemble plus à un théoricien de la conspiration qu'à un sénateur en exercice", a déclaré une porte-parole du parti.
La CIA a été accusée du blanchiment d'un rapport remis au Congrès avant des votes cruciaux sur l'Irak, de nombreux fonctionnaires ont été accusés de diffuser des informations trompeuses sur les capacités d'armement de l'Irak, et le ministère de la défense a été gravement accusé de répéter des "renseignements" totalement faux qui lui avaient été fournis par des groupes d'exilés irakiens en échange de fonds. Face à l'enquête, l'administration a fait bonne figure en promettant de "continuer à travailler avec le Congrès pour déterminer pleinement la menace des armes de destruction massive irakiennes", mais la plupart des républicains n'ont pas semblé vouloir se plier à l'enquête et ont considéré les questions encore en suspens dans le rapport de l'ONU comme une justification de leur soutien à l'élimination de Saddam et ont réitéré leur soutien au président. Par exemple, le sénateur Jeff Sessions de l'Alabama a déclaré : "Il est clair maintenant, d'après les Nations unies, que le président a raison, l'Irak constitue une menace évidente" et certains républicains plus modérés ont même tenu à passer à autre chose, le sénateur Trent Lott ayant déclaré : "Nous devons cesser de nous plaindre de ces problèmes de Washington, qui n'ont pas d'importance en dehors de la Capitale".

Bob Graham (D), président de la commission du renseignement du Sénat
Mais il était clair que l'attention politique du pays était focalisée sur la course à l'investiture démocrate. Le 3 février, les trois candidats démocrates en tête s'affrontaient dans la première course aux primaires dans plusieurs États, et c'était le moment ou jamais pour les candidats de se lancer dans la course. L'ancien vice-président Al Gore a été snobé à deux reprises, se classant troisième dans l'Iowa et deuxième dans le New Hampshire face à ses adversaires sénatoriaux John Edwards et John Kerry. Les États en lice ont été le Delaware, la Caroline du Sud, le Missouri, l'Oklahoma, le Dakota du Nord, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Les sondeurs et les analystes, qui avaient prédit pendant des semaines un balayage en faveur de Gore, poussaient de plus en plus d'États dans la catégorie des ballottages. Le sénateur Edwards s'est hissé à la première place en Caroline du Sud (son État natal et voisin de l'État où il a servi la Caroline du Nord) et, après sa victoire dans l'Iowa, il a fait jeu égal avec Gore dans l'État voisin du Missouri. Kerry, fort de sa victoire dans le New Hampshire, a également bénéficié d'une remontée dans les sondages nationaux, à quelques encablures de Gore, dans le Delaware, le Dakota du Nord et l'Arizona. Les primaires s'annonçaient donc riches en événements et chaque candidat s'est lancé à corps perdu dans la campagne.
La campagne de M. Edwards s'est rassemblée en Caroline du Sud. Alors qu'il y a un mois, elle peinait à remplir ses propres bureaux, elle a désormais rempli les églises et les salles de spectacle de ses partisans. "Les foules ne cessent de grossir, il est clair que les gens pensent différemment à cette course après l'Iowa", a déclaré M. Edwards, étonné par la taille croissante de ses foules. Il a prononcé son discours en promettant plus d'argent pour les soins de santé et l'éducation, ainsi qu'un crédit d'impôt pour les familles de travailleurs et de la classe moyenne, dénonçant l'administration Bush pour avoir ignoré les travailleurs pauvres et s'être montrée complaisante avec les lobbyistes de Washington. Il s'est engagé à vaincre le président en lançant un appel dans tout le pays : "Je peux le battre dans le Nord, dans l'Ouest, dans le Midwest et même dans le Sud". Sa campagne était manifestement enthousiaste à l'approche de la mini-élection du mardi : "On s'attendait à ce que nous finissions quatrième dans l'Iowa et que nous abandonnions après le New Hampshire, mais l'élan est avec nous... nous avons un génie dans une lampe".
La campagne de Kerry, récemment sur le point d'abandonner, a été stimulée par sa victoire dans le New Hampshire. Les analystes ont attribué sa victoire aux nombreux électeurs indécis et à ceux qui se sont détournés de Gore à la dernière minute, car il a séduit une grande partie des électeurs de Gore sans avoir le malheureux bagage de ce dernier. Faisant campagne à Fargo, dans le Dakota du Nord, un État dans lequel Kerry avait fait une percée, il s'est opposé à la politique économique injuste de l'administration Bush et s'est attaqué aux accords commerciaux qui ne tiennent pas compte du travailleur américain : "Les démocrates du Dakota du Nord veulent un nouveau président, mais ils ne savent pas encore qui c'est", a déclaré un électeur indécis. À Tulsa, Kerry a commencé à insister sur son expérience militaire (une rareté pour lui) et sur son expérience sur le terrain par rapport à tous les autres candidats, y compris le président Bush : "Ils n'ont jamais fait la guerre, et le président des États-Unis n'a même jamais effectué un tour de service à l'intérieur du pays. Nous avons besoin d'un vrai candidat et c'est, à mon avis, John Kerry", a déclaré le sénateur Max Cleland, en soutenant Kerry.
Al Gore a fait campagne dans le Missouri voisin, où il a bombardé les réseaux de publicités de dernière minute. Désespéré de devoir lutter contre ses adversaires dans cet État riche en délégués, il s'est appuyé sur ses caractéristiques de père de famille avant tout, toujours aux côtés de sa femme Tipper : "Mon mari a fait des soins de santé la pièce maîtresse de sa campagne, ainsi que de l'éducation", a-t-elle déclaré. "Nous pensons que si l'on peut donner à chaque famille, à chaque enfant, un bon départ grâce aux soins de santé et au meilleur système éducatif possible, alors nous ferons de notre mieux pour renforcer les familles et les communautés et, par conséquent, pour que notre nation reste forte". La campagne de Gore a redoublé d'efforts pour gonfler sa base, en vantant son expérience et ses qualités de législateur, mais il devenait évident que Gore n'était plus le candidat inévitable qu'il avait été. Cependant, il conservait le statut de favori, devançant ses adversaires dans les sondages dans la plupart des États. La campagne de Gore s'est attaquée aux campagnes d'Edwards et de Kerry en cooptant leur message. Gore a commencé à diffuser des publicités mettant l'accent sur son propre passé au Vietnam et à promouvoir son programme de lutte contre la pauvreté : "Alors que ce président a réduit les impôts du 1% des Américains les plus riches, le niveau de pauvreté a augmenté, nous avons besoin d'un président innovant pour créer des emplois de haute qualité"

Principaux candidats démocrates à la présidence Gore, Kerry et Edwards
La campagne est devenue frénétique, tous les candidats se précipitant à travers le pays pour faire grimper leurs sondages. Chaque pourcentage comptait, dans certains États, c'était la différence entre gagner et perdre, mais rester compétitif signifiait encore obtenir des délégués : "Gagner ou perdre, tant que nous obtenons autant de délégués que possible". a déclaré un collaborateur de Gore au Nouveau-Mexique. Les espoirs d'un super balayage de Gore, semblable à celui qu'il avait réalisé en 2000, ont disparu. Ils se battaient à présent pour chaque délégué, faisant campagne en Arizona, l'ancien vice-président a critiqué l'administration Bush pour son incapacité à faire face aux fabricants de médicaments : "Le président affirme qu'il n'appartient pas au gouvernement de dicter les prix des médicaments, mais lorsque vous êtes victime de prix abusifs ou que vous vous faites arnaquer par les fabricants de médicaments, je pense que le gouvernement doit intervenir". Gore était en pleine forme, persuadé qu'une fois qu'il aurait remporté des victoires, sa campagne reprendrait de l'élan, grâce au soutien de l'establishment et à la solidité des coffres de la campagne.
"Et les Panthers ?" John Edwards a demandé à une foule du Missouri qui célébrait la victoire de son équipe locale au Superbowl quelques jours plus tôt : "Cela veut vraiment dire quelque chose, tous ces Caroliniens qui gagnent au Texas, j'ai hâte de répéter leurs succès". Coiffé d'un costume impeccable, le sénateur Edwards a fait campagne dans le centre et le sud-ouest du pays, à tel point que sa voix était devenue rauque lorsqu'il a atterri au Nouveau-Mexique. Les sondages ont progressivement tourné en sa faveur après sa victoire, peut-être que sa campagne axée sur les classes sociales s'est imposée dans le pays.
Kerry a ressorti ses talents d'orateur de la vieille école Kennedy : "Les Américains ne devraient pas seulement travailler pour l'économie, l'économie devrait travailler pour les Américains". a-t-il déclaré dans un local syndical du Delaware avant de passer 45 minutes à signer tous les chapeaux, drapeaux et photographies placés devant lui. Kerry avait besoin de toutes les voix, malgré sa victoire dans le New Hampshire, il était encore en retard dans tous les États, l'effet d'entraînement était peut-être en train de s'estomper et la presse rapportait que Gore reprenait du poil de la bête, l'attention qu'il a reçue après sa victoire n'était pas toujours bonne, les gens le qualifiaient de sincère, d'authentique mais pas de charismatique ou d'énergique, L'équipe de Kerry était convaincue qu'elle parviendrait à terminer en force, à gagner quelques États et à se positionner comme l'alternative à Gore, la mieux placée pour battre le président en novembre.

Les candidats démocrates dans leur jeunesse : Gore, Kerry et Edwards
Les résultats de la première compétition multi-états de la course démocrate ont considérablement bouleversé la donne pour les trois principaux candidats ; la compétition a été très disputée, les trois principaux candidats se qualifiant pour des délégués dans pratiquement toutes les compétitions. Dans l'évaluation la plus large des électeurs, tant sur le plan géographique que sur celui de la terminologie populaire, le verdict a été clair : Gore et Edwards l'ont emporté haut la main. La conclusion immédiate était que Gore était de retour dans la course. Après des semaines de recul, de chute dans les sondages et d'échec dans les premiers États, la campagne de Gore avait une bonne raison de se réjouir : après une spirale de doutes, Gore s'était imposé dans quatre États, remportant les primaires de l'Arizona et du Delaware et les caucus du Nouveau-Mexique et du Dakota du Sud. "Mon cœur est plein ce soir", a déclaré M. Gore mardi soir dans l'État de Washington (où se déroulera une prochaine élection). "C'est aussi votre victoire", a-t-il déclaré à une foule de partisans.
Mais alors qu'il semblait que la campagne de Gore allait enfin briller, l'attention nationale s'est rapidement détournée de lui, lorsque le sénateur Edwards, candidat outsider, a maintenu sa campagne en vie en remportant trois primaires en Caroline du Sud, dans le Missouri et dans l'Oklahoma. Les victoires du sénateur, dont c'est le premier mandat, signifient que, bien qu'il soit toujours derrière Gore en termes de délégués, il était à égalité en ce qui concernait le nombre d'États remportés. La campagne intensive d'Edward dans les États du Sud a porté ses fruits : "c'est une nuit extraordinaire pour nous, "premier en Caroline du Sud, premier dans le Missouri, premier dans l'Oklahoma". La compétition serrée a conduit à des victoires étroites pour les deux camps, au Nouveau-Mexique et dans le Missouri, où Gore et Edwards se sont battus de justesse l'un contre l'autre. "Tout a dépassé mes attentes, merci beaucoup", a déclaré M. Edwards à la foule. "Ce soir, vous avez dit que la politique qui consiste à élever les gens l'emporte sur celle qui consiste à les démolir", a-t-il ajouté.
Pour Kerry, la soirée a été clairement décevante, puisqu'il n'a remporté aucun des États en lice et qu'il est arrivé loin derrière dans l'Oklahoma et le Delaware, où il espérait gagner. Les experts se demandaient si Kerry avait la capacité de poursuivre sa campagne, mais il est resté stoïque et n'a pas laissé entendre qu'il se préparait à se retirer de la course : "Il est important de ne rien tenir pour acquis, je suis touché par votre soutien, quand je regarde ce que nous avons accompli, c'est énorme, et je me réjouis de poursuivre cette campagne". D'aucuns se sont toutefois inquiétés du fait que la campagne de Kerry ne disposait pas des fonds nécessaires pour rivaliser efficacement avec les autres candidats.
L'analyse de la soirée a montré où les succès et les échecs de chaque candidat pouvaient être attribués, dans un sondage sur les questions les plus importantes pour les électeurs démocrates, la défaite de Bush et l'économie étaient les questions clés. Le succès du sénateur Edward est dû à son attrait pour les électeurs blancs, les ouvriers et les électeurs plus modérés, ainsi qu'au soutien plus important que prévu des groupes minoritaires qui devaient être très favorables à Gore et des électeurs indécis qui avaient basculé en faveur de Kerry dans le New Hampshire. Gore a nettement progressé par rapport aux scrutins précédents auprès des électeurs plus âgés et plus libéraux.
Les votes ont modifié la campagne, il n'y avait toujours pas de leader clair, pas de victoire écrasante, pas de candidat par défaut et les trois candidats ont rapidement repris le chemin de la campagne en se préparant pour les prochaines élections dans les États du Michigan et de Washington qui seront suivies par les primaires dans le Tennessee et en Virginie.
Résultats du "Mini-Tuesday" du 3 février

Les candidats Gore, Edwards et Kerry s'expriment après les résultats de l'élection.
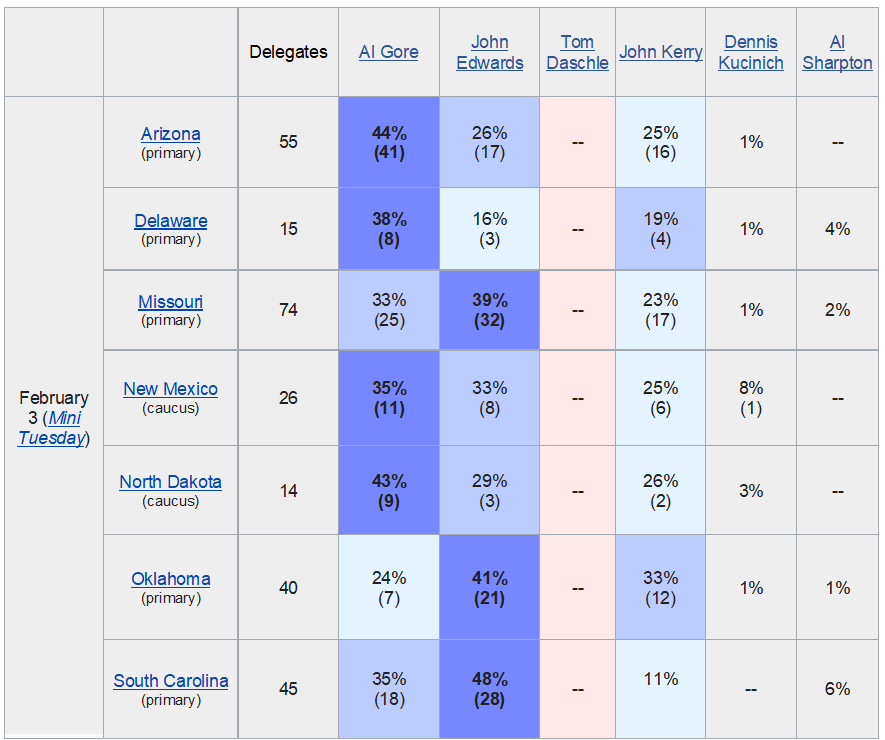
Résultats du Mini-Tuesday du 3 février
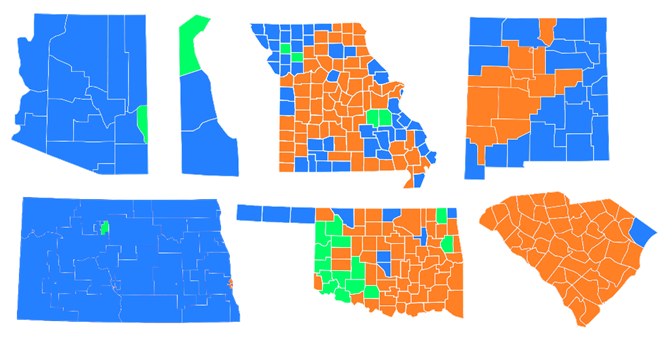
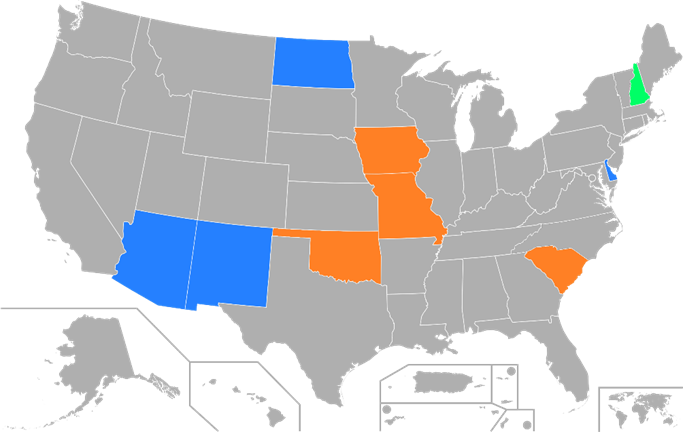
Résultats des primaires démocrates au 4 février
Le président s'est présenté devant le public pour son troisième discours sur l'état de l'Union. Contrairement aux précédents, il s'agissait d'un discours clairement conçu pour préfigurer sa propre campagne de réélection, mêlant des rappels de ses réalisations en tant que président, pilotant l'économie nationale vers la reprise, et guidant le pays vers de nouvelles perspectives à l'étranger, tout en cherchant à réduire les attaques de l'opposition contre son leadership. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir politique du pays jusqu'au discours, les primaires démocrates et républicaines n'ayant pas encore commencé, mais aussi les Nations Unies devant publier leur rapport final détaillant la fin des inspections d'armes en Irak, et résumant les conclusions des missions. Blix avait déjà annoncé en avant-première la conclusion du rapport, à savoir qu'aucune ADM n'avait été trouvée. Cette annonce a été à elle seule un coup dur pour l'administration, dont certains membres continuaient à croire qu'ils pourraient encore donner tort aux Nations unies et aux démocrates du Congrès, rétablir fermement la crédibilité de l'administration sur cette question et donner raison au commandant en chef. Mais l'administration se préparait régulièrement à se retirer de la question, et les discours de la Maison Blanche n'évoquaient plus les armes de destruction massive. Il en était de même pour l'attaché de presse de Bush, Ari Fleischer, qui a démissionné à Noël. Grand défenseur de la politique irakienne de l'administration, il avait été accusé de ne pas avoir été très honnête avec les journalistes sur cette question.
En ce qui concernait l'Irak, dans son discours sur l'état de l'Union, M. Bush avait déjà réorienté les objectifs de son administration dans ce pays, décrivant son approche comme étant jusqu'à présent couronnée de succès. "Grâce au leadership des États-Unis, le monde et les Nations unies ont commencé à s'attaquer à ces problèmes, mais nous savons tous qu'il reste encore beaucoup à faire. On ne peut pas faire confiance à Saddam Hussein pour qu'il se démilitarise lui-même de façon permanente, et la politique de cette administration reste de voir un Irak véritablement libre".
M. Bush a consacré l'essentiel de son temps à la politique intérieure, domaine dans lequel les sondages ont généralement montré qu'il était plus faible que n'importe lequel des principaux candidats démocrates. Il a joué les équilibristes républicains en s'engageant à faire preuve de compassion sur les questions économiques pour toucher les électeurs modérés et ceux qui changent d'avis, et en s'en tenant au conservatisme sur les questions sociales pour rallier la base républicaine. Il s'est engagé à protéger la famille américaine, les écoles et les institutions religieuses en tant que "piliers de la civilisation, qui doivent rester forts en Amérique". Il a promis de définir le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme et a juré de financer l'éducation à l'abstinence et le dépistage des drogues dans les écoles, deux outils qui, selon lui, "sauveraient la vie des enfants". Ces engagements ont été conçus par le conseiller politique Karl Rove pour cibler les groupes socialement conservateurs.
Le discours n'a pas apporté grand-chose en termes de nouvelle politique, mais il a surtout fait la promotion de son programme et a fustigé les démocrates pour l'avoir saboté ailleurs, s'engageant à opposer son veto à leurs efforts de socialisation de l'assurance-maladie et terminant par des mots qui ont rappelé son père : "Et ainsi, nous avançons ensemble, une nation qui s'élève". Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis".
Le président Bush prononçant l'état de l'Union en 2004
98%. Le rapport final de Hans Blix indiquait que 98 % des armes de destruction massive de l'Irak avaient été recensées puis détruites ou inutilisables. Le rapport était rédigé dans un langage typiquement diplomatique et faisait parfois l'éloge de l'administration américaine pour avoir déployé les forces américaines qui ont forcé l'Irak à se plier aux inspections internationales. Le rapport indiquait que les inspecteurs n'avaient pas été bloqués, bien qu'il décrivait de nombreuses tentatives d'intimidation de la part de l'Irak. Un nombre suffisant de membres du gouvernement irakien se sont soumis à des entretiens et des missiles illégaux ont été démolis. Mais après les recherches approfondies, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'armes de destruction massive et la quasi-totalité de l'ancien arsenal chimique de l'Irak a été retrouvée. Quant aux 2 % manquants, les inspecteurs étaient convaincus qu'ils étaient désormais chimiquement inertes et ne présentaient aucun danger sérieux.
La commission n'a trouvé aucune preuve de l'existence d'installations d'essai mobiles, de stocks de missiles, de laboratoires souterrains, de programmes illicites de drones, de cultures biologiques ou d'installations de raffinage de l'uranium. Cependant, M. Blix a laissé planer le doute dans son rapport : il a noté qu'il n'existait aucune preuve détaillée de la destruction des armes de destruction massive avant l'arrivée des inspecteurs, que l'Irak n'avait pas remis les dossiers ou ne s'était pas pleinement plié aux exigences des enquêteurs afin de prouver de manière absolue la destruction de ces armes. Contre toute attente, il n'y avait pas de réponse claire à apporter aux opposants à l'intervention, l'ONU avait fait son devoir et conclu qu'il n'était pas prouvé que l'Irak avait manqué à ses obligations en matière d'armement, mais elle avait refusé de prouver absolument son innocence, personne ne se sentait à l'aise pour qualifier l'Irak de Saddam de véridique, mais le récit détaillé et froid de Blix sur le processus de désarmement avait pris fin. Les spin doctors n'ont pas tardé à agir, les articles favorables à l'intervention soulignant le fait que l'Irak ne s'était pas pleinement conformé à ses obligations et n'avait pas prouvé la destruction des armes de destruction massive.
La conclusion des inspections signifiait que la question devait être renvoyée au Conseil de sécurité des Nations unies pour décider d'une intervention, mais c'était déjà un point discutable, l'élection de nouveaux membres du Conseil signifiait que deux votes d'équilibre, le Mexique et le Cameroun, avaient été remplacés par de solides non, le Brésil et l'Algérie. Les membres permanents, la France, la Russie et la Chine étaient également satisfaits du rapport de Blix, le président Jospin se déclarant "satisfait et soulagé par le rapport" et reconnaissant qu'"aucune action militaire n'est nécessaire", ce qui garantissait presque un veto. Le président Poutine a déclaré qu'il était heureux qu'une "solution politique ait été trouvée" et le ministre chinois des affaires étrangères, Li Zhaoxing, a déclaré : "Nous sommes heureux que la guerre ait été évitée". En février 2004, l'idée d'une intervention armée des États-Unis s'estompait dans l'esprit du public, qui se concentrait davantage sur la politique intérieure, et même les faucons semblaient avoir abandonné l'idée d'une invasion américaine unilatérale.
Hans Blix, inspecteur en désarmement de l'ONU
Mais la publication du rapport de l'ONU sur les armes en Irak a rouvert le débat politique dans les couloirs du Congrès américain et s'est fortement enflammé lorsque le président de la commission du renseignement du Sénat, Bob Graham (un critique fréquent de la politique irakienne de l'administration Bush), a annoncé que la commission allait entamer son propre examen des ADM irakiennes, ainsi que de la qualité du processus de renseignement des États-Unis. Cette annonce a particulièrement inquiété la Maison Blanche, la CIA, le ministère de la Défense et le département d'État, qui s'étaient mutuellement assuré que leurs évaluations des ADM irakiennes étaient correctes, avant d'être battus en brèche par les fuites, les rumeurs et les conversations officieuses qui mettaient en doute la position de l'administration. Les responsables républicains ont rapidement dénoncé l'enquête comme une attaque partisane : "Le sénateur Graham ressemble plus à un théoricien de la conspiration qu'à un sénateur en exercice", a déclaré une porte-parole du parti.
La CIA a été accusée du blanchiment d'un rapport remis au Congrès avant des votes cruciaux sur l'Irak, de nombreux fonctionnaires ont été accusés de diffuser des informations trompeuses sur les capacités d'armement de l'Irak, et le ministère de la défense a été gravement accusé de répéter des "renseignements" totalement faux qui lui avaient été fournis par des groupes d'exilés irakiens en échange de fonds. Face à l'enquête, l'administration a fait bonne figure en promettant de "continuer à travailler avec le Congrès pour déterminer pleinement la menace des armes de destruction massive irakiennes", mais la plupart des républicains n'ont pas semblé vouloir se plier à l'enquête et ont considéré les questions encore en suspens dans le rapport de l'ONU comme une justification de leur soutien à l'élimination de Saddam et ont réitéré leur soutien au président. Par exemple, le sénateur Jeff Sessions de l'Alabama a déclaré : "Il est clair maintenant, d'après les Nations unies, que le président a raison, l'Irak constitue une menace évidente" et certains républicains plus modérés ont même tenu à passer à autre chose, le sénateur Trent Lott ayant déclaré : "Nous devons cesser de nous plaindre de ces problèmes de Washington, qui n'ont pas d'importance en dehors de la Capitale".
Bob Graham (D), président de la commission du renseignement du Sénat
Mais il était clair que l'attention politique du pays était focalisée sur la course à l'investiture démocrate. Le 3 février, les trois candidats démocrates en tête s'affrontaient dans la première course aux primaires dans plusieurs États, et c'était le moment ou jamais pour les candidats de se lancer dans la course. L'ancien vice-président Al Gore a été snobé à deux reprises, se classant troisième dans l'Iowa et deuxième dans le New Hampshire face à ses adversaires sénatoriaux John Edwards et John Kerry. Les États en lice ont été le Delaware, la Caroline du Sud, le Missouri, l'Oklahoma, le Dakota du Nord, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Les sondeurs et les analystes, qui avaient prédit pendant des semaines un balayage en faveur de Gore, poussaient de plus en plus d'États dans la catégorie des ballottages. Le sénateur Edwards s'est hissé à la première place en Caroline du Sud (son État natal et voisin de l'État où il a servi la Caroline du Nord) et, après sa victoire dans l'Iowa, il a fait jeu égal avec Gore dans l'État voisin du Missouri. Kerry, fort de sa victoire dans le New Hampshire, a également bénéficié d'une remontée dans les sondages nationaux, à quelques encablures de Gore, dans le Delaware, le Dakota du Nord et l'Arizona. Les primaires s'annonçaient donc riches en événements et chaque candidat s'est lancé à corps perdu dans la campagne.
La campagne de M. Edwards s'est rassemblée en Caroline du Sud. Alors qu'il y a un mois, elle peinait à remplir ses propres bureaux, elle a désormais rempli les églises et les salles de spectacle de ses partisans. "Les foules ne cessent de grossir, il est clair que les gens pensent différemment à cette course après l'Iowa", a déclaré M. Edwards, étonné par la taille croissante de ses foules. Il a prononcé son discours en promettant plus d'argent pour les soins de santé et l'éducation, ainsi qu'un crédit d'impôt pour les familles de travailleurs et de la classe moyenne, dénonçant l'administration Bush pour avoir ignoré les travailleurs pauvres et s'être montrée complaisante avec les lobbyistes de Washington. Il s'est engagé à vaincre le président en lançant un appel dans tout le pays : "Je peux le battre dans le Nord, dans l'Ouest, dans le Midwest et même dans le Sud". Sa campagne était manifestement enthousiaste à l'approche de la mini-élection du mardi : "On s'attendait à ce que nous finissions quatrième dans l'Iowa et que nous abandonnions après le New Hampshire, mais l'élan est avec nous... nous avons un génie dans une lampe".
La campagne de Kerry, récemment sur le point d'abandonner, a été stimulée par sa victoire dans le New Hampshire. Les analystes ont attribué sa victoire aux nombreux électeurs indécis et à ceux qui se sont détournés de Gore à la dernière minute, car il a séduit une grande partie des électeurs de Gore sans avoir le malheureux bagage de ce dernier. Faisant campagne à Fargo, dans le Dakota du Nord, un État dans lequel Kerry avait fait une percée, il s'est opposé à la politique économique injuste de l'administration Bush et s'est attaqué aux accords commerciaux qui ne tiennent pas compte du travailleur américain : "Les démocrates du Dakota du Nord veulent un nouveau président, mais ils ne savent pas encore qui c'est", a déclaré un électeur indécis. À Tulsa, Kerry a commencé à insister sur son expérience militaire (une rareté pour lui) et sur son expérience sur le terrain par rapport à tous les autres candidats, y compris le président Bush : "Ils n'ont jamais fait la guerre, et le président des États-Unis n'a même jamais effectué un tour de service à l'intérieur du pays. Nous avons besoin d'un vrai candidat et c'est, à mon avis, John Kerry", a déclaré le sénateur Max Cleland, en soutenant Kerry.
Al Gore a fait campagne dans le Missouri voisin, où il a bombardé les réseaux de publicités de dernière minute. Désespéré de devoir lutter contre ses adversaires dans cet État riche en délégués, il s'est appuyé sur ses caractéristiques de père de famille avant tout, toujours aux côtés de sa femme Tipper : "Mon mari a fait des soins de santé la pièce maîtresse de sa campagne, ainsi que de l'éducation", a-t-elle déclaré. "Nous pensons que si l'on peut donner à chaque famille, à chaque enfant, un bon départ grâce aux soins de santé et au meilleur système éducatif possible, alors nous ferons de notre mieux pour renforcer les familles et les communautés et, par conséquent, pour que notre nation reste forte". La campagne de Gore a redoublé d'efforts pour gonfler sa base, en vantant son expérience et ses qualités de législateur, mais il devenait évident que Gore n'était plus le candidat inévitable qu'il avait été. Cependant, il conservait le statut de favori, devançant ses adversaires dans les sondages dans la plupart des États. La campagne de Gore s'est attaquée aux campagnes d'Edwards et de Kerry en cooptant leur message. Gore a commencé à diffuser des publicités mettant l'accent sur son propre passé au Vietnam et à promouvoir son programme de lutte contre la pauvreté : "Alors que ce président a réduit les impôts du 1% des Américains les plus riches, le niveau de pauvreté a augmenté, nous avons besoin d'un président innovant pour créer des emplois de haute qualité"
Principaux candidats démocrates à la présidence Gore, Kerry et Edwards
La campagne est devenue frénétique, tous les candidats se précipitant à travers le pays pour faire grimper leurs sondages. Chaque pourcentage comptait, dans certains États, c'était la différence entre gagner et perdre, mais rester compétitif signifiait encore obtenir des délégués : "Gagner ou perdre, tant que nous obtenons autant de délégués que possible". a déclaré un collaborateur de Gore au Nouveau-Mexique. Les espoirs d'un super balayage de Gore, semblable à celui qu'il avait réalisé en 2000, ont disparu. Ils se battaient à présent pour chaque délégué, faisant campagne en Arizona, l'ancien vice-président a critiqué l'administration Bush pour son incapacité à faire face aux fabricants de médicaments : "Le président affirme qu'il n'appartient pas au gouvernement de dicter les prix des médicaments, mais lorsque vous êtes victime de prix abusifs ou que vous vous faites arnaquer par les fabricants de médicaments, je pense que le gouvernement doit intervenir". Gore était en pleine forme, persuadé qu'une fois qu'il aurait remporté des victoires, sa campagne reprendrait de l'élan, grâce au soutien de l'establishment et à la solidité des coffres de la campagne.
"Et les Panthers ?" John Edwards a demandé à une foule du Missouri qui célébrait la victoire de son équipe locale au Superbowl quelques jours plus tôt : "Cela veut vraiment dire quelque chose, tous ces Caroliniens qui gagnent au Texas, j'ai hâte de répéter leurs succès". Coiffé d'un costume impeccable, le sénateur Edwards a fait campagne dans le centre et le sud-ouest du pays, à tel point que sa voix était devenue rauque lorsqu'il a atterri au Nouveau-Mexique. Les sondages ont progressivement tourné en sa faveur après sa victoire, peut-être que sa campagne axée sur les classes sociales s'est imposée dans le pays.
Kerry a ressorti ses talents d'orateur de la vieille école Kennedy : "Les Américains ne devraient pas seulement travailler pour l'économie, l'économie devrait travailler pour les Américains". a-t-il déclaré dans un local syndical du Delaware avant de passer 45 minutes à signer tous les chapeaux, drapeaux et photographies placés devant lui. Kerry avait besoin de toutes les voix, malgré sa victoire dans le New Hampshire, il était encore en retard dans tous les États, l'effet d'entraînement était peut-être en train de s'estomper et la presse rapportait que Gore reprenait du poil de la bête, l'attention qu'il a reçue après sa victoire n'était pas toujours bonne, les gens le qualifiaient de sincère, d'authentique mais pas de charismatique ou d'énergique, L'équipe de Kerry était convaincue qu'elle parviendrait à terminer en force, à gagner quelques États et à se positionner comme l'alternative à Gore, la mieux placée pour battre le président en novembre.
Les candidats démocrates dans leur jeunesse : Gore, Kerry et Edwards
Les résultats de la première compétition multi-états de la course démocrate ont considérablement bouleversé la donne pour les trois principaux candidats ; la compétition a été très disputée, les trois principaux candidats se qualifiant pour des délégués dans pratiquement toutes les compétitions. Dans l'évaluation la plus large des électeurs, tant sur le plan géographique que sur celui de la terminologie populaire, le verdict a été clair : Gore et Edwards l'ont emporté haut la main. La conclusion immédiate était que Gore était de retour dans la course. Après des semaines de recul, de chute dans les sondages et d'échec dans les premiers États, la campagne de Gore avait une bonne raison de se réjouir : après une spirale de doutes, Gore s'était imposé dans quatre États, remportant les primaires de l'Arizona et du Delaware et les caucus du Nouveau-Mexique et du Dakota du Sud. "Mon cœur est plein ce soir", a déclaré M. Gore mardi soir dans l'État de Washington (où se déroulera une prochaine élection). "C'est aussi votre victoire", a-t-il déclaré à une foule de partisans.
Mais alors qu'il semblait que la campagne de Gore allait enfin briller, l'attention nationale s'est rapidement détournée de lui, lorsque le sénateur Edwards, candidat outsider, a maintenu sa campagne en vie en remportant trois primaires en Caroline du Sud, dans le Missouri et dans l'Oklahoma. Les victoires du sénateur, dont c'est le premier mandat, signifient que, bien qu'il soit toujours derrière Gore en termes de délégués, il était à égalité en ce qui concernait le nombre d'États remportés. La campagne intensive d'Edward dans les États du Sud a porté ses fruits : "c'est une nuit extraordinaire pour nous, "premier en Caroline du Sud, premier dans le Missouri, premier dans l'Oklahoma". La compétition serrée a conduit à des victoires étroites pour les deux camps, au Nouveau-Mexique et dans le Missouri, où Gore et Edwards se sont battus de justesse l'un contre l'autre. "Tout a dépassé mes attentes, merci beaucoup", a déclaré M. Edwards à la foule. "Ce soir, vous avez dit que la politique qui consiste à élever les gens l'emporte sur celle qui consiste à les démolir", a-t-il ajouté.
Pour Kerry, la soirée a été clairement décevante, puisqu'il n'a remporté aucun des États en lice et qu'il est arrivé loin derrière dans l'Oklahoma et le Delaware, où il espérait gagner. Les experts se demandaient si Kerry avait la capacité de poursuivre sa campagne, mais il est resté stoïque et n'a pas laissé entendre qu'il se préparait à se retirer de la course : "Il est important de ne rien tenir pour acquis, je suis touché par votre soutien, quand je regarde ce que nous avons accompli, c'est énorme, et je me réjouis de poursuivre cette campagne". D'aucuns se sont toutefois inquiétés du fait que la campagne de Kerry ne disposait pas des fonds nécessaires pour rivaliser efficacement avec les autres candidats.
L'analyse de la soirée a montré où les succès et les échecs de chaque candidat pouvaient être attribués, dans un sondage sur les questions les plus importantes pour les électeurs démocrates, la défaite de Bush et l'économie étaient les questions clés. Le succès du sénateur Edward est dû à son attrait pour les électeurs blancs, les ouvriers et les électeurs plus modérés, ainsi qu'au soutien plus important que prévu des groupes minoritaires qui devaient être très favorables à Gore et des électeurs indécis qui avaient basculé en faveur de Kerry dans le New Hampshire. Gore a nettement progressé par rapport aux scrutins précédents auprès des électeurs plus âgés et plus libéraux.
Les votes ont modifié la campagne, il n'y avait toujours pas de leader clair, pas de victoire écrasante, pas de candidat par défaut et les trois candidats ont rapidement repris le chemin de la campagne en se préparant pour les prochaines élections dans les États du Michigan et de Washington qui seront suivies par les primaires dans le Tennessee et en Virginie.
Résultats du "Mini-Tuesday" du 3 février
Les candidats Gore, Edwards et Kerry s'expriment après les résultats de l'élection.
Résultats du Mini-Tuesday du 3 février
Résultats des primaires démocrates au 4 février

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 32: Ralentisseurs
Depuis la fin des négociations de paix officielles entre Israël et la Palestine dans les années 90, les violences entre militants palestiniens et forces de sécurité israéliennes se sont multipliées, dans le cadre d'un conflit connu sous le nom de seconde Intifada. La communauté internationale s'est réunie pour créer une nouvelle formule de paix, appelée Feuille de route pour la paix, élaborée par les membres du Quatuor supranational composé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies. Les négociations entre Israël et la Palestine sont restées longtemps interrompues, des violences sporadiques ayant interrompu la capacité (ou le désir) des deux parties de s'asseoir à la table des négociations. Les factions du gouvernement israélien et de l'Autorité palestinienne n'étaient pas non plus d'accord sur la manière dont les pourparlers devaient se dérouler. Les deux principaux domaines de conflit étaient la position d'Israël sur le retrait des territoires contestés et la poursuite de la construction des colonies israéliennes à l'intérieur du territoire palestinien, et les groupes palestiniens étaient divisés entre la direction plus modérée associée au Fatah et la faction de plus en plus militante et islamiste associée au Hamas.
Malgré le fractionnisme, les groupes palestiniens ont fait un premier pas important en déclarant uniformément un cessez-le-feu contre Israël à l'été 2003 et en s'engageant à le maintenir tant qu'Israël remplirait certaines conditions, à savoir l'arrêt de l'agression, la cessation de la construction de colonies et le début du retrait militaire du territoire palestinien.
Après quelques désaccords, le gouvernement israélien a approuvé la "feuille de route" et a renoué un dialogue direct avec le gouvernement palestinien. La balle a enfin recommencé à rouler. Le gouvernement israélien ne s'est pas engagé à se retirer sur les frontières d'avant 2000 ni à démanteler les colonies. Le Premier ministre israélien, Ariel Sharon, surnommé "le père des colonies", a toutefois opéré un revirement surprenant : poussé par la conseillère américaine à la sécurité nationale, Condoleezza Rice, Sharon a semblé s'engager fermement en faveur de la feuille de route, qualifiant la politique israélienne actuelle de pseudo-occupation d'insoutenable : "Vous ne pouvez pas aimer le mot, mais ce qui se passe, c'est une occupation - maintenir 3,5 millions de Palestiniens sous occupation. Je pense que c'est une chose terrible pour Israël et pour les Palestiniens", Il a ainsi proposé un gel des colonies en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces décisions du leader palestinien Yasser Arafat et du Premier ministre Ariel Sharon ont été accueillies avec circonspection par leurs opinions publiques respectives, car la plupart des Palestiniens et des Israéliens étaient sceptiques à l'égard de la feuille de route, et des violences occasionnelles de faible intensité menaçaient de compromettre les manœuvres prudentes des deux parties.

Le dirigeant palestinien Arafat et le Premier ministre israélien Sharon
Il y avait des problèmes évidents, Israël n'avait pas encore pris de décision ferme pour avancer sur la feuille de route, s'engager à retirer les colonies et se retirer du territoire palestinien, et il semblait à beaucoup qu'Israël se retirait lentement des négociations et n'était pas désireux de régler les questions fondamentales avec la Palestine. Le gouvernement a affirmé qu'il suivait scrupuleusement le plan, mais alors que certains avant-postes militaires ont été supprimés, d'autres ont été construits, et bien que les raids en Palestine aient diminué, le nombre de barrages routiers a augmenté, et au lieu de libérer immédiatement 700 prisonniers palestiniens détenus sans inculpation, les Israéliens les ont libérés au compte-gouttes. Les Palestiniens et les négociateurs étaient de plus en plus frustrés par les tactiques israéliennes et le président Bush a écrit une lettre à Sharon pour lui faire part de sa frustration de voir qu'Israël ne respectait pas ses engagements de retrait, et beaucoup se demandaient si Sharon avait un tant soit peu foi en l'initiative. Le Quartet international a tenu une conférence de presse où il a formulé une demande simple : "conformément à la feuille de route, les activités de colonisation doivent cesser".
Les critiques du gouvernement américain à l'égard d'Israël et le rôle du Quartet dans les négociations ont été brusquement interrompus par les tensions accrues dues à la crise du désarmement irakien, les États-Unis cherchant à obtenir le soutien des pays du Moyen-Orient si une invasion de l'Irak s'avérait nécessaire. Mais à l'hiver 2003, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Irak commençaient à s'estomper, la question de l'intransigeance israélienne a refait surface. Le gouvernement Sharon a finalement rendu public son plan de désengagement unilatéral de la bande de Gaza, y compris le déplacement des colonies à l'intérieur de la bande de Gaza. Le plan de désengagement comportait également des engagements plus modestes visant à retirer certains colons de la Cisjordanie. Ni les faucons ni les colombes israéliens, ni les dirigeants palestiniens ni les partisans de la ligne dure n'ont été enthousiasmés par cette décision, et même certains ministres israéliens, comme le ministre des finances Benjamin Netanyahu, l'ont désapprouvée publiquement et ont demandé au gouvernement d'organiser un référendum pour se prononcer sur la question. Les Palestiniens ont considéré les mesures de Sharon avec suspicion, son refus de faire progresser totalement la feuille de route et de s'engager pleinement dans la formation d'un État palestinien a été notable, de même que l'absence d'un retrait autour de Jérusalem.
Les analystes de la politique étrangère ont noté que le retrait des colonies pourrait avoir plus à voir avec la politique de sécurité qu'avec les questions humanitaires ou pour calmer les esprits occidentaux (le plan de désengagement a été associé au détournement de la voie de construction de la barrière en Cisjordanie, un point de friction pour les groupes humanitaires), mais les États-Unis et le grand quartet ont tout de même salué la manœuvre, Cette initiative, qui doit conduire à un retrait total d'Israël et à la fin complète de l'occupation à Gaza, pourrait constituer un pas en avant vers la réalisation de la vision de deux États et contribuer aux progrès de la feuille de route", a déclaré le secrétaire général Kofi Annan. Les décisions palestiniennes et israéliennes n'ont pas inspiré beaucoup d'optimisme, mais elles ont au moins permis une transition plus pacifique et ont constitué ce qui est généralement considéré comme la fin de la seconde Intifada.

Second Intifada Wiki Box
Le mois de février a été le plus tendu pour les candidats démocrates restants : dix États et le district de Columbia ont organisé leurs élections, et les primaires et les caucus se sont étalés sur tout le calendrier. À l'issue du mois de janvier, deux candidats s'étaient imposés. L'ancien vice-président Al Gore et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards étaient les deux favoris qui s'affrontaient pour l'investiture démocrate. Il s'agissait d'un affrontement classique entre l'homme d'expérience Gore, fort de 30 ans d'expérience militaire, législative et exécutive, qui avait déjà remporté l'investiture démocrate avant de se voir refuser la présidence par une décision très controversée de la Cour suprême il y a quatre ans. Comparé au jeune sénateur John Edwards, que la campagne de Gore en 2000 avait sérieusement envisagé comme candidat à la vice-présidence. Il n'y avait pas de division politique claire entre les deux hommes, et tous deux défendaient des valeurs néo-démocrates traditionnelles. Mais il y avait des différences entre les deux hommes sur certaines questions sociales, économiques et de défense.
La position de Gore a évolué depuis l'époque où il était un démocrate du sud du Tennessee, largement conservateur sur ces questions, jusqu'à devenir largement libéral. Ses détracteurs ont accusé le vice-président de faire volte-face sur la question, en changeant d'avis pour s'adapter aux électeurs, tandis que ses défenseurs ont fait remarquer que l'opinion de l'ensemble du pays avait évolué ''Il y a beaucoup de gens qui seraient aujourd'hui considérés comme pro-choix, qui votaient de manière très similaire à Al Gore au milieu des années 1980'', a déclaré le sénateur Charles E. Schumer, démocrate de New York.
Edwards a vanté sa bonne foi pro-choix, avec un taux de vote pro-choix de 100 %, contre 84 % pour Gore, et a souligné que, contrairement à Gore, il avait été un opposant résolu aux attaques des conservateurs contre le droit à l'avortement, y compris les avortements tardifs. L'autre grande question sociale, celle des droits des homosexuels, a été plus complexe entre les candidats, leurs opinions officielles étant les mêmes, à savoir qu'ils soutenaient personnellement les unions civiles et non le mariage homosexuel, mais qu'ils étaient favorables au droit des États de définir le mariage (une question soulevée par la légalisation dans le Massachusetts). Le désaccord notable sur la question de la défense découlait de la crise du désarmement irakien. Bien que Gore et Edwards s'opposent à la stratégie globale du président et n'excluent pas une frappe unilatérale contre l'Irak, ils ont tous deux adopté des tons différents sur cette question. L'année précédente, Gore s'était opposé à l'invasion de l'Irak et s'était engagé à poursuivre la politique d'endiguement.
Il a déclaré que le système de sanctions, de zones d'exclusion aérienne et de frappes militaires avait porté ses fruits sous l'administration Clinton et qu'il continuerait à fonctionner. Edwards a adopté une position plus dure et a souligné son engagement en faveur de la loi sur la libération de l'Irak, qui faisait de l'élimination du régime de Saddam un élément de la politique étrangère américaine. Leurs politiques économiques constituaient la plus grande différence. Gore représentait la continuité du libéralisme néo-démocrate, donnant la priorité à l'élimination de la dette et au renforcement du filet de sécurité sociale afin d'aider les personnes dans le besoin et de les sortir de la pauvreté. Edwards s'est toutefois détourné du programme économique néo-démocrate, sa campagne était davantage axée sur les classes sociales, son discours de campagne portait sur les "deux Amériques", "l'Amérique des privilégiés et des riches, et l'Amérique de ceux qui vivent d'un chèque de paie à l'autre". Il a mis l'accent sur davantage d'interventions économiques que Gore, notamment en augmentant le salaire minimum et en soulignant l'importance des syndicats (un groupe de vote clé qui lui a permis de gagner le Missouri) et a critiqué les entreprises et les accords commerciaux pour l'externalisation des emplois, ces accords commerciaux étant des réalisations de l'administration Clinton-Gore.

L'ancien vice-président Al Gore et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards
Les trois autres candidats étaient le sénateur John Kerry du Massachusetts, le militant des droits civiques Al Sharpton et le représentant de l'Ohio Dennis Kucinich. Seule la campagne de Kerry reste prometteuse. Deuxième dans l'Iowa et vainqueur dans le New Hampshire, ce héros de guerre libéral, bien éduqué et éloquent, avait, de l'avis de beaucoup, l'aura d'un président, mais son apogée dans les sondages semblait avoir disparu après qu'il eut échoué à remporter un État lors des mini-élections du mardi, même s'il bénéficiait encore d'une bonne partie du soutien des anciens combattants et des libéraux de la classe moyenne qui voyaient en lui une alternative attrayante à Bush ou Gore. Sharpton insistait pour que le parti démocrate ne cède pas de terrain sur les droits civiques et Kucinich était le candidat le plus à gauche, soutenant le mariage homosexuel, la légalisation de la marijuana, l'isolationnisme militaire total et la destitution de George Bush. Les deux campagnes de Kucinich se sont concentrées sur les États afin de gagner des délégués pour influencer le parti, plutôt que sur le pays dans son ensemble.
Les premières compétitions ont été les caucus du Michigan et de Washington, tous deux dans la foulée immédiate de la mini-concours du mardi, Gore et Edwards menant fermement le peloton, Edwards ayant dépassé Kerry dans l'État de Washington après ses victoires (un État dans lequel Edwards s'était peu investi), mais il semblait que Gore était également en train de rebondir, Les démocrates, y compris de nombreux membres de l'establishment, étaient prêts à tout pour ne pas répéter leur défaite face à George W. Bush, mais n'avaient pas encore réussi à trouver le successeur idéal. Les victoires d'Edwards aux primaires ont fait de lui le principal candidat anti-Gore et lui ont permis d'attirer l'attention des médias bien plus que celle de Gore. Kerry, qui avait besoin d'une victoire pour raviver les espoirs d'une éventuelle candidature, a mené une campagne acharnée à Washington, un État qui voyait d'un bon œil les outsiders et qui avait l'habitude de résultats imprévisibles. Une victoire à Washington, suivie d'une victoire dans le Maine le lendemain, pourrait le relancer.
Les résultats ont confirmé l'opinion générale selon laquelle une course à deux chevaux s'était développée lorsque Gore et Edwards ont triomphé respectivement à Washington et dans le Michigan, Kerry n'arrivant qu'en troisième position (mais suffisamment pour empêcher l'un ou l'autre des candidats de remporter une victoire écrasante). Il constituait un grand pas en avant pour les deux hommes dans la course, en particulier pour Edwards, dont la victoire dans le Michigan montrait qu'il avait du succès en dehors du Sud : "C'est un signe clair que cette course est loin d'être terminée". L'élection signifiait que les deux hommes restaient à égalité pour le nombre d'États qu'ils avaient chacun remportés et que les deux hommes avaient fait des percées démographiques. M. Gore a prononcé un discours de victoire à Seattle : "C'est un bon présage et une décision claire, c'est le début de la fin pour George Bush". La décevante troisième place de Kerry a fait resurgir la possibilité de la fin de sa campagne, mais le candidat a de nouveau écarté cette suggestion : "Cette course n'est pas encore terminée, et nous attendons avec impatience le Caucus du Maine de demain".
Dans le Maine, les enjeux étaient élevés pour la campagne de Kerry, qui avait désespérément besoin d'une victoire et l'État de la Nouvelle-Angleterre était sa meilleure chance d'en remporter une. Il avait obtenu quelques soutiens de premier plan, notamment celui de l'ancien sénateur George Mitchell, figure de proue du parti démocrate, l'État était coincé entre deux grandes compétitions et la campagne de Kerry avait déployé des efforts considérables, mais les résultats décevants obtenus après le New Hampshire avaient fait sombrer les espoirs. Kerry a attaqué Bush sur son leadership et s'est ouvert aux rumeurs concernant le service militaire du président Bush : "La question est de savoir s'il était présent et actif en Alabama à l'époque où il était censé l'être", faisant référence à l'époque où Bush faisait partie de la garde nationale.
L'État a également attiré l'outsider Dennis Kucinich, qui a consacré la majeure partie de son budget restant à l'État. Cependant, après la réunion des 400 caucus de l'État, malgré les efforts acharnés de Kerry, il n'a pas obtenu le soutien significatif dont il avait besoin dans le Maine et s'est à nouveau classé à une décevante troisième place, avec seulement quelques points d'avance sur Kucinich. Mais cette fois, c'est Gore qui a battu Edwards dans la compétition en remportant l'État et, pour la première fois, il est arrivé en tête des victoires dans l'État, avec 42 % contre 36 % pour Edwards. Il semblait que Gore était enfin en train de prendre de l'élan face à ses rivaux. "Les gens vont vers le vainqueur", a déclaré le sénateur Kerry, semblant admettre qu'il avait une tâche insurmontable devant lui, mais il a tout de même déclaré qu'il avait l'intention de participer aux prochains scrutins. Les deux rivaux s'affrontaient déjà dans le sud lors des prochaines élections en Virginie et dans l'État natal de Gore, le Tennessee.
Les deux sudistes se sont fortement mobilisés et ont investi des ressources considérables dans ces États. Malgré les attentes de la campagne de Gore, qui pensait que la compétition ne serait qu'une formalité, Edwards a considérablement progressé dans les sondages, au point que la campagne de Gore a été obligée de commencer à acheter des publicités dans le Tennessee pour éviter l'embarras de voir le favori s'incliner dans son État d'origine. La campagne de Gore espérait qu'en battant Edwards dans le Sud, elle mettrait fin à sa campagne : "Une fois que Gore aura gagné dans le Sud, cela montrera qu'il dispose encore d'un large soutien national et qu'il peut gagner n'importe où". Mais il a été poursuivi tout au long de sa campagne, les électeurs démocrates l'ayant constamment qualifié de moins éligible, moins sympathique et moins favorable que ses adversaires. Mais Kerry ayant été écarté par la plupart des instituts de sondage, les électeurs de Virginie et du Tennessee n'avaient plus qu'à choisir entre Gore et Edwards. Les craintes que la lune de miel soit terminée pour Edwards et que les électeurs deviennent enfin sérieux quant à leur choix présidentiel ont été suggérées, et Gore a regagné des points et repris sa solide avance dans le Tennessee, mais la Virginie n'a pas été épargnée. Cependant, Edwards a remporté un triomphe majeur pour sa campagne en recevant le soutien du gouverneur démocrate de la Virginie, Mark Warner. Le populaire gouverneur a apporté un soutien important au candidat désormais outsider : "Nous avons besoin d'un franc-parler à la Maison Blanche, qui se battra pour chaque vote", a déclaré Warner.

Le gouverneur Mark Warner (à droite) soutient le sénateur Edwards (à gauche)
Les sondages annonçaient une soirée serrée en Virginie et une victoire écrasante dans le Tennessee, mais en Virginie, probablement aidé par le soutien de dernière minute de Warner, Edwards a remporté une victoire décisive de 18 points, 49 % contre 31 %, sa plus grande victoire à ce jour. Dans le Tennessee, l'État d'origine de Gore, le vice-président n'a pas obtenu les résultats escomptés, les sondages culminant à 60 %, mais il avait perdu suffisamment de soutien mais il a conservé une forte avance et a remporté l'État avec 57 % des suffrages, ce qui est encore très satisfaisant.
Après cette double défaite dans le sud, l'équipe de Kerry a pris la décision de suspendre sa campagne. Kerry a déclaré aux médias que c'était la fin de sa course à la présidence : "C'est la fin de la campagne pour la présidence", a déclaré Kerry après ses deux troisièmes places et il a pris le temps de faire l'éloge de ses rivaux démocrates : "Ce sont de bons hommes, de bons démocrates et de bons patriotes ... et j'ai hâte d'aider l'un ou l'autre d'entre eux à vaincre le président Bush".
Avant les nouvelles élections du parti démocrate, les droits des homosexuels sont redevenus un sujet de premier plan dans le dialogue national. Ce changement a été provoqué par les événements survenus à San Francisco. À l'issue d'une élection serrée qui a failli donner lieu à une deuxième surprise dans l'État doré, le maire démocrate Gavin Newsom, longtemps considéré comme un modéré pour cette ville traditionnellement libérale, a battu son adversaire de gauche issu du parti vert. Le nouveau maire a été invité par la représentante de la ville et leader démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, au discours sur l'état de l'Union en 2004, événement au cours duquel le président Bush s'est élevé contre les "juges activistes qui redéfinissent le mariage", en réponse à la légalisation effective du mariage homosexuel dans le Massachusetts. M. Newsom et d'autres fonctionnaires municipaux de San Francisco ont préparé un plan ambitieux et, le 12 février, la ville a commencé à délivrer des licences de mariage aux couples de même sexe, affirmant que la constitution de la Californie et des États-Unis lui donnait le pouvoir de le faire en vertu des lois sur l'égalité de protection. En l'espace de quelques heures, des centaines de couples ont fait la queue devant l'hôtel de ville pour se voir délivrer des certificats de mariage.

(À gauche) Un couple gay fête la réception de son certificat de mariage. (À droite) Le maire de San Francisco, Gavin Newsom.
La reconnaissance de facto du mariage gay par le maire (démocrate) élu de la ville a été rapidement critiquée par les commentateurs et les politiciens conservateurs, qui y ont vu un outrage moral et un grave excès de pouvoir de la part de M. Newsom, ainsi qu'une violation de la loi californienne qui définit le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Mathew D. Staver, chef d'un groupe d'avocats déterminés à poursuivre la ville, a déclaré que les certificats de mariage délivrés jeudi ne valaient pas le papier sur lequel ils étaient écrits et a ajouté que M. Newsom donnait l'impression que les maires étaient au-dessus de la loi. Au sein de l'État, la gouverneure de Californie, Mme Huffington, s'est largement alignée sur M. Newsom, refusant d'ouvrir une enquête au motif que San Francisco et des groupes opposés avaient déjà entamé des actions en justice, et a indiqué qu'elle soutenait largement le mariage gay (ouvrant ainsi la possibilité d'une légalisation). Cette question brûlante s'est rapidement retrouvée dans la sphère nationale et dans les primaires démocrates. Le candidat Gore a de nouveau été examiné à la loupe en ce qui concerne sa position sur le mariage gay, en partie à cause de sa campagne en Californie l'année précédente, où il avait soutenu Newsom, et de nouvelles questions concernant les divergences entre ses déclarations sur le mariage gay.
Tous les candidats ont été appelés à donner leur avis sur la question. Le président s'est dit troublé par la décision et a déclaré que "le peuple doit être impliqué dans cette décision, pas les tribunaux" et, peu après, il a officiellement déclaré qu'il soutenait un amendement constitutionnel interdisant le mariage gay. La décision de San Francisco s'est clairement répercutée dans tout le pays, une douzaine de responsables de comtés ayant notamment réitéré la même décision.
À la suite de la décision prise à San Francisco, des élections démocrates ont été organisées à Washington et au Nevada. Avant le concours officiel, D.C. avait organisé une primaire informelle avant son caucus officiel. Gore a triomphé lors de la primaire informelle avec 2/3 des voix, le reste étant réparti entre les candidats mineurs (son principal adversaire ne figurant pas sur le bulletin de vote). Lors du caucus officiel, bien qu'il reste le grand vainqueur, sa part de voix est tombée à 41 %, Edwards et Sharpton lui ayant retiré un soutien considérable. Mais dans le Nevada, le caucus s'est joué entre les deux favoris. Cet État très disputé a été divisé en raison de l'intervention du parti démocrate de l'État et de son influent sénateur Harry Reid qui, depuis des mois, mettait en garde les délégués du parti contre les dangers d'une nouvelle nomination de Gore et soulignait qu'un nouveau visage était désespérément nécessaire pour battre Bush. Le Nevada, un État pivot, était considéré comme un indicateur clé et certains analystes craignaient que Gore ait négligé cet État et fasse campagne dans le Wisconsin, riche en délégués, afin d'empêcher Edwards de remporter un deuxième État du nord du pays. Les résultats ont permis à Edwards de remporter une nouvelle victoire sur Gore et, à la fermeture des bureaux de vote le jour de la Saint-Valentin, le triangle amoureux du parti démocrate n'était pas terminé.

Al Gore et John Edwards font campagne pour l'investiture démocrate.
À une semaine des élections décisives du Super Tuesday, quatre États sont encore en jeu : le Wisconsin le 17, puis Hawaï, l'Idaho et l'Utah le 24. Les primaires du Wisconsin ont donné lieu à une véritable bataille entre les candidats. Après les victoires d'Edward dans le Michigan, la Virginie et le Nevada, il est désormais devancé de peu par Gore, car sa campagne contestataire et son message populiste ont fait mouche dans l'État, où Gore a martelé qu'il avait toujours soutenu des groupes syndicaux. Les deux hommes ont mené une campagne acharnée pour remporter la victoire. Mais la campagne de Gore a subi un nouveau revers lorsque les électeurs ont choisi Edwards avec une marge de six points. Il s'agit d'une victoire massive pour l'équipe d'Edwards, qui égalise le nombre d'États remportés par chaque candidat. La victoire d'Edwards a été rendue possible par un nombre considérable d'électeurs modérés et conservateurs, ainsi que par le soutien des syndicats et de certains journaux locaux, et par le fait que les électeurs de dernière minute se sont toujours rangés de son côté. "Ils ont dit qu'ils nous avaient battus, mais pas si vite", a déclaré M. Edwards. L'idée que la campagne d'Edward n'avait pas de jambes a bel et bien été écartée, car de nombreux électeurs démocrates considéraient Edwards comme un concurrent sérieux et comme un candidat un peu plus préférable.
"Ce type est comme le nouveau Clinton", a déclaré un électeur d'Edward, "il nous fait vibrer".
Dans les jours qui ont suivi la victoire d'Edward dans le Wisconsin, le paysage politique s'est considérablement modifié lorsque Edwards a obtenu deux soutiens importants. Le premier, le 19 février, a été annoncé par l'AFL-CIO, la plus grande organisation syndicale américaine représentant 13 millions de travailleurs : "Il sera notre champion à la Maison Blanche", a déclaré le président du syndicat, John Sweeney. Le message anti-libre-échange d'Edwards et ses victoires dans les États de la ceinture de rouille, le Wisconsin et le Michigan, avaient séduit les syndicats par rapport à Gore (qui avait déjà obtenu ce soutien en 2000) et beaucoup préféraient ce nouveau visage et son charisme.
Le deuxième soutien majeur a été celui du sénateur Edward Kennedy. Dans une salle de convention bondée de son Massachusetts natal, le plus célèbre descendant vivant de la plus célèbre famille du Parti démocrate a soulevé la foule avant de soutenir chaleureusement le sénateur Edwards : "Il y a deux choses dont nous avons besoin dans un candidat, l'engagement et le caractère, et c'est ce que vous avez ! C'est ce que vous avez !", a déclaré le maître de 71 ans en soutenant le jeune sénateur Edwards. Depuis des mois, les experts avaient décelé des indices montrant que Kennedy avait pris ses distances avec la campagne de Gore, d'abord au profit d'un allié naturel, John Kerry, son collègue sénateur du Massachusetts, mais qu'il s'en remettait désormais à Edwards, avec qui il avait travaillé en étroite collaboration pendant son mandat de sénateur, comme une sorte de mentor. Ce soutien a été très important, car il a permis à Edwards de faire des incursions dans le bloc des électeurs libéraux du parti démocrate.

Le sénateur Ted Kennedy soutient le sénateur Edwards
La dernière série de compétitions avant le Super Tuesday s'est avérée cruciale. Edwards était en pleine forme, avec des soutiens cruciaux et une forte dynamique due à ses victoires. En comparaison, la campagne de Gore piétinait. Une vaste campagne conservatrice avait été lancée pour dépeindre Gore comme trop extrémiste sur les questions LGBT, notamment en publiant le texte d'un discours que le vice-président avait prononcé l'année précédente devant un groupe de défense des droits LGBT et dans lequel il décrivait le mariage homosexuel comme un "amour qui devait être honoré et respecté", un radical en matière d'environnement qui nuirait encore plus à l'économie et à l'industrie énergétique du pays, et un faible en matière de politique étrangère pour ses critiques de l'administration sur l'Irak et ses nombreuses apparitions à la télévision où il déclarait que Saddam Hussein n'était pas une "menace imminente". C'était peut-être la dernière chance pour Gore de blesser sérieusement Edwards avant la dernière ligne droite, mais ce fut une nouvelle déception pour l'ancien vice-président. Edwards avait remporté l'Utah et l'Idaho à une large majorité, tandis que le vice-président avait gagné à Hawaï (probablement aidé par la décision de Kucinich de faire campagne dans cet État souvent ignoré). Avant le Super Tuesday, il semblait que les rôles étaient une fois de plus inversés et que le nouveau venu Edwards devenait le favori pour l'investiture.
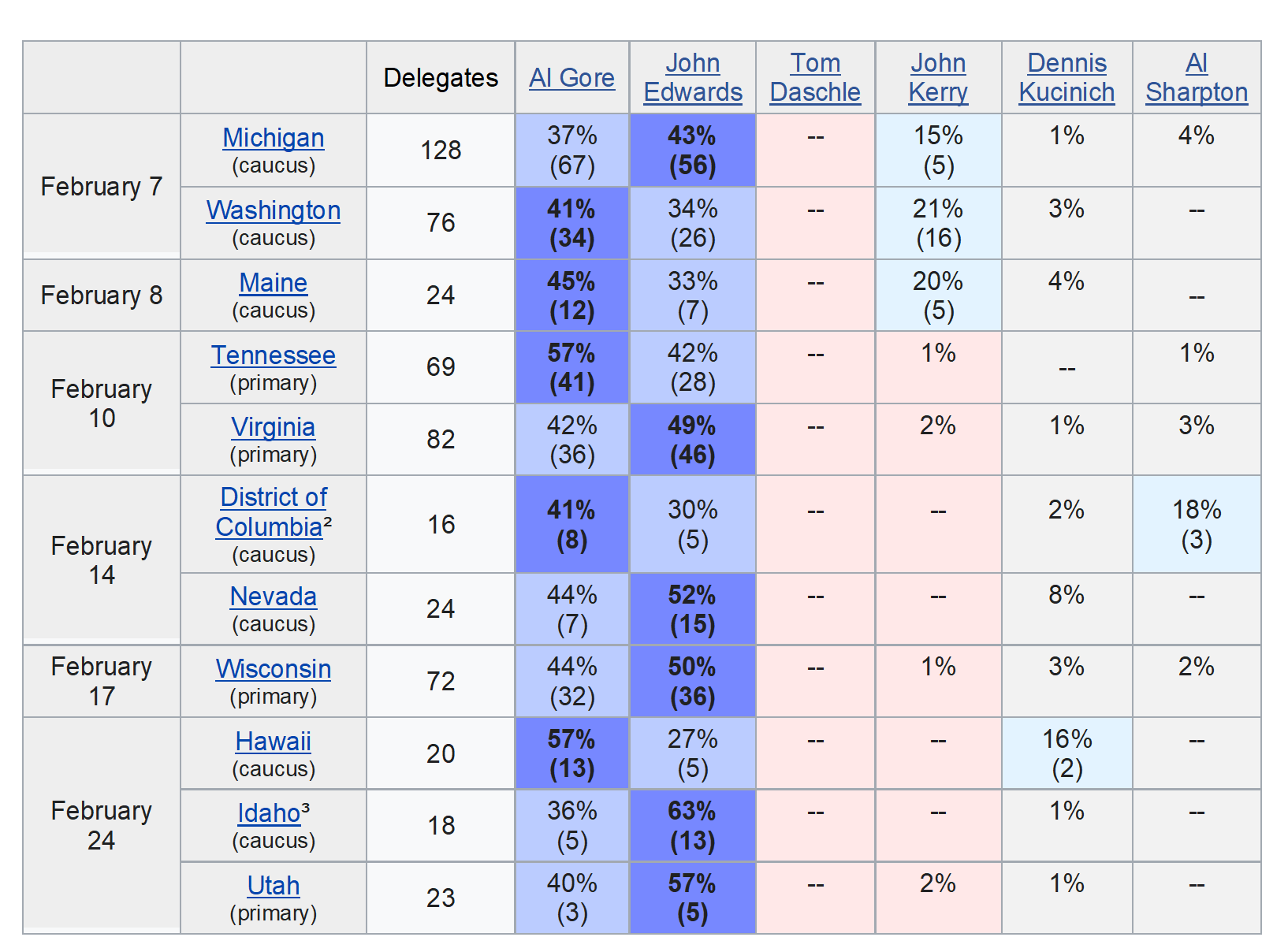
Résultats de la primaire démocrate de février
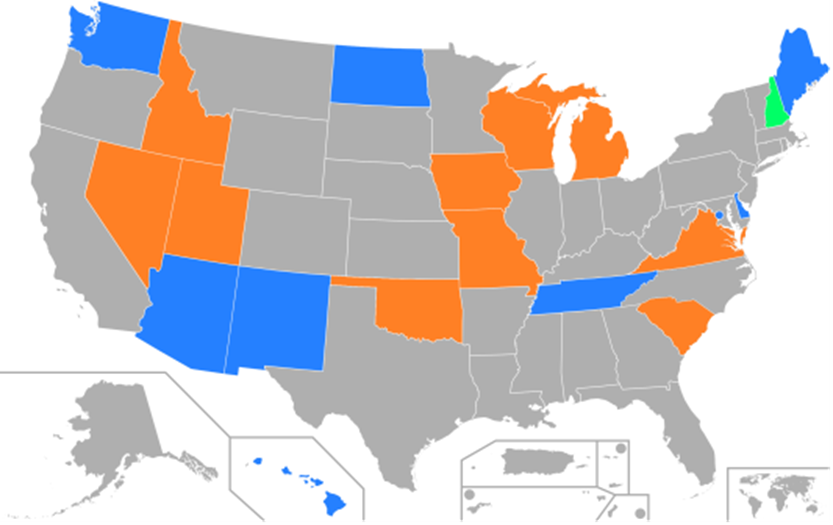
Carte de la primaire démocrate après le concours de février: Gore (Bleu), Edwards (Orange),Kerry (Vert).

Le sénateur Edwards et le vice-président Gore célèbrent leurs victoires aux primaires
Depuis la fin des négociations de paix officielles entre Israël et la Palestine dans les années 90, les violences entre militants palestiniens et forces de sécurité israéliennes se sont multipliées, dans le cadre d'un conflit connu sous le nom de seconde Intifada. La communauté internationale s'est réunie pour créer une nouvelle formule de paix, appelée Feuille de route pour la paix, élaborée par les membres du Quatuor supranational composé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies. Les négociations entre Israël et la Palestine sont restées longtemps interrompues, des violences sporadiques ayant interrompu la capacité (ou le désir) des deux parties de s'asseoir à la table des négociations. Les factions du gouvernement israélien et de l'Autorité palestinienne n'étaient pas non plus d'accord sur la manière dont les pourparlers devaient se dérouler. Les deux principaux domaines de conflit étaient la position d'Israël sur le retrait des territoires contestés et la poursuite de la construction des colonies israéliennes à l'intérieur du territoire palestinien, et les groupes palestiniens étaient divisés entre la direction plus modérée associée au Fatah et la faction de plus en plus militante et islamiste associée au Hamas.
Malgré le fractionnisme, les groupes palestiniens ont fait un premier pas important en déclarant uniformément un cessez-le-feu contre Israël à l'été 2003 et en s'engageant à le maintenir tant qu'Israël remplirait certaines conditions, à savoir l'arrêt de l'agression, la cessation de la construction de colonies et le début du retrait militaire du territoire palestinien.
Après quelques désaccords, le gouvernement israélien a approuvé la "feuille de route" et a renoué un dialogue direct avec le gouvernement palestinien. La balle a enfin recommencé à rouler. Le gouvernement israélien ne s'est pas engagé à se retirer sur les frontières d'avant 2000 ni à démanteler les colonies. Le Premier ministre israélien, Ariel Sharon, surnommé "le père des colonies", a toutefois opéré un revirement surprenant : poussé par la conseillère américaine à la sécurité nationale, Condoleezza Rice, Sharon a semblé s'engager fermement en faveur de la feuille de route, qualifiant la politique israélienne actuelle de pseudo-occupation d'insoutenable : "Vous ne pouvez pas aimer le mot, mais ce qui se passe, c'est une occupation - maintenir 3,5 millions de Palestiniens sous occupation. Je pense que c'est une chose terrible pour Israël et pour les Palestiniens", Il a ainsi proposé un gel des colonies en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces décisions du leader palestinien Yasser Arafat et du Premier ministre Ariel Sharon ont été accueillies avec circonspection par leurs opinions publiques respectives, car la plupart des Palestiniens et des Israéliens étaient sceptiques à l'égard de la feuille de route, et des violences occasionnelles de faible intensité menaçaient de compromettre les manœuvres prudentes des deux parties.
Le dirigeant palestinien Arafat et le Premier ministre israélien Sharon
Il y avait des problèmes évidents, Israël n'avait pas encore pris de décision ferme pour avancer sur la feuille de route, s'engager à retirer les colonies et se retirer du territoire palestinien, et il semblait à beaucoup qu'Israël se retirait lentement des négociations et n'était pas désireux de régler les questions fondamentales avec la Palestine. Le gouvernement a affirmé qu'il suivait scrupuleusement le plan, mais alors que certains avant-postes militaires ont été supprimés, d'autres ont été construits, et bien que les raids en Palestine aient diminué, le nombre de barrages routiers a augmenté, et au lieu de libérer immédiatement 700 prisonniers palestiniens détenus sans inculpation, les Israéliens les ont libérés au compte-gouttes. Les Palestiniens et les négociateurs étaient de plus en plus frustrés par les tactiques israéliennes et le président Bush a écrit une lettre à Sharon pour lui faire part de sa frustration de voir qu'Israël ne respectait pas ses engagements de retrait, et beaucoup se demandaient si Sharon avait un tant soit peu foi en l'initiative. Le Quartet international a tenu une conférence de presse où il a formulé une demande simple : "conformément à la feuille de route, les activités de colonisation doivent cesser".
Les critiques du gouvernement américain à l'égard d'Israël et le rôle du Quartet dans les négociations ont été brusquement interrompus par les tensions accrues dues à la crise du désarmement irakien, les États-Unis cherchant à obtenir le soutien des pays du Moyen-Orient si une invasion de l'Irak s'avérait nécessaire. Mais à l'hiver 2003, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Irak commençaient à s'estomper, la question de l'intransigeance israélienne a refait surface. Le gouvernement Sharon a finalement rendu public son plan de désengagement unilatéral de la bande de Gaza, y compris le déplacement des colonies à l'intérieur de la bande de Gaza. Le plan de désengagement comportait également des engagements plus modestes visant à retirer certains colons de la Cisjordanie. Ni les faucons ni les colombes israéliens, ni les dirigeants palestiniens ni les partisans de la ligne dure n'ont été enthousiasmés par cette décision, et même certains ministres israéliens, comme le ministre des finances Benjamin Netanyahu, l'ont désapprouvée publiquement et ont demandé au gouvernement d'organiser un référendum pour se prononcer sur la question. Les Palestiniens ont considéré les mesures de Sharon avec suspicion, son refus de faire progresser totalement la feuille de route et de s'engager pleinement dans la formation d'un État palestinien a été notable, de même que l'absence d'un retrait autour de Jérusalem.
Les analystes de la politique étrangère ont noté que le retrait des colonies pourrait avoir plus à voir avec la politique de sécurité qu'avec les questions humanitaires ou pour calmer les esprits occidentaux (le plan de désengagement a été associé au détournement de la voie de construction de la barrière en Cisjordanie, un point de friction pour les groupes humanitaires), mais les États-Unis et le grand quartet ont tout de même salué la manœuvre, Cette initiative, qui doit conduire à un retrait total d'Israël et à la fin complète de l'occupation à Gaza, pourrait constituer un pas en avant vers la réalisation de la vision de deux États et contribuer aux progrès de la feuille de route", a déclaré le secrétaire général Kofi Annan. Les décisions palestiniennes et israéliennes n'ont pas inspiré beaucoup d'optimisme, mais elles ont au moins permis une transition plus pacifique et ont constitué ce qui est généralement considéré comme la fin de la seconde Intifada.
Second Intifada Wiki Box
Le mois de février a été le plus tendu pour les candidats démocrates restants : dix États et le district de Columbia ont organisé leurs élections, et les primaires et les caucus se sont étalés sur tout le calendrier. À l'issue du mois de janvier, deux candidats s'étaient imposés. L'ancien vice-président Al Gore et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards étaient les deux favoris qui s'affrontaient pour l'investiture démocrate. Il s'agissait d'un affrontement classique entre l'homme d'expérience Gore, fort de 30 ans d'expérience militaire, législative et exécutive, qui avait déjà remporté l'investiture démocrate avant de se voir refuser la présidence par une décision très controversée de la Cour suprême il y a quatre ans. Comparé au jeune sénateur John Edwards, que la campagne de Gore en 2000 avait sérieusement envisagé comme candidat à la vice-présidence. Il n'y avait pas de division politique claire entre les deux hommes, et tous deux défendaient des valeurs néo-démocrates traditionnelles. Mais il y avait des différences entre les deux hommes sur certaines questions sociales, économiques et de défense.
La position de Gore a évolué depuis l'époque où il était un démocrate du sud du Tennessee, largement conservateur sur ces questions, jusqu'à devenir largement libéral. Ses détracteurs ont accusé le vice-président de faire volte-face sur la question, en changeant d'avis pour s'adapter aux électeurs, tandis que ses défenseurs ont fait remarquer que l'opinion de l'ensemble du pays avait évolué ''Il y a beaucoup de gens qui seraient aujourd'hui considérés comme pro-choix, qui votaient de manière très similaire à Al Gore au milieu des années 1980'', a déclaré le sénateur Charles E. Schumer, démocrate de New York.
Edwards a vanté sa bonne foi pro-choix, avec un taux de vote pro-choix de 100 %, contre 84 % pour Gore, et a souligné que, contrairement à Gore, il avait été un opposant résolu aux attaques des conservateurs contre le droit à l'avortement, y compris les avortements tardifs. L'autre grande question sociale, celle des droits des homosexuels, a été plus complexe entre les candidats, leurs opinions officielles étant les mêmes, à savoir qu'ils soutenaient personnellement les unions civiles et non le mariage homosexuel, mais qu'ils étaient favorables au droit des États de définir le mariage (une question soulevée par la légalisation dans le Massachusetts). Le désaccord notable sur la question de la défense découlait de la crise du désarmement irakien. Bien que Gore et Edwards s'opposent à la stratégie globale du président et n'excluent pas une frappe unilatérale contre l'Irak, ils ont tous deux adopté des tons différents sur cette question. L'année précédente, Gore s'était opposé à l'invasion de l'Irak et s'était engagé à poursuivre la politique d'endiguement.
Il a déclaré que le système de sanctions, de zones d'exclusion aérienne et de frappes militaires avait porté ses fruits sous l'administration Clinton et qu'il continuerait à fonctionner. Edwards a adopté une position plus dure et a souligné son engagement en faveur de la loi sur la libération de l'Irak, qui faisait de l'élimination du régime de Saddam un élément de la politique étrangère américaine. Leurs politiques économiques constituaient la plus grande différence. Gore représentait la continuité du libéralisme néo-démocrate, donnant la priorité à l'élimination de la dette et au renforcement du filet de sécurité sociale afin d'aider les personnes dans le besoin et de les sortir de la pauvreté. Edwards s'est toutefois détourné du programme économique néo-démocrate, sa campagne était davantage axée sur les classes sociales, son discours de campagne portait sur les "deux Amériques", "l'Amérique des privilégiés et des riches, et l'Amérique de ceux qui vivent d'un chèque de paie à l'autre". Il a mis l'accent sur davantage d'interventions économiques que Gore, notamment en augmentant le salaire minimum et en soulignant l'importance des syndicats (un groupe de vote clé qui lui a permis de gagner le Missouri) et a critiqué les entreprises et les accords commerciaux pour l'externalisation des emplois, ces accords commerciaux étant des réalisations de l'administration Clinton-Gore.
L'ancien vice-président Al Gore et le sénateur de Caroline du Nord John Edwards
Les trois autres candidats étaient le sénateur John Kerry du Massachusetts, le militant des droits civiques Al Sharpton et le représentant de l'Ohio Dennis Kucinich. Seule la campagne de Kerry reste prometteuse. Deuxième dans l'Iowa et vainqueur dans le New Hampshire, ce héros de guerre libéral, bien éduqué et éloquent, avait, de l'avis de beaucoup, l'aura d'un président, mais son apogée dans les sondages semblait avoir disparu après qu'il eut échoué à remporter un État lors des mini-élections du mardi, même s'il bénéficiait encore d'une bonne partie du soutien des anciens combattants et des libéraux de la classe moyenne qui voyaient en lui une alternative attrayante à Bush ou Gore. Sharpton insistait pour que le parti démocrate ne cède pas de terrain sur les droits civiques et Kucinich était le candidat le plus à gauche, soutenant le mariage homosexuel, la légalisation de la marijuana, l'isolationnisme militaire total et la destitution de George Bush. Les deux campagnes de Kucinich se sont concentrées sur les États afin de gagner des délégués pour influencer le parti, plutôt que sur le pays dans son ensemble.
Les premières compétitions ont été les caucus du Michigan et de Washington, tous deux dans la foulée immédiate de la mini-concours du mardi, Gore et Edwards menant fermement le peloton, Edwards ayant dépassé Kerry dans l'État de Washington après ses victoires (un État dans lequel Edwards s'était peu investi), mais il semblait que Gore était également en train de rebondir, Les démocrates, y compris de nombreux membres de l'establishment, étaient prêts à tout pour ne pas répéter leur défaite face à George W. Bush, mais n'avaient pas encore réussi à trouver le successeur idéal. Les victoires d'Edwards aux primaires ont fait de lui le principal candidat anti-Gore et lui ont permis d'attirer l'attention des médias bien plus que celle de Gore. Kerry, qui avait besoin d'une victoire pour raviver les espoirs d'une éventuelle candidature, a mené une campagne acharnée à Washington, un État qui voyait d'un bon œil les outsiders et qui avait l'habitude de résultats imprévisibles. Une victoire à Washington, suivie d'une victoire dans le Maine le lendemain, pourrait le relancer.
Les résultats ont confirmé l'opinion générale selon laquelle une course à deux chevaux s'était développée lorsque Gore et Edwards ont triomphé respectivement à Washington et dans le Michigan, Kerry n'arrivant qu'en troisième position (mais suffisamment pour empêcher l'un ou l'autre des candidats de remporter une victoire écrasante). Il constituait un grand pas en avant pour les deux hommes dans la course, en particulier pour Edwards, dont la victoire dans le Michigan montrait qu'il avait du succès en dehors du Sud : "C'est un signe clair que cette course est loin d'être terminée". L'élection signifiait que les deux hommes restaient à égalité pour le nombre d'États qu'ils avaient chacun remportés et que les deux hommes avaient fait des percées démographiques. M. Gore a prononcé un discours de victoire à Seattle : "C'est un bon présage et une décision claire, c'est le début de la fin pour George Bush". La décevante troisième place de Kerry a fait resurgir la possibilité de la fin de sa campagne, mais le candidat a de nouveau écarté cette suggestion : "Cette course n'est pas encore terminée, et nous attendons avec impatience le Caucus du Maine de demain".
Dans le Maine, les enjeux étaient élevés pour la campagne de Kerry, qui avait désespérément besoin d'une victoire et l'État de la Nouvelle-Angleterre était sa meilleure chance d'en remporter une. Il avait obtenu quelques soutiens de premier plan, notamment celui de l'ancien sénateur George Mitchell, figure de proue du parti démocrate, l'État était coincé entre deux grandes compétitions et la campagne de Kerry avait déployé des efforts considérables, mais les résultats décevants obtenus après le New Hampshire avaient fait sombrer les espoirs. Kerry a attaqué Bush sur son leadership et s'est ouvert aux rumeurs concernant le service militaire du président Bush : "La question est de savoir s'il était présent et actif en Alabama à l'époque où il était censé l'être", faisant référence à l'époque où Bush faisait partie de la garde nationale.
L'État a également attiré l'outsider Dennis Kucinich, qui a consacré la majeure partie de son budget restant à l'État. Cependant, après la réunion des 400 caucus de l'État, malgré les efforts acharnés de Kerry, il n'a pas obtenu le soutien significatif dont il avait besoin dans le Maine et s'est à nouveau classé à une décevante troisième place, avec seulement quelques points d'avance sur Kucinich. Mais cette fois, c'est Gore qui a battu Edwards dans la compétition en remportant l'État et, pour la première fois, il est arrivé en tête des victoires dans l'État, avec 42 % contre 36 % pour Edwards. Il semblait que Gore était enfin en train de prendre de l'élan face à ses rivaux. "Les gens vont vers le vainqueur", a déclaré le sénateur Kerry, semblant admettre qu'il avait une tâche insurmontable devant lui, mais il a tout de même déclaré qu'il avait l'intention de participer aux prochains scrutins. Les deux rivaux s'affrontaient déjà dans le sud lors des prochaines élections en Virginie et dans l'État natal de Gore, le Tennessee.
Les deux sudistes se sont fortement mobilisés et ont investi des ressources considérables dans ces États. Malgré les attentes de la campagne de Gore, qui pensait que la compétition ne serait qu'une formalité, Edwards a considérablement progressé dans les sondages, au point que la campagne de Gore a été obligée de commencer à acheter des publicités dans le Tennessee pour éviter l'embarras de voir le favori s'incliner dans son État d'origine. La campagne de Gore espérait qu'en battant Edwards dans le Sud, elle mettrait fin à sa campagne : "Une fois que Gore aura gagné dans le Sud, cela montrera qu'il dispose encore d'un large soutien national et qu'il peut gagner n'importe où". Mais il a été poursuivi tout au long de sa campagne, les électeurs démocrates l'ayant constamment qualifié de moins éligible, moins sympathique et moins favorable que ses adversaires. Mais Kerry ayant été écarté par la plupart des instituts de sondage, les électeurs de Virginie et du Tennessee n'avaient plus qu'à choisir entre Gore et Edwards. Les craintes que la lune de miel soit terminée pour Edwards et que les électeurs deviennent enfin sérieux quant à leur choix présidentiel ont été suggérées, et Gore a regagné des points et repris sa solide avance dans le Tennessee, mais la Virginie n'a pas été épargnée. Cependant, Edwards a remporté un triomphe majeur pour sa campagne en recevant le soutien du gouverneur démocrate de la Virginie, Mark Warner. Le populaire gouverneur a apporté un soutien important au candidat désormais outsider : "Nous avons besoin d'un franc-parler à la Maison Blanche, qui se battra pour chaque vote", a déclaré Warner.
Le gouverneur Mark Warner (à droite) soutient le sénateur Edwards (à gauche)
Les sondages annonçaient une soirée serrée en Virginie et une victoire écrasante dans le Tennessee, mais en Virginie, probablement aidé par le soutien de dernière minute de Warner, Edwards a remporté une victoire décisive de 18 points, 49 % contre 31 %, sa plus grande victoire à ce jour. Dans le Tennessee, l'État d'origine de Gore, le vice-président n'a pas obtenu les résultats escomptés, les sondages culminant à 60 %, mais il avait perdu suffisamment de soutien mais il a conservé une forte avance et a remporté l'État avec 57 % des suffrages, ce qui est encore très satisfaisant.
Après cette double défaite dans le sud, l'équipe de Kerry a pris la décision de suspendre sa campagne. Kerry a déclaré aux médias que c'était la fin de sa course à la présidence : "C'est la fin de la campagne pour la présidence", a déclaré Kerry après ses deux troisièmes places et il a pris le temps de faire l'éloge de ses rivaux démocrates : "Ce sont de bons hommes, de bons démocrates et de bons patriotes ... et j'ai hâte d'aider l'un ou l'autre d'entre eux à vaincre le président Bush".
Avant les nouvelles élections du parti démocrate, les droits des homosexuels sont redevenus un sujet de premier plan dans le dialogue national. Ce changement a été provoqué par les événements survenus à San Francisco. À l'issue d'une élection serrée qui a failli donner lieu à une deuxième surprise dans l'État doré, le maire démocrate Gavin Newsom, longtemps considéré comme un modéré pour cette ville traditionnellement libérale, a battu son adversaire de gauche issu du parti vert. Le nouveau maire a été invité par la représentante de la ville et leader démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, au discours sur l'état de l'Union en 2004, événement au cours duquel le président Bush s'est élevé contre les "juges activistes qui redéfinissent le mariage", en réponse à la légalisation effective du mariage homosexuel dans le Massachusetts. M. Newsom et d'autres fonctionnaires municipaux de San Francisco ont préparé un plan ambitieux et, le 12 février, la ville a commencé à délivrer des licences de mariage aux couples de même sexe, affirmant que la constitution de la Californie et des États-Unis lui donnait le pouvoir de le faire en vertu des lois sur l'égalité de protection. En l'espace de quelques heures, des centaines de couples ont fait la queue devant l'hôtel de ville pour se voir délivrer des certificats de mariage.
(À gauche) Un couple gay fête la réception de son certificat de mariage. (À droite) Le maire de San Francisco, Gavin Newsom.
La reconnaissance de facto du mariage gay par le maire (démocrate) élu de la ville a été rapidement critiquée par les commentateurs et les politiciens conservateurs, qui y ont vu un outrage moral et un grave excès de pouvoir de la part de M. Newsom, ainsi qu'une violation de la loi californienne qui définit le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Mathew D. Staver, chef d'un groupe d'avocats déterminés à poursuivre la ville, a déclaré que les certificats de mariage délivrés jeudi ne valaient pas le papier sur lequel ils étaient écrits et a ajouté que M. Newsom donnait l'impression que les maires étaient au-dessus de la loi. Au sein de l'État, la gouverneure de Californie, Mme Huffington, s'est largement alignée sur M. Newsom, refusant d'ouvrir une enquête au motif que San Francisco et des groupes opposés avaient déjà entamé des actions en justice, et a indiqué qu'elle soutenait largement le mariage gay (ouvrant ainsi la possibilité d'une légalisation). Cette question brûlante s'est rapidement retrouvée dans la sphère nationale et dans les primaires démocrates. Le candidat Gore a de nouveau été examiné à la loupe en ce qui concerne sa position sur le mariage gay, en partie à cause de sa campagne en Californie l'année précédente, où il avait soutenu Newsom, et de nouvelles questions concernant les divergences entre ses déclarations sur le mariage gay.
Tous les candidats ont été appelés à donner leur avis sur la question. Le président s'est dit troublé par la décision et a déclaré que "le peuple doit être impliqué dans cette décision, pas les tribunaux" et, peu après, il a officiellement déclaré qu'il soutenait un amendement constitutionnel interdisant le mariage gay. La décision de San Francisco s'est clairement répercutée dans tout le pays, une douzaine de responsables de comtés ayant notamment réitéré la même décision.
À la suite de la décision prise à San Francisco, des élections démocrates ont été organisées à Washington et au Nevada. Avant le concours officiel, D.C. avait organisé une primaire informelle avant son caucus officiel. Gore a triomphé lors de la primaire informelle avec 2/3 des voix, le reste étant réparti entre les candidats mineurs (son principal adversaire ne figurant pas sur le bulletin de vote). Lors du caucus officiel, bien qu'il reste le grand vainqueur, sa part de voix est tombée à 41 %, Edwards et Sharpton lui ayant retiré un soutien considérable. Mais dans le Nevada, le caucus s'est joué entre les deux favoris. Cet État très disputé a été divisé en raison de l'intervention du parti démocrate de l'État et de son influent sénateur Harry Reid qui, depuis des mois, mettait en garde les délégués du parti contre les dangers d'une nouvelle nomination de Gore et soulignait qu'un nouveau visage était désespérément nécessaire pour battre Bush. Le Nevada, un État pivot, était considéré comme un indicateur clé et certains analystes craignaient que Gore ait négligé cet État et fasse campagne dans le Wisconsin, riche en délégués, afin d'empêcher Edwards de remporter un deuxième État du nord du pays. Les résultats ont permis à Edwards de remporter une nouvelle victoire sur Gore et, à la fermeture des bureaux de vote le jour de la Saint-Valentin, le triangle amoureux du parti démocrate n'était pas terminé.
Al Gore et John Edwards font campagne pour l'investiture démocrate.
À une semaine des élections décisives du Super Tuesday, quatre États sont encore en jeu : le Wisconsin le 17, puis Hawaï, l'Idaho et l'Utah le 24. Les primaires du Wisconsin ont donné lieu à une véritable bataille entre les candidats. Après les victoires d'Edward dans le Michigan, la Virginie et le Nevada, il est désormais devancé de peu par Gore, car sa campagne contestataire et son message populiste ont fait mouche dans l'État, où Gore a martelé qu'il avait toujours soutenu des groupes syndicaux. Les deux hommes ont mené une campagne acharnée pour remporter la victoire. Mais la campagne de Gore a subi un nouveau revers lorsque les électeurs ont choisi Edwards avec une marge de six points. Il s'agit d'une victoire massive pour l'équipe d'Edwards, qui égalise le nombre d'États remportés par chaque candidat. La victoire d'Edwards a été rendue possible par un nombre considérable d'électeurs modérés et conservateurs, ainsi que par le soutien des syndicats et de certains journaux locaux, et par le fait que les électeurs de dernière minute se sont toujours rangés de son côté. "Ils ont dit qu'ils nous avaient battus, mais pas si vite", a déclaré M. Edwards. L'idée que la campagne d'Edward n'avait pas de jambes a bel et bien été écartée, car de nombreux électeurs démocrates considéraient Edwards comme un concurrent sérieux et comme un candidat un peu plus préférable.
"Ce type est comme le nouveau Clinton", a déclaré un électeur d'Edward, "il nous fait vibrer".
Dans les jours qui ont suivi la victoire d'Edward dans le Wisconsin, le paysage politique s'est considérablement modifié lorsque Edwards a obtenu deux soutiens importants. Le premier, le 19 février, a été annoncé par l'AFL-CIO, la plus grande organisation syndicale américaine représentant 13 millions de travailleurs : "Il sera notre champion à la Maison Blanche", a déclaré le président du syndicat, John Sweeney. Le message anti-libre-échange d'Edwards et ses victoires dans les États de la ceinture de rouille, le Wisconsin et le Michigan, avaient séduit les syndicats par rapport à Gore (qui avait déjà obtenu ce soutien en 2000) et beaucoup préféraient ce nouveau visage et son charisme.
Le deuxième soutien majeur a été celui du sénateur Edward Kennedy. Dans une salle de convention bondée de son Massachusetts natal, le plus célèbre descendant vivant de la plus célèbre famille du Parti démocrate a soulevé la foule avant de soutenir chaleureusement le sénateur Edwards : "Il y a deux choses dont nous avons besoin dans un candidat, l'engagement et le caractère, et c'est ce que vous avez ! C'est ce que vous avez !", a déclaré le maître de 71 ans en soutenant le jeune sénateur Edwards. Depuis des mois, les experts avaient décelé des indices montrant que Kennedy avait pris ses distances avec la campagne de Gore, d'abord au profit d'un allié naturel, John Kerry, son collègue sénateur du Massachusetts, mais qu'il s'en remettait désormais à Edwards, avec qui il avait travaillé en étroite collaboration pendant son mandat de sénateur, comme une sorte de mentor. Ce soutien a été très important, car il a permis à Edwards de faire des incursions dans le bloc des électeurs libéraux du parti démocrate.
Le sénateur Ted Kennedy soutient le sénateur Edwards
La dernière série de compétitions avant le Super Tuesday s'est avérée cruciale. Edwards était en pleine forme, avec des soutiens cruciaux et une forte dynamique due à ses victoires. En comparaison, la campagne de Gore piétinait. Une vaste campagne conservatrice avait été lancée pour dépeindre Gore comme trop extrémiste sur les questions LGBT, notamment en publiant le texte d'un discours que le vice-président avait prononcé l'année précédente devant un groupe de défense des droits LGBT et dans lequel il décrivait le mariage homosexuel comme un "amour qui devait être honoré et respecté", un radical en matière d'environnement qui nuirait encore plus à l'économie et à l'industrie énergétique du pays, et un faible en matière de politique étrangère pour ses critiques de l'administration sur l'Irak et ses nombreuses apparitions à la télévision où il déclarait que Saddam Hussein n'était pas une "menace imminente". C'était peut-être la dernière chance pour Gore de blesser sérieusement Edwards avant la dernière ligne droite, mais ce fut une nouvelle déception pour l'ancien vice-président. Edwards avait remporté l'Utah et l'Idaho à une large majorité, tandis que le vice-président avait gagné à Hawaï (probablement aidé par la décision de Kucinich de faire campagne dans cet État souvent ignoré). Avant le Super Tuesday, il semblait que les rôles étaient une fois de plus inversés et que le nouveau venu Edwards devenait le favori pour l'investiture.
Résultats de la primaire démocrate de février
Carte de la primaire démocrate après le concours de février: Gore (Bleu), Edwards (Orange),Kerry (Vert).
Le sénateur Edwards et le vice-président Gore célèbrent leurs victoires aux primaires

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 33: des balles et des bulletins de votes.
Haïti
Parallèlement à la course à l'investiture du parti démocrate, un deuxième événement majeur s'est produit dans le demi-frère révolutionnaire de l'Amérique, la nation caribéenne d'Haïti. En Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide, prêtre né dans un bidonville et premier dirigeant démocratiquement élu du pays, connaissait une période difficile. Peu après sa victoire électorale en 1991, il a été renversé par un coup d'État militaire, mais lorsque l'administration de George H. W. Bush a pris fin et que Bill Clinton a pris le relais, les États-Unis ont insisté sur le retour d'Aristide et sur la fin de la junte haïtienne ; à la suite de négociations, la junte a obtempéré et les troupes américaines ont été déployées dans le cadre d'une opération de "maintien de la démocratie" et Aristide est rentré d'exil. Il a créé un nouveau parti politique et s'est renforcé à l'approche des élections de 2000. Aristide s'est fait de nombreux ennemis qui l'ont accusé de manipulation électorale et, lors de l'élection présidentielle, ils ont choisi de boycotter la procédure, ce qui a permis à Aristide de remporter l'élection avec 90 % des voix (bien que de nombreux observateurs aient noté que le taux de participation était suffisamment élevé pour qu'Aristide ait pu l'emporter de toute façon). Après son retour à la présidence, Aristide a gouverné Haïti d'une manière qui en a inquiété plus d'un.
Il était un réformateur radical et il a exigé que la France rembourse à Haïti les milliards qu'elle avait versés pour son indépendance. Dans un pays dépendant des dons internationaux et bien que son gouvernement se soit engagé à aider les pauvres, ses méthodes sont devenues de plus en plus erratiques et autoritaires, pour faire appliquer ses lois des milices ont été organisées, la police a été réformée avec des pouvoirs étendus pour réprimer les protestations alors que la corruption continuait à prospérer dans le pays. Pire encore, malgré la grande vision d'Aristide, l'économie d'Haïti ne s'est pas redressée et le pays est resté la nation la plus pauvre des Amériques. Le pays était considéré dans le monde entier comme un État dépendant des dons internationaux et la suspension de l'aide américaine par l'administration Bush lui a été très préjudiciable. Son comportement erratique a persisté et ses discours sont devenus plus brutaux, encourageant les actes violents contre les ennemis politiques, et certains de ses partisans ont fait de même.
En janvier 2004, le pays a commencé à célébrer le 200e anniversaire de son indépendance. Au même moment, l'ancienne armée transformée en groupes paramilitaires a commencé à mener une insurrection organisée, sous le nom de Front révolutionnaire national pour la libération et la reconstruction d'Haïti. La direction des insurgés était composée d'anciens militaires, de trafiquants de drogue, d'escadrons de la mort de la junte et de dissidents, tous liés par leur opposition à Aristide. En même temps que l'opposition politique se coalisait, un groupe de chefs d'entreprise, de médecins, d'intellectuels, d'étudiants et d'agriculteurs a commencé à réclamer la démission d'Aristide et les fréquents affrontements entre eux et ses partisans se sont soldés par des violences et parfois par des morts. En quelques semaines, l'insurrection a commencé à s'emparer des campagnes et à attaquer les postes de police. La violence s'est intensifiée dans les villes : à Port-au-Prince, des milices armées ont tiré sur des milliers d'étudiants et beaucoup ont reproché à Aristide d'avoir empêché la police d'enquêter sur ces crimes. Peu après, les forces d'opposition ont pris le contrôle des Gonaïves, la quatrième ville d'Haïti, et l'ont pillée pour y trouver des armes et des véhicules. Le gouvernement a réagi en dressant des barricades dans la capitale, l'état d'urgence a été instauré et de nombreux Haïtiens ont commencé à fuir le pays en prévision d'une nouvelle flambée de violence.

(Gauche) Président Jean Aristide, (Droite) Rebelles haïtiens
La situation s'est rapidement détériorée et le monde l'a remarqué. Au cours du mois de février, les forces rebelles ont progressé sur la côte, prenant le contrôle du pays avec peu d'opposition formelle (Aristide avait aboli l'armée). Le monde entier s'est divisé sur la réponse à apporter et l'administration Bush a présenté différentes options. Le secrétaire d'État Powell a d'abord mis en garde contre l'éviction d'Aristide par les rebelles, avant de faire marche arrière quelques jours plus tard et de rendre Aristide partiellement responsable de la violence : "Une grande partie de la violence à laquelle nous assistons aujourd'hui est le fait des gangs qui étaient autrefois alignés sur le gouvernement d'Aristide". a déclaré un porte-parole du département d'État, suggérant que la démission d'Aristide pourrait être une solution appropriée. Certains ont exhorté le président à agir. "Si nous sommes capables d'envoyer des forces militaires au Libéria - à 3.000 miles de là - nous pouvons certainement agir pour protéger nos intérêts dans notre propre jardin", a indiqué le sénateur Bob Graham. L'inaction ne peut plus être notre politique", a déclaré le sénateur Bob Graham, "en agissant ainsi, nous ferons en sorte qu'Haïti soit gouverné par des voyous et des criminels". D'autres démocrates se sont attaqués à la mauvaise communication de la Maison Blanche, qualifiant sa réponse de "tergiversation" ou de "manque d'intérêt". Le candidat à la présidence et militant des droits civiques Al Sharpton a déclaré qu'il se rendrait personnellement en Haïti, et Al Gore et John Edwards ont accusé le président d'ignorer Haïti, voire de donner du pouvoir aux rebelles, par des déclarations suggérant la démission d'Aristide.
Alors que les rebelles se rapprochaient de la capitale et que la menace d'un bain de sang augmentait, des négociateurs internationaux, dont les États-Unis et divers États des Caraïbes, sont intervenus dans l'espoir de négocier des pourparlers entre les deux forces. L'administration Bush a présenté une proposition qu'Aristide a acceptée, visant à réduire le pouvoir du président tout en permettant à Aristide d'aller jusqu'au bout de son mandat. Mais les dirigeants de l'opposition haïtienne ont rejeté ces ouvertures. "Il n'y aura plus de retard ; notre réponse reste la même", a déclaré à l'Associated Press Maurice LaFortune, président de la Chambre de commerce haïtienne et l'un des principaux dirigeants de l'opposition. Aristide doit démissionner. Alors que les jours s'égrenaient, que les bandes rebelles avançaient ville après ville, prenant le contrôle du nord, l'effondrement du plan de paix apparaissait pour beaucoup comme le coup de grâce à son règne. Il n'avait que peu de forces à appeler à se battre pour lui, et les villes faisaient défection sans se battre, tandis qu'Aristide restait défiant, prononçant un discours en l'honneur des policiers qui avaient été tués lors du soulèvement : "Je suis prêt à donner ma vie si c'est ce qu'il faut pour défendre mon pays". Cette issue est de plus en plus proche, si les États-Unis ne souhaitaient pas le protéger et si les rebelles mettaient à exécution leurs menaces de plus en plus explicites.
Il a toutefois continué à affirmer qu'il n'était pas question de démissionner et a qualifié ces propositions de "rumeurs infondées". Des milliers de partisans armés parcouraient la ville, seul espoir pour le président de repousser les rebelles, et Haïti se préparait à une bataille.
Le 29 février, les événements se précipitent. Guy Philip, le chef des rebelles, a lancé un ultimatum : "Nous allons simplement prendre nos positions et attendre le bon moment [pour attaquer]", a déclaré M. Philippe, un ancien officier de l'armée haïtienne démantelée : "S'il n'y a pas de démission, alors nous attaquerons". En l'absence d'accord avec les rebelles, le gouvernement américain a supposé que le seul moyen pacifique de mettre fin à la situation en Haïti était le départ d'Aristide du pays. Il lui a donc proposé de démissionner en échange de son évacuation et de celle de sa famille en toute sécurité, l'avertissant que les forces rebelles marcheraient sur la ville et que des milliers de vies, dont la sienne, étaient en danger s'il ne quittait pas le pays. Aristide a été à la fois choqué et indigné, demandant l'aide des Américains tout en les accusant de se ranger du côté de ses ennemis[1] Il a tenté de répondre aux appels téléphoniques de ses alliés qui lui ont déconseillé de fuir le pays car cela conduirait à la victoire des rebelles et aux représailles massives qui s'ensuivraient, et l'ont mis en garde contre l'offre des Américains en la qualifiant de "coup d'État organisé par Washington" Il a absolument rejeté toute demande de démission ou d'exil et a appelé plusieurs agences de presse et hommes politiques américains[2] pour dire qu'il avait rejeté l'offre.
Le lundi 1er mars, des centaines de rebelles sont entrés dans la capitale, Port-au-Prince, et des affrontements armés ont été signalés à la périphérie entre les forces rebelles et les loyalistes d'Aristides. Les rues ont été envahies, tandis que le bruit des tirs se rapprochant de plus en plus du centre de la ville résonnait. Les rebelles, bien équipés et expérimentés, ont apparemment fait un travail rapide contre les milices d'Aristide et la police de la ville n'a été d'aucune aide pour le gouvernement, la plupart ayant fait défection à l'opposition ou étant restés chez eux. Guy Philippe a réitéré ses demandes de démission du président sous peine d'arrestation et, à la fin de la journée, il était clair que les rebelles seraient bientôt maîtres de la ville, encerclant déjà l'aéroport Toussaint Louverture (un moyen clé de fuite pour Aristide et sécurisé par un détachement d'urgence de marines américains). Sûr de lui, Guy Philippe a appelé les agences de presse internationales et s'est déclaré nouveau chef de la police de Port-au-Prince, offrant à Aristide une dernière chance de démissionner avant que ses forces ne prennent le palais présidentiel par la force. En retour, le silence règne, Aristide ne fit aucune proclamation publique, il avait fui le palais avec l'intention de se rendre à l'ambassade américaine où le président en difficulté avait soi-disant l'intention de présenter sa démission et de faire appel à la protection américaine (c'est la version américaine des événements).
Mais il faudra attendre plusieurs longues heures avant que la lumière du jour ne révèle l'horrible vérité, à savoir qu'à un moment donné de la nuit, Jean Bertrand Aristide, ainsi qu'un petit contingent de gardes du corps, avaient été tués. La voiture du Président a été retrouvée arrêtée au milieu de la route et le véhicule, ainsi que le Président, son chauffeur et un garde du corps, tous criblés de balles.

(A gauche) Les rues de Port Au Prince le 1er, (A droite) La voiture d'Aristide en cours d'investigation.
La mort du président était un événement inattendu, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit associée à la nouvelle que les forces rebelles s'étaient emparées du palais présidentiel et du quartier général de la police nationale. Le pays, désormais sans président et envahi par des milices rebelles, risque de sombrer dans le chaos. Le président des États-Unis a annoncé que, pour éviter un nouvel effondrement, une coalition de pays américains assurerait immédiatement la sécurité du pays en vertu d'une résolution de l'ONU (l'opération "Safer tomorrow" a fourni environ 1 000 hommes des États-Unis, du Canada, du Chili et de diverses autres nations d'Amérique du Sud et des Caraïbes). En ce qui concernait le nouveau gouvernement haïtien, les États-Unis et la communauté internationale dans son ensemble, ainsi que les rebelles, ont convenu que, conformément à la constitution haïtienne, le juge de la Cour suprême Boniface Alexander assumerait la présidence, qui, le même jour, a demandé l'envoi d'une force de maintien de la paix de l'ONU.
Malgré les craintes d'une accélération de la violence, l'intervention des États-Unis et le déploiement rapide des troupes ont permis d'éviter une nouvelle dégradation de l'ordre, mais des questions ont continué à se poser. Les partisans d'Aristide ont accusé les États-Unis d'avoir orchestré un coup d'État et d'être responsables de sa mort. Selon leur version des faits, les États-Unis auraient refusé d'accorder leur protection à Aristide sans qu'il ne démissionne et auraient même forcé ses agents de sécurité sous contrat avec les États-Unis à quitter Haïti pour l'inciter à quitter lui aussi le pays. Ils ont également déclaré que l'incapacité du département d'État à soutenir le président légitime avait encouragé les rebelles à attaquer la ville. Certains sont allés plus loin et ont rendu les États-Unis responsables de l'ensemble du soulèvement, en affirmant que les forces paramilitaires et Guy Philippe avaient été entraînés en République dominicaine, prétendument par les forces spéciales américaines, et en insistant sur le fait que les États-Unis avaient exigé qu'Aristide se présente à l'ambassade plutôt qu'à l'aéroport, malgré la distance supplémentaire et le danger d'un tel voyage. Le département d'État a répondu à ces accusations par un démenti explicite : "toutes ces suggestions sont totalement fausses, Aristide a proposé de se rendre à l'ambassade et de démissionner volontairement ... aucune exigence n'a jamais été formulée".
Les démocrates ont exigé une enquête : "Nous essayons d'obtenir des réponses, car il est plutôt désastreux pour notre pays de saper un gouvernement élu ailleurs, même si nous n'aimons pas ce gouvernement, et de donner du pouvoir à des tueurs", a déclaré le sénateur Byron Dorgan (N.D.). Les membres du Congressional Black Caucus, qu'Aristide avait appelés quelques heures avant sa mort, ont fait connaître leur colère : "Je suis convaincue que le récent coup d'État meurtrier n'impliquait pas seulement les barons de la drogue et les voyous armés, mais aussi notre propre gouvernement", a déclaré la députée Maxine Waters (D-Calif.), tandis que le sénateur Chris Dodd (D-Conn.) a déclaré que les États-Unis n'avaient pas protégé le gouvernement haïtien : "Quoi qu'il se soit passé lundi, il est clair que les États-Unis auraient pu éviter sa mort, nous aurions pu empêcher ce renversement". Il a également contesté la thèse du gouvernement selon laquelle l'entêtement d'Aristide l'avait effectivement fait tuer : "Je pense qu'il y a un vrai problème ici : l'administration Bush dit une chose et la réalité est différente". Il était clair que l'administration Bush s'était à nouveau enfoncée dans l'eau chaude à cause de sa politique étrangère.
Espagne.

Mardi 9 mars 2004, 10:08 GMT 11:08 UK
Quatrième explosion à Madrid après l'avertissement de l'ETA

La scène après un attentat à la voiture piégée à Madrid
La police madrilène a procédé à une détonation contrôlée dans un parking adjacent à l'aéroport international de Barajas.
La détonation, qui a endommagé plusieurs véhicules et provoqué une interruption majeure à l'aéroport, s'est produite quelques minutes seulement après qu'un appel prétendant être associé au groupe séparatiste basque ETA a lancé un avertissement selon lequel une explosion était imminente.
Aucun blessé n'a été signalé, mais la zone et la ville dans son ensemble ont été bouclées et d'importantes mesures de police ont été prises, après une série d'attentats à la voiture piégée similaires depuis le début du mois.
Avec cet engin, quatre bombes ont explosé dans la capitale espagnole et l'ETA a promis que d'autres attentats étaient imminents. L'ETA, qui est responsable d'environ 800 morts au cours de sa campagne de 36 ans pour un État basque indépendant, a promis de perpétrer des attentats jusqu'à ce que ses revendications politiques soient satisfaites.
Le nombre important de voitures piégées a fait au moins trois morts et des dizaines de blessés lorsque l'un de ces engins a explosé à l'extérieur d'un restaurant madrilène. Un autre a été trouvé par la police à l'extérieur d'un théâtre et un troisième a explosé dans un wagon de train évacué.
Un certain nombre de suspects ont été arrêtés au cours de la semaine. Cependant, la poursuite des attaques montre que le groupe est toujours capable de mener à bien ces opérations.
L'explosion s'est produite dans un parking à étages vers 08h00 heure locale (06h00GMT).
La structure n'a pas été endommagée et aucun vol n'a été annulé, mais les voyageurs ont été contraints de marcher jusqu'au terminal avec leurs bagages à la main.
La multiplication des attentats a interrompu la vie des Espagnols dans la capitale, la police ayant mis en place des recherches et des points de contrôle dans toute la ville pour tenter de retrouver les auteurs de ces attentats.
Le pays se prépare également à des élections générales la semaine prochaine pour décider qui remplacera le premier ministre José Maria Aznar, qui s'est engagé à poursuivre l'enquête pour trouver les coupables : "Nous traduirons les coupables en justice", a déclaré M. Aznar. "Aucune piste d'enquête ne sera écartée.
Le mois de mars 2004 a été particulièrement sanglant pour l'Espagne. Alors que le pays s'apprêtait à se rendre aux urnes pour décider qui prendrait la relève du premier ministre José María Aznar, du parti populaire conservateur, qui avait exercé deux mandats. Une série d'attentats terroristes a été perpétrée dans la capitale. Une demi-douzaine de bombes ont été trouvées dans une série d'attaques au cours des deux semaines précédant les élections générales du 14 mars, tuant 4 personnes et faisant des dizaines de blessés. Les explosions ont été accompagnées de vidéos récemment diffusées par le groupe séparatiste basque ETA, qui avertissait à l'avance des attaques et en revendiquait la responsabilité, tout en promettant de "poursuivre sa mission contre ceux qui veulent nous nier, par la force des armes". La nature orchestrée des attentats a entraîné une réaction massive de la police à Madrid, qui a balayé la ville et évacué les cibles potentielles, ce qui a permis de retrouver un camion rempli d'une demi-tonne d'explosifs et d'arrêter plusieurs membres de l'ETA qui se préparaient à commettre d'autres attentats à la bombe.
La série d'attaques et d'arrestations a culminé lors des élections du 14 mars 2004. Le parti populaire sortant et son successeur désigné, Mariano Rajoy, conservent les rênes du pouvoir avec une plus grande part des voix (47,1 %) et 12 sièges supplémentaires, ce qui leur confère une majorité plus forte. La part de voix plus importante que prévu des partis populaires a été attribuée à l'approbation par le public de la gestion de la "crise de mars" par le gouvernement. On s'attendait à ce que Rajoy, le nouveau Premier ministre espagnol, se glisse facilement dans les souliers laissés par Azar, un conservateur social convaincu opposé à l'immigration et à l'avortement, ce qui a été perçu comme un virage à droite du gouvernement, Rajoy a promis de nouvelles réductions d'impôts, une répression des activités terroristes et une lutte contre l'immigration illégale[3].

Élections générales espagnoles de 2004 Wiki Box
L'Afghanistan
Le nord de l'Afghanistan est en proie aux flammes. La guerre civile qui fait rage depuis longtemps entre les talibans fondamentalistes et les seigneurs de guerre de l'alliance du nord est entrée dans une nouvelle phase. Suite à la décision de l'administration Bush d'apporter un soutien militaire renouvelé à l'alliance du Nord, y compris par des actions secrètes des forces spéciales, l'alliance du Nord est passée à l'offensive, luttant pour reprendre des territoires dans le nord de l'Afghanistan, renforcer son emprise sur les régions et établir des lignes de ravitaillement sûres vers ses voisins du nord. Grâce au soutien américain et aux frappes aériennes, les forces de Massoud ont pu surpasser les forces talibanes, ce qui a renforcé le moral de son armée et la confiance des chefs de guerre, suffisamment pour mener une offensive majeure lors du siège de Kunduz.
Kunduz était l'un des principaux bastions des talibans dans le nord du pays, et avec lui, ils contrôlaient la principale voie d'approvisionnement vers le Tadjikistan voisin ainsi qu'une partie de l'agriculture la plus vitale du pays. Son importance n'était pas inconnue des talibans, qui avaient placé environ 15 000 combattants dans la ville, déterminés à garder la population sous contrôle et l'alliance du Nord fermement à l'écart.
Les forces de l'alliance du Nord étaient commandées par le général Abdul Rashid Dostum, un seigneur de guerre ouzbek revenu en Afghanistan en 2003 à la suite du renouvellement de l'aide militaire des États-Unis. Dostum a rallié ses forces pour encercler la ville et exiger la reddition des forces talibanes, mais lorsque le mollah Omar, le mystérieux chef des talibans, a ordonné aux forces de se battre jusqu'à la mort, un siège sanglant a commencé, et la ville est devenue un champ de bataille déchiqueté, les forces adverses tirant à la mitrailleuse, à la roquette et à l'artillerie à travers la ville pour tenter de briser les forces ennemies. Pendant des mois, la ville a été réduite à l'état de ruines, sans compter les maladies et les conditions hivernales glaciales dont les civils ont lourdement souffert. Les conseillers américains et Massoud ont imploré Dostum de se retirer, reconnaissant qu'ils subissaient également de lourdes pertes, mais Dostum, connu pour son style de guerre brutal, a refusé. À la fin de l'hiver, l'armée de Dostum a remporté une victoire majeure lorsque plusieurs milliers de combattants talibans se sont rendus à lui. Mais les centaines de combattants étrangers sont restés, conscients que toute reddition pouvait signifier une condamnation à mort.

Le siège de Kunduz
Au bord de la victoire, les États-Unis ont décidé d'envoyer des forces spéciales pour aider Dostum dans sa dernière opération visant à débarrasser la ville des résistants rejoints par le général Daud Daud de l'Alliance du Nord. Après deux semaines de combats intenses, le 23 mars 2004, la ville est tombée sous le contrôle total de l'Alliance du Nord.
Après coup, on s'est rendu compte que Dostum avait pratiquement triplé le nombre de talibans qui contrôlaient la ville, mais le siège a été l'acte le plus meurtrier de la guerre à ce jour, avec des dizaines de milliers de victimes civiles. La prise de Kunduz signifiait que l'alliance nordiste avait clairement la mainmise sur le nord de l'Afghanistan et se préparait rapidement à consolider ses gains dans le nord en s'attaquant au dernier grand bastion nordiste des talibans, Mazar-i-Sharif.
Malheureusement pour les États-Unis, l'analyse des morts et des captifs n'a révélé aucun membre de la liste des personnes les plus recherchées par les Américains, mais il y a eu une surprise parmi les prisonniers, un combattant étranger, un Américain de 23 ans du nom de John Walker Lindh.
Lindh, un enfant du milieu catholique né à Washington, s'était converti à l'islam et s'était rendu en Afghanistan pour rejoindre les talibans. La capture d'un citoyen américain constituait un dilemme pour l'administration. En effet, Lindh n'avait techniquement commis aucun délit aux États-Unis, il s'était associé à divers groupes terroristes pendant son séjour en Afghanistan, mais rien ne prouvait qu'il avait joué un rôle dans la planification ou l'exécution d'un quelconque attentat pendant son séjour[4]. Il n'était pas non plus illégal de se porter volontaire pour combattre au nom d'un tel groupe. Alors qu'il risquait d'être libéré s'il était renvoyé aux États-Unis, Lindh est resté prisonnier de l'Alliance du Nord.

(Gauche) Dostum, chef de guerre afghan (Droite) John Walker Lindh, le taliban américain
Taïwan
Après 55 ans de règne ininterrompu, le Kuomintang a mis fin à sa longue domination sur Taïwan lors des élections dramatiques de 2000. Sa chute a été provoquée par une scission au sein du parti entre le vice-président Lien Chan et le populaire gouverneur de Taïwan (poste aujourd'hui supprimé) James Soong. Cette scission a permis au Parti démocrate progressiste, dirigé par Chen Shui-bian, parti nationaliste de gauche, de détrôner le KMT, bien qu'il n'ait remporté les élections qu'avec un tiers des voix.
Son mandat a été controversé, le DPP ne comptant que peu de personnalités politiques nationales, il a été contraint de travailler avec de nombreux membres du KMT pour constituer son cabinet, y compris son premier ministre. Il a été contraint de modérer sa position sur l'indépendance de Taïwan et s'est engagé à ne pas déclarer l'indépendance de Taïwan tant que la République populaire de Chine n'aurait pas l'intention d'utiliser la force militaire contre Taïwan, Afin d'asseoir sa position post-partisane, il démissionne de la direction du DPP, ce qui renforce sa popularité. Il est également invité aux États-Unis, rompant ainsi un accord tacite entre la RPC et les États-Unis selon lequel aucun dirigeant taïwanais ne doit se rendre à New York ou à Washington.
Mais le gouvernement de Chen s'est rapidement effondré. Le krach boursier asiatique a plongé le pays dans une crise économique, tandis que le corps législatif (contrôlé par le KMT) bloquait ses politiques et que chacun rejetait la responsabilité des problèmes sur l'autre. Il a été pris dans une controverse concernant sa tentative d'annuler la construction d'une centrale nucléaire favorisée par le KMT, ce qui a mis fin à ses relations de travail avec l'opposition, à la démission de son premier ministre et au retour de Chen au sein du DPP. Au cours de son mandat, la popularité du président est passée de 70 % à 25 %.

Le président taïwanais Chen Shui-bian
En préparation de sa campagne de réélection, Chen a commencé à redoubler d'efforts pour faire valoir ses qualités de nationaliste. Il a fait adopter une loi prévoyant un référendum défensif d'urgence si le pays était sous la menace d'une attaque imminente, mais un jour après l'approbation de cette loi, Chen a fait part de son intention d'invoquer le référendum sur la seule question des missiles de la République populaire de Chine. Chen s'est à nouveau envolé pour New York où il a serré la main du secrétaire d'État Colin Powell, ce qui lui a permis d'obtenir 35 % des voix, devant le candidat du KMT, Lien Chan. Nombre de ses détracteurs ont accusé Chen d'avoir tenté d'obtenir l'indépendance de Taïwan par le biais du référendum d'urgence.
Chen a choisi sa vice-présidente Annette Lu pour faire partie de son équipe, un choix controversé en raison de certaines de ses déclarations sur l'indépendance, et qui signifiait qu'elle n'avait pas tenu sa promesse de prendre sa retraite l'année précédente, ce qui allait à l'encontre des souhaits de nombreux membres du parti, y compris ceux qui avaient déjà été nommés pour le poste. Pendant ce temps, le KMT a recomposé son parti fracturé en renommant Lien Chan à la présidence et James Song à la vice-présidence, étant donné que chacun des deux candidats avait recueilli 60 % des voix, il était considéré comme assuré que le KMT reviendrait au pouvoir.
Les partis se sont livrés une lutte féroce et les questions politiques ont été reléguées au second plan derrière les attaques personnelles, le KMT s'étant considérablement rapproché du DPP sur les questions nationalistes, abandonnant l'idée d'un pays et de deux systèmes. Des allégations de corruption, de fraude fiscale, d'évasion fiscale, de transactions illégales et de violences conjugales ont été soulevées et le pays s'est divisé. Des événements ont commencé à favoriser le DPP, notamment un grand rassemblement en l'honneur des victimes de l'ère Chiang-Kai-Shek, ainsi qu'une controverse sur l'établissement par le KMT de bureaux de campagne en Chine continentale, y compris des rencontres avec des fugitifs taïwanais. Ces incidents et d'autres maladresses de campagne ont considérablement réduit le nombre de voix dans les sondages.
Le 19 mars, dernier jour de la campagne, les sondages indiquaient que le KMT conservait une courte avance. Pour les millions de Taïwanais anxieux qui souhaitaient simplement que cette campagne particulièrement toxique prenne fin, il restait encore une surprise de taille. Alors que le président et le vice-président participaient à un rassemblement, se déplaçant dans une rue bondée de partisans, ils se tenaient au sommet d'une jeep décapotable. Des pétards ont été tirés sur la voiture qui passait tandis que les dirigeants saluaient, un événement courant dans la politique taïwanaise, mais quelque chose était clairement différent cette fois-ci, le président s'est effondré, et il était clair que du sang s'infiltrait dans ses vêtements. Des coups de feu ont été tirés et tous deux ont été escortés vers un hôpital. La police sur place a établi que des tireurs potentiellement multiples avaient tiré sur le véhicule du président et la sécurité nationale du pays a été activée.
Le pays tout entier a été plongé dans la crise, des théories ont vu le jour selon lesquelles l'événement avait peut-être été orchestré pour empêcher une invasion chinoise, un coup d'État militaire ou un auto-coup d'État du président afin de retarder les élections ou d'attirer des votes de sympathie[5]. Alors que le président était emmené d'urgence au bloc opératoire, la police a ratissé la zone à la recherche de preuves. La situation est devenue tendue dans toute l'île, des centaines de partisans acharnés se préparant à d'éventuelles violences de la part du camp opposé. Pour dissiper les inquiétudes, le vice-président a lancé un appel au calme et les deux partis ont déclaré qu'ils suspendaient tout événement de la campagne électorale. Des images prises peu après les tirs ont montré la gravité des blessures du président et ont sérieusement ébranlé le gouvernement taïwanais et l'opinion publique. La question de savoir si l'élection pouvait avoir lieu (la loi taïwanaise prévoit la suspension d'une élection en cas de décès d'un candidat) a été rejetée par le gouvernement, bien que la gravité de l'état de santé du président ait empêché quiconque de le rencontrer.
Une nation nerveuse s'est rendue aux urnes, ne sachant pas si l'un des candidats serait physiquement capable d'accéder à la présidence.
La police et l'armée étaient présentes en force pour réprimer d'éventuels troubles, et il était clair que le pays était sous le choc de l'attentat contre le président.Il était midi lorsque l'on a commencé à apprendre que le président était mort.Il avait été blessé par plusieurs balles tirées dans la poitrine et les chirurgiens n'avaient pas pu contenir l'importante hémorragie interne.Le décès du président le jour des élections a constitué une crise électorale.La constitution stipule que "la commission électorale centrale doit immédiatement annoncer la suspension de l'élection" en cas de décès d'un candidat à la présidence, mais cette disposition ne s'applique que si le décès survient "après la date limite d'inscription et avant le jour du scrutin". Selon la commission, l'élection devait être maintenue.
Les votes se sont poursuivis et des milliers de partisans du DPP en colère ont exprimé leurs frustrations, principalement dans les urnes, mais des manifestations occasionnelles devant le siège du KMT ont dû être dispersées par la police. La nouvelle présidente à court terme, Annette Lu, s'est adressée au pays et a lancé un nouvel appel au calme, commémorant Chen et demandant au pays de continuer à voter et que les résultats de l'élection soient maintenus. Le KMT s'est largement abstenu de toute critique et les candidats se sont fait l'écho des sentiments de Lu à l'égard de l'ancien président et de l'élection.

Le président Chen avant les coups de feu de l'assassin, aujourd'hui la présidente Annette Lu
Ce n'est que le dimanche 21 que les pétards ont vraiment explosé, le défunt président Chen Shui-bian ayant été déclaré vainqueur de sa réélection par une marge infime, ce qui signifie que sa candidate à la vice-présidence (et maintenant présidente) Annette Lu accèderait instantanément à la présidence le jour de l'investiture. Le KMT n'est plus resté silencieux et a exigé l'annulation de l'élection, reprenant les allégations douteuses selon lesquelles Lu avait retardé l'annonce du décès du président jusqu'au jour du scrutin pour remporter l'élection.
Le faible écart a été obtenu sous une montagne de soupçons, a déclaré M. Lien à une foule de partisans frustrés. Il s'agit d'une fausse élection. Préparez-vous à annuler l'élection". Des milliers de partisans du KMT sont descendus dans la rue pour protester contre le résultat des élections, affirmant que des centaines de milliers de votes avaient été illégalement invalidés, que l'état d'urgence imposé empêchait des milliers de membres de l'armée et de la police de voter et que de nombreux électeurs du KMT avaient été harcelés. Mais la commission électorale et Lu sont restés fermes sur le fait qu'il n'y avait pas de conspiration et qu'il n'y aurait pas de recomptage des voix. Les troubles se sont multipliés, le KMT faisant pression pour obtenir de nombreuses directives afin de mettre un terme à toutes les questions litigieuses en organisant des sit-in et des rassemblements. Le président a accepté un recomptage complet, mais l'opposition n'était pas satisfaite, invoquant des allégations de fraude et exigeant une enquête approfondie sur la mort de Chen.
La tension a commencé à monter lorsque le président et le KMT n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les conditions du recomptage des voix. Des milliers de manifestants ont suivi les discours de responsables du KMT qui dénonçaient les résultats des élections et ont tenté de pénétrer dans le bureau du président, avant d'être repoussés par la police et les forces militaires.
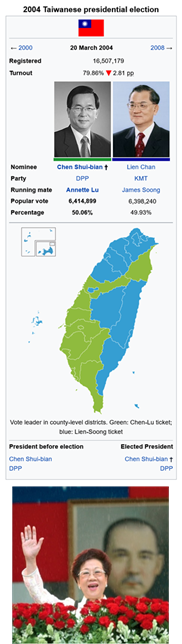
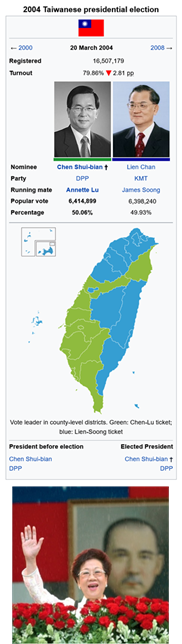
Élection présidentielle taïwanaise de 2004 Wiki Box
[1] La version exacte des événements est controversée entre Aristide et les Etats-Unis, j'ai choisi un mélange des deux versions
[2] Aristide avait des liens étroits avec le caucus noir du Congrès
[3] La gestion par le gouvernement de l'attentat à la bombe contre le train de Madrid a été un désastre politique et constitue l'un des seuls exemples que je puisse trouver d'une nation rejetant son leadership après une tragédie majeure.
[4] Sans PATRIOT Act, être membre d’une organisation terroriste à lui seul n’est pas un crime
[5] C’est la conspiration majeure de la politique taïwanaise, mais je la trouve un peu ridicule.
Le point sur les élections américaines dans la partie 2...
Haïti
Parallèlement à la course à l'investiture du parti démocrate, un deuxième événement majeur s'est produit dans le demi-frère révolutionnaire de l'Amérique, la nation caribéenne d'Haïti. En Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide, prêtre né dans un bidonville et premier dirigeant démocratiquement élu du pays, connaissait une période difficile. Peu après sa victoire électorale en 1991, il a été renversé par un coup d'État militaire, mais lorsque l'administration de George H. W. Bush a pris fin et que Bill Clinton a pris le relais, les États-Unis ont insisté sur le retour d'Aristide et sur la fin de la junte haïtienne ; à la suite de négociations, la junte a obtempéré et les troupes américaines ont été déployées dans le cadre d'une opération de "maintien de la démocratie" et Aristide est rentré d'exil. Il a créé un nouveau parti politique et s'est renforcé à l'approche des élections de 2000. Aristide s'est fait de nombreux ennemis qui l'ont accusé de manipulation électorale et, lors de l'élection présidentielle, ils ont choisi de boycotter la procédure, ce qui a permis à Aristide de remporter l'élection avec 90 % des voix (bien que de nombreux observateurs aient noté que le taux de participation était suffisamment élevé pour qu'Aristide ait pu l'emporter de toute façon). Après son retour à la présidence, Aristide a gouverné Haïti d'une manière qui en a inquiété plus d'un.
Il était un réformateur radical et il a exigé que la France rembourse à Haïti les milliards qu'elle avait versés pour son indépendance. Dans un pays dépendant des dons internationaux et bien que son gouvernement se soit engagé à aider les pauvres, ses méthodes sont devenues de plus en plus erratiques et autoritaires, pour faire appliquer ses lois des milices ont été organisées, la police a été réformée avec des pouvoirs étendus pour réprimer les protestations alors que la corruption continuait à prospérer dans le pays. Pire encore, malgré la grande vision d'Aristide, l'économie d'Haïti ne s'est pas redressée et le pays est resté la nation la plus pauvre des Amériques. Le pays était considéré dans le monde entier comme un État dépendant des dons internationaux et la suspension de l'aide américaine par l'administration Bush lui a été très préjudiciable. Son comportement erratique a persisté et ses discours sont devenus plus brutaux, encourageant les actes violents contre les ennemis politiques, et certains de ses partisans ont fait de même.
En janvier 2004, le pays a commencé à célébrer le 200e anniversaire de son indépendance. Au même moment, l'ancienne armée transformée en groupes paramilitaires a commencé à mener une insurrection organisée, sous le nom de Front révolutionnaire national pour la libération et la reconstruction d'Haïti. La direction des insurgés était composée d'anciens militaires, de trafiquants de drogue, d'escadrons de la mort de la junte et de dissidents, tous liés par leur opposition à Aristide. En même temps que l'opposition politique se coalisait, un groupe de chefs d'entreprise, de médecins, d'intellectuels, d'étudiants et d'agriculteurs a commencé à réclamer la démission d'Aristide et les fréquents affrontements entre eux et ses partisans se sont soldés par des violences et parfois par des morts. En quelques semaines, l'insurrection a commencé à s'emparer des campagnes et à attaquer les postes de police. La violence s'est intensifiée dans les villes : à Port-au-Prince, des milices armées ont tiré sur des milliers d'étudiants et beaucoup ont reproché à Aristide d'avoir empêché la police d'enquêter sur ces crimes. Peu après, les forces d'opposition ont pris le contrôle des Gonaïves, la quatrième ville d'Haïti, et l'ont pillée pour y trouver des armes et des véhicules. Le gouvernement a réagi en dressant des barricades dans la capitale, l'état d'urgence a été instauré et de nombreux Haïtiens ont commencé à fuir le pays en prévision d'une nouvelle flambée de violence.
(Gauche) Président Jean Aristide, (Droite) Rebelles haïtiens
La situation s'est rapidement détériorée et le monde l'a remarqué. Au cours du mois de février, les forces rebelles ont progressé sur la côte, prenant le contrôle du pays avec peu d'opposition formelle (Aristide avait aboli l'armée). Le monde entier s'est divisé sur la réponse à apporter et l'administration Bush a présenté différentes options. Le secrétaire d'État Powell a d'abord mis en garde contre l'éviction d'Aristide par les rebelles, avant de faire marche arrière quelques jours plus tard et de rendre Aristide partiellement responsable de la violence : "Une grande partie de la violence à laquelle nous assistons aujourd'hui est le fait des gangs qui étaient autrefois alignés sur le gouvernement d'Aristide". a déclaré un porte-parole du département d'État, suggérant que la démission d'Aristide pourrait être une solution appropriée. Certains ont exhorté le président à agir. "Si nous sommes capables d'envoyer des forces militaires au Libéria - à 3.000 miles de là - nous pouvons certainement agir pour protéger nos intérêts dans notre propre jardin", a indiqué le sénateur Bob Graham. L'inaction ne peut plus être notre politique", a déclaré le sénateur Bob Graham, "en agissant ainsi, nous ferons en sorte qu'Haïti soit gouverné par des voyous et des criminels". D'autres démocrates se sont attaqués à la mauvaise communication de la Maison Blanche, qualifiant sa réponse de "tergiversation" ou de "manque d'intérêt". Le candidat à la présidence et militant des droits civiques Al Sharpton a déclaré qu'il se rendrait personnellement en Haïti, et Al Gore et John Edwards ont accusé le président d'ignorer Haïti, voire de donner du pouvoir aux rebelles, par des déclarations suggérant la démission d'Aristide.
Alors que les rebelles se rapprochaient de la capitale et que la menace d'un bain de sang augmentait, des négociateurs internationaux, dont les États-Unis et divers États des Caraïbes, sont intervenus dans l'espoir de négocier des pourparlers entre les deux forces. L'administration Bush a présenté une proposition qu'Aristide a acceptée, visant à réduire le pouvoir du président tout en permettant à Aristide d'aller jusqu'au bout de son mandat. Mais les dirigeants de l'opposition haïtienne ont rejeté ces ouvertures. "Il n'y aura plus de retard ; notre réponse reste la même", a déclaré à l'Associated Press Maurice LaFortune, président de la Chambre de commerce haïtienne et l'un des principaux dirigeants de l'opposition. Aristide doit démissionner. Alors que les jours s'égrenaient, que les bandes rebelles avançaient ville après ville, prenant le contrôle du nord, l'effondrement du plan de paix apparaissait pour beaucoup comme le coup de grâce à son règne. Il n'avait que peu de forces à appeler à se battre pour lui, et les villes faisaient défection sans se battre, tandis qu'Aristide restait défiant, prononçant un discours en l'honneur des policiers qui avaient été tués lors du soulèvement : "Je suis prêt à donner ma vie si c'est ce qu'il faut pour défendre mon pays". Cette issue est de plus en plus proche, si les États-Unis ne souhaitaient pas le protéger et si les rebelles mettaient à exécution leurs menaces de plus en plus explicites.
Il a toutefois continué à affirmer qu'il n'était pas question de démissionner et a qualifié ces propositions de "rumeurs infondées". Des milliers de partisans armés parcouraient la ville, seul espoir pour le président de repousser les rebelles, et Haïti se préparait à une bataille.
Le 29 février, les événements se précipitent. Guy Philip, le chef des rebelles, a lancé un ultimatum : "Nous allons simplement prendre nos positions et attendre le bon moment [pour attaquer]", a déclaré M. Philippe, un ancien officier de l'armée haïtienne démantelée : "S'il n'y a pas de démission, alors nous attaquerons". En l'absence d'accord avec les rebelles, le gouvernement américain a supposé que le seul moyen pacifique de mettre fin à la situation en Haïti était le départ d'Aristide du pays. Il lui a donc proposé de démissionner en échange de son évacuation et de celle de sa famille en toute sécurité, l'avertissant que les forces rebelles marcheraient sur la ville et que des milliers de vies, dont la sienne, étaient en danger s'il ne quittait pas le pays. Aristide a été à la fois choqué et indigné, demandant l'aide des Américains tout en les accusant de se ranger du côté de ses ennemis[1] Il a tenté de répondre aux appels téléphoniques de ses alliés qui lui ont déconseillé de fuir le pays car cela conduirait à la victoire des rebelles et aux représailles massives qui s'ensuivraient, et l'ont mis en garde contre l'offre des Américains en la qualifiant de "coup d'État organisé par Washington" Il a absolument rejeté toute demande de démission ou d'exil et a appelé plusieurs agences de presse et hommes politiques américains[2] pour dire qu'il avait rejeté l'offre.
Le lundi 1er mars, des centaines de rebelles sont entrés dans la capitale, Port-au-Prince, et des affrontements armés ont été signalés à la périphérie entre les forces rebelles et les loyalistes d'Aristides. Les rues ont été envahies, tandis que le bruit des tirs se rapprochant de plus en plus du centre de la ville résonnait. Les rebelles, bien équipés et expérimentés, ont apparemment fait un travail rapide contre les milices d'Aristide et la police de la ville n'a été d'aucune aide pour le gouvernement, la plupart ayant fait défection à l'opposition ou étant restés chez eux. Guy Philippe a réitéré ses demandes de démission du président sous peine d'arrestation et, à la fin de la journée, il était clair que les rebelles seraient bientôt maîtres de la ville, encerclant déjà l'aéroport Toussaint Louverture (un moyen clé de fuite pour Aristide et sécurisé par un détachement d'urgence de marines américains). Sûr de lui, Guy Philippe a appelé les agences de presse internationales et s'est déclaré nouveau chef de la police de Port-au-Prince, offrant à Aristide une dernière chance de démissionner avant que ses forces ne prennent le palais présidentiel par la force. En retour, le silence règne, Aristide ne fit aucune proclamation publique, il avait fui le palais avec l'intention de se rendre à l'ambassade américaine où le président en difficulté avait soi-disant l'intention de présenter sa démission et de faire appel à la protection américaine (c'est la version américaine des événements).
Mais il faudra attendre plusieurs longues heures avant que la lumière du jour ne révèle l'horrible vérité, à savoir qu'à un moment donné de la nuit, Jean Bertrand Aristide, ainsi qu'un petit contingent de gardes du corps, avaient été tués. La voiture du Président a été retrouvée arrêtée au milieu de la route et le véhicule, ainsi que le Président, son chauffeur et un garde du corps, tous criblés de balles.
(A gauche) Les rues de Port Au Prince le 1er, (A droite) La voiture d'Aristide en cours d'investigation.
La mort du président était un événement inattendu, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit associée à la nouvelle que les forces rebelles s'étaient emparées du palais présidentiel et du quartier général de la police nationale. Le pays, désormais sans président et envahi par des milices rebelles, risque de sombrer dans le chaos. Le président des États-Unis a annoncé que, pour éviter un nouvel effondrement, une coalition de pays américains assurerait immédiatement la sécurité du pays en vertu d'une résolution de l'ONU (l'opération "Safer tomorrow" a fourni environ 1 000 hommes des États-Unis, du Canada, du Chili et de diverses autres nations d'Amérique du Sud et des Caraïbes). En ce qui concernait le nouveau gouvernement haïtien, les États-Unis et la communauté internationale dans son ensemble, ainsi que les rebelles, ont convenu que, conformément à la constitution haïtienne, le juge de la Cour suprême Boniface Alexander assumerait la présidence, qui, le même jour, a demandé l'envoi d'une force de maintien de la paix de l'ONU.
Malgré les craintes d'une accélération de la violence, l'intervention des États-Unis et le déploiement rapide des troupes ont permis d'éviter une nouvelle dégradation de l'ordre, mais des questions ont continué à se poser. Les partisans d'Aristide ont accusé les États-Unis d'avoir orchestré un coup d'État et d'être responsables de sa mort. Selon leur version des faits, les États-Unis auraient refusé d'accorder leur protection à Aristide sans qu'il ne démissionne et auraient même forcé ses agents de sécurité sous contrat avec les États-Unis à quitter Haïti pour l'inciter à quitter lui aussi le pays. Ils ont également déclaré que l'incapacité du département d'État à soutenir le président légitime avait encouragé les rebelles à attaquer la ville. Certains sont allés plus loin et ont rendu les États-Unis responsables de l'ensemble du soulèvement, en affirmant que les forces paramilitaires et Guy Philippe avaient été entraînés en République dominicaine, prétendument par les forces spéciales américaines, et en insistant sur le fait que les États-Unis avaient exigé qu'Aristide se présente à l'ambassade plutôt qu'à l'aéroport, malgré la distance supplémentaire et le danger d'un tel voyage. Le département d'État a répondu à ces accusations par un démenti explicite : "toutes ces suggestions sont totalement fausses, Aristide a proposé de se rendre à l'ambassade et de démissionner volontairement ... aucune exigence n'a jamais été formulée".
Les démocrates ont exigé une enquête : "Nous essayons d'obtenir des réponses, car il est plutôt désastreux pour notre pays de saper un gouvernement élu ailleurs, même si nous n'aimons pas ce gouvernement, et de donner du pouvoir à des tueurs", a déclaré le sénateur Byron Dorgan (N.D.). Les membres du Congressional Black Caucus, qu'Aristide avait appelés quelques heures avant sa mort, ont fait connaître leur colère : "Je suis convaincue que le récent coup d'État meurtrier n'impliquait pas seulement les barons de la drogue et les voyous armés, mais aussi notre propre gouvernement", a déclaré la députée Maxine Waters (D-Calif.), tandis que le sénateur Chris Dodd (D-Conn.) a déclaré que les États-Unis n'avaient pas protégé le gouvernement haïtien : "Quoi qu'il se soit passé lundi, il est clair que les États-Unis auraient pu éviter sa mort, nous aurions pu empêcher ce renversement". Il a également contesté la thèse du gouvernement selon laquelle l'entêtement d'Aristide l'avait effectivement fait tuer : "Je pense qu'il y a un vrai problème ici : l'administration Bush dit une chose et la réalité est différente". Il était clair que l'administration Bush s'était à nouveau enfoncée dans l'eau chaude à cause de sa politique étrangère.
Espagne.
Mardi 9 mars 2004, 10:08 GMT 11:08 UK
Quatrième explosion à Madrid après l'avertissement de l'ETA
La scène après un attentat à la voiture piégée à Madrid
La police madrilène a procédé à une détonation contrôlée dans un parking adjacent à l'aéroport international de Barajas.
La détonation, qui a endommagé plusieurs véhicules et provoqué une interruption majeure à l'aéroport, s'est produite quelques minutes seulement après qu'un appel prétendant être associé au groupe séparatiste basque ETA a lancé un avertissement selon lequel une explosion était imminente.
Aucun blessé n'a été signalé, mais la zone et la ville dans son ensemble ont été bouclées et d'importantes mesures de police ont été prises, après une série d'attentats à la voiture piégée similaires depuis le début du mois.
Avec cet engin, quatre bombes ont explosé dans la capitale espagnole et l'ETA a promis que d'autres attentats étaient imminents. L'ETA, qui est responsable d'environ 800 morts au cours de sa campagne de 36 ans pour un État basque indépendant, a promis de perpétrer des attentats jusqu'à ce que ses revendications politiques soient satisfaites.
Le nombre important de voitures piégées a fait au moins trois morts et des dizaines de blessés lorsque l'un de ces engins a explosé à l'extérieur d'un restaurant madrilène. Un autre a été trouvé par la police à l'extérieur d'un théâtre et un troisième a explosé dans un wagon de train évacué.
Un certain nombre de suspects ont été arrêtés au cours de la semaine. Cependant, la poursuite des attaques montre que le groupe est toujours capable de mener à bien ces opérations.
L'explosion s'est produite dans un parking à étages vers 08h00 heure locale (06h00GMT).
La structure n'a pas été endommagée et aucun vol n'a été annulé, mais les voyageurs ont été contraints de marcher jusqu'au terminal avec leurs bagages à la main.
La multiplication des attentats a interrompu la vie des Espagnols dans la capitale, la police ayant mis en place des recherches et des points de contrôle dans toute la ville pour tenter de retrouver les auteurs de ces attentats.
Le pays se prépare également à des élections générales la semaine prochaine pour décider qui remplacera le premier ministre José Maria Aznar, qui s'est engagé à poursuivre l'enquête pour trouver les coupables : "Nous traduirons les coupables en justice", a déclaré M. Aznar. "Aucune piste d'enquête ne sera écartée.
Le mois de mars 2004 a été particulièrement sanglant pour l'Espagne. Alors que le pays s'apprêtait à se rendre aux urnes pour décider qui prendrait la relève du premier ministre José María Aznar, du parti populaire conservateur, qui avait exercé deux mandats. Une série d'attentats terroristes a été perpétrée dans la capitale. Une demi-douzaine de bombes ont été trouvées dans une série d'attaques au cours des deux semaines précédant les élections générales du 14 mars, tuant 4 personnes et faisant des dizaines de blessés. Les explosions ont été accompagnées de vidéos récemment diffusées par le groupe séparatiste basque ETA, qui avertissait à l'avance des attaques et en revendiquait la responsabilité, tout en promettant de "poursuivre sa mission contre ceux qui veulent nous nier, par la force des armes". La nature orchestrée des attentats a entraîné une réaction massive de la police à Madrid, qui a balayé la ville et évacué les cibles potentielles, ce qui a permis de retrouver un camion rempli d'une demi-tonne d'explosifs et d'arrêter plusieurs membres de l'ETA qui se préparaient à commettre d'autres attentats à la bombe.
La série d'attaques et d'arrestations a culminé lors des élections du 14 mars 2004. Le parti populaire sortant et son successeur désigné, Mariano Rajoy, conservent les rênes du pouvoir avec une plus grande part des voix (47,1 %) et 12 sièges supplémentaires, ce qui leur confère une majorité plus forte. La part de voix plus importante que prévu des partis populaires a été attribuée à l'approbation par le public de la gestion de la "crise de mars" par le gouvernement. On s'attendait à ce que Rajoy, le nouveau Premier ministre espagnol, se glisse facilement dans les souliers laissés par Azar, un conservateur social convaincu opposé à l'immigration et à l'avortement, ce qui a été perçu comme un virage à droite du gouvernement, Rajoy a promis de nouvelles réductions d'impôts, une répression des activités terroristes et une lutte contre l'immigration illégale[3].
Élections générales espagnoles de 2004 Wiki Box
L'Afghanistan
Le nord de l'Afghanistan est en proie aux flammes. La guerre civile qui fait rage depuis longtemps entre les talibans fondamentalistes et les seigneurs de guerre de l'alliance du nord est entrée dans une nouvelle phase. Suite à la décision de l'administration Bush d'apporter un soutien militaire renouvelé à l'alliance du Nord, y compris par des actions secrètes des forces spéciales, l'alliance du Nord est passée à l'offensive, luttant pour reprendre des territoires dans le nord de l'Afghanistan, renforcer son emprise sur les régions et établir des lignes de ravitaillement sûres vers ses voisins du nord. Grâce au soutien américain et aux frappes aériennes, les forces de Massoud ont pu surpasser les forces talibanes, ce qui a renforcé le moral de son armée et la confiance des chefs de guerre, suffisamment pour mener une offensive majeure lors du siège de Kunduz.
Kunduz était l'un des principaux bastions des talibans dans le nord du pays, et avec lui, ils contrôlaient la principale voie d'approvisionnement vers le Tadjikistan voisin ainsi qu'une partie de l'agriculture la plus vitale du pays. Son importance n'était pas inconnue des talibans, qui avaient placé environ 15 000 combattants dans la ville, déterminés à garder la population sous contrôle et l'alliance du Nord fermement à l'écart.
Les forces de l'alliance du Nord étaient commandées par le général Abdul Rashid Dostum, un seigneur de guerre ouzbek revenu en Afghanistan en 2003 à la suite du renouvellement de l'aide militaire des États-Unis. Dostum a rallié ses forces pour encercler la ville et exiger la reddition des forces talibanes, mais lorsque le mollah Omar, le mystérieux chef des talibans, a ordonné aux forces de se battre jusqu'à la mort, un siège sanglant a commencé, et la ville est devenue un champ de bataille déchiqueté, les forces adverses tirant à la mitrailleuse, à la roquette et à l'artillerie à travers la ville pour tenter de briser les forces ennemies. Pendant des mois, la ville a été réduite à l'état de ruines, sans compter les maladies et les conditions hivernales glaciales dont les civils ont lourdement souffert. Les conseillers américains et Massoud ont imploré Dostum de se retirer, reconnaissant qu'ils subissaient également de lourdes pertes, mais Dostum, connu pour son style de guerre brutal, a refusé. À la fin de l'hiver, l'armée de Dostum a remporté une victoire majeure lorsque plusieurs milliers de combattants talibans se sont rendus à lui. Mais les centaines de combattants étrangers sont restés, conscients que toute reddition pouvait signifier une condamnation à mort.
Le siège de Kunduz
Au bord de la victoire, les États-Unis ont décidé d'envoyer des forces spéciales pour aider Dostum dans sa dernière opération visant à débarrasser la ville des résistants rejoints par le général Daud Daud de l'Alliance du Nord. Après deux semaines de combats intenses, le 23 mars 2004, la ville est tombée sous le contrôle total de l'Alliance du Nord.
Après coup, on s'est rendu compte que Dostum avait pratiquement triplé le nombre de talibans qui contrôlaient la ville, mais le siège a été l'acte le plus meurtrier de la guerre à ce jour, avec des dizaines de milliers de victimes civiles. La prise de Kunduz signifiait que l'alliance nordiste avait clairement la mainmise sur le nord de l'Afghanistan et se préparait rapidement à consolider ses gains dans le nord en s'attaquant au dernier grand bastion nordiste des talibans, Mazar-i-Sharif.
Malheureusement pour les États-Unis, l'analyse des morts et des captifs n'a révélé aucun membre de la liste des personnes les plus recherchées par les Américains, mais il y a eu une surprise parmi les prisonniers, un combattant étranger, un Américain de 23 ans du nom de John Walker Lindh.
Lindh, un enfant du milieu catholique né à Washington, s'était converti à l'islam et s'était rendu en Afghanistan pour rejoindre les talibans. La capture d'un citoyen américain constituait un dilemme pour l'administration. En effet, Lindh n'avait techniquement commis aucun délit aux États-Unis, il s'était associé à divers groupes terroristes pendant son séjour en Afghanistan, mais rien ne prouvait qu'il avait joué un rôle dans la planification ou l'exécution d'un quelconque attentat pendant son séjour[4]. Il n'était pas non plus illégal de se porter volontaire pour combattre au nom d'un tel groupe. Alors qu'il risquait d'être libéré s'il était renvoyé aux États-Unis, Lindh est resté prisonnier de l'Alliance du Nord.
(Gauche) Dostum, chef de guerre afghan (Droite) John Walker Lindh, le taliban américain
Taïwan
Après 55 ans de règne ininterrompu, le Kuomintang a mis fin à sa longue domination sur Taïwan lors des élections dramatiques de 2000. Sa chute a été provoquée par une scission au sein du parti entre le vice-président Lien Chan et le populaire gouverneur de Taïwan (poste aujourd'hui supprimé) James Soong. Cette scission a permis au Parti démocrate progressiste, dirigé par Chen Shui-bian, parti nationaliste de gauche, de détrôner le KMT, bien qu'il n'ait remporté les élections qu'avec un tiers des voix.
Son mandat a été controversé, le DPP ne comptant que peu de personnalités politiques nationales, il a été contraint de travailler avec de nombreux membres du KMT pour constituer son cabinet, y compris son premier ministre. Il a été contraint de modérer sa position sur l'indépendance de Taïwan et s'est engagé à ne pas déclarer l'indépendance de Taïwan tant que la République populaire de Chine n'aurait pas l'intention d'utiliser la force militaire contre Taïwan, Afin d'asseoir sa position post-partisane, il démissionne de la direction du DPP, ce qui renforce sa popularité. Il est également invité aux États-Unis, rompant ainsi un accord tacite entre la RPC et les États-Unis selon lequel aucun dirigeant taïwanais ne doit se rendre à New York ou à Washington.
Mais le gouvernement de Chen s'est rapidement effondré. Le krach boursier asiatique a plongé le pays dans une crise économique, tandis que le corps législatif (contrôlé par le KMT) bloquait ses politiques et que chacun rejetait la responsabilité des problèmes sur l'autre. Il a été pris dans une controverse concernant sa tentative d'annuler la construction d'une centrale nucléaire favorisée par le KMT, ce qui a mis fin à ses relations de travail avec l'opposition, à la démission de son premier ministre et au retour de Chen au sein du DPP. Au cours de son mandat, la popularité du président est passée de 70 % à 25 %.
Le président taïwanais Chen Shui-bian
En préparation de sa campagne de réélection, Chen a commencé à redoubler d'efforts pour faire valoir ses qualités de nationaliste. Il a fait adopter une loi prévoyant un référendum défensif d'urgence si le pays était sous la menace d'une attaque imminente, mais un jour après l'approbation de cette loi, Chen a fait part de son intention d'invoquer le référendum sur la seule question des missiles de la République populaire de Chine. Chen s'est à nouveau envolé pour New York où il a serré la main du secrétaire d'État Colin Powell, ce qui lui a permis d'obtenir 35 % des voix, devant le candidat du KMT, Lien Chan. Nombre de ses détracteurs ont accusé Chen d'avoir tenté d'obtenir l'indépendance de Taïwan par le biais du référendum d'urgence.
Chen a choisi sa vice-présidente Annette Lu pour faire partie de son équipe, un choix controversé en raison de certaines de ses déclarations sur l'indépendance, et qui signifiait qu'elle n'avait pas tenu sa promesse de prendre sa retraite l'année précédente, ce qui allait à l'encontre des souhaits de nombreux membres du parti, y compris ceux qui avaient déjà été nommés pour le poste. Pendant ce temps, le KMT a recomposé son parti fracturé en renommant Lien Chan à la présidence et James Song à la vice-présidence, étant donné que chacun des deux candidats avait recueilli 60 % des voix, il était considéré comme assuré que le KMT reviendrait au pouvoir.
Les partis se sont livrés une lutte féroce et les questions politiques ont été reléguées au second plan derrière les attaques personnelles, le KMT s'étant considérablement rapproché du DPP sur les questions nationalistes, abandonnant l'idée d'un pays et de deux systèmes. Des allégations de corruption, de fraude fiscale, d'évasion fiscale, de transactions illégales et de violences conjugales ont été soulevées et le pays s'est divisé. Des événements ont commencé à favoriser le DPP, notamment un grand rassemblement en l'honneur des victimes de l'ère Chiang-Kai-Shek, ainsi qu'une controverse sur l'établissement par le KMT de bureaux de campagne en Chine continentale, y compris des rencontres avec des fugitifs taïwanais. Ces incidents et d'autres maladresses de campagne ont considérablement réduit le nombre de voix dans les sondages.
Le 19 mars, dernier jour de la campagne, les sondages indiquaient que le KMT conservait une courte avance. Pour les millions de Taïwanais anxieux qui souhaitaient simplement que cette campagne particulièrement toxique prenne fin, il restait encore une surprise de taille. Alors que le président et le vice-président participaient à un rassemblement, se déplaçant dans une rue bondée de partisans, ils se tenaient au sommet d'une jeep décapotable. Des pétards ont été tirés sur la voiture qui passait tandis que les dirigeants saluaient, un événement courant dans la politique taïwanaise, mais quelque chose était clairement différent cette fois-ci, le président s'est effondré, et il était clair que du sang s'infiltrait dans ses vêtements. Des coups de feu ont été tirés et tous deux ont été escortés vers un hôpital. La police sur place a établi que des tireurs potentiellement multiples avaient tiré sur le véhicule du président et la sécurité nationale du pays a été activée.
Le pays tout entier a été plongé dans la crise, des théories ont vu le jour selon lesquelles l'événement avait peut-être été orchestré pour empêcher une invasion chinoise, un coup d'État militaire ou un auto-coup d'État du président afin de retarder les élections ou d'attirer des votes de sympathie[5]. Alors que le président était emmené d'urgence au bloc opératoire, la police a ratissé la zone à la recherche de preuves. La situation est devenue tendue dans toute l'île, des centaines de partisans acharnés se préparant à d'éventuelles violences de la part du camp opposé. Pour dissiper les inquiétudes, le vice-président a lancé un appel au calme et les deux partis ont déclaré qu'ils suspendaient tout événement de la campagne électorale. Des images prises peu après les tirs ont montré la gravité des blessures du président et ont sérieusement ébranlé le gouvernement taïwanais et l'opinion publique. La question de savoir si l'élection pouvait avoir lieu (la loi taïwanaise prévoit la suspension d'une élection en cas de décès d'un candidat) a été rejetée par le gouvernement, bien que la gravité de l'état de santé du président ait empêché quiconque de le rencontrer.
Une nation nerveuse s'est rendue aux urnes, ne sachant pas si l'un des candidats serait physiquement capable d'accéder à la présidence.
La police et l'armée étaient présentes en force pour réprimer d'éventuels troubles, et il était clair que le pays était sous le choc de l'attentat contre le président.Il était midi lorsque l'on a commencé à apprendre que le président était mort.Il avait été blessé par plusieurs balles tirées dans la poitrine et les chirurgiens n'avaient pas pu contenir l'importante hémorragie interne.Le décès du président le jour des élections a constitué une crise électorale.La constitution stipule que "la commission électorale centrale doit immédiatement annoncer la suspension de l'élection" en cas de décès d'un candidat à la présidence, mais cette disposition ne s'applique que si le décès survient "après la date limite d'inscription et avant le jour du scrutin". Selon la commission, l'élection devait être maintenue.
Les votes se sont poursuivis et des milliers de partisans du DPP en colère ont exprimé leurs frustrations, principalement dans les urnes, mais des manifestations occasionnelles devant le siège du KMT ont dû être dispersées par la police. La nouvelle présidente à court terme, Annette Lu, s'est adressée au pays et a lancé un nouvel appel au calme, commémorant Chen et demandant au pays de continuer à voter et que les résultats de l'élection soient maintenus. Le KMT s'est largement abstenu de toute critique et les candidats se sont fait l'écho des sentiments de Lu à l'égard de l'ancien président et de l'élection.
Le président Chen avant les coups de feu de l'assassin, aujourd'hui la présidente Annette Lu
Ce n'est que le dimanche 21 que les pétards ont vraiment explosé, le défunt président Chen Shui-bian ayant été déclaré vainqueur de sa réélection par une marge infime, ce qui signifie que sa candidate à la vice-présidence (et maintenant présidente) Annette Lu accèderait instantanément à la présidence le jour de l'investiture. Le KMT n'est plus resté silencieux et a exigé l'annulation de l'élection, reprenant les allégations douteuses selon lesquelles Lu avait retardé l'annonce du décès du président jusqu'au jour du scrutin pour remporter l'élection.
Le faible écart a été obtenu sous une montagne de soupçons, a déclaré M. Lien à une foule de partisans frustrés. Il s'agit d'une fausse élection. Préparez-vous à annuler l'élection". Des milliers de partisans du KMT sont descendus dans la rue pour protester contre le résultat des élections, affirmant que des centaines de milliers de votes avaient été illégalement invalidés, que l'état d'urgence imposé empêchait des milliers de membres de l'armée et de la police de voter et que de nombreux électeurs du KMT avaient été harcelés. Mais la commission électorale et Lu sont restés fermes sur le fait qu'il n'y avait pas de conspiration et qu'il n'y aurait pas de recomptage des voix. Les troubles se sont multipliés, le KMT faisant pression pour obtenir de nombreuses directives afin de mettre un terme à toutes les questions litigieuses en organisant des sit-in et des rassemblements. Le président a accepté un recomptage complet, mais l'opposition n'était pas satisfaite, invoquant des allégations de fraude et exigeant une enquête approfondie sur la mort de Chen.
La tension a commencé à monter lorsque le président et le KMT n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les conditions du recomptage des voix. Des milliers de manifestants ont suivi les discours de responsables du KMT qui dénonçaient les résultats des élections et ont tenté de pénétrer dans le bureau du président, avant d'être repoussés par la police et les forces militaires.
Élection présidentielle taïwanaise de 2004 Wiki Box
[1] La version exacte des événements est controversée entre Aristide et les Etats-Unis, j'ai choisi un mélange des deux versions
[2] Aristide avait des liens étroits avec le caucus noir du Congrès
[3] La gestion par le gouvernement de l'attentat à la bombe contre le train de Madrid a été un désastre politique et constitue l'un des seuls exemples que je puisse trouver d'une nation rejetant son leadership après une tragédie majeure.
[4] Sans PATRIOT Act, être membre d’une organisation terroriste à lui seul n’est pas un crime
[5] C’est la conspiration majeure de la politique taïwanaise, mais je la trouve un peu ridicule.
Le point sur les élections américaines dans la partie 2...

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 34: des balles et des bulletins de vote partie 2 (la nomination démocrate).
Le 2 mars sera la plus grande journée de primaires du calendrier, 10 états organisant leurs primaires et caucus, et en une nuit plus d'un quart des délégués disponibles seront décidés et répartis entre les deux derniers candidats sérieux, l'ancien vice-président Al Gore et le sénateur John Edwards, si l'un des candidats arrivait à devancer l'autre de manière significative, cela marquerait plus que probablement la fin de la compétition et déciderait du vainqueur de l'investiture démocrate.
Il y avait de nombreux prix à gagner lors de cette soirée, notamment la Californie et New York, les deux États les plus peuplés de l'Union, l'ensemble du pays était représenté avec la région de la Nouvelle-Angleterre bien représentée, notamment le Massachusetts, le Vermont et le Rhode Island. Le Midwest était également présent avec l'Ohio et le Minnesota, et le Sud n'était pas en reste avec la Géorgie et le mélange de banlieusards blancs de Washington et d'Afro-Américains de Baltimore qui composaient le Maryland. Le concours a garanti que la nation aurait la possibilité de décider de sa préférence.
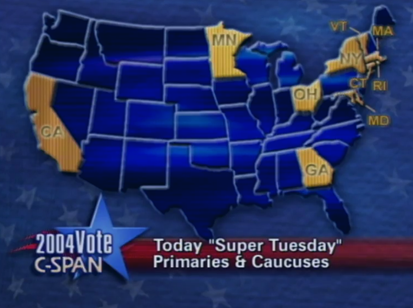
Couverture par C-Span du "Super Tuesday"
Il n'y avait pas de leader incontestable dans la course, et les sondages oscillaient d'un côté comme de l'autre en ce qui concernait les intentions du parti démocrate. Il est certain que les deux candidats se battaient pour chaque voix, sans être rassurés par leur avance dans chaque État respectif. Si l'on regarde la carte, Gore avait un avantage en Californie et à New York - les "big enchiladas", comme l'ont dit les experts - où l'électorat et les tendances penchaient en sa faveur. Mais la dynamique de Edwards a été clairement ressentie par de nombreux démocrates qui sont restés à l'écart du jeu des soutiens, pour ne pas perdre de chances. Gore a néanmoins obtenu des soutiens importants de la part de la sénatrice californienne Dianne Feinstein et de l'épouse sénatoriale de son ex-employeur Hilary Clinton, celle-ci ayant mis de côté l'apparente animosité entre les deux et l'ayant qualifié de "meilleur conseiller, ami et même président que vous puissiez demander". Mais M. Edwards a continué à étonner en recevant le soutien surprise du comité éditorial du plus grand journal du pays, le New York Times, qui l'a décrit comme ayant "une énorme discipline [établissant] une connexion directe et authentiquement émotionnelle avec des personnes de tous horizons, qui est facile à imaginer à la Maison Blanche".
Le journal a certes fait l'éloge de Gore pour sa capacité à communiquer et le fait qu'il était manifestement très bien informé, suggérant qu'il ferait un ajout parfait à n'importe quel cabinet, mais a concédé qu'il manquait de style et qu'il était entravé par le passé, le Comité s'est inquiété qu'un nouveau match entre Gore et Bush détournerait le pays des problèmes d'aujourd'hui, ou pour mettre les mots d'un chroniqueur moins aimable sur le papier : "Oh, boo hoo. Il ne s'agit pas de la rédemption d'Al Gore. Il ne s'agit pas non plus d'un affrontement rancunier. La dernière chose dont nous ayons besoin aujourd'hui, c'est de nous complaire dans le passé, ce qu'une nomination de Gore ne manquera pas d'entraîner".
En Californie, avec ses 370 délégués, Gore avait une longueur d'avance et ses nouvelles idées libérales y trouvaient un public plus réceptif. C'était la première fois depuis 1972 que les Californiens avaient l'occasion de jouer un rôle important dans le processus de nomination. Mais les deux candidats ont fait campagne dans l'État, et Edwards a mené une campagne bien organisée. Les experts ont noté que malgré les tendances californiennes, l'État comptait encore des millions de démocrates modérés et d'indépendants. "La Californie est récemment devenue le centre d'une controverse politique lorsque le maire de San Francisco, Gavin Newsom, a commencé à signer des licences de mariage pour les couples de même sexe, légalisant ainsi le mariage homosexuel, et ce coup d'éclat a même fait naître l'idée d'une légalisation de cette pratique dans l'État, à laquelle, selon les sondages, une majorité de Californiens et d'Américains sont opposés.
En dehors des grands prix, Edwards avait la main plus forte, dans le Midwest, dans l'Ohio et le Minnesota, son message de populisme économique et de réexamen des accords commerciaux a très bien fonctionné et il a obtenu des résultats supérieurs à ceux de Gore dans ces deux États. L'Ohio était un état critique et les deux candidats ont fait campagne dans cet état, mais la campagne d'Edward dans tout le pays s'est révélée assez limitée.

Débat à New York entre John Edwards et AL Gore
La Géorgie, le Maryland et les États de la Nouvelle-Angleterre ont été les véritables ballottages. Gore avait initialement obtenu de bons résultats auprès des électeurs afro-américains, ce qui lui donnait une large avance dans le sud, mais la montée en puissance d'Edwards avait permis de faire des percées significatives auprès des électeurs noirs et il restait attractif pour les démocrates blancs plus modérés du sud, en dépit des antécédents de Gore. Les deux candidats ont joué sur leurs racines sudistes : "Je partage les valeurs des Sudistes ruraux : la foi, la famille et l'intégrité. Ce sont les choses auxquelles j'ai cru toute ma vie", a déclaré Edwards, tandis que Gore est monté sur scène avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler et a pris un fort accent du Sud, en dehors de son attitude habituelle d'homme d'État, et a parlé de l'importance de sa foi tout en critiquant la religion de "droite" du président : "Si vous m'élisez président, les voix de toutes les organisations religieuses feront partie intégrante des politiques mises en place dans mon administration".
En Nouvelle-Angleterre, les soutiens ont joué un rôle important : Gore a reçu le soutien de l'ancien gouverneur du Vermont Howard Dean, très populaire, tandis que dans le Massachusetts, le sénateur Ted Kennedy a soutenu John Edwards, ce qui a donné un coup de pouce à chacun d'entre eux dans ces États respectifs. L'ancien colistier de Gore, le sénateur du Connecticut Joe Lieberman, l'a soutenu et, malgré la discrétion habituelle de Rhode Island, les épouses des candidats, Tipper Gore et Elizabeth Edwards, sont venues se rassembler dans ce petit État.
Dans tout le pays, les démocrates prenaient leurs décisions finales. "Tout le monde évalue qui peut battre Bush ? a déclaré un expert, et avec un si grand nombre d'États clés, les candidats étaient très sollicités dans tout le pays, ils commençaient à être clairement épuisés ; des mois avant que la campagne n'ait réellement commencé, les deux hommes se sont lancés dans une course contre la montre pour obtenir des rebondissements dans les sondages à la fin du jeu. Dans le même temps, il est apparu clairement que le président Bush préparait également sa campagne de réélection, alors qu'il commençait à prononcer ses premiers discours de campagne et que les premières publicités politiques étaient diffusées pour vanter les réalisations du président, notamment son soutien à l'industrie de l'énergie, en réponse aux attaques des démocrates sur sa politique climatique (et sur Enron). Mais un autre éléphant s'est invité dans la pièce sous la forme de Ralph Nader, le candidat du parti vert quatre ans plus tôt. De nombreux démocrates lui reprochaient encore d'avoir siphonné des électeurs cruciaux de Gore en Floride, et Nader a déclaré que "le duopole bipartite doit être combattu" et a qualifié Washington D.C. de "territoire occupé par les entreprises" lorsqu'il a annoncé qu'il se présentait.
Les démocrates de tout le pays ont voté, tandis que les candidats achevaient leur tournée nationale. Avec Gore à Atlanta et Edwards à New York, chaque candidat s'est présenté comme le meilleur moyen de battre George Bush et de rajeunir l'économie américaine, les options étant "l'expérience du bon sens" ou "l'énergie de la fraîcheur".
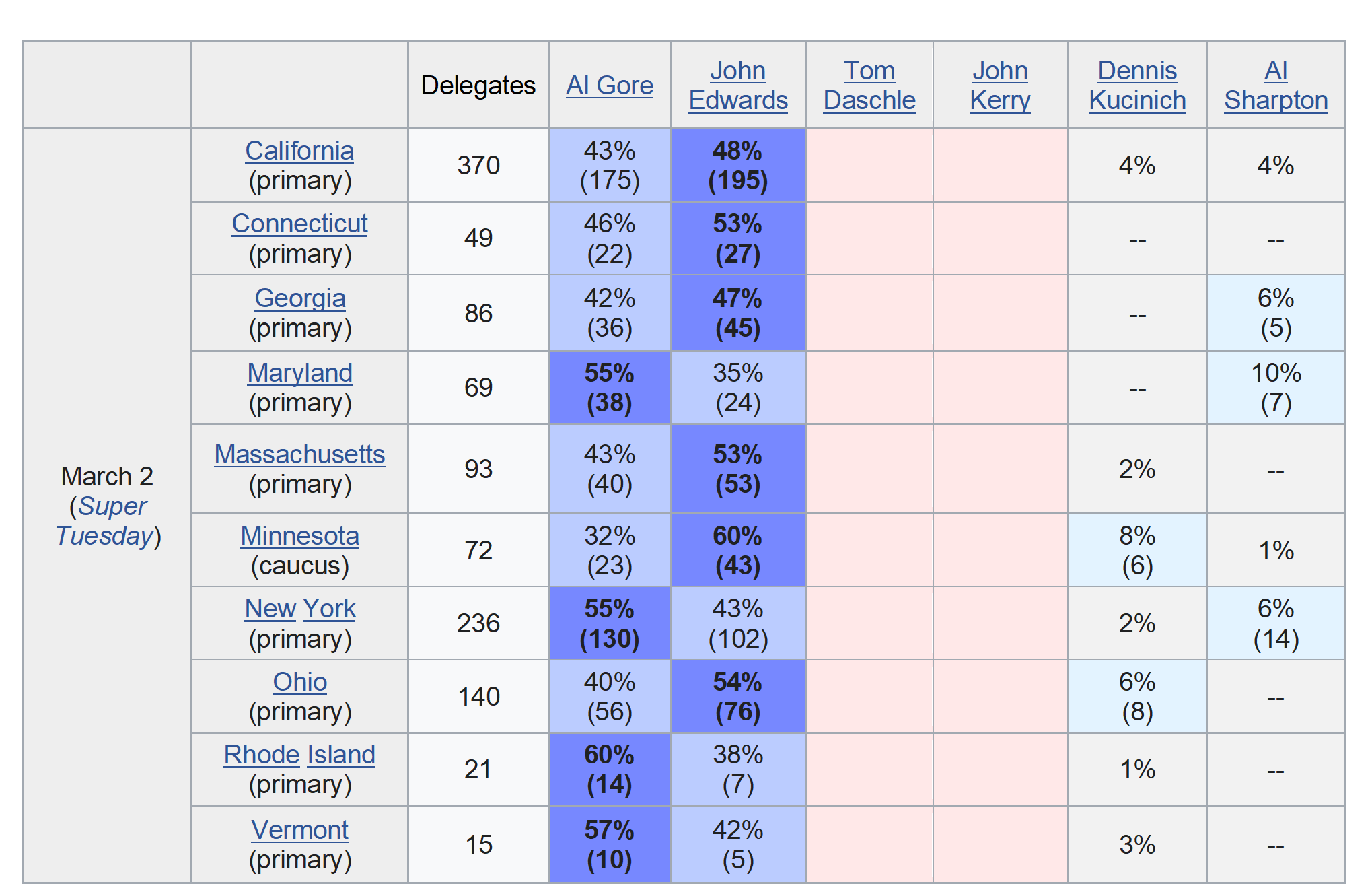
Résultats du Super Tuesday
https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/1665412144729-png.780696/
Résultats des États après le Super Tuesday
Malgré des résultats serrés, en termes de délégués, d'États et de vote populaire, le sénateur John Edwards a devancé l'ancien vice-président Al Gore. Sa campagne insurrectionnelle a remporté plusieurs victoires serrées, autrefois considérées comme impossibles, dans des États de tout le pays - le Massachusetts, l'Ohio, la Géorgie et le plus grand de la soirée, la Californie - où Gore jouissait d'une avance dans les sondages. La voix du sénateur, visiblement fatiguée, a commencé à s'enrouer vers la fin de son discours : "La vérité, c'est que je perds peut-être ma voix, mais vous n'avez pas perdu la vôtre, merci".
Mais Gore n'était pas encore éliminé, il conservait la tête des délégués grâce aux superdélégués et, lors de son propre meeting, il a déclaré : "Merci pour vos votes en faveur de l'accès des Américains aux soins de santé, de la création et de la formation d'emplois verts, contre les réductions d'impôts pour les riches, et pour vos votes en faveur de la reconquête du leadership américain, c'était ainsi et ce sera ainsi à nouveau". L'affrontement final entre les candidats commencerait dans un certain nombre d'États du Sud.
Mais malgré l'optimisme de Gore, les sondages commencent à se retourner contre lui, Edwards, tout auréolé de ses victoires, bénéficiant d'un rebond substantiel dans les sondages. Son soutien au sein du parti démocrate s'est élargi, élargissant sa coalition gagnante. Dans les jours qui ont suivi le Super Tuesday, d'autres sondages ont confirmé la perception qu'avait le public des deux candidats : Edwards était considéré comme le candidat le plus favorable et, pour la première fois, plusieurs sondages le donnaient battant Bush de plusieurs points lors de l'élection générale. La victoire d'Edwards en Géorgie a également été un indicateur clé de son soutien croissant auprès des électeurs noirs, combiné à celui des électeurs modérés.

(A gauche) rassemblement de John Edwards et (à droite) d'Al Gore lors du Super Tuesday
Les États suivants étaient tous des États du sud, où Edwards et Gore ont tenté d'obtenir l'avantage du terrain. La Caroline du Nord et le Tennessee ont tous deux tenté de séduire les électeurs, en particulier dans les vastes plaines du Texas, où M. Gore a vu sa meilleure chance de prouver que les sondeurs se trompaient et de reprendre l'élan de la course. Lors d'un rassemblement à San Antonio, M. Gore s'en est pris au président, cherchant à contrer les affirmations selon lesquelles il était trop libéral et prévoyait d'augmenter les impôts : "Ce sont des tactiques de peur, et je pense qu'il est dommage que le président se soit déjà éloigné de la vérité".
Tous les candidats ont également déployé des efforts considérables pour accroître leur part de la base électorale hispanique, toujours plus nombreuse. Alors que le président rencontrait le président mexicain Vicente Fox, John Edwards mettait en avant ses valeurs familiales et son soutien à l'élargissement du rêve américain aux immigrants, tandis que M. Gore faisait étalage de ses prouesses bilingues : "Je vous dis ce soir : "Todavia no han visto nada" Vous n'avez encore rien vu". Mettant l'accent sur ses valeurs en matière d'éducation et de soins de santé, M. Gore s'est efforcé de séduire les électeurs hispaniques, contrairement au président Clinton, ce qui a constitué un facteur important de sa défaite en 2000 (et de la perte de la Californie).
Lors de ce que l'on a appelé le "Southern Tuesday", le parti démocrate a de nouveau voté. Ce qui s'annonçait comme une soirée serrée pour les candidats s'est transformé en un balayage du Sud pour Edwards, qui a remporté tous les États en compétition, ne perdant que les Samoa américaines, qui n'offraient que 3 délégués au total, et dans les États du Texas et de la Floride, Edwards a battu Gore à une large majorité. Ce fut un moment inoubliable pour la campagne d'Edwards, qui signifiait qu'il avait remporté sa plus grande victoire. "Si je souris, c'est parce que cette campagne ne fait que commencer". Avec sa femme et ses enfants à ses côtés, il a remercié la foule enthousiaste et a quitté la scène en tant que favori pour l'investiture du parti démocrate.
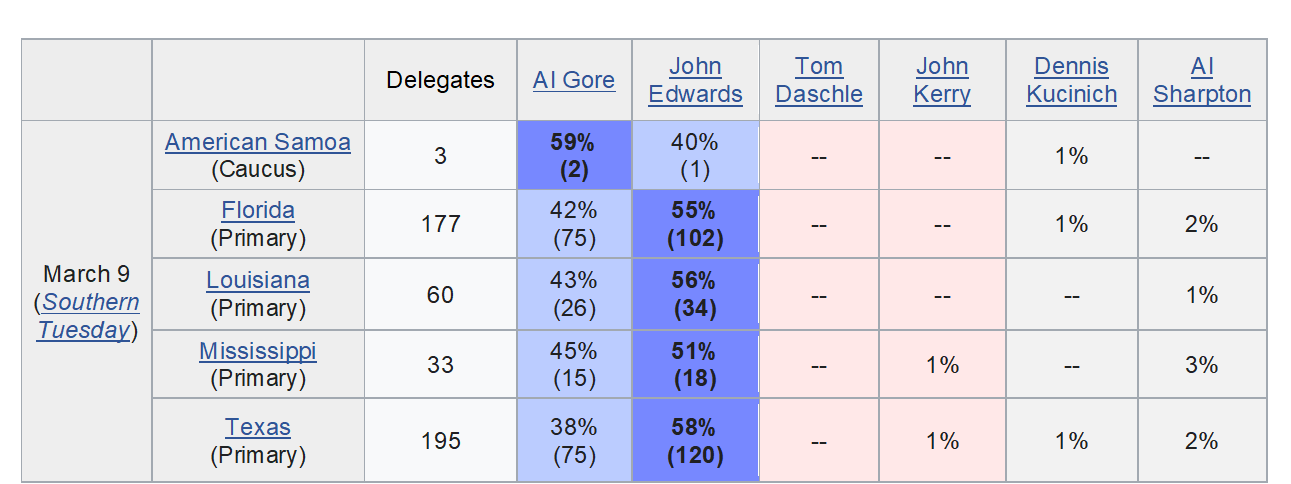
Résultats du " Southern Tuesday " (Mardi du Sud)
La campagne de Gore n'avait plus droit à l'erreur s'il voulait, d'une manière ou d'une autre, inverser la tendance, mais les preuves affluaient que les démocrates avaient pris leur décision quant à celui qu'ils pensaient être le mieux à même de battre Bush. Une nouvelle série de sondages a mis en évidence les avantages d'Edward, sa cote de popularité et sa capacité à être élu ont été gonflées, tandis que les chiffres de Gore se sont effondrés. Les responsables de la campagne de Gore ont commencé à s'irriter d'un manque de discipline et d'un manque de moral général, les démocrates ayant refusé, l'un après l'autre, d'accorder leur soutien au candidat. Après quelques autres élections en mars, les chances de Gore devenaient de plus en plus impossibles à surmonter et ses faveurs continuaient à chuter à la suite de deux défaites douloureuses au Kansas, puis dans l'Illinois, riche en délégués (une circonscription que Gore devait absolument remporter), seulement trois jours plus tard.
Les gros titres devenaient de plus en plus sévères, chacun prononçant la mort de la seconde candidature de Gore à la présidence : "Al Gore est comme mort ... il n'y a pas de bonnes nouvelles à l'horizon car les démocrates semblent avoir de plus en plus arrêté leur choix sur leur candidat préféré et les dirigeants démocrates sont impatients de se consolider en vue d'une campagne longue et coûteuse contre le président Bush en exercice" - Slate.com : La finale de Gore ? Le calcul des délégués était techniquement possible, si Gore avait pu remporter une série de victoires écrasantes en attendant une implosion rapide de la campagne d'Edwards. Le candidat avait eu des mots encourageants pour ses partisans : "Nous nous battons pour un gouvernement sain qui peut prendre des décisions intelligentes et, pour l'instant, c'est ce sur quoi cette campagne continue de porter", mais le vent soufflait de plus en plus dans l'autre sens.
Les démocrates semblaient avoir choisi leur candidat. Gore a continué à se battre, remportant des victoires dans de petits États et territoires, dont l'Alaska et les Démocrates à l'étranger, mais à la suite de plusieurs changements de superdélégués et d'une nouvelle victoire d'Edwards dans le Wyoming, il était clair que les choses étaient écrites sur le mur. Après quelques jours de réflexion politique, M. Gore s'est officiellement retiré de la course démocrate à la présidence et a exhorté ses partisans à soutenir son ancien rival, John Edwards, lors des élections de novembre : "C'est un jour amer, certains ont accusé cette campagne de porter sur le passé, mais nous savons qu'elle a toujours porté sur l'avenir... Je tiens à vous remercier, en tant que démocrates, de m'avoir fait l'honneur d'être votre candidat à la présidence il y a quatre ans et je tiens à remercier chacun d'entre vous de m'avoir rejoint aujourd'hui encore. Je voudrais demander à chacun d'entre vous d'aider John Edwards à devenir le prochain président des États-Unis".
Après le soutien de M. Gore, le sénateur John Edwards a prononcé son premier discours en tant que candidat démocrate présomptif : "Je tiens à remercier Al Gore pour les décennies qu'il a passées au service du parti démocrate et de notre pays ; pour beaucoup, il représente l'âme distinguée du parti et a incité des milliers de personnes à entrer dans le service public." Mais il a également lancé ses premières attaques cinglantes contre la Maison-Blanche, préfigurant les élections générales à venir : "Nous ne pouvons pas nous faire d'illusions, la capacité de nuisances des Républicains est telle que nous ne savons pas ce qu'ils sont prêts à faire, mais je peux vous promettre qu'ensemble, je n'ai aucun doute sur le fait que nous les vaincrons et qu'avec votre aide, nous aurons un aller simple pour la Maison-Blanche ! "
Toute dissection de l'investiture démocrate de 2004 est généralement centrée sur l'échec de la campagne de Gore. Gore, largement pressenti pour l'investiture après sa courte défaite de 2000, avait apparemment brisé les espoirs de victoire et envoyé les démocrates dans les bras de l'arriviste Edwards. Sa campagne a souffert d'un manque cruel d'enthousiasme de la part des démocrates de l'intérieur et, bien qu'il ait conservé un fort soutien parmi les militants les plus idéologiques du parti, son principal argument de vente, son expérience, est devenu un repoussoir pour de nombreux électeurs. Il a polarisé l'attention d'un grand nombre d'électeurs, a obtenu une cote de défaveur élevée et a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias. De nombreux Américains étaient prêts à tourner la page de l'élection de 2000 et beaucoup d'entre eux espéraient désespérément éviter une nouvelle réédition. En comparaison, la campagne d'Edward, une campagne de proximité à long terme qui visait à attirer le centre du parti démocrate dans ses rangs, s'est révélée être le meilleur concurrent de Gore et le parti s'est rapidement rallié à sa candidature[1].

Résultats définitifs des primaires présidentielles 2004 du Parti démocrate
https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/1665412568998-png.780701/
(Gauche) Candidat à l'investiture démocrate de 2000, l'ancien vice-président Al Gore
(A droite) Candidat démocrate de 2004, le sénateur John Edwards
https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/1665411796474-png.780692/
Arrestations à New York, "Un attentat au cyanure déjoué".
Associated Press
Tue 18 Mar 2004 11.16 BST
Le maire de New York, Mark Green, a déclaré aujourd'hui qu'une attaque terroriste dans la station de métro de New York avait été évitée, grâce à l'arrestation de six hommes et à la saisie de plusieurs produits chimiques qui, combinés, forment un gaz mortel, le cyanure d'hydrogène.
Les suspects, qui seraient liés à des groupes terroristes islamiques radicaux, dont Al-Qaida, l'organisation terroriste basée en Afghanistan responsable de l'attentat à la bombe contre une base militaire américaine l'année dernière et de plusieurs tentatives de détournement d'avion il y a deux ans, avaient prévu de fabriquer des engins capables de répandre le gaz dans le réseau de métro de New York, a déclaré M. Green.
"Nous avons empêché un attentat aussi grave que celui du World Trade Center", a déclaré le commissaire de police Raymond Kelly, faisant référence à l'attentat au camion piégé perpétré en 1993 au pied de la tour nord, qui avait fait 6 morts et 1 000 blessés, en précisant qu'un tel attentat pouvait entraîner des pathologies graves, voire la mort[2].
La police affirme avoir démantelé le complot lorsque les voisins de l'une des personnes arrêtées, l'Américain José Padilla, ont signalé des activités étranges, notamment de fortes odeurs chimiques, des conversations téléphoniques bruyantes et, une fois, un incendie. Selon les informations disponibles, José Padilla aurait voyagé à plusieurs reprises en Afghanistan, où il est soupçonné d'avoir établi des contacts avec plusieurs organisations terroristes et d'avoir suivi une formation à la fabrication d'armes chimiques et explosives.
Parmi les autres membres du complot figurent trois Britanniques d'origine pakistanaise et deux Américains de l'État de New York d'origine yéménite, tous accusés d'entretenir des liens avec plusieurs groupes terroristes islamiques, dont le groupe d'Asie orientale Jemaah Islamiyah, et le célèbre "terroriste indépendant" Khalid Shaikh Mohammed, accusé d'avoir préparé de nombreux attentats contre les États-Unis et qui résiderait dans l'Afghanistan contrôlé par les talibans.
Le chef de la CIA qui a aidé la police de New York dans son enquête, George Tenet, a déclaré que les suspects s'étaient entraînés avec de nombreux groupes terroristes et que "La plupart d'entre eux savent comment préparer des engins explosifs improvisés", a-t-il déclaré aux journalistes.
Les suspects ont été arrêtés lors d'une série de perquisitions dans la ville de New York. Les suspects étaient surveillés depuis des semaines, a déclaré M. Tenet. Ils sont détenus pour de multiples accusations de tentative de meurtre et de terrorisme.
M. Green a déclaré que les preuves contre les quatre détenus étaient "solides et inattaquables", ajoutant que des opérations de suivi étaient en cours. "Que personne ne sous-estime notre détermination à assurer la sécurité de New York et des New-Yorkais", a-t-il déclaré.
Des armes chimiques ont déjà été utilisées occasionnellement par des groupes terroristes, la plus connue étant l'attaque du métro de Tokyo par une secte religieuse qui a utilisé l'agent neurotoxique sarin, tuant 12 personnes et en blessant des centaines d'autres. Aux États-Unis, il y a quelques mois à peine, des suprémacistes blancs ont projeté d'attaquer des bâtiments gouvernementaux au Texas en utilisant une bombe artisanale au cyanure, mais le projet a été déjoué par le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms[3].
Les arrestations ont suscité des critiques de la part de groupes de défense des droits civiques qui affirment que certaines des tactiques utilisées par la police, notamment la surveillance intensive, représentent un possible abus de pouvoir ...

(A gauche) Le suspect du "complot du cyanure" arrêté, José Padilla [4] (A droite) les dispositifs créés pour diffuser les agents chimiques.
[1] Gore ne s'est pas présenté en 2000 parce qu'il pensait que George Bush était trop populaire à l'époque. Malheureusement pour Gore, je suis d'accord avec sa décision OTL : les comebacks politiques sont rares dans la politique américaine et je me réfère généralement à la citation de Patton : "Les Américains aiment les vainqueurs et ne tolèrent pas les perdants". Peut-être Gore est-il spécial parce qu'il pouvait légitimement prétendre avoir gagné l'élection de 2000, mais je pense immédiatement à Hillary Clinton en 2016 ou à Humprhey en 72.
[2] Il existe peu de preuves tangibles de ce complot, qui n'a été mentionné que dans plusieurs mémoires affirmant que le complot a été annulé par les dirigeants d'Al-Qaïda pour plusieurs raisons. J'ai de sérieux doutes quant à la réussite potentielle d'un tel complot (les armes chimiques sont plus difficiles à fabriquer et moins mortelles que les explosifs conventionnels), mais le chef ATL d'Al-Qaida étant plus intéressé par les armes chimiques et biologiques, on peut imaginer qu'ils ont tenté de mener à bien le complot, mais que celui-ci a été démantelé à son stade préparatoire.
[3] Un véritable complot qui a été éclipsé par la guerre contre le terrorisme, le nom de l'organisation a été changé en Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs) après le 11 septembre.
[4] Jose Padilla est le "terroriste" qui a tenté de fabriquer une bombe nucléaire en suivant un guide parodique qui proposait de "mettre de l'uranium dans des seaux et de les faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre au-dessus de votre tête". Ici son plan est moins audacieux mais tout aussi vain.
Le 2 mars sera la plus grande journée de primaires du calendrier, 10 états organisant leurs primaires et caucus, et en une nuit plus d'un quart des délégués disponibles seront décidés et répartis entre les deux derniers candidats sérieux, l'ancien vice-président Al Gore et le sénateur John Edwards, si l'un des candidats arrivait à devancer l'autre de manière significative, cela marquerait plus que probablement la fin de la compétition et déciderait du vainqueur de l'investiture démocrate.
Il y avait de nombreux prix à gagner lors de cette soirée, notamment la Californie et New York, les deux États les plus peuplés de l'Union, l'ensemble du pays était représenté avec la région de la Nouvelle-Angleterre bien représentée, notamment le Massachusetts, le Vermont et le Rhode Island. Le Midwest était également présent avec l'Ohio et le Minnesota, et le Sud n'était pas en reste avec la Géorgie et le mélange de banlieusards blancs de Washington et d'Afro-Américains de Baltimore qui composaient le Maryland. Le concours a garanti que la nation aurait la possibilité de décider de sa préférence.
Couverture par C-Span du "Super Tuesday"
Il n'y avait pas de leader incontestable dans la course, et les sondages oscillaient d'un côté comme de l'autre en ce qui concernait les intentions du parti démocrate. Il est certain que les deux candidats se battaient pour chaque voix, sans être rassurés par leur avance dans chaque État respectif. Si l'on regarde la carte, Gore avait un avantage en Californie et à New York - les "big enchiladas", comme l'ont dit les experts - où l'électorat et les tendances penchaient en sa faveur. Mais la dynamique de Edwards a été clairement ressentie par de nombreux démocrates qui sont restés à l'écart du jeu des soutiens, pour ne pas perdre de chances. Gore a néanmoins obtenu des soutiens importants de la part de la sénatrice californienne Dianne Feinstein et de l'épouse sénatoriale de son ex-employeur Hilary Clinton, celle-ci ayant mis de côté l'apparente animosité entre les deux et l'ayant qualifié de "meilleur conseiller, ami et même président que vous puissiez demander". Mais M. Edwards a continué à étonner en recevant le soutien surprise du comité éditorial du plus grand journal du pays, le New York Times, qui l'a décrit comme ayant "une énorme discipline [établissant] une connexion directe et authentiquement émotionnelle avec des personnes de tous horizons, qui est facile à imaginer à la Maison Blanche".
Le journal a certes fait l'éloge de Gore pour sa capacité à communiquer et le fait qu'il était manifestement très bien informé, suggérant qu'il ferait un ajout parfait à n'importe quel cabinet, mais a concédé qu'il manquait de style et qu'il était entravé par le passé, le Comité s'est inquiété qu'un nouveau match entre Gore et Bush détournerait le pays des problèmes d'aujourd'hui, ou pour mettre les mots d'un chroniqueur moins aimable sur le papier : "Oh, boo hoo. Il ne s'agit pas de la rédemption d'Al Gore. Il ne s'agit pas non plus d'un affrontement rancunier. La dernière chose dont nous ayons besoin aujourd'hui, c'est de nous complaire dans le passé, ce qu'une nomination de Gore ne manquera pas d'entraîner".
En Californie, avec ses 370 délégués, Gore avait une longueur d'avance et ses nouvelles idées libérales y trouvaient un public plus réceptif. C'était la première fois depuis 1972 que les Californiens avaient l'occasion de jouer un rôle important dans le processus de nomination. Mais les deux candidats ont fait campagne dans l'État, et Edwards a mené une campagne bien organisée. Les experts ont noté que malgré les tendances californiennes, l'État comptait encore des millions de démocrates modérés et d'indépendants. "La Californie est récemment devenue le centre d'une controverse politique lorsque le maire de San Francisco, Gavin Newsom, a commencé à signer des licences de mariage pour les couples de même sexe, légalisant ainsi le mariage homosexuel, et ce coup d'éclat a même fait naître l'idée d'une légalisation de cette pratique dans l'État, à laquelle, selon les sondages, une majorité de Californiens et d'Américains sont opposés.
En dehors des grands prix, Edwards avait la main plus forte, dans le Midwest, dans l'Ohio et le Minnesota, son message de populisme économique et de réexamen des accords commerciaux a très bien fonctionné et il a obtenu des résultats supérieurs à ceux de Gore dans ces deux États. L'Ohio était un état critique et les deux candidats ont fait campagne dans cet état, mais la campagne d'Edward dans tout le pays s'est révélée assez limitée.
Débat à New York entre John Edwards et AL Gore
La Géorgie, le Maryland et les États de la Nouvelle-Angleterre ont été les véritables ballottages. Gore avait initialement obtenu de bons résultats auprès des électeurs afro-américains, ce qui lui donnait une large avance dans le sud, mais la montée en puissance d'Edwards avait permis de faire des percées significatives auprès des électeurs noirs et il restait attractif pour les démocrates blancs plus modérés du sud, en dépit des antécédents de Gore. Les deux candidats ont joué sur leurs racines sudistes : "Je partage les valeurs des Sudistes ruraux : la foi, la famille et l'intégrité. Ce sont les choses auxquelles j'ai cru toute ma vie", a déclaré Edwards, tandis que Gore est monté sur scène avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler et a pris un fort accent du Sud, en dehors de son attitude habituelle d'homme d'État, et a parlé de l'importance de sa foi tout en critiquant la religion de "droite" du président : "Si vous m'élisez président, les voix de toutes les organisations religieuses feront partie intégrante des politiques mises en place dans mon administration".
En Nouvelle-Angleterre, les soutiens ont joué un rôle important : Gore a reçu le soutien de l'ancien gouverneur du Vermont Howard Dean, très populaire, tandis que dans le Massachusetts, le sénateur Ted Kennedy a soutenu John Edwards, ce qui a donné un coup de pouce à chacun d'entre eux dans ces États respectifs. L'ancien colistier de Gore, le sénateur du Connecticut Joe Lieberman, l'a soutenu et, malgré la discrétion habituelle de Rhode Island, les épouses des candidats, Tipper Gore et Elizabeth Edwards, sont venues se rassembler dans ce petit État.
Dans tout le pays, les démocrates prenaient leurs décisions finales. "Tout le monde évalue qui peut battre Bush ? a déclaré un expert, et avec un si grand nombre d'États clés, les candidats étaient très sollicités dans tout le pays, ils commençaient à être clairement épuisés ; des mois avant que la campagne n'ait réellement commencé, les deux hommes se sont lancés dans une course contre la montre pour obtenir des rebondissements dans les sondages à la fin du jeu. Dans le même temps, il est apparu clairement que le président Bush préparait également sa campagne de réélection, alors qu'il commençait à prononcer ses premiers discours de campagne et que les premières publicités politiques étaient diffusées pour vanter les réalisations du président, notamment son soutien à l'industrie de l'énergie, en réponse aux attaques des démocrates sur sa politique climatique (et sur Enron). Mais un autre éléphant s'est invité dans la pièce sous la forme de Ralph Nader, le candidat du parti vert quatre ans plus tôt. De nombreux démocrates lui reprochaient encore d'avoir siphonné des électeurs cruciaux de Gore en Floride, et Nader a déclaré que "le duopole bipartite doit être combattu" et a qualifié Washington D.C. de "territoire occupé par les entreprises" lorsqu'il a annoncé qu'il se présentait.
Les démocrates de tout le pays ont voté, tandis que les candidats achevaient leur tournée nationale. Avec Gore à Atlanta et Edwards à New York, chaque candidat s'est présenté comme le meilleur moyen de battre George Bush et de rajeunir l'économie américaine, les options étant "l'expérience du bon sens" ou "l'énergie de la fraîcheur".
Résultats du Super Tuesday
https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/1665412144729-png.780696/
Résultats des États après le Super Tuesday
Malgré des résultats serrés, en termes de délégués, d'États et de vote populaire, le sénateur John Edwards a devancé l'ancien vice-président Al Gore. Sa campagne insurrectionnelle a remporté plusieurs victoires serrées, autrefois considérées comme impossibles, dans des États de tout le pays - le Massachusetts, l'Ohio, la Géorgie et le plus grand de la soirée, la Californie - où Gore jouissait d'une avance dans les sondages. La voix du sénateur, visiblement fatiguée, a commencé à s'enrouer vers la fin de son discours : "La vérité, c'est que je perds peut-être ma voix, mais vous n'avez pas perdu la vôtre, merci".
Mais Gore n'était pas encore éliminé, il conservait la tête des délégués grâce aux superdélégués et, lors de son propre meeting, il a déclaré : "Merci pour vos votes en faveur de l'accès des Américains aux soins de santé, de la création et de la formation d'emplois verts, contre les réductions d'impôts pour les riches, et pour vos votes en faveur de la reconquête du leadership américain, c'était ainsi et ce sera ainsi à nouveau". L'affrontement final entre les candidats commencerait dans un certain nombre d'États du Sud.
Mais malgré l'optimisme de Gore, les sondages commencent à se retourner contre lui, Edwards, tout auréolé de ses victoires, bénéficiant d'un rebond substantiel dans les sondages. Son soutien au sein du parti démocrate s'est élargi, élargissant sa coalition gagnante. Dans les jours qui ont suivi le Super Tuesday, d'autres sondages ont confirmé la perception qu'avait le public des deux candidats : Edwards était considéré comme le candidat le plus favorable et, pour la première fois, plusieurs sondages le donnaient battant Bush de plusieurs points lors de l'élection générale. La victoire d'Edwards en Géorgie a également été un indicateur clé de son soutien croissant auprès des électeurs noirs, combiné à celui des électeurs modérés.
(A gauche) rassemblement de John Edwards et (à droite) d'Al Gore lors du Super Tuesday
Les États suivants étaient tous des États du sud, où Edwards et Gore ont tenté d'obtenir l'avantage du terrain. La Caroline du Nord et le Tennessee ont tous deux tenté de séduire les électeurs, en particulier dans les vastes plaines du Texas, où M. Gore a vu sa meilleure chance de prouver que les sondeurs se trompaient et de reprendre l'élan de la course. Lors d'un rassemblement à San Antonio, M. Gore s'en est pris au président, cherchant à contrer les affirmations selon lesquelles il était trop libéral et prévoyait d'augmenter les impôts : "Ce sont des tactiques de peur, et je pense qu'il est dommage que le président se soit déjà éloigné de la vérité".
Tous les candidats ont également déployé des efforts considérables pour accroître leur part de la base électorale hispanique, toujours plus nombreuse. Alors que le président rencontrait le président mexicain Vicente Fox, John Edwards mettait en avant ses valeurs familiales et son soutien à l'élargissement du rêve américain aux immigrants, tandis que M. Gore faisait étalage de ses prouesses bilingues : "Je vous dis ce soir : "Todavia no han visto nada" Vous n'avez encore rien vu". Mettant l'accent sur ses valeurs en matière d'éducation et de soins de santé, M. Gore s'est efforcé de séduire les électeurs hispaniques, contrairement au président Clinton, ce qui a constitué un facteur important de sa défaite en 2000 (et de la perte de la Californie).
Lors de ce que l'on a appelé le "Southern Tuesday", le parti démocrate a de nouveau voté. Ce qui s'annonçait comme une soirée serrée pour les candidats s'est transformé en un balayage du Sud pour Edwards, qui a remporté tous les États en compétition, ne perdant que les Samoa américaines, qui n'offraient que 3 délégués au total, et dans les États du Texas et de la Floride, Edwards a battu Gore à une large majorité. Ce fut un moment inoubliable pour la campagne d'Edwards, qui signifiait qu'il avait remporté sa plus grande victoire. "Si je souris, c'est parce que cette campagne ne fait que commencer". Avec sa femme et ses enfants à ses côtés, il a remercié la foule enthousiaste et a quitté la scène en tant que favori pour l'investiture du parti démocrate.
Résultats du " Southern Tuesday " (Mardi du Sud)
La campagne de Gore n'avait plus droit à l'erreur s'il voulait, d'une manière ou d'une autre, inverser la tendance, mais les preuves affluaient que les démocrates avaient pris leur décision quant à celui qu'ils pensaient être le mieux à même de battre Bush. Une nouvelle série de sondages a mis en évidence les avantages d'Edward, sa cote de popularité et sa capacité à être élu ont été gonflées, tandis que les chiffres de Gore se sont effondrés. Les responsables de la campagne de Gore ont commencé à s'irriter d'un manque de discipline et d'un manque de moral général, les démocrates ayant refusé, l'un après l'autre, d'accorder leur soutien au candidat. Après quelques autres élections en mars, les chances de Gore devenaient de plus en plus impossibles à surmonter et ses faveurs continuaient à chuter à la suite de deux défaites douloureuses au Kansas, puis dans l'Illinois, riche en délégués (une circonscription que Gore devait absolument remporter), seulement trois jours plus tard.
Les gros titres devenaient de plus en plus sévères, chacun prononçant la mort de la seconde candidature de Gore à la présidence : "Al Gore est comme mort ... il n'y a pas de bonnes nouvelles à l'horizon car les démocrates semblent avoir de plus en plus arrêté leur choix sur leur candidat préféré et les dirigeants démocrates sont impatients de se consolider en vue d'une campagne longue et coûteuse contre le président Bush en exercice" - Slate.com : La finale de Gore ? Le calcul des délégués était techniquement possible, si Gore avait pu remporter une série de victoires écrasantes en attendant une implosion rapide de la campagne d'Edwards. Le candidat avait eu des mots encourageants pour ses partisans : "Nous nous battons pour un gouvernement sain qui peut prendre des décisions intelligentes et, pour l'instant, c'est ce sur quoi cette campagne continue de porter", mais le vent soufflait de plus en plus dans l'autre sens.
Les démocrates semblaient avoir choisi leur candidat. Gore a continué à se battre, remportant des victoires dans de petits États et territoires, dont l'Alaska et les Démocrates à l'étranger, mais à la suite de plusieurs changements de superdélégués et d'une nouvelle victoire d'Edwards dans le Wyoming, il était clair que les choses étaient écrites sur le mur. Après quelques jours de réflexion politique, M. Gore s'est officiellement retiré de la course démocrate à la présidence et a exhorté ses partisans à soutenir son ancien rival, John Edwards, lors des élections de novembre : "C'est un jour amer, certains ont accusé cette campagne de porter sur le passé, mais nous savons qu'elle a toujours porté sur l'avenir... Je tiens à vous remercier, en tant que démocrates, de m'avoir fait l'honneur d'être votre candidat à la présidence il y a quatre ans et je tiens à remercier chacun d'entre vous de m'avoir rejoint aujourd'hui encore. Je voudrais demander à chacun d'entre vous d'aider John Edwards à devenir le prochain président des États-Unis".
Après le soutien de M. Gore, le sénateur John Edwards a prononcé son premier discours en tant que candidat démocrate présomptif : "Je tiens à remercier Al Gore pour les décennies qu'il a passées au service du parti démocrate et de notre pays ; pour beaucoup, il représente l'âme distinguée du parti et a incité des milliers de personnes à entrer dans le service public." Mais il a également lancé ses premières attaques cinglantes contre la Maison-Blanche, préfigurant les élections générales à venir : "Nous ne pouvons pas nous faire d'illusions, la capacité de nuisances des Républicains est telle que nous ne savons pas ce qu'ils sont prêts à faire, mais je peux vous promettre qu'ensemble, je n'ai aucun doute sur le fait que nous les vaincrons et qu'avec votre aide, nous aurons un aller simple pour la Maison-Blanche ! "
Toute dissection de l'investiture démocrate de 2004 est généralement centrée sur l'échec de la campagne de Gore. Gore, largement pressenti pour l'investiture après sa courte défaite de 2000, avait apparemment brisé les espoirs de victoire et envoyé les démocrates dans les bras de l'arriviste Edwards. Sa campagne a souffert d'un manque cruel d'enthousiasme de la part des démocrates de l'intérieur et, bien qu'il ait conservé un fort soutien parmi les militants les plus idéologiques du parti, son principal argument de vente, son expérience, est devenu un repoussoir pour de nombreux électeurs. Il a polarisé l'attention d'un grand nombre d'électeurs, a obtenu une cote de défaveur élevée et a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias. De nombreux Américains étaient prêts à tourner la page de l'élection de 2000 et beaucoup d'entre eux espéraient désespérément éviter une nouvelle réédition. En comparaison, la campagne d'Edward, une campagne de proximité à long terme qui visait à attirer le centre du parti démocrate dans ses rangs, s'est révélée être le meilleur concurrent de Gore et le parti s'est rapidement rallié à sa candidature[1].
Résultats définitifs des primaires présidentielles 2004 du Parti démocrate
https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/1665412568998-png.780701/
(Gauche) Candidat à l'investiture démocrate de 2000, l'ancien vice-président Al Gore
(A droite) Candidat démocrate de 2004, le sénateur John Edwards
https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/1665411796474-png.780692/
Arrestations à New York, "Un attentat au cyanure déjoué".
Associated Press
Tue 18 Mar 2004 11.16 BST
Le maire de New York, Mark Green, a déclaré aujourd'hui qu'une attaque terroriste dans la station de métro de New York avait été évitée, grâce à l'arrestation de six hommes et à la saisie de plusieurs produits chimiques qui, combinés, forment un gaz mortel, le cyanure d'hydrogène.
Les suspects, qui seraient liés à des groupes terroristes islamiques radicaux, dont Al-Qaida, l'organisation terroriste basée en Afghanistan responsable de l'attentat à la bombe contre une base militaire américaine l'année dernière et de plusieurs tentatives de détournement d'avion il y a deux ans, avaient prévu de fabriquer des engins capables de répandre le gaz dans le réseau de métro de New York, a déclaré M. Green.
"Nous avons empêché un attentat aussi grave que celui du World Trade Center", a déclaré le commissaire de police Raymond Kelly, faisant référence à l'attentat au camion piégé perpétré en 1993 au pied de la tour nord, qui avait fait 6 morts et 1 000 blessés, en précisant qu'un tel attentat pouvait entraîner des pathologies graves, voire la mort[2].
La police affirme avoir démantelé le complot lorsque les voisins de l'une des personnes arrêtées, l'Américain José Padilla, ont signalé des activités étranges, notamment de fortes odeurs chimiques, des conversations téléphoniques bruyantes et, une fois, un incendie. Selon les informations disponibles, José Padilla aurait voyagé à plusieurs reprises en Afghanistan, où il est soupçonné d'avoir établi des contacts avec plusieurs organisations terroristes et d'avoir suivi une formation à la fabrication d'armes chimiques et explosives.
Parmi les autres membres du complot figurent trois Britanniques d'origine pakistanaise et deux Américains de l'État de New York d'origine yéménite, tous accusés d'entretenir des liens avec plusieurs groupes terroristes islamiques, dont le groupe d'Asie orientale Jemaah Islamiyah, et le célèbre "terroriste indépendant" Khalid Shaikh Mohammed, accusé d'avoir préparé de nombreux attentats contre les États-Unis et qui résiderait dans l'Afghanistan contrôlé par les talibans.
Le chef de la CIA qui a aidé la police de New York dans son enquête, George Tenet, a déclaré que les suspects s'étaient entraînés avec de nombreux groupes terroristes et que "La plupart d'entre eux savent comment préparer des engins explosifs improvisés", a-t-il déclaré aux journalistes.
Les suspects ont été arrêtés lors d'une série de perquisitions dans la ville de New York. Les suspects étaient surveillés depuis des semaines, a déclaré M. Tenet. Ils sont détenus pour de multiples accusations de tentative de meurtre et de terrorisme.
M. Green a déclaré que les preuves contre les quatre détenus étaient "solides et inattaquables", ajoutant que des opérations de suivi étaient en cours. "Que personne ne sous-estime notre détermination à assurer la sécurité de New York et des New-Yorkais", a-t-il déclaré.
Des armes chimiques ont déjà été utilisées occasionnellement par des groupes terroristes, la plus connue étant l'attaque du métro de Tokyo par une secte religieuse qui a utilisé l'agent neurotoxique sarin, tuant 12 personnes et en blessant des centaines d'autres. Aux États-Unis, il y a quelques mois à peine, des suprémacistes blancs ont projeté d'attaquer des bâtiments gouvernementaux au Texas en utilisant une bombe artisanale au cyanure, mais le projet a été déjoué par le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms[3].
Les arrestations ont suscité des critiques de la part de groupes de défense des droits civiques qui affirment que certaines des tactiques utilisées par la police, notamment la surveillance intensive, représentent un possible abus de pouvoir ...
(A gauche) Le suspect du "complot du cyanure" arrêté, José Padilla [4] (A droite) les dispositifs créés pour diffuser les agents chimiques.
[1] Gore ne s'est pas présenté en 2000 parce qu'il pensait que George Bush était trop populaire à l'époque. Malheureusement pour Gore, je suis d'accord avec sa décision OTL : les comebacks politiques sont rares dans la politique américaine et je me réfère généralement à la citation de Patton : "Les Américains aiment les vainqueurs et ne tolèrent pas les perdants". Peut-être Gore est-il spécial parce qu'il pouvait légitimement prétendre avoir gagné l'élection de 2000, mais je pense immédiatement à Hillary Clinton en 2016 ou à Humprhey en 72.
[2] Il existe peu de preuves tangibles de ce complot, qui n'a été mentionné que dans plusieurs mémoires affirmant que le complot a été annulé par les dirigeants d'Al-Qaïda pour plusieurs raisons. J'ai de sérieux doutes quant à la réussite potentielle d'un tel complot (les armes chimiques sont plus difficiles à fabriquer et moins mortelles que les explosifs conventionnels), mais le chef ATL d'Al-Qaida étant plus intéressé par les armes chimiques et biologiques, on peut imaginer qu'ils ont tenté de mener à bien le complot, mais que celui-ci a été démantelé à son stade préparatoire.
[3] Un véritable complot qui a été éclipsé par la guerre contre le terrorisme, le nom de l'organisation a été changé en Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs) après le 11 septembre.
[4] Jose Padilla est le "terroriste" qui a tenté de fabriquer une bombe nucléaire en suivant un guide parodique qui proposait de "mettre de l'uranium dans des seaux et de les faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre au-dessus de votre tête". Ici son plan est moins audacieux mais tout aussi vain.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 35: Wolverine
Saddam Hussein, le dictateur irakien de longue date, a accordé un rare entretien approfondi aux médias occidentaux. Le président était d'humeur optimiste et il n'était pas difficile de comprendre pourquoi, de son point de vue, il avait remporté une grande victoire sur les États-Unis. Les Nations unies venaient de terminer leur enquête, concluant qu'elles n'avaient trouvé aucune preuve que l'Irak avait violé les lois internationales concernant ses programmes d'armement, et les inspecteurs s'apprêtaient à quitter le pays.
Ce fut une longue interview au cours de laquelle le dictateur fixait parfois l'objectif de la caméra ou l'intervieweur Dan Rather, parfois il tapait du poing sur la table et, par l'intermédiaire d'un traducteur, il exprimait sa conviction absolue qu'il resterait le président de l'Irak et que les États-Unis ne conquerraient jamais le peuple irakien : "En dépit de leurs mensonges ou de leur prétendu statut de superpuissance, le peuple irakien ne se soumettra jamais à une force américaine impie, et maintenant nous en avons convaincu le monde entier !"
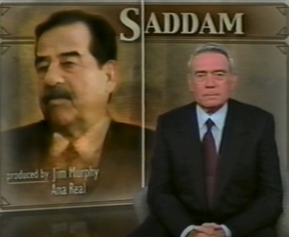
Interview de Saddam Hussein à 60 minutes
Un an s'est écoulé depuis le début de la crise du désarmement irakien, lorsqu'un avion américain s'est écrasé ou a été abattu dans le désert irakien, tuant le pilote et son RINO ce qui a déclenché des tensions entre les États-Unis et l'Irak, Les États-Unis accusaient Saddam de violer les accords des Nations unies et de détenir de prétendues "armes de destruction massive", mais après des mois de frappes de missiles sur l'Irak, le grand mastodonte américain avait été contraint de faire marche arrière, confronté à ses alliés et au Congrès contrôlé par les démocrates, qui s'opposaient à l'intervention du président en Irak.
Pendant des mois, Saddam a tenu les mêmes propos jubilatoires, se moquant du président Bush, l'appelant le "petit Bush" et déclarant qu'il était bien plus intelligent que le "chimpanzé président". Ses interviews et ses railleries ne sont pas passées inaperçues à la Maison Blanche.
Le président américain, malgré les efforts des membres de son administration pour tenter de tourner la page de l'Irak et de se lancer dans la course à la réélection, en avait été empêché par de puissants partisans qui continuaient à réclamer la chute du régime baasiste. La politique américaine a commencé à refléter cette politique de plus en plus dure. Les zones d'exclusion aérienne dans le nord et le sud de l'Irak sont devenues encore plus strictes et les règles d'engagement ont été ouvertes, permettant aux forces de la coalition de frapper toute tentative d'organisation des forces irakiennes dans les régions. La politique d'application stricte a été décrite comme une "zone d'exclusion" destinée à empêcher le gouvernement irakien de coordonner ses forces dans les régions kurdes ou méridionales. Cette politique a été défendue par les partisans de la ligne dure de l'administration Bush depuis le début. Les jets américains et britanniques ont ciblé les bases militaires (en grande partie détruites au cours de la campagne de l'année précédente), les lignes de communication et même les convois militaires et les mouvements de troupes. Les campagnes de bombardement et l'application de sanctions sévères ont dévasté l'infrastructure et la qualité de vie des Irakiens, entraînant une pauvreté routinière en matière d'électricité, de nourriture et d'eau.
La "zone interdite" envisagée par le secrétaire adjoint à la défense, Paul Wolfowitz, visait à briser l'emprise de Bagdad sur le sud de l'Irak, comme elle l'avait fait dans le nord, dans l'espoir de déclencher une sorte de soulèvement contre Saddam, comme cela s'était produit en 1991 ou en 1999, ou même un coup d'État militaire, comme en 1996. Mais contrairement au néocon Wolfowitz, la plupart des fonctionnaires étaient convaincus que l'Irak continuerait à défier les États-Unis, que Saddam contrôlait encore suffisamment de forces militaires, paramilitaires et policières pour imposer son autorité dans le sud de l'Irak et que les chiites n'étaient pas en mesure de se soulever, malgré les efforts croissants de la CIA pour semer les graines de la discorde par le biais de pots-de-vin et de propagande, qui inondait les régions kurdes et chiites. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'IFRA (Iraqi Freedom Activities), une série d'actions secrètes autorisées par le président et destinées à renverser la dictature irakienne.
Le président Bush avait déjà ordonné une action militaire secrète dans la région kurde pour aider les forces kurdes Peshmerga à chasser les forces islamistes radicales campées dans la région frontalière entre le territoire kurde et l'Iran. Cette action avait pour but de permettre aux forces kurdes de se joindre à une éventuelle guerre ou d'aider à un soulèvement contre l'Irak de Saddam, mais elle s'est soldée par une victoire kurde et par la fuite des militants sur le sol iranien.

Les combattants kurdes à gauche et la zone de l'offensive kurde à gauche.
Le gouvernement irakien a saisi toutes les occasions pour dénoncer publiquement "l'ingérence américaine" en montrant de prétendus mouchards et en rassemblant les traîtres présumés pour les exécuter rapidement et brutalement, notamment plusieurs colonels irakiens accusés d'avoir fourni des informations militaires aux Américains et qui ont été traînés jusqu'à la mort dans le désert. Le jeu du chat et de la souris entre les États-Unis et les services de renseignement irakiens a été brutal, des sommes importantes ayant été utilisées pour corrompre et soutirer des actifs avant que la milice des Fedayins ne puisse les éliminer. L'ampleur des pots-de-vin a été telle que dans certains villages, le dollar américain avait remplacé le dinar irakien en tant que monnaie locale.
Washington craignait que ces opérations ne dépassent les capacités des services de renseignement américains ou que le nombre d'opérations ne mette la pression sur la CIA et n'aide les efforts de contre-espionnage irakiens. En outre, les opérations n'avaient pas d'objectif clair en dehors de la déstabilisation et il n'était pas évident que ces efforts soient couronnés de succès. Malgré les zones interdites à la circulation, l'influence de Bagdad dans le sud n'a pas faibli et les tentatives de protestation ont été réprimées tout aussi rapidement par la police et les milices locales. Le vice-président Cheney et le secrétaire à la défense Rumsfeld, frustrés par les désaccords entre la CIA et le département d'État, n'ont pas tenu compte de ces désaccords et ont transmis leurs directives directement au président.
L'opération Wolverine, autorisée par le président l'année précédente, visait à obtenir un changement de régime en Irak, mais au lieu d'une invasion américaine, que l'opinion publique et le président jugeaient désormais trop risquée sur le plan politique, Wolverine a prévu une frappe chirurgicale pour éliminer Saddam Hussein et décapiter le gouvernement irakien. La mort du président Saddam Hussein serait utilisée pour déclencher une révolte dans le sud de l'Irak, aidée par une application stricte de la zone d'interdiction de circuler, et ce qui resterait des fidèles à l'ancien régime serait chassé du sud. Après cela, les plans sont restés vagues, peut-être les Etats-Unis étendraient-ils leurs opérations aériennes à l'ensemble de l'Irak, ce qui permettrait la fin totale de l'Etat baasiste, et les forces spéciales américaines au Koweït pourraient entrer pour aider le nouveau sud de l'Irak, qui serait autonome. Ces aléas furent l'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'ampleur de l'opération ne fut jamais discutée ou prise au sérieux par de nombreux officiers de renseignement ou diplomates de carrière, sauf entre ses architectes et le président. Les principaux départements ministériels n'étant que vaguement au courant du complot visant à fomenter un coup d'État interne, les partisans de la ligne dure craignaient que le secrétaire d'État Colin Powell ou peut-être la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice ne tentent de dissuader une tentative d'assassinat du dictateur, mettant en garde contre les conséquences inconnues, l'absence d'un successeur clair et les allégations selon lesquelles les États-Unis enfreindraient les règles internationales et nationales en vigueur.
Le directeur de la CIA, George Tenet, a soutenu l'opération à contrecœur (au détriment de certains de ses subordonnés), estimant que, selon les analystes, l'assassinat de Saddam entraînerait la chute de l'État. Il aurait dit au président qu'il était "la clé de voûte, sans lui tout s'écroule" (Tenet a contesté cette version des faits)[1].
Saddam Hussein a survécu à une demi-douzaine de complots visant à le tuer. Dans les années 90, les États-Unis ont lancé des attaques de missiles contre des lieux fréquentés par Saddam Hussein, et plusieurs membres de l'armée irakienne ont été brièvement manipulés, avant d'être rapidement purgés par le dictateur. De nombreux complots de la CIA et du Mossad avaient été planifiés, mais toutes ces opérations ont été abandonnées en raison de la nature de plus en plus évasive du dirigeant irakien, qui utilisait des doublures, arrivait souvent en retard aux réunions ou ne s'y rendait pas du tout et était devenu beaucoup plus reclus, apparemment par crainte d'une tentative d'assassinat américaine, négligeant de communiquer par téléphone et s'appuyant sur une ligne de communication informelle avec ses subalternes.

Portrait de Saddam Hussein en Irak
L'administration a utilisé l'enquête de la Chambre des représentants pour attaquer l'Irak et les démocrates en les accusant d'être indulgents à l'égard de Saddam, rappelant au public ses méfaits, les massacres de Kurdes et de Chiites, l'invasion du Koweït, les incendies de pétrole, la mort de militaires américains, les complots visant à assassiner des Américains et les liens avec des groupes terroristes qui avaient planifié des attentats aux États-Unis et tué des Américains à l'étranger. Le président Bush a déclaré à la presse : "Indépendamment de ce que disent certains membres du Congrès ou des médias, nous devons arrêter ce dangereux tueur".
La dernière étape de Wolverine consistait en une mission militaire secrète menée par des exilés irakiens spécialement entraînés, surnommés les Scorpions. Contrairement aux forces d'exil habituelles de la FIF, les Scorpions étaient généralement kurdes et avaient suivi une formation spécialisée, et certains avaient des liens avec des groupes d'opposition à l'intérieur de l'Irak. Les Scorpions représentaient les ressources les mieux entraînées de la CIA à l'intérieur et à l'extérieur de l'Irak, qui menaient l'essentiel des exercices d'espionnage et de sabotage, ainsi que l'élaboration de cibles pour les frappes américaines. En cas d'invasion américaine, les Scorpions étaient censés contribuer à créer le chaos, mais depuis le report de l'invasion, leur mission a radicalement changé. Les Scorpions ont été chargés de déclencher le soulèvement prévu, 80 hommes équipés de matériel soviétique et déguisés en soldats irakiens prendraient le contrôle d'une base aérienne irakienne près de la frontière koweïtienne, à l'extérieur de la ville de Bassorah, et diffuseraient leur message, donnant l'impression qu'un soulèvement interne est déjà en cours[2].
Avec la frappe de décapitation et la révolte interne, le DoD pensait que le peuple irakien aurait amplement l'occasion de se révolter et de chasser les restes des forces de Saddam. Il s'agissait d'un plan radical, mais il représentait un grand pas en arrière pour les partisans de la ligne dure et il a été bien accueilli par le président. Il y avait des détracteurs, des juristes et des diplomates qui craignaient que le président n'enfreigne le droit international et national, mais après une année de division interne sur la politique irakienne, l'administration a opté pour Wolverine, une action rapide et décisive aux conséquences gérables pour elle sur le plan politique et mondial. Pour Bush, c'était quelque chose qu'il fallait faire, il n'allait pas reculer devant Saddam[3].
Le 2 mai 2004, les services de renseignement américains ont signalé que Saddam Hussein allait diriger une réunion de son équipe de sécurité nationale depuis un complexe situé dans la banlieue de Bagdad, pour la première fois depuis le début de la campagne de bombardements Desert Badger, il y a près d'un an. Il s'agissait de la première véritable occasion de frapper Saddam et elle intervenait un mois après l'interview de Hussain aux États-Unis, qui avait exaspéré le président et contraint l'équipe de sécurité nationale à prendre des mesures pour frapper. Après la confirmation de l'arrivée de Saddam et de son prochain discours, le président George W. Bush a ordonné les frappes.
Publiquement, les frappes étaient une nouvelle série de punitions, ordonnées pour démolir l'infrastructure terroriste. La sécurité et la profondeur potentielle de l'enceinte supposée signifiaient que les missiles conventionnels laisseraient le président indemne, se contentant de démolir la couche superficielle. Pour détruire correctement le site, des avions de combat furtifs devraient larguer des bombes de type "bunker-buster". Les deux jets devraient pénétrer dans l'espace aérien irakien sans protection, en traversant le golfe Persique orageux depuis le Qatar, en étant ravitaillés en vol à la frontière irakienne, puis en traversant la section la plus lourdement défendue de l'espace aérien irakien. Leur seule défense était une couverture fournie par des frappes dans la zone d'exclusion aérienne et quelques drones pour attirer l'attention des forces irakiennes. Une heure et demie après que l'ordre a été donné, les bombes ont été larguées et les avions se sont éloignés, toujours très seuls dans l'espace aérien ennemi, cherchant à s'échapper et à se ravitailler en carburant, lorsque le ravitailleur est entré en contact radio avec un pilote d'avion à réaction et lui a demandé comment les choses s'étaient déroulées. Le pilote a répondu : "Je vous le dirai quand je saurai ce que nous avons touché".

(A gauche) Avion furtif au-dessus de l'Irak, (A droite) position d'attaque du complexe.
Des explosifs d'une masse de 8000 livres ont frappé le complexe qui était censé contenir des membres du gouvernement irakien, dont Saddam Hussein. Mais il n'y avait aucun moyen de savoir si quelqu'un avait été tué lors de cette attaque. Au lendemain de l'attentat, la panique s'est emparée du gouvernement irakien, les forces armées s'efforçant de communiquer entre elles et Bagdad se préparant à d'autres attaques. Une fois les bombardements terminés, le reste de l'opération Wolverine a débuté. La radio, la télévision et les tracts de propagande américains rendent compte de la frappe en indiquant que le président Hussein avait été " gravement blessé ". Le président Bush a fait une brève déclaration à la presse en expliquant que le bombardement américain s'inscrivait dans le cadre d'une " stratégie américaine de routine visant à épuiser les capacités de guerre de l'Irak et à détruire sa capacité à faire régner la terreur ", ajoutant que l'action était " nécessaire et juste, les tueurs ne peuvent se soustraire à la justice ". La déclaration du président ne mentionnait pas la cible de l'opération et il n'y avait toujours pas de confirmation définitive de la mort de Saddam.
La déclaration du président ressemblait à celle faite par son père après la guerre du Golfe, appelant directement le peuple irakien à agir. "Seul le peuple irakien a la capacité de prendre les mesures qui mettraient fin à cette situation, qui réuniraient nos nations, qui élimineraient les tueurs et les dictateurs qui les gouvernent, qui construiraient un Irak libre". Alors que ses paroles résonnaient dans les oreilles des Américains et des Irakiens, les forces "Scorpion" ont franchi la frontière à bord d'hélicoptères de transport soviétique et ont convergé vers la piste d'atterrissage d'Az-Zubayr. La piste d'atterrissage a été facilement prise par les exilés bien armés et ils ont rapidement commencé à diffuser leur propre message appelant au soulèvement, un message qui a également été repris par la propagande américaine et diffusé : "Saddam et ses fils sont des criminels et l'armée irakienne appelle le peuple irakien à les renverser et à descendre dans la rue".

(A gauche) Hélicoptère militaire irakien, (A droite) Point de frappe Scorpion
Le monde entier a réagi avec stupeur : hormis quelques échanges verbaux, il n'y a pas eu d'escalade sérieuse entre les États-Unis et l'Irak depuis la fin des inspections de l'ONU. Le président avait donné très peu d'informations aux alliés de l'Amérique, craignant que quelqu'un ne prévienne les Irakiens. Le monde et le public américain ont réagi comme ils l'ont toujours fait, avec la consternation de ceux qui s'opposaient à l'unilatéralisme de Bush et les applaudissements de ceux qui le soutenaient. Mais personne au sein de l'administration n'écoutait les protestations de l'ONU ou de quelques libéraux du Congrès, tous attendaient avec impatience de connaître les résultats des frappes militaires et la réaction du peuple irakien.
Le président a également attendu plus d'informations lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien Kim Beazley. Les deux hommes avaient eu une histoire difficile: Beazley avait été un partisan global de la politique étrangère du président et avait rejoint une alliance antiterroriste informelle réunissant les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie pour collaborer en matière de renseignement afin de contrer les groupes terroristes islamiques au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, mais Beazley avait été contraint de retirer son soutien à une invasion de l'Irak en raison de l'opposition intérieure. Lors de la réunion, "Bomber" Beazley s'est montré très intéressé par la frappe américaine,il s'est alors de nouveau engagé dans une alliance continue avec les États-Unis et a partagé son espoir en privé avec Bush : "Le régime des voyous de Saddam sera renversé avec le soutien du peuple irakien".

Le Premier ministre Kim Beazley rencontre le président George Bush
Le décor était planté depuis un an, l'armée irakienne avait été malmenée, incapable de s'organiser dans la majeure partie du pays sous l'omniprésence de l'armée de l'air américaine qui les surveillait, le complexe militaire du président était en flammes et le peuple irakien opprimé avait été poussé par un gouvernement américain favorable et une centaine de « soldats irakiens » à se révolter. Le monde a regardé, attendant de voir si le peuple irakien saisirait cette opportunité, mais dans la nuit du 2, le monde n'avait pas encore grand-chose à voir. La CIA a alimenté des informations faisant état de civils rebelles violant le couvre-feu et d'autres signes de protestation. Certaines milices chiites sont sorties à grands pas au mépris de la loi baasiste pour pratiquer leur foi et diffuser de la littérature illégale, mais ces histoires se sont ajoutées à celles d'une répression continue.
Des milliers de soldats irakiens, de policiers et de fidèles Fedayin se sont déplacés rue après rue, maison après maison pour imposer des couvre-feux, tabasser les manifestants et tirer sur tous ceux qui manifestaient. A l'annonce de l'occupation d'un bâtiment gouvernemental à Nassiriya, les forces du régime l'ont rasé avec des mortiers. Et à Bassorah, où les émissions des Scorpions pouvaient encore être entendues, les forces du régime ont coupé le courant, détruit les lignes téléphoniques et érigé des barricades pour se préparer à une éventuelle invasion. Il y a eu quelques signes de confusion, les Fedayin ont affronté les militaires dans la ville portuaire, perplexes quant à la possibilité d'un coup d'État et ont détruit quelques hélicoptères gouvernementaux. Le bruit des coups de feu, des échanges de tirs ou des exécutions sommaires s'est poursuivi toute la nuit.
Juste avant que la lumière du matin ne se lève sur le berceau de la civilisation, une voix familière s'est glissée sur les ondes nationales irakiennes : « Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant, souvenez-vous de ses paroles avec ce message : « Je suis avec vous donnez de la fermeté aux croyants . Je vais semer la terreur dans le cœur des incroyants : frappez-les au-dessus de leur cou et frappez-les de tous les bouts de leurs doigts.… Vive le grand Irak et sa vaillante armée de moudjahidines. Vive notre glorieuse nation arabe. Les misérables agresseurs et les traîtres infidèles seront éteints », a déclaré la voix de Saddam Hussein.
L'opération Wolverine était déjà un échec. L’objectif était hors de portée, l’apparente survie de Saddam et la diffusion de sa voix étaient les clous du cercueil. En dehors de Bassorah, il n’y avait aucun signe d’effondrement du commandement irakien ou de révolte militaire. Les protestations irakiennes ne se sont jamais intensifiées de manière significative pour perturber le régime, n’ayant pas réussi à atteindre celui des soulèvements de 99 ou 91 et n’ont pas nécessité d’effusion de sang importante pour les réprimer. La frustration était évidente dans l’aile ouest, alors que les membres du cabinet et les conseillers qui avaient été amenés à croire que le peuple irakien implorait une opportunité de renverser Saddam, ont été visiblement consternés par les résultats.
Quant aux « Scorpions » d’élite, il n’a pas fallu longtemps pour que leurs forces soient encerclées par des bandes de troupes irakiennes, chargées d’éliminer toute opposition par le président (et soi-disant le prophète) lui-même. Isolés et sans ordres, les Scorpions étaient condamnés. La CIA a toujours souhaité qu’une telle opération ne soit l’étincelle d’une plus grande révolte et serait prête à fournir un soutien aérien pour détruire l’armée irakienne. Mais avec l’échec de l’opération, les Irakiens n’ont pas eu besoin d’envoyer des divisions organisées dans la région, s’appuyant plutôt sur leurs fidèles milices locales pour reprendre la base aérienne avec des armes légères. Il n’y avait aucune chance d’extraire les soldats en toute sécurité sans exposer les soldats américains à un risque grave d’être eux-mêmes abattus. Ne voulant pas aider ou extraire les Scorpions, ils ont été abandonnés à leur sort lorsque les forces loyales de Saddam se sont rapprochées, attaquant la base aérienne, détruisant leurs hélicoptères, tuant la plupart des exilés et capturant le reste.

(À gauche) La police irakienne célèbre, (À droite) la capture des « Scorpions » irakiens
L’opération Wolverine a été un échec désastreux ; l’analyse post-opération ainsi que l’enquête du Congrès ont montré qu’à chaque instant, les États-Unis n’avaient pas réussi à comprendre leur manque d'infos en Irak. La CIA et le ministère de la Défense ont continué de s'appuyer sur des évaluations inexactes de la population irakienne et de la structure du pouvoir de Saddam. Les informateurs américains étaient le plus souvent des agents doubles fournissant de fausses informations, mentant délibérément pour fuir le pays ou étant eux-mêmes totalement mal informés. Le ministère de la Défense a été critiqué pour sa confiance continue dans les informations manifestement inexactes fournies par des groupes en exil, y compris le fraudeur Achmed Chalabi, dénoncé publiquement, qui a fourni des informations sur la prétendue capacité des irakiens à renverser le pouvoir de Saddam (une enquête du Congrès a révélé que l'Iran payait également Chalabi pour le mêmes informations).
La plupart des critiques ont d'abord été adressées à la frappe de Bagdad, lorsque le ministère de la Défense a finalement été contraint d'admettre qu'il n'y avait aucune confirmation de l'existence d'un bunker, ni si Saddam Hussein avait jamais été présent dans l'enceinte le jour en question. (l'informateur qui a fourni cette information cruciale, un garde du palais du président a ensuite été tué pour avoir conspiré contre le régime), en outre, la frappe combinée aurait été un échec complet, un avion furtif avait complètement raté sa cible et l'autre seulement détruit le mur extérieur de l'enceinte.
Cependant, certains ont avancés les mérites des frappes de missiles de croisière dans le sud, contre les mouvements militaires irakiens, comme étant bien plus efficaces. La réaction immédiate du régime à l'annonce d'un soulèvement potentiel a fait partir quelques colonnes de troupes irakiennes, dont une formation de la Garde républicaine depuis une base de commandement à Amrah. Ces formations ont été frappées sous la base de la zone d'exclusion aérienne, causant des pertes importantes et quelques morts notables, dont le gouverneur de Bassorah, Walid Tawfiq et le chef de la Garde républicaine Qusay Hussein (un des fils de Saddam), les deux décès ont été confirmés dans une émission ultérieure de Saddam qui les a salués comme des martyrs censés se rendre dans le sud pour vaincre un soulèvement potentiel, le président Bush, en revanche, a salué la mort de Qusay, le qualifiant d'« auteur de génocide » et a déclaré que les frappes étaient nécessaires pour empêcher l'Irak de tuer davantage de chiites.

(À gauche) {5}Qusay Hussain, l'enfant du milieu de Saddam et chef des Fedayin, (à droite) Walid Tawfiq, gouverneur de Bassora
Le rôle des Scorpions a mis plus de temps à être évoqué aux yeux du public, mais une enquête du Congrès, des fuites et un article de l’Associated Press en 2005 ont détaillé l’étendue du rôle des États-Unis dans la mission, révélant même le site du Nevada où les Scorpions ont été entraînés. Il a également été révélé que l'opération était largement prédite comme un échec par de nombreux membres de la CIA qui ont ridiculisé les Scorpions en les qualifiant de non-professionnels et ont qualifié l'ensemble de l'incident de « Baie des Chèvres » [4], une parodie de la Baie des Cochons, la tentative ratée d’envahir Cuba et de renverser Castro en utilisant des exilés en 1961.
L’opération a été presque unanimement condamnée par le monde et par les opposants politiques de l’administration, qui ont reproché à Bush d’avoir mené une action militaire apparemment sans prétexte ni autorisation suffisante, tout en ignorant le consensus militaire ou politique. Le candidat démocrate de 2004, John Edwards, a qualifié les actions du président de « absurdes ». « Le Congrès a été clair envers le président : s'il a des raisons légitimes de recourir à la force militaire, il doit partager ces raisons avec le Congrès. ». Le Sénat américain, qui avait déjà ouvert une enquête sur d'éventuelles tentatives de l'administration visant à tromper le public sur l'Irak, a ouvert une nouvelle ligne d'attaque contre le ministère de la Défense, que certains responsables, en particulier le secrétaire Rumsfeld et son adjoint Wolfowitz, continuaient de promouvoir de manière non vérifiée. informations et approvisionnement. Se concentrant sur leur relation avec Achmed Chalabi, les millions fournis à son groupe en exil, les antécédents criminels de Chalabi et ses liens avec le gouvernement iranien. La « Baie des Chèvres » est devenue un fiasco pour l'administration, perçue comme une erreur par la plupart du public avec des membres clés de l'administration sous le microscope, le président a décidé d'agir en demandant la démission de Paul Wolfowitz et du directeur de la CIA George Tenet accusé par beaucoup de promotion de l'Opération Wolverine au-dessus de la tête de ses subordonnés. Wolfowitz a été remplacé par le secrétaire à la Marine Gordon England et Tenet a été remplacé par le diplomate de carrière et expert en lutte contre le terrorisme Paul « Jerry » Bremer.

(De gauche à droite) L'ancien secrétaire adjoint à la Défense Paul Wolfowitz et son successeur Navy Gordon, le président George W Bush, l'ancien directeur du renseignement central George Tenet et son successeur Paul Bremer
[1] George Tenet était divisé sur la politique en Irak, cédant à l'invasion pour conserver son emploi, ici il cède à ce plan à la place.
[2] C'était l'un des nombreux plans réels visant à formuler un casus belli contre l'Irak, IOTL, les scorpions sont devenus une force de police militaire/une équipe de torture.
[3] il ressort clairement de ses propres écrits que George Bush a été très personnellement impliqué dans la décision de renverser Sadda,
[4] c'est ainsi que l'ancien commandant du CENTCOM Anthony Zinni a décrit une telle opération
[5] A
[6] Mesdames et messieurs, nous l'avons eu.
Saddam Hussein, le dictateur irakien de longue date, a accordé un rare entretien approfondi aux médias occidentaux. Le président était d'humeur optimiste et il n'était pas difficile de comprendre pourquoi, de son point de vue, il avait remporté une grande victoire sur les États-Unis. Les Nations unies venaient de terminer leur enquête, concluant qu'elles n'avaient trouvé aucune preuve que l'Irak avait violé les lois internationales concernant ses programmes d'armement, et les inspecteurs s'apprêtaient à quitter le pays.
Ce fut une longue interview au cours de laquelle le dictateur fixait parfois l'objectif de la caméra ou l'intervieweur Dan Rather, parfois il tapait du poing sur la table et, par l'intermédiaire d'un traducteur, il exprimait sa conviction absolue qu'il resterait le président de l'Irak et que les États-Unis ne conquerraient jamais le peuple irakien : "En dépit de leurs mensonges ou de leur prétendu statut de superpuissance, le peuple irakien ne se soumettra jamais à une force américaine impie, et maintenant nous en avons convaincu le monde entier !"
Interview de Saddam Hussein à 60 minutes
Un an s'est écoulé depuis le début de la crise du désarmement irakien, lorsqu'un avion américain s'est écrasé ou a été abattu dans le désert irakien, tuant le pilote et son RINO ce qui a déclenché des tensions entre les États-Unis et l'Irak, Les États-Unis accusaient Saddam de violer les accords des Nations unies et de détenir de prétendues "armes de destruction massive", mais après des mois de frappes de missiles sur l'Irak, le grand mastodonte américain avait été contraint de faire marche arrière, confronté à ses alliés et au Congrès contrôlé par les démocrates, qui s'opposaient à l'intervention du président en Irak.
Pendant des mois, Saddam a tenu les mêmes propos jubilatoires, se moquant du président Bush, l'appelant le "petit Bush" et déclarant qu'il était bien plus intelligent que le "chimpanzé président". Ses interviews et ses railleries ne sont pas passées inaperçues à la Maison Blanche.
Le président américain, malgré les efforts des membres de son administration pour tenter de tourner la page de l'Irak et de se lancer dans la course à la réélection, en avait été empêché par de puissants partisans qui continuaient à réclamer la chute du régime baasiste. La politique américaine a commencé à refléter cette politique de plus en plus dure. Les zones d'exclusion aérienne dans le nord et le sud de l'Irak sont devenues encore plus strictes et les règles d'engagement ont été ouvertes, permettant aux forces de la coalition de frapper toute tentative d'organisation des forces irakiennes dans les régions. La politique d'application stricte a été décrite comme une "zone d'exclusion" destinée à empêcher le gouvernement irakien de coordonner ses forces dans les régions kurdes ou méridionales. Cette politique a été défendue par les partisans de la ligne dure de l'administration Bush depuis le début. Les jets américains et britanniques ont ciblé les bases militaires (en grande partie détruites au cours de la campagne de l'année précédente), les lignes de communication et même les convois militaires et les mouvements de troupes. Les campagnes de bombardement et l'application de sanctions sévères ont dévasté l'infrastructure et la qualité de vie des Irakiens, entraînant une pauvreté routinière en matière d'électricité, de nourriture et d'eau.
La "zone interdite" envisagée par le secrétaire adjoint à la défense, Paul Wolfowitz, visait à briser l'emprise de Bagdad sur le sud de l'Irak, comme elle l'avait fait dans le nord, dans l'espoir de déclencher une sorte de soulèvement contre Saddam, comme cela s'était produit en 1991 ou en 1999, ou même un coup d'État militaire, comme en 1996. Mais contrairement au néocon Wolfowitz, la plupart des fonctionnaires étaient convaincus que l'Irak continuerait à défier les États-Unis, que Saddam contrôlait encore suffisamment de forces militaires, paramilitaires et policières pour imposer son autorité dans le sud de l'Irak et que les chiites n'étaient pas en mesure de se soulever, malgré les efforts croissants de la CIA pour semer les graines de la discorde par le biais de pots-de-vin et de propagande, qui inondait les régions kurdes et chiites. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'IFRA (Iraqi Freedom Activities), une série d'actions secrètes autorisées par le président et destinées à renverser la dictature irakienne.
Le président Bush avait déjà ordonné une action militaire secrète dans la région kurde pour aider les forces kurdes Peshmerga à chasser les forces islamistes radicales campées dans la région frontalière entre le territoire kurde et l'Iran. Cette action avait pour but de permettre aux forces kurdes de se joindre à une éventuelle guerre ou d'aider à un soulèvement contre l'Irak de Saddam, mais elle s'est soldée par une victoire kurde et par la fuite des militants sur le sol iranien.
Les combattants kurdes à gauche et la zone de l'offensive kurde à gauche.
Le gouvernement irakien a saisi toutes les occasions pour dénoncer publiquement "l'ingérence américaine" en montrant de prétendus mouchards et en rassemblant les traîtres présumés pour les exécuter rapidement et brutalement, notamment plusieurs colonels irakiens accusés d'avoir fourni des informations militaires aux Américains et qui ont été traînés jusqu'à la mort dans le désert. Le jeu du chat et de la souris entre les États-Unis et les services de renseignement irakiens a été brutal, des sommes importantes ayant été utilisées pour corrompre et soutirer des actifs avant que la milice des Fedayins ne puisse les éliminer. L'ampleur des pots-de-vin a été telle que dans certains villages, le dollar américain avait remplacé le dinar irakien en tant que monnaie locale.
Washington craignait que ces opérations ne dépassent les capacités des services de renseignement américains ou que le nombre d'opérations ne mette la pression sur la CIA et n'aide les efforts de contre-espionnage irakiens. En outre, les opérations n'avaient pas d'objectif clair en dehors de la déstabilisation et il n'était pas évident que ces efforts soient couronnés de succès. Malgré les zones interdites à la circulation, l'influence de Bagdad dans le sud n'a pas faibli et les tentatives de protestation ont été réprimées tout aussi rapidement par la police et les milices locales. Le vice-président Cheney et le secrétaire à la défense Rumsfeld, frustrés par les désaccords entre la CIA et le département d'État, n'ont pas tenu compte de ces désaccords et ont transmis leurs directives directement au président.
L'opération Wolverine, autorisée par le président l'année précédente, visait à obtenir un changement de régime en Irak, mais au lieu d'une invasion américaine, que l'opinion publique et le président jugeaient désormais trop risquée sur le plan politique, Wolverine a prévu une frappe chirurgicale pour éliminer Saddam Hussein et décapiter le gouvernement irakien. La mort du président Saddam Hussein serait utilisée pour déclencher une révolte dans le sud de l'Irak, aidée par une application stricte de la zone d'interdiction de circuler, et ce qui resterait des fidèles à l'ancien régime serait chassé du sud. Après cela, les plans sont restés vagues, peut-être les Etats-Unis étendraient-ils leurs opérations aériennes à l'ensemble de l'Irak, ce qui permettrait la fin totale de l'Etat baasiste, et les forces spéciales américaines au Koweït pourraient entrer pour aider le nouveau sud de l'Irak, qui serait autonome. Ces aléas furent l'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'ampleur de l'opération ne fut jamais discutée ou prise au sérieux par de nombreux officiers de renseignement ou diplomates de carrière, sauf entre ses architectes et le président. Les principaux départements ministériels n'étant que vaguement au courant du complot visant à fomenter un coup d'État interne, les partisans de la ligne dure craignaient que le secrétaire d'État Colin Powell ou peut-être la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice ne tentent de dissuader une tentative d'assassinat du dictateur, mettant en garde contre les conséquences inconnues, l'absence d'un successeur clair et les allégations selon lesquelles les États-Unis enfreindraient les règles internationales et nationales en vigueur.
Le directeur de la CIA, George Tenet, a soutenu l'opération à contrecœur (au détriment de certains de ses subordonnés), estimant que, selon les analystes, l'assassinat de Saddam entraînerait la chute de l'État. Il aurait dit au président qu'il était "la clé de voûte, sans lui tout s'écroule" (Tenet a contesté cette version des faits)[1].
Saddam Hussein a survécu à une demi-douzaine de complots visant à le tuer. Dans les années 90, les États-Unis ont lancé des attaques de missiles contre des lieux fréquentés par Saddam Hussein, et plusieurs membres de l'armée irakienne ont été brièvement manipulés, avant d'être rapidement purgés par le dictateur. De nombreux complots de la CIA et du Mossad avaient été planifiés, mais toutes ces opérations ont été abandonnées en raison de la nature de plus en plus évasive du dirigeant irakien, qui utilisait des doublures, arrivait souvent en retard aux réunions ou ne s'y rendait pas du tout et était devenu beaucoup plus reclus, apparemment par crainte d'une tentative d'assassinat américaine, négligeant de communiquer par téléphone et s'appuyant sur une ligne de communication informelle avec ses subalternes.
Portrait de Saddam Hussein en Irak
L'administration a utilisé l'enquête de la Chambre des représentants pour attaquer l'Irak et les démocrates en les accusant d'être indulgents à l'égard de Saddam, rappelant au public ses méfaits, les massacres de Kurdes et de Chiites, l'invasion du Koweït, les incendies de pétrole, la mort de militaires américains, les complots visant à assassiner des Américains et les liens avec des groupes terroristes qui avaient planifié des attentats aux États-Unis et tué des Américains à l'étranger. Le président Bush a déclaré à la presse : "Indépendamment de ce que disent certains membres du Congrès ou des médias, nous devons arrêter ce dangereux tueur".
La dernière étape de Wolverine consistait en une mission militaire secrète menée par des exilés irakiens spécialement entraînés, surnommés les Scorpions. Contrairement aux forces d'exil habituelles de la FIF, les Scorpions étaient généralement kurdes et avaient suivi une formation spécialisée, et certains avaient des liens avec des groupes d'opposition à l'intérieur de l'Irak. Les Scorpions représentaient les ressources les mieux entraînées de la CIA à l'intérieur et à l'extérieur de l'Irak, qui menaient l'essentiel des exercices d'espionnage et de sabotage, ainsi que l'élaboration de cibles pour les frappes américaines. En cas d'invasion américaine, les Scorpions étaient censés contribuer à créer le chaos, mais depuis le report de l'invasion, leur mission a radicalement changé. Les Scorpions ont été chargés de déclencher le soulèvement prévu, 80 hommes équipés de matériel soviétique et déguisés en soldats irakiens prendraient le contrôle d'une base aérienne irakienne près de la frontière koweïtienne, à l'extérieur de la ville de Bassorah, et diffuseraient leur message, donnant l'impression qu'un soulèvement interne est déjà en cours[2].
Avec la frappe de décapitation et la révolte interne, le DoD pensait que le peuple irakien aurait amplement l'occasion de se révolter et de chasser les restes des forces de Saddam. Il s'agissait d'un plan radical, mais il représentait un grand pas en arrière pour les partisans de la ligne dure et il a été bien accueilli par le président. Il y avait des détracteurs, des juristes et des diplomates qui craignaient que le président n'enfreigne le droit international et national, mais après une année de division interne sur la politique irakienne, l'administration a opté pour Wolverine, une action rapide et décisive aux conséquences gérables pour elle sur le plan politique et mondial. Pour Bush, c'était quelque chose qu'il fallait faire, il n'allait pas reculer devant Saddam[3].
Le 2 mai 2004, les services de renseignement américains ont signalé que Saddam Hussein allait diriger une réunion de son équipe de sécurité nationale depuis un complexe situé dans la banlieue de Bagdad, pour la première fois depuis le début de la campagne de bombardements Desert Badger, il y a près d'un an. Il s'agissait de la première véritable occasion de frapper Saddam et elle intervenait un mois après l'interview de Hussain aux États-Unis, qui avait exaspéré le président et contraint l'équipe de sécurité nationale à prendre des mesures pour frapper. Après la confirmation de l'arrivée de Saddam et de son prochain discours, le président George W. Bush a ordonné les frappes.
Publiquement, les frappes étaient une nouvelle série de punitions, ordonnées pour démolir l'infrastructure terroriste. La sécurité et la profondeur potentielle de l'enceinte supposée signifiaient que les missiles conventionnels laisseraient le président indemne, se contentant de démolir la couche superficielle. Pour détruire correctement le site, des avions de combat furtifs devraient larguer des bombes de type "bunker-buster". Les deux jets devraient pénétrer dans l'espace aérien irakien sans protection, en traversant le golfe Persique orageux depuis le Qatar, en étant ravitaillés en vol à la frontière irakienne, puis en traversant la section la plus lourdement défendue de l'espace aérien irakien. Leur seule défense était une couverture fournie par des frappes dans la zone d'exclusion aérienne et quelques drones pour attirer l'attention des forces irakiennes. Une heure et demie après que l'ordre a été donné, les bombes ont été larguées et les avions se sont éloignés, toujours très seuls dans l'espace aérien ennemi, cherchant à s'échapper et à se ravitailler en carburant, lorsque le ravitailleur est entré en contact radio avec un pilote d'avion à réaction et lui a demandé comment les choses s'étaient déroulées. Le pilote a répondu : "Je vous le dirai quand je saurai ce que nous avons touché".
(A gauche) Avion furtif au-dessus de l'Irak, (A droite) position d'attaque du complexe.
Des explosifs d'une masse de 8000 livres ont frappé le complexe qui était censé contenir des membres du gouvernement irakien, dont Saddam Hussein. Mais il n'y avait aucun moyen de savoir si quelqu'un avait été tué lors de cette attaque. Au lendemain de l'attentat, la panique s'est emparée du gouvernement irakien, les forces armées s'efforçant de communiquer entre elles et Bagdad se préparant à d'autres attaques. Une fois les bombardements terminés, le reste de l'opération Wolverine a débuté. La radio, la télévision et les tracts de propagande américains rendent compte de la frappe en indiquant que le président Hussein avait été " gravement blessé ". Le président Bush a fait une brève déclaration à la presse en expliquant que le bombardement américain s'inscrivait dans le cadre d'une " stratégie américaine de routine visant à épuiser les capacités de guerre de l'Irak et à détruire sa capacité à faire régner la terreur ", ajoutant que l'action était " nécessaire et juste, les tueurs ne peuvent se soustraire à la justice ". La déclaration du président ne mentionnait pas la cible de l'opération et il n'y avait toujours pas de confirmation définitive de la mort de Saddam.
La déclaration du président ressemblait à celle faite par son père après la guerre du Golfe, appelant directement le peuple irakien à agir. "Seul le peuple irakien a la capacité de prendre les mesures qui mettraient fin à cette situation, qui réuniraient nos nations, qui élimineraient les tueurs et les dictateurs qui les gouvernent, qui construiraient un Irak libre". Alors que ses paroles résonnaient dans les oreilles des Américains et des Irakiens, les forces "Scorpion" ont franchi la frontière à bord d'hélicoptères de transport soviétique et ont convergé vers la piste d'atterrissage d'Az-Zubayr. La piste d'atterrissage a été facilement prise par les exilés bien armés et ils ont rapidement commencé à diffuser leur propre message appelant au soulèvement, un message qui a également été repris par la propagande américaine et diffusé : "Saddam et ses fils sont des criminels et l'armée irakienne appelle le peuple irakien à les renverser et à descendre dans la rue".
(A gauche) Hélicoptère militaire irakien, (A droite) Point de frappe Scorpion
Le monde entier a réagi avec stupeur : hormis quelques échanges verbaux, il n'y a pas eu d'escalade sérieuse entre les États-Unis et l'Irak depuis la fin des inspections de l'ONU. Le président avait donné très peu d'informations aux alliés de l'Amérique, craignant que quelqu'un ne prévienne les Irakiens. Le monde et le public américain ont réagi comme ils l'ont toujours fait, avec la consternation de ceux qui s'opposaient à l'unilatéralisme de Bush et les applaudissements de ceux qui le soutenaient. Mais personne au sein de l'administration n'écoutait les protestations de l'ONU ou de quelques libéraux du Congrès, tous attendaient avec impatience de connaître les résultats des frappes militaires et la réaction du peuple irakien.
Le président a également attendu plus d'informations lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien Kim Beazley. Les deux hommes avaient eu une histoire difficile: Beazley avait été un partisan global de la politique étrangère du président et avait rejoint une alliance antiterroriste informelle réunissant les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie pour collaborer en matière de renseignement afin de contrer les groupes terroristes islamiques au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, mais Beazley avait été contraint de retirer son soutien à une invasion de l'Irak en raison de l'opposition intérieure. Lors de la réunion, "Bomber" Beazley s'est montré très intéressé par la frappe américaine,il s'est alors de nouveau engagé dans une alliance continue avec les États-Unis et a partagé son espoir en privé avec Bush : "Le régime des voyous de Saddam sera renversé avec le soutien du peuple irakien".
Le Premier ministre Kim Beazley rencontre le président George Bush
Le décor était planté depuis un an, l'armée irakienne avait été malmenée, incapable de s'organiser dans la majeure partie du pays sous l'omniprésence de l'armée de l'air américaine qui les surveillait, le complexe militaire du président était en flammes et le peuple irakien opprimé avait été poussé par un gouvernement américain favorable et une centaine de « soldats irakiens » à se révolter. Le monde a regardé, attendant de voir si le peuple irakien saisirait cette opportunité, mais dans la nuit du 2, le monde n'avait pas encore grand-chose à voir. La CIA a alimenté des informations faisant état de civils rebelles violant le couvre-feu et d'autres signes de protestation. Certaines milices chiites sont sorties à grands pas au mépris de la loi baasiste pour pratiquer leur foi et diffuser de la littérature illégale, mais ces histoires se sont ajoutées à celles d'une répression continue.
Des milliers de soldats irakiens, de policiers et de fidèles Fedayin se sont déplacés rue après rue, maison après maison pour imposer des couvre-feux, tabasser les manifestants et tirer sur tous ceux qui manifestaient. A l'annonce de l'occupation d'un bâtiment gouvernemental à Nassiriya, les forces du régime l'ont rasé avec des mortiers. Et à Bassorah, où les émissions des Scorpions pouvaient encore être entendues, les forces du régime ont coupé le courant, détruit les lignes téléphoniques et érigé des barricades pour se préparer à une éventuelle invasion. Il y a eu quelques signes de confusion, les Fedayin ont affronté les militaires dans la ville portuaire, perplexes quant à la possibilité d'un coup d'État et ont détruit quelques hélicoptères gouvernementaux. Le bruit des coups de feu, des échanges de tirs ou des exécutions sommaires s'est poursuivi toute la nuit.
Juste avant que la lumière du matin ne se lève sur le berceau de la civilisation, une voix familière s'est glissée sur les ondes nationales irakiennes : « Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Compatissant, souvenez-vous de ses paroles avec ce message : « Je suis avec vous donnez de la fermeté aux croyants . Je vais semer la terreur dans le cœur des incroyants : frappez-les au-dessus de leur cou et frappez-les de tous les bouts de leurs doigts.… Vive le grand Irak et sa vaillante armée de moudjahidines. Vive notre glorieuse nation arabe. Les misérables agresseurs et les traîtres infidèles seront éteints », a déclaré la voix de Saddam Hussein.
L'opération Wolverine était déjà un échec. L’objectif était hors de portée, l’apparente survie de Saddam et la diffusion de sa voix étaient les clous du cercueil. En dehors de Bassorah, il n’y avait aucun signe d’effondrement du commandement irakien ou de révolte militaire. Les protestations irakiennes ne se sont jamais intensifiées de manière significative pour perturber le régime, n’ayant pas réussi à atteindre celui des soulèvements de 99 ou 91 et n’ont pas nécessité d’effusion de sang importante pour les réprimer. La frustration était évidente dans l’aile ouest, alors que les membres du cabinet et les conseillers qui avaient été amenés à croire que le peuple irakien implorait une opportunité de renverser Saddam, ont été visiblement consternés par les résultats.
Quant aux « Scorpions » d’élite, il n’a pas fallu longtemps pour que leurs forces soient encerclées par des bandes de troupes irakiennes, chargées d’éliminer toute opposition par le président (et soi-disant le prophète) lui-même. Isolés et sans ordres, les Scorpions étaient condamnés. La CIA a toujours souhaité qu’une telle opération ne soit l’étincelle d’une plus grande révolte et serait prête à fournir un soutien aérien pour détruire l’armée irakienne. Mais avec l’échec de l’opération, les Irakiens n’ont pas eu besoin d’envoyer des divisions organisées dans la région, s’appuyant plutôt sur leurs fidèles milices locales pour reprendre la base aérienne avec des armes légères. Il n’y avait aucune chance d’extraire les soldats en toute sécurité sans exposer les soldats américains à un risque grave d’être eux-mêmes abattus. Ne voulant pas aider ou extraire les Scorpions, ils ont été abandonnés à leur sort lorsque les forces loyales de Saddam se sont rapprochées, attaquant la base aérienne, détruisant leurs hélicoptères, tuant la plupart des exilés et capturant le reste.
(À gauche) La police irakienne célèbre, (À droite) la capture des « Scorpions » irakiens
L’opération Wolverine a été un échec désastreux ; l’analyse post-opération ainsi que l’enquête du Congrès ont montré qu’à chaque instant, les États-Unis n’avaient pas réussi à comprendre leur manque d'infos en Irak. La CIA et le ministère de la Défense ont continué de s'appuyer sur des évaluations inexactes de la population irakienne et de la structure du pouvoir de Saddam. Les informateurs américains étaient le plus souvent des agents doubles fournissant de fausses informations, mentant délibérément pour fuir le pays ou étant eux-mêmes totalement mal informés. Le ministère de la Défense a été critiqué pour sa confiance continue dans les informations manifestement inexactes fournies par des groupes en exil, y compris le fraudeur Achmed Chalabi, dénoncé publiquement, qui a fourni des informations sur la prétendue capacité des irakiens à renverser le pouvoir de Saddam (une enquête du Congrès a révélé que l'Iran payait également Chalabi pour le mêmes informations).
La plupart des critiques ont d'abord été adressées à la frappe de Bagdad, lorsque le ministère de la Défense a finalement été contraint d'admettre qu'il n'y avait aucune confirmation de l'existence d'un bunker, ni si Saddam Hussein avait jamais été présent dans l'enceinte le jour en question. (l'informateur qui a fourni cette information cruciale, un garde du palais du président a ensuite été tué pour avoir conspiré contre le régime), en outre, la frappe combinée aurait été un échec complet, un avion furtif avait complètement raté sa cible et l'autre seulement détruit le mur extérieur de l'enceinte.
Cependant, certains ont avancés les mérites des frappes de missiles de croisière dans le sud, contre les mouvements militaires irakiens, comme étant bien plus efficaces. La réaction immédiate du régime à l'annonce d'un soulèvement potentiel a fait partir quelques colonnes de troupes irakiennes, dont une formation de la Garde républicaine depuis une base de commandement à Amrah. Ces formations ont été frappées sous la base de la zone d'exclusion aérienne, causant des pertes importantes et quelques morts notables, dont le gouverneur de Bassorah, Walid Tawfiq et le chef de la Garde républicaine Qusay Hussein (un des fils de Saddam), les deux décès ont été confirmés dans une émission ultérieure de Saddam qui les a salués comme des martyrs censés se rendre dans le sud pour vaincre un soulèvement potentiel, le président Bush, en revanche, a salué la mort de Qusay, le qualifiant d'« auteur de génocide » et a déclaré que les frappes étaient nécessaires pour empêcher l'Irak de tuer davantage de chiites.
(À gauche) {5}Qusay Hussain, l'enfant du milieu de Saddam et chef des Fedayin, (à droite) Walid Tawfiq, gouverneur de Bassora
Le rôle des Scorpions a mis plus de temps à être évoqué aux yeux du public, mais une enquête du Congrès, des fuites et un article de l’Associated Press en 2005 ont détaillé l’étendue du rôle des États-Unis dans la mission, révélant même le site du Nevada où les Scorpions ont été entraînés. Il a également été révélé que l'opération était largement prédite comme un échec par de nombreux membres de la CIA qui ont ridiculisé les Scorpions en les qualifiant de non-professionnels et ont qualifié l'ensemble de l'incident de « Baie des Chèvres » [4], une parodie de la Baie des Cochons, la tentative ratée d’envahir Cuba et de renverser Castro en utilisant des exilés en 1961.
L’opération a été presque unanimement condamnée par le monde et par les opposants politiques de l’administration, qui ont reproché à Bush d’avoir mené une action militaire apparemment sans prétexte ni autorisation suffisante, tout en ignorant le consensus militaire ou politique. Le candidat démocrate de 2004, John Edwards, a qualifié les actions du président de « absurdes ». « Le Congrès a été clair envers le président : s'il a des raisons légitimes de recourir à la force militaire, il doit partager ces raisons avec le Congrès. ». Le Sénat américain, qui avait déjà ouvert une enquête sur d'éventuelles tentatives de l'administration visant à tromper le public sur l'Irak, a ouvert une nouvelle ligne d'attaque contre le ministère de la Défense, que certains responsables, en particulier le secrétaire Rumsfeld et son adjoint Wolfowitz, continuaient de promouvoir de manière non vérifiée. informations et approvisionnement. Se concentrant sur leur relation avec Achmed Chalabi, les millions fournis à son groupe en exil, les antécédents criminels de Chalabi et ses liens avec le gouvernement iranien. La « Baie des Chèvres » est devenue un fiasco pour l'administration, perçue comme une erreur par la plupart du public avec des membres clés de l'administration sous le microscope, le président a décidé d'agir en demandant la démission de Paul Wolfowitz et du directeur de la CIA George Tenet accusé par beaucoup de promotion de l'Opération Wolverine au-dessus de la tête de ses subordonnés. Wolfowitz a été remplacé par le secrétaire à la Marine Gordon England et Tenet a été remplacé par le diplomate de carrière et expert en lutte contre le terrorisme Paul « Jerry » Bremer.
(De gauche à droite) L'ancien secrétaire adjoint à la Défense Paul Wolfowitz et son successeur Navy Gordon, le président George W Bush, l'ancien directeur du renseignement central George Tenet et son successeur Paul Bremer
[1] George Tenet était divisé sur la politique en Irak, cédant à l'invasion pour conserver son emploi, ici il cède à ce plan à la place.
[2] C'était l'un des nombreux plans réels visant à formuler un casus belli contre l'Irak, IOTL, les scorpions sont devenus une force de police militaire/une équipe de torture.
[3] il ressort clairement de ses propres écrits que George Bush a été très personnellement impliqué dans la décision de renverser Sadda,
[4] c'est ainsi que l'ancien commandant du CENTCOM Anthony Zinni a décrit une telle opération
[5] A
[6] Mesdames et messieurs, nous l'avons eu.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Wow l'échec critique tant sur le plan militaire que politique.
Je ne sais pas où nous mène cette histoire, mais pour l'instant les tentative de l'administration Bush Jr sont assez pathétiques.
Je ne sais pas où nous mène cette histoire, mais pour l'instant les tentative de l'administration Bush Jr sont assez pathétiques.
_________________
« Ce n’est que devant l’épreuve, la vraie, celle qui met en jeu l’existence même, que les hommes cessent de se mentir et révèlent vraiment ce qu’ils sont. »
Alexandre Lang.
Au Bord de l'Abîme et au-delà
Uranium Colonel aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Et je reviens à la traduction de Geronimo après de longues semaines d'absence, m'excusant encore de ce retard 

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Rayan du Griffoul aime ce message
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 36: Flétrissure
Géorgie et Adjarie
Les montagnes de Géorgie étaient troublées. Malgré la révolution populaire qui avait réussi à renverser l'ancien régime autoritaire lors d'un soulèvement sans effusion de sang l'hiver précédent, remplaçant le régime autoritaire post-communiste par une démocratie libérale, le nouveau système était déjà menacé. Lorsque Mikhaïl Saakachvili a prêté serment en tant que président de la Géorgie en janvier, le pays était déjà fracturé. La Géorgie devait équilibrer sa politique étrangère face à son puissant voisin et partenaire commercial, la Russie, et à son soutien radicale, les États-Unis, un équilibre d'autant plus difficile à trouver que les deux puissances étaient de plus en plus en désaccord. Saakashvili espérait régler de graves problèmes avec la Russie concernant les trois provinces sécessionnistes du pays, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud au nord et l'Adjarie au sud. Ces trois provinces avaient effectivement rompu avec la Géorgie au lendemain de la dissolution de l'Union soviétique, lorsque différentes ethnies et groupes séparatistes en avaient pris le contrôle au détriment du gouvernement central de Tiblissi. Les provinces du nord ont fait l'objet d'une guerre sanglante qui s'est achevée lorsque les forces russes envoyées par le président Eltsine ont créé la rupture, tandis que dans le sud, le gouverneur Aslan Abashidze, chef de l'Adjarie, a discrètement fermé la frontière avec sa province, donnant ainsi à la région une indépendance de facto.

(à gauche) Carte de la Géorgie avec les régions contestées en jaune (à droite) Aslan Abashidze, chef de l'Adjarie
Ces pseudo-États indépendants semblaient voués à la confrontation avec la nouvelle démocratie géorgienne dès le premier jour, lorsque Saakashvili a prêté serment de protéger "l'intégrité territoriale de la Géorgie... Sur la tombe du roi David, nous devons tous dire : "La Géorgie sera unie et forte, elle rétablira sa plénitude et deviendra un État uni et fort". Il s'est engagé à y parvenir par le biais d'incitations économiques et de négociations pacifiques, mais a également précisé que la Géorgie devait construire et entretenir une armée forte pour restaurer son intégrité territoriale en dernier recours. Il a souligné qu'il espérait que la Géorgie ferait partie de l'Europe et qu'elle devrait lutter contre la corruption et le déclin économique du pays afin de rejoindre l'UE. Il s'agissait d'une vision ambitieuse et optimiste donnée à un moment où le soutien de l'opinion publique à son égard atteignait des niveaux inégalés.
Mais des obstacles se sont rapidement dressés sur le chemin de Saakashvili : le dirigeant de l'Ossétie du Sud a demandé au président russe Vladimir Poutine de reconnaître son indépendance et Poutine a répondu en envoyant un soutien militaire aux pseudo-États du nord pour défendre leurs "citoyens" et mettre fin aux luttes de pouvoir croissantes dans les provinces, que le gouvernement russe a imputées à la Géorgie. La Russie a commencé à adopter une position plus dure à l'égard de la Géorgie, le ministère de la défense et M. Poutine ont commencé à réprimander publiquement le pays et ont fait allusion à des frappes militaires "pour le bien de la sécurité de la Russie". Au lendemain de la révolution géorgienne, les contacts entre Moscou et les régions séparatistes se sont multipliés et Poutine a insisté pour que les forces militaires russes basées dans les provinces soient autorisées à rester, et a suggéré que certains Géorgiens (issus du gouvernement autocratique et entretenant de bonnes relations avec le Kremlin) restent en place, ce à quoi Saakashvili a répondu en démettant les ministres de leurs fonctions et en continuant d'affirmer que tout accord devait prévoir le retrait des troupes russes.
Saakashvili a cherché à défier rapidement la province méridionale d'Adjara et à ébranler le fief d'Abashidze en répétant les actions qui l'ont amené au pouvoir à Tbilissi. Il a condamné Abashidze, le qualifiant d'extrémiste, et a encouragé les manifestants à manifester leur mécontentement. Peu après, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et la police et des dizaines de personnes ont été blessées au cours de ces échauffourées, à la suite desquelles Abashidze a perquisitionné les maisons et les bureaux de l'opposition. Saakashvili a lancé un appel au monde entier, demandant que des élections libres puissent avoir lieu dans la province, et a invité les dirigeants européens à condamner les brutalités policières. Abashidze a timidement entamé des négociations dans l'espoir d'éviter de nouvelles perturbations, mais il est resté évident que des divergences importantes existaient entre les deux partis. Saakashvili a ordonné des exercices militaires simulant une invasion de la ville portuaire de Batumi dans le cadre d'une formation américaine de base [1], et les forces armées adjares ont été mobilisées en réponse, sous la supervision de généraux russes.
Abashidze bénéficiait d'un soutien national, son gouvernement avait connu beaucoup plus de succès économiques que celui du gouvernement central géorgien et il avait annoncé publiquement son intention de quitter son poste à la fin de son mandat en 2005, mais pour Saaksvhili, l'Adjarie représentait un test de la légitimité du nouveau gouvernement géorgien. Une province pouvait-elle être autorisée à défier ouvertement le président ? Il a exigé que l'Adjarie dissolve totalement ses forces de sécurité, ce à quoi Abashidze a répondu en interdisant aux fonctionnaires géorgiens d'entrer dans la région et en bloquant le principal point de passage, le pont de Choloki, ce à quoi Saakashvili a réagi en imposant des sanctions à la région.

(De gauche à droite) Les troupes adjares fidèles à Abashidze, le drapeau de l'Adjarie et les manifestants adjares pro-Saakshvili.
Les efforts de médiation de la crise par une tierce partie n'ont pas abouti, les États-Unis et la Russie soutenant timidement des camps opposés et n'étant pas en mesure de satisfaire l'autre à la table des négociations. Abashidze a accepté de rouvrir la région mais a refusé de désarmer ses milices et les forces militaires basées en Adjarie ont proclamé leur loyauté à Abashidze plutôt qu'à Saakashvili. L'échec des négociations a provoqué une nouvelle série de manifestations et de mesures de répression.
Pour prévenir une invasion imminente, Abashidze aurait ordonné de faire sauter le pont de Choloki et de miner la frontière avec l'Adjarie. La réponse immédiate a été une nouvelle série de grandes manifestations qui ont éclaté à Batoumi pour demander la démission d'Abashidze. Mais une fois de plus, les forces de sécurité les ont violemment réprimées. Ces scènes particulièrement violentes ont incité des milliers d'Adjarans à se rendre à Batoumi pour manifester. Ces manifestations ont été empêchées par les militaires adjarans, rejoints par les forces russes locales de la 12e base militaire, qui ont contribué à bloquer les routes menant à la ville et ont empêché les manifestants d'y entrer.
La nouvelle de l'aide ouverte des forces russes à Abashidze a été un coup dur pour le gouvernement de Tbilissi. Jusqu'à aujourd'hui, la Russie n'avait apporté qu'un soutien tacite à l'Adjarie, tentant d'utiliser les crises régionales pour obtenir un accord plus large avec le gouvernement géorgien sur la présence militaire russe. Mais le mot est venu directement de Poutine lorsqu'il a déclaré que, dans l'intérêt de la paix dans la région, il avait envoyé les forces russes pour soutenir Abashidze à sa demande. Cette nouvelle a provoqué un revirement spectaculaire du gouvernement géorgien, le recours à la force militaire ne semblant plus être une option viable, et les forces ont été retirées[2].
La dissidence se poursuivait dans la région, avec des protestations sporadiques, des graffitis et des campagnes d'affichage contre Abashidze, mais pour l'instant, son pouvoir restait en place, garanti par l'intervention de Moscou. La consternation était la même dans la capitale géorgienne, car la tentative de Saakashvili de réunifier rapidement la Géorgie avait échoué, mais il gardait l'espoir que "toute la Géorgie sera libre".


(De gauche à droite) Président russe Vladimir Poutine, troupes russes à Batoumi, capitale de la région contestée d'Adjarie, Président géorgien Mikael Saakashvili.
Canada
Paul Martin a finalement accédé au poste de Premier ministre en décembre 2003, à l'issue d'une lutte de pouvoir acharnée entre son ancien patron, le chef du parti libéral et Premier ministre Jean Chrétien, à l'issue d'une campagne difficile qui a mis en lumière une fracture au sein du parti libéral au pouvoir et menacé sa mainmise sur le pouvoir depuis dix ans. Les manœuvres de M. Martin ont été critiquées comme étant trop agressives et nuisant à la popularité du parti auprès de l'électorat, tout cela dans le but d'écarter rapidement ses rivaux potentiels pour le poste de premier ministre.
Martin tente alors de tracer une ligne de démarcation entre Chrétien et lui-même, en éliminant la moitié du cabinet et en prenant le contrôle de l'appareil du parti pour choisir les candidats qui soutiennent son programme. Son jeune gouvernement a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part du public, mais il a rapidement été confronté à un scandale lorsqu'il a été révélé qu'au cours des dix dernières années, des contrats publics d'une valeur de plusieurs millions de dollars, destinés à stimuler l'économie du Québec, avaient été entachés de corruption de haut en bas, l'argent se retrouvant entre les mains d'une poignée de personnes, y compris des alliés et des partisans du parti libéral.
Le "scandale des commandites" est devenu incontrôlable et, très vite, l'odeur de la fraude s'est répandue sur le parti libéral et sa direction. Martin a été partiellement protégé des retombées car l'administration Chrétiens a pris le plus gros des coups, et Martin a agi en mettant fin au programme, mais les enquêteurs ont progressivement découvert des douzaines d'alliés libéraux impliqués dans le scandale et la popularité du gouvernement s'en est trouvée fortement entamée, avec une baisse à deux chiffres.

Jean Chrétien félicite son successeur Paul Martin
Paul Martin, cherchant à profiter de sa période de lune de miel et à unifier le parti, a décidé de convoquer des élections fédérales anticipées alors que les libéraux étaient encore plus populaires que l'opposition. Les espoirs de Paul Martin de créer un front uni ne se sont pas concrétisés et la popularité de son gouvernement a continué à chuter de 15 % depuis janvier en raison du scandale et des critiques de Chrétien dans l'arrière-ban. Pour ne rien arranger, après des années de désunion et de luttes intestines, l'opposition s'est finalement regroupée autour d'un nouveau "parti conservateur" dirigé par l'homme qui a contribué à sa création, le chef de l'opposition Stephen Harper, sous la direction duquel les conservateurs ont bénéficié d'un regain de soutien dans l'ouest du Canada et dans l'Ontario. Les sondages montrent pour la première fois qu'ils sont en avance sur le Parti libéral, et il semble que le pari de Martin soit en train de s'effondrer.
Les deux plus petits partis ont également bénéficié d'un regain de popularité, le Nouveau Parti Démocratique et son nouveau leader Jack Layton ont été revitalisés et se sont concentrés sur les politiques sociales-démocrates, et Layton a prédit qu'ils seraient en mesure de battre leur précédent record parlementaire en bénéficiant de l'éclatement du soutien libéral. Le Bloc Québécois était en bonne voie pour remporter une victoire majeure, le scandale des parrainages avait fait grimper le soutien à l'indépendance du Québec à près de 50 % et la chute rapide de la popularité des libéraux avait considérablement renforcé ses chances, les sondages indiquant qu'il obtiendrait la moitié des voix des Québécois.
Désireux de regagner le terrain perdu, les libéraux ont lancé un programme ambitieux, réformant les soins de santé, la garde d'enfants, le contrôle des armes à feu et la décriminalisation des drogues. Ils se sont efforcés de mettre en évidence le "programme caché" du parti conservateur, accusé de vouloir faire reculer le progrès social au Canada, en revenant sur le droit à l'avortement et le mariage homosexuel, en imposant des allégements fiscaux aux riches au détriment des programmes sociaux et en soutenant une politique étrangère agressive. Ce cadrage a été en partie facilité par l'évocation de certaines citations de Stephen Harper sur l'homosexualité, l'avortement et le bilinguisme, qu'il avait décriés comme des maux sociétaux qui détérioraient le tissu social du pays.
Harper a répliqué en affirmant que les libéraux étaient "coincés dans la boue" et contraints à une stratégie de campagne négative. Cela semblait exact car les libéraux ont commencé à attaquer le NPD en décrivant le parti comme des conservateurs déguisés : "Si vous envisagez de voter NPD, vous pourriez bien aider Stephen Harper à devenir premier ministre". Et ils ont prédit qu'une victoire du Bloc pourrait entraîner la dissolution du Canada.
À quelques semaines de l'élection, les conservateurs et les libéraux étaient au coude à coude, mais aucun des deux ne disposait d'une voie sûre pour obtenir une majorité parlementaire. Pendant les débats, les dirigeants des deux principaux partis se sont affrontés dans une série d'échanges houleux, au cours desquels Harper a qualifié les libéraux de parti de la corruption et Martin a déclaré que la vision conservatrice du Canada de Harper était contraire aux valeurs canadiennes.
Les résultats de l'élection n'étaient bons pour aucun des deux grands partis. Les deux avaient perdu des voix par rapport à l'élection précédente, mais ce sont les libéraux qui avaient perdu le plus. Les conservateurs sont devenus le plus grand parti avec 124 sièges, tandis que les libéraux ont perdu un nombre important de sièges et sont tombés dans l'opposition avec 101 sièges. Cependant, les conservateurs n'ont pas réussi à obtenir une majorité. Il en résulte un gouvernement minoritaire dirigé par les conservateurs, le premier en 24 ans, et Harper deviendra le 22e Premier ministre du Canada, mais dépendant des voix de gauche pour faire passer son programme, il était difficile de savoir combien de temps cela pourrait durer[2b].
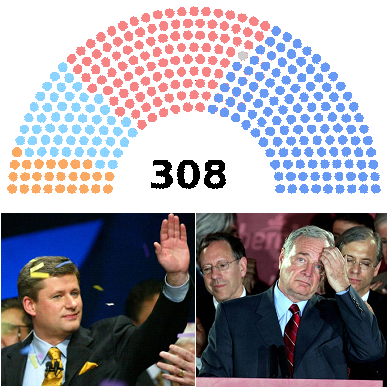
(Dans le sens des aiguilles d'une montre) Résultat des élections canadiennes de 2004, Premier ministre vaincu Paul Martin, Premier ministre victorieux Stephen Harper.

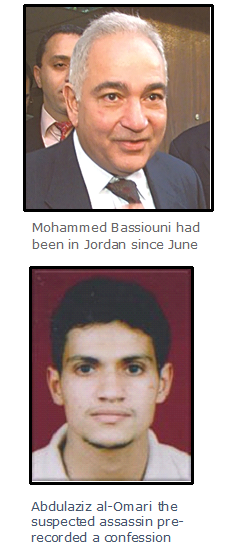
Un homme armé tue un diplomate égyptien en Jordanie
L'Égypte a confirmé l'assassinat du sénateur et ancien ambassadeur en Israël, après sa visite au Royaume de Jordanie.
Un message Internet émanant prétendument du groupe militant Al-Jihad a été diffusé jeudi, revendiquant la responsabilité de la mort du diplomate égyptien Mohammed Bassiouni, qui a été tué hier.
Une vidéo diffusée sur un site web montre des membres du groupe avouant avoir prétendument assassiné M. Bassiouni, diplomate égyptien de longue date, qui a été pendant des années le seul ambassadeur de la région arabe auprès d'Israël.
Le Caire est un allié des États-Unis et l'un des rares pays arabes à reconnaître Israël.
Le président égyptien Hosni Moubarak a présenté ses condoléances à la famille de M. Bassiouni et a critiqué les éléments extrémistes à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Confession en ligne
Mohamed Sayed Tantawi, haut dignitaire religieux sunnite, a condamné l'assassinat en le qualifiant de "crime contre la religion, la moralité et l'humanité et de crime contraire à l'honneur et à la chevalerie".
Mais les dirigeants de l'opposition ont rejeté la responsabilité sur le gouvernement, estimant qu'il avait été trop indulgent à l'égard d'Israël et des États-Unis.
"Son sang est sur les mains de ceux qui l'ont envoyé en Israël pour commencer", a déclaré à l'agence de presse Reuters Dia el-Din Dawoud, chef du parti nassérien.
"Moubarak voulait se démarquer en s'engageant en faveur des politiques américaines, mais tant que nos politiques ne découleront pas de nos intérêts nationaux et arabes, le résultat sera le même."
Mohamed Habib, chef adjoint des Frères musulmans, a déclaré que l'assassinat était incompatible avec l'islam, mais que l'agenda israélien et pro-américain du pays en était la cause.
M. Bassiouni a été abattu samedi à Amman, dans un hôtel de la capitale jordanienne, et le tireur, un ressortissant saoudien du nom d'Abdulaziz al-Omari [3], a avoué l'avoir tué pour le compte de l'organisation al-Jihad et de Jama'at, un autre groupe radical.
Une déclaration également publiée mercredi au nom de Jama'at et de son chef Abu Al-Zarqawi indique que Bassiouni a été tué parce qu'il était un "apostat", qui avait trahi sa foi. Il a ensuite menacé d'autres membres du gouvernement du Caire pour leur soutien à l'administration israélienne et américaine.
La Jama'at affirme avoir perpétré d'autres attaques contre le gouvernement égyptien, notamment l'attaque du consulat au Pakistan. Zarqawi, fugitif jordanien, est recherché pour une série d'attentats commis en 2000.
Il a menacé de commettre d'autres attentats
Une déclaration écrite publiée sur le site web jeudi indique que "le verdict de Dieu contre l'ambassadeur des infidèles, l'ambassadeur d'Égypte, a été exécuté".
Le site a également diffusé une déclaration préenregistrée dans laquelle le tireur de M. Bassiouni avoue son implication.
La déclaration indique que le groupe prévoit de tuer d'autres fonctionnaires égyptiens.
"Cela marque le début de notre mission, qui consiste à construire un véritable front islamique et à restaurer la véritable opposition islamique".
En Égypte, plusieurs bombes ont visé des bureaux du gouvernement municipal et plusieurs consulats égyptiens en Afrique du Nord ont été la cible d'incendies criminels. Moubarak a affirmé que ces attaques étaient provoquées par les gouvernements islamiques d'Afghanistan et du Soudan et par certains groupes radicaux à l'intérieur de ces pays.
Tchétchénie
Alors que la Géorgie menaçait de sombrer dans la guerre civile, le conflit voisin en Tchétchénie se poursuivait, mêlant soldats russes, milices tchétchènes et de nombreux civils.
Moscou, dans ses efforts pour contenir l'insurrection, a placé la province sous la loi martiale, les forces militaires étant chargées de tous les aspects de la vie quotidienne. Mais cette mesure avait l'inconvénient de laisser les forces russes constamment exposées aux embuscades. Les efforts déployés pour mettre un terme aux luttes intestines en Tchétchénie ont largement échoué ; chaque fois que des élections étaient organisées, l'une des parties trouvait le moyen de provoquer la colère de l'autre, ce qui avait pour effet de retarder les élections et de prolonger la crise.
La triarchie qui contrôlait officiellement la Tchétchénie n'avait aucun semblant d'unité. Le président Abramov, financier d'origine russe, était clairement détesté par les Tchétchènes de souche et il passait le plus de temps possible en dehors de la Tchétchénie, comptant sur une escorte militaire massive pour l'accompagner partout où il se rendait à l'intérieur de la Tchétchénie. Il y avait ensuite Alkhanov, le ministre de l'intérieur et le chef des "vieux Russes" qui soutenaient les efforts russes en Tchétchénie depuis les années 90. Ses forces de police étaient censées assurer le maintien de l'ordre à Grozny, mais les attaques incessantes au missile, au mortier, à la grenade et à la bombe ont transformé la ville en une plaie ouverte. Abramov étant constamment absent de la région, Alkhanov est devenu le président de facto et a tenté de gérer le pays comme un camp de prisonniers, mais son application sévère de la loi a été rendue muette par les Kadyrovsky, les loyalistes du président assassiné Ahmad Kadyrov, Aujourd'hui commandée par son fils Ramzan Kadyrov, cette grande milice a contourné Alkhanov et tenté de diriger le pays comme son propre fief, volant, kidnappant et assassinant qui et quoi que ce soit, quelle que soit leur allégeance, y compris les ministres du gouvernement et les forces de sécurité.

(De gauche à droite), le commandant de la milice Ramzan Kadyrov, le ministre de l'intérieur Alu Alkhanov, les chefs rebelles tchétchènes Ibn Al-Khattab et Shamil Basayev.
Les luttes intestines étant telles qu'il était difficile de savoir qui était l'ennemi, des exilés tchétchènes ou des moudjahidin. La division du gouvernement a permis aux exilés d'éliminer un flot continu de soldats russes, au rythme d'une douzaine par semaine. Cependant, les efforts des forces russes pour verrouiller l'ensemble de l'État ont finalement commencé à porter leurs fruits, les rebelles étant tués à l'entrée et à la sortie du pays. En conséquence, les tactiques des rebelles sont devenues moins centralisées et plus sporadiques. L'homme présenté comme le chef des rebelles, Shamil Basayev, a commencé à diffuser des messages vidéo continus relatant les victoires, les assassinats et les attaques de ses forces en Tchétchénie et dans l'ensemble de la Russie. En juillet, un bataillon des forces rebelles s'est emparé de la ville russe de Nazran, attaquant les bâtiments gouvernementaux, libérant des prisonniers et s'emparant d'armes avant de s'enfuir. Basayev a affirmé que ses forces étaient "à l'offensive, le régime va trembler et bientôt il tombera". Son proche allié islamiste, Ibn Al-Khattab (accusé par la Russie d'entretenir des liens avec des groupes terroristes) a envoyé un message similaire à la presse la veille de l'investiture de Poutine : "Les Russes ont déclaré la guerre à la Tchétchénie, ils ont envoyé des mines, des chars et des hommes, mais par Dieu, nous les renverrons, et pas seulement ces choses, mais des choses que vous ne pouvez pas encore imaginer seront renvoyées... Vous verrez, si Dieu le veut, des centaines de personnes estropiées".
Mais malgré l'escalade des menaces, les tensions sont devenues si fortes entre Alkahov et Kadyrov que les échanges de coups de feu sont devenus trop fréquents entre les supposés alliés. Lors d'un incident notable, des partisans de Kadyrov ont attaqué le ministère des finances, ce qui a donné lieu à une bataille de rue pour le bureau, qui s'est terminée lorsque les forces militaires russes ont mis fin au siège avec des chars. Il était clair que Kadyrov n'était pas satisfait de son rôle actuel et qu'il souhaitait occuper une position plus importante dans le pays. Il s'est senti menacé lorsqu'il a appris qu'Alkahov tentait de convaincre les forces russes de le soutenir officiellement dans la lutte pour le pouvoir et de convaincre le Kremlin que Kadyrov était à l'origine d'un trop grand chaos et qu'il nuisait aux efforts de la Russie.
Kadyrov a réagi à ces informations en envoyant ses troupes prendre d'assaut le bâtiment du parlement pour le forcer à le nommer premier ministre. Cette réaction erratique s'est soldée par un désastre lorsque les forces russes Spetsnaz ont de nouveau été appelées à intervenir pour mettre fin au conflit. Le mécontentement de Ramzan s'est amplifié lorsque les Kadyrovtsy ont enlevé et tué des dizaines d'ennemis présumés.
La terreur kadyrovite s'est encore aggravée le 11 juillet lorsque, à la suite d'un prétendu scrutin, Kadyrov a déclaré qu'il était le président de la Tchétchénie et qu'il allait occuper le poste présidentiel. Un contingent de son armée privée s'est emparé du bureau. Après une courte fusillade, les hommes de Kadyrov se sont emparés du bureau du président et ont commencé à publier ses prétendus diktats[4].
Les actions du jeune Kadyrov ont continué à alimenter le sentiment de chaos dans le pays, la désunion entre les factions tchétchènes continuant à se répandre dans les rues. Mais dans le Caucase, terre de la vendetta, il n'y avait aucun signe de lumière. En fait, les choses étaient sur le point de s'assombrir considérablement.

Grozny ; juillet 2004
[1] L'administration Bush a sauté sur l'occasion de soutenir Saakashvili dans le monde de l'après-Doctrine Bush ; dans l'univers de Geronimo les Etats-Unis sont plus lents à le soutenir.
[2] Poutine a essayé de soutenir Aslan mais a échoué parce qu'il a agi trop lentement, dans cette uchronie il a de moins bonnes relations avec les Etats-Unis et le soutient donc plus tôt.
[2b] Les conservateurs ont été taxés de clones canadiens de Bush et l'absence de guerre en Irak les aide à franchir la ligne de démarcation.
[3] Ce qui aurait pu devenir l'un des pirate de l'air du 11 septembre ici a tué l'ambassadeur égyptien.
[4] Poutine a toléré Kadyrov parce qu'il pensait que sa brutalité était efficace ; dans Geronimo, cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien.
Géorgie et Adjarie
Les montagnes de Géorgie étaient troublées. Malgré la révolution populaire qui avait réussi à renverser l'ancien régime autoritaire lors d'un soulèvement sans effusion de sang l'hiver précédent, remplaçant le régime autoritaire post-communiste par une démocratie libérale, le nouveau système était déjà menacé. Lorsque Mikhaïl Saakachvili a prêté serment en tant que président de la Géorgie en janvier, le pays était déjà fracturé. La Géorgie devait équilibrer sa politique étrangère face à son puissant voisin et partenaire commercial, la Russie, et à son soutien radicale, les États-Unis, un équilibre d'autant plus difficile à trouver que les deux puissances étaient de plus en plus en désaccord. Saakashvili espérait régler de graves problèmes avec la Russie concernant les trois provinces sécessionnistes du pays, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud au nord et l'Adjarie au sud. Ces trois provinces avaient effectivement rompu avec la Géorgie au lendemain de la dissolution de l'Union soviétique, lorsque différentes ethnies et groupes séparatistes en avaient pris le contrôle au détriment du gouvernement central de Tiblissi. Les provinces du nord ont fait l'objet d'une guerre sanglante qui s'est achevée lorsque les forces russes envoyées par le président Eltsine ont créé la rupture, tandis que dans le sud, le gouverneur Aslan Abashidze, chef de l'Adjarie, a discrètement fermé la frontière avec sa province, donnant ainsi à la région une indépendance de facto.
(à gauche) Carte de la Géorgie avec les régions contestées en jaune (à droite) Aslan Abashidze, chef de l'Adjarie
Ces pseudo-États indépendants semblaient voués à la confrontation avec la nouvelle démocratie géorgienne dès le premier jour, lorsque Saakashvili a prêté serment de protéger "l'intégrité territoriale de la Géorgie... Sur la tombe du roi David, nous devons tous dire : "La Géorgie sera unie et forte, elle rétablira sa plénitude et deviendra un État uni et fort". Il s'est engagé à y parvenir par le biais d'incitations économiques et de négociations pacifiques, mais a également précisé que la Géorgie devait construire et entretenir une armée forte pour restaurer son intégrité territoriale en dernier recours. Il a souligné qu'il espérait que la Géorgie ferait partie de l'Europe et qu'elle devrait lutter contre la corruption et le déclin économique du pays afin de rejoindre l'UE. Il s'agissait d'une vision ambitieuse et optimiste donnée à un moment où le soutien de l'opinion publique à son égard atteignait des niveaux inégalés.
Mais des obstacles se sont rapidement dressés sur le chemin de Saakashvili : le dirigeant de l'Ossétie du Sud a demandé au président russe Vladimir Poutine de reconnaître son indépendance et Poutine a répondu en envoyant un soutien militaire aux pseudo-États du nord pour défendre leurs "citoyens" et mettre fin aux luttes de pouvoir croissantes dans les provinces, que le gouvernement russe a imputées à la Géorgie. La Russie a commencé à adopter une position plus dure à l'égard de la Géorgie, le ministère de la défense et M. Poutine ont commencé à réprimander publiquement le pays et ont fait allusion à des frappes militaires "pour le bien de la sécurité de la Russie". Au lendemain de la révolution géorgienne, les contacts entre Moscou et les régions séparatistes se sont multipliés et Poutine a insisté pour que les forces militaires russes basées dans les provinces soient autorisées à rester, et a suggéré que certains Géorgiens (issus du gouvernement autocratique et entretenant de bonnes relations avec le Kremlin) restent en place, ce à quoi Saakashvili a répondu en démettant les ministres de leurs fonctions et en continuant d'affirmer que tout accord devait prévoir le retrait des troupes russes.
Saakashvili a cherché à défier rapidement la province méridionale d'Adjara et à ébranler le fief d'Abashidze en répétant les actions qui l'ont amené au pouvoir à Tbilissi. Il a condamné Abashidze, le qualifiant d'extrémiste, et a encouragé les manifestants à manifester leur mécontentement. Peu après, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et la police et des dizaines de personnes ont été blessées au cours de ces échauffourées, à la suite desquelles Abashidze a perquisitionné les maisons et les bureaux de l'opposition. Saakashvili a lancé un appel au monde entier, demandant que des élections libres puissent avoir lieu dans la province, et a invité les dirigeants européens à condamner les brutalités policières. Abashidze a timidement entamé des négociations dans l'espoir d'éviter de nouvelles perturbations, mais il est resté évident que des divergences importantes existaient entre les deux partis. Saakashvili a ordonné des exercices militaires simulant une invasion de la ville portuaire de Batumi dans le cadre d'une formation américaine de base [1], et les forces armées adjares ont été mobilisées en réponse, sous la supervision de généraux russes.
Abashidze bénéficiait d'un soutien national, son gouvernement avait connu beaucoup plus de succès économiques que celui du gouvernement central géorgien et il avait annoncé publiquement son intention de quitter son poste à la fin de son mandat en 2005, mais pour Saaksvhili, l'Adjarie représentait un test de la légitimité du nouveau gouvernement géorgien. Une province pouvait-elle être autorisée à défier ouvertement le président ? Il a exigé que l'Adjarie dissolve totalement ses forces de sécurité, ce à quoi Abashidze a répondu en interdisant aux fonctionnaires géorgiens d'entrer dans la région et en bloquant le principal point de passage, le pont de Choloki, ce à quoi Saakashvili a réagi en imposant des sanctions à la région.
(De gauche à droite) Les troupes adjares fidèles à Abashidze, le drapeau de l'Adjarie et les manifestants adjares pro-Saakshvili.
Les efforts de médiation de la crise par une tierce partie n'ont pas abouti, les États-Unis et la Russie soutenant timidement des camps opposés et n'étant pas en mesure de satisfaire l'autre à la table des négociations. Abashidze a accepté de rouvrir la région mais a refusé de désarmer ses milices et les forces militaires basées en Adjarie ont proclamé leur loyauté à Abashidze plutôt qu'à Saakashvili. L'échec des négociations a provoqué une nouvelle série de manifestations et de mesures de répression.
Pour prévenir une invasion imminente, Abashidze aurait ordonné de faire sauter le pont de Choloki et de miner la frontière avec l'Adjarie. La réponse immédiate a été une nouvelle série de grandes manifestations qui ont éclaté à Batoumi pour demander la démission d'Abashidze. Mais une fois de plus, les forces de sécurité les ont violemment réprimées. Ces scènes particulièrement violentes ont incité des milliers d'Adjarans à se rendre à Batoumi pour manifester. Ces manifestations ont été empêchées par les militaires adjarans, rejoints par les forces russes locales de la 12e base militaire, qui ont contribué à bloquer les routes menant à la ville et ont empêché les manifestants d'y entrer.
La nouvelle de l'aide ouverte des forces russes à Abashidze a été un coup dur pour le gouvernement de Tbilissi. Jusqu'à aujourd'hui, la Russie n'avait apporté qu'un soutien tacite à l'Adjarie, tentant d'utiliser les crises régionales pour obtenir un accord plus large avec le gouvernement géorgien sur la présence militaire russe. Mais le mot est venu directement de Poutine lorsqu'il a déclaré que, dans l'intérêt de la paix dans la région, il avait envoyé les forces russes pour soutenir Abashidze à sa demande. Cette nouvelle a provoqué un revirement spectaculaire du gouvernement géorgien, le recours à la force militaire ne semblant plus être une option viable, et les forces ont été retirées[2].
La dissidence se poursuivait dans la région, avec des protestations sporadiques, des graffitis et des campagnes d'affichage contre Abashidze, mais pour l'instant, son pouvoir restait en place, garanti par l'intervention de Moscou. La consternation était la même dans la capitale géorgienne, car la tentative de Saakashvili de réunifier rapidement la Géorgie avait échoué, mais il gardait l'espoir que "toute la Géorgie sera libre".
(De gauche à droite) Président russe Vladimir Poutine, troupes russes à Batoumi, capitale de la région contestée d'Adjarie, Président géorgien Mikael Saakashvili.
Canada
Paul Martin a finalement accédé au poste de Premier ministre en décembre 2003, à l'issue d'une lutte de pouvoir acharnée entre son ancien patron, le chef du parti libéral et Premier ministre Jean Chrétien, à l'issue d'une campagne difficile qui a mis en lumière une fracture au sein du parti libéral au pouvoir et menacé sa mainmise sur le pouvoir depuis dix ans. Les manœuvres de M. Martin ont été critiquées comme étant trop agressives et nuisant à la popularité du parti auprès de l'électorat, tout cela dans le but d'écarter rapidement ses rivaux potentiels pour le poste de premier ministre.
Martin tente alors de tracer une ligne de démarcation entre Chrétien et lui-même, en éliminant la moitié du cabinet et en prenant le contrôle de l'appareil du parti pour choisir les candidats qui soutiennent son programme. Son jeune gouvernement a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part du public, mais il a rapidement été confronté à un scandale lorsqu'il a été révélé qu'au cours des dix dernières années, des contrats publics d'une valeur de plusieurs millions de dollars, destinés à stimuler l'économie du Québec, avaient été entachés de corruption de haut en bas, l'argent se retrouvant entre les mains d'une poignée de personnes, y compris des alliés et des partisans du parti libéral.
Le "scandale des commandites" est devenu incontrôlable et, très vite, l'odeur de la fraude s'est répandue sur le parti libéral et sa direction. Martin a été partiellement protégé des retombées car l'administration Chrétiens a pris le plus gros des coups, et Martin a agi en mettant fin au programme, mais les enquêteurs ont progressivement découvert des douzaines d'alliés libéraux impliqués dans le scandale et la popularité du gouvernement s'en est trouvée fortement entamée, avec une baisse à deux chiffres.
Jean Chrétien félicite son successeur Paul Martin
Paul Martin, cherchant à profiter de sa période de lune de miel et à unifier le parti, a décidé de convoquer des élections fédérales anticipées alors que les libéraux étaient encore plus populaires que l'opposition. Les espoirs de Paul Martin de créer un front uni ne se sont pas concrétisés et la popularité de son gouvernement a continué à chuter de 15 % depuis janvier en raison du scandale et des critiques de Chrétien dans l'arrière-ban. Pour ne rien arranger, après des années de désunion et de luttes intestines, l'opposition s'est finalement regroupée autour d'un nouveau "parti conservateur" dirigé par l'homme qui a contribué à sa création, le chef de l'opposition Stephen Harper, sous la direction duquel les conservateurs ont bénéficié d'un regain de soutien dans l'ouest du Canada et dans l'Ontario. Les sondages montrent pour la première fois qu'ils sont en avance sur le Parti libéral, et il semble que le pari de Martin soit en train de s'effondrer.
Les deux plus petits partis ont également bénéficié d'un regain de popularité, le Nouveau Parti Démocratique et son nouveau leader Jack Layton ont été revitalisés et se sont concentrés sur les politiques sociales-démocrates, et Layton a prédit qu'ils seraient en mesure de battre leur précédent record parlementaire en bénéficiant de l'éclatement du soutien libéral. Le Bloc Québécois était en bonne voie pour remporter une victoire majeure, le scandale des parrainages avait fait grimper le soutien à l'indépendance du Québec à près de 50 % et la chute rapide de la popularité des libéraux avait considérablement renforcé ses chances, les sondages indiquant qu'il obtiendrait la moitié des voix des Québécois.
Désireux de regagner le terrain perdu, les libéraux ont lancé un programme ambitieux, réformant les soins de santé, la garde d'enfants, le contrôle des armes à feu et la décriminalisation des drogues. Ils se sont efforcés de mettre en évidence le "programme caché" du parti conservateur, accusé de vouloir faire reculer le progrès social au Canada, en revenant sur le droit à l'avortement et le mariage homosexuel, en imposant des allégements fiscaux aux riches au détriment des programmes sociaux et en soutenant une politique étrangère agressive. Ce cadrage a été en partie facilité par l'évocation de certaines citations de Stephen Harper sur l'homosexualité, l'avortement et le bilinguisme, qu'il avait décriés comme des maux sociétaux qui détérioraient le tissu social du pays.
Harper a répliqué en affirmant que les libéraux étaient "coincés dans la boue" et contraints à une stratégie de campagne négative. Cela semblait exact car les libéraux ont commencé à attaquer le NPD en décrivant le parti comme des conservateurs déguisés : "Si vous envisagez de voter NPD, vous pourriez bien aider Stephen Harper à devenir premier ministre". Et ils ont prédit qu'une victoire du Bloc pourrait entraîner la dissolution du Canada.
À quelques semaines de l'élection, les conservateurs et les libéraux étaient au coude à coude, mais aucun des deux ne disposait d'une voie sûre pour obtenir une majorité parlementaire. Pendant les débats, les dirigeants des deux principaux partis se sont affrontés dans une série d'échanges houleux, au cours desquels Harper a qualifié les libéraux de parti de la corruption et Martin a déclaré que la vision conservatrice du Canada de Harper était contraire aux valeurs canadiennes.
Les résultats de l'élection n'étaient bons pour aucun des deux grands partis. Les deux avaient perdu des voix par rapport à l'élection précédente, mais ce sont les libéraux qui avaient perdu le plus. Les conservateurs sont devenus le plus grand parti avec 124 sièges, tandis que les libéraux ont perdu un nombre important de sièges et sont tombés dans l'opposition avec 101 sièges. Cependant, les conservateurs n'ont pas réussi à obtenir une majorité. Il en résulte un gouvernement minoritaire dirigé par les conservateurs, le premier en 24 ans, et Harper deviendra le 22e Premier ministre du Canada, mais dépendant des voix de gauche pour faire passer son programme, il était difficile de savoir combien de temps cela pourrait durer[2b].
(Dans le sens des aiguilles d'une montre) Résultat des élections canadiennes de 2004, Premier ministre vaincu Paul Martin, Premier ministre victorieux Stephen Harper.
Un homme armé tue un diplomate égyptien en Jordanie
L'Égypte a confirmé l'assassinat du sénateur et ancien ambassadeur en Israël, après sa visite au Royaume de Jordanie.
Un message Internet émanant prétendument du groupe militant Al-Jihad a été diffusé jeudi, revendiquant la responsabilité de la mort du diplomate égyptien Mohammed Bassiouni, qui a été tué hier.
Une vidéo diffusée sur un site web montre des membres du groupe avouant avoir prétendument assassiné M. Bassiouni, diplomate égyptien de longue date, qui a été pendant des années le seul ambassadeur de la région arabe auprès d'Israël.
Le Caire est un allié des États-Unis et l'un des rares pays arabes à reconnaître Israël.
Le président égyptien Hosni Moubarak a présenté ses condoléances à la famille de M. Bassiouni et a critiqué les éléments extrémistes à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Confession en ligne
Mohamed Sayed Tantawi, haut dignitaire religieux sunnite, a condamné l'assassinat en le qualifiant de "crime contre la religion, la moralité et l'humanité et de crime contraire à l'honneur et à la chevalerie".
Mais les dirigeants de l'opposition ont rejeté la responsabilité sur le gouvernement, estimant qu'il avait été trop indulgent à l'égard d'Israël et des États-Unis.
"Son sang est sur les mains de ceux qui l'ont envoyé en Israël pour commencer", a déclaré à l'agence de presse Reuters Dia el-Din Dawoud, chef du parti nassérien.
"Moubarak voulait se démarquer en s'engageant en faveur des politiques américaines, mais tant que nos politiques ne découleront pas de nos intérêts nationaux et arabes, le résultat sera le même."
Mohamed Habib, chef adjoint des Frères musulmans, a déclaré que l'assassinat était incompatible avec l'islam, mais que l'agenda israélien et pro-américain du pays en était la cause.
M. Bassiouni a été abattu samedi à Amman, dans un hôtel de la capitale jordanienne, et le tireur, un ressortissant saoudien du nom d'Abdulaziz al-Omari [3], a avoué l'avoir tué pour le compte de l'organisation al-Jihad et de Jama'at, un autre groupe radical.
Une déclaration également publiée mercredi au nom de Jama'at et de son chef Abu Al-Zarqawi indique que Bassiouni a été tué parce qu'il était un "apostat", qui avait trahi sa foi. Il a ensuite menacé d'autres membres du gouvernement du Caire pour leur soutien à l'administration israélienne et américaine.
La Jama'at affirme avoir perpétré d'autres attaques contre le gouvernement égyptien, notamment l'attaque du consulat au Pakistan. Zarqawi, fugitif jordanien, est recherché pour une série d'attentats commis en 2000.
Il a menacé de commettre d'autres attentats
Une déclaration écrite publiée sur le site web jeudi indique que "le verdict de Dieu contre l'ambassadeur des infidèles, l'ambassadeur d'Égypte, a été exécuté".
Le site a également diffusé une déclaration préenregistrée dans laquelle le tireur de M. Bassiouni avoue son implication.
La déclaration indique que le groupe prévoit de tuer d'autres fonctionnaires égyptiens.
"Cela marque le début de notre mission, qui consiste à construire un véritable front islamique et à restaurer la véritable opposition islamique".
En Égypte, plusieurs bombes ont visé des bureaux du gouvernement municipal et plusieurs consulats égyptiens en Afrique du Nord ont été la cible d'incendies criminels. Moubarak a affirmé que ces attaques étaient provoquées par les gouvernements islamiques d'Afghanistan et du Soudan et par certains groupes radicaux à l'intérieur de ces pays.
Tchétchénie
Alors que la Géorgie menaçait de sombrer dans la guerre civile, le conflit voisin en Tchétchénie se poursuivait, mêlant soldats russes, milices tchétchènes et de nombreux civils.
Moscou, dans ses efforts pour contenir l'insurrection, a placé la province sous la loi martiale, les forces militaires étant chargées de tous les aspects de la vie quotidienne. Mais cette mesure avait l'inconvénient de laisser les forces russes constamment exposées aux embuscades. Les efforts déployés pour mettre un terme aux luttes intestines en Tchétchénie ont largement échoué ; chaque fois que des élections étaient organisées, l'une des parties trouvait le moyen de provoquer la colère de l'autre, ce qui avait pour effet de retarder les élections et de prolonger la crise.
La triarchie qui contrôlait officiellement la Tchétchénie n'avait aucun semblant d'unité. Le président Abramov, financier d'origine russe, était clairement détesté par les Tchétchènes de souche et il passait le plus de temps possible en dehors de la Tchétchénie, comptant sur une escorte militaire massive pour l'accompagner partout où il se rendait à l'intérieur de la Tchétchénie. Il y avait ensuite Alkhanov, le ministre de l'intérieur et le chef des "vieux Russes" qui soutenaient les efforts russes en Tchétchénie depuis les années 90. Ses forces de police étaient censées assurer le maintien de l'ordre à Grozny, mais les attaques incessantes au missile, au mortier, à la grenade et à la bombe ont transformé la ville en une plaie ouverte. Abramov étant constamment absent de la région, Alkhanov est devenu le président de facto et a tenté de gérer le pays comme un camp de prisonniers, mais son application sévère de la loi a été rendue muette par les Kadyrovsky, les loyalistes du président assassiné Ahmad Kadyrov, Aujourd'hui commandée par son fils Ramzan Kadyrov, cette grande milice a contourné Alkhanov et tenté de diriger le pays comme son propre fief, volant, kidnappant et assassinant qui et quoi que ce soit, quelle que soit leur allégeance, y compris les ministres du gouvernement et les forces de sécurité.
(De gauche à droite), le commandant de la milice Ramzan Kadyrov, le ministre de l'intérieur Alu Alkhanov, les chefs rebelles tchétchènes Ibn Al-Khattab et Shamil Basayev.
Les luttes intestines étant telles qu'il était difficile de savoir qui était l'ennemi, des exilés tchétchènes ou des moudjahidin. La division du gouvernement a permis aux exilés d'éliminer un flot continu de soldats russes, au rythme d'une douzaine par semaine. Cependant, les efforts des forces russes pour verrouiller l'ensemble de l'État ont finalement commencé à porter leurs fruits, les rebelles étant tués à l'entrée et à la sortie du pays. En conséquence, les tactiques des rebelles sont devenues moins centralisées et plus sporadiques. L'homme présenté comme le chef des rebelles, Shamil Basayev, a commencé à diffuser des messages vidéo continus relatant les victoires, les assassinats et les attaques de ses forces en Tchétchénie et dans l'ensemble de la Russie. En juillet, un bataillon des forces rebelles s'est emparé de la ville russe de Nazran, attaquant les bâtiments gouvernementaux, libérant des prisonniers et s'emparant d'armes avant de s'enfuir. Basayev a affirmé que ses forces étaient "à l'offensive, le régime va trembler et bientôt il tombera". Son proche allié islamiste, Ibn Al-Khattab (accusé par la Russie d'entretenir des liens avec des groupes terroristes) a envoyé un message similaire à la presse la veille de l'investiture de Poutine : "Les Russes ont déclaré la guerre à la Tchétchénie, ils ont envoyé des mines, des chars et des hommes, mais par Dieu, nous les renverrons, et pas seulement ces choses, mais des choses que vous ne pouvez pas encore imaginer seront renvoyées... Vous verrez, si Dieu le veut, des centaines de personnes estropiées".
Mais malgré l'escalade des menaces, les tensions sont devenues si fortes entre Alkahov et Kadyrov que les échanges de coups de feu sont devenus trop fréquents entre les supposés alliés. Lors d'un incident notable, des partisans de Kadyrov ont attaqué le ministère des finances, ce qui a donné lieu à une bataille de rue pour le bureau, qui s'est terminée lorsque les forces militaires russes ont mis fin au siège avec des chars. Il était clair que Kadyrov n'était pas satisfait de son rôle actuel et qu'il souhaitait occuper une position plus importante dans le pays. Il s'est senti menacé lorsqu'il a appris qu'Alkahov tentait de convaincre les forces russes de le soutenir officiellement dans la lutte pour le pouvoir et de convaincre le Kremlin que Kadyrov était à l'origine d'un trop grand chaos et qu'il nuisait aux efforts de la Russie.
Kadyrov a réagi à ces informations en envoyant ses troupes prendre d'assaut le bâtiment du parlement pour le forcer à le nommer premier ministre. Cette réaction erratique s'est soldée par un désastre lorsque les forces russes Spetsnaz ont de nouveau été appelées à intervenir pour mettre fin au conflit. Le mécontentement de Ramzan s'est amplifié lorsque les Kadyrovtsy ont enlevé et tué des dizaines d'ennemis présumés.
La terreur kadyrovite s'est encore aggravée le 11 juillet lorsque, à la suite d'un prétendu scrutin, Kadyrov a déclaré qu'il était le président de la Tchétchénie et qu'il allait occuper le poste présidentiel. Un contingent de son armée privée s'est emparé du bureau. Après une courte fusillade, les hommes de Kadyrov se sont emparés du bureau du président et ont commencé à publier ses prétendus diktats[4].
Les actions du jeune Kadyrov ont continué à alimenter le sentiment de chaos dans le pays, la désunion entre les factions tchétchènes continuant à se répandre dans les rues. Mais dans le Caucase, terre de la vendetta, il n'y avait aucun signe de lumière. En fait, les choses étaient sur le point de s'assombrir considérablement.
Grozny ; juillet 2004
[1] L'administration Bush a sauté sur l'occasion de soutenir Saakashvili dans le monde de l'après-Doctrine Bush ; dans l'univers de Geronimo les Etats-Unis sont plus lents à le soutenir.
[2] Poutine a essayé de soutenir Aslan mais a échoué parce qu'il a agi trop lentement, dans cette uchronie il a de moins bonnes relations avec les Etats-Unis et le soutient donc plus tôt.
[2b] Les conservateurs ont été taxés de clones canadiens de Bush et l'absence de guerre en Irak les aide à franchir la ligne de démarcation.
[3] Ce qui aurait pu devenir l'un des pirate de l'air du 11 septembre ici a tué l'ambassadeur égyptien.
[4] Poutine a toléré Kadyrov parce qu'il pensait que sa brutalité était efficace ; dans Geronimo, cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 37: Conventions 2004

Logos des Conventions nationales du Parti démocrate et du Parti républicain de 2004
Washington grondait ; maintenant que les primaires étaient terminées, les bus de campagne faisaient le plein, les macarons et les panneaux de pelouse étaient imprimés et les querelles partisanes se faisaient de plus en plus bruyantes. Il n'y a pas que les campagnes qui ont électrifié la capitale, il y a eu aussi des scandales. Le président Bush a été critiqué par les médias et les démocrates du Congrès pour sa récente intervention militaire en Irak (opération Wolverine), qui n'a pas atteint son objectif présumé, à savoir tuer Saddam Hussein et imposer un changement de régime dans le pays. L'opinion publique, qui s'était brièvement ralliée à l'opération, s'est depuis lors divisée et la cote d'approbation du président se maintenait à 47 %. L'attention des médias et la désapprobation de l'opinion publique ont fait chuter le soutien national à la stratégie du président et, pour la première fois, une majorité d'Américains a désapprouvé la gestion de la crise irakienne par le président. La démocrate Nancy Pelosi a accusé Bush de n'avoir "aucune politique pour l'Irak fondée sur la réalité" et le sénateur Robert Byrd, critique virulent, s'est dit "stupéfait par l'absence de stratégie de cette administration pour traiter la question irakienne"
L'équipe de communication de la Maison Blanche a fait des heures supplémentaires pour soutenir le Président, qui a pris "les mesures appropriées pour faire face à la menace de Saddam Hussein", selon le secrétaire de presse Scott McClellan. "On ne peut attendre d'un président qu'il consulte des centaines de législateurs avant de prendre des décisions en une fraction de seconde, c'est moi qui suis décideur, c'est moi qui décide", a déclaré le président. Mais Bush a manifestement été blessé par son action. Il a été contraint de demander à deux hauts fonctionnaires de démissionner, Paul Wolfowitz (au centre d'une enquête du Congrès démocrate) et George Tenet, qui avait insisté pour démissionner en raison des échecs des services de renseignement. Mais les médias et les démocrates n'ont pas cessé de menacer de citer à comparaître les dossiers de la Maison Blanche relatifs à l'opération ainsi qu'à d'autres questions.
La cerise sur le gâteau a été la réapparition d'une vieille controverse, celle du service militaire du président Bush. Apparue en 2000, la controverse l'accusait de ne pas avoir respecté son contrat militaire qui consistait à servir dans la garde nationale par opposition à la guerre du Viêt Nam. L'implication était que Bush avait triché pour ne pas servir dans la guerre. La controverse s'est transformée en un jeu du chat et de la souris où divers journalistes ont trouvé des documents qui contredisaient les diverses affirmations du président selon lesquelles il avait déjà tout révélé il y a quatre ans. Indépendamment de la validité de la controverse, le déluge de rapports n'a pas été favorable à Bush, plusieurs commentateurs dénigrant son service comme étant "bien en deçà de ses obligations militaires". L'humoriste Larry David s'est moqué du président en comparant son propre service dans les réserves de l'armée : "Chaque fois que j'ai mentionné mon service dans la réserve pendant le Viêt Nam, j'ai été accueilli par des ricanements et des moqueries. Mais aujourd'hui, grâce au président Bush, je peux me lever fièrement à ses côtés et aux côtés de tous les autres gars qui ont gardé le front intérieur".
Les attaques politiques ont connu une brève accalmie lorsque, le 5 juin 2004, l'ancien président Ronald Reagan est décédé chez lui, en Californie, à l'âge de 93 ans. Toutes les campagnes ont été temporairement suspendues par respect pour le "Gipper" et des funérailles nationales ont été organisées, auxquelles ont participé le plus grand nombre de dignitaires étrangers depuis les funérailles de John F. Kennedy en 1963. Lors d'une conférence de presse, le président Bush a fait l'éloge de Reagan pour avoir "mis fin à une ère de division et de doute" et l'a remercié en termes grandioses d'avoir restauré la nation et contribué à sauver le monde. "Il nous a toujours dit que le meilleur était à venir pour l'Amérique. Nous nous consolons en sachant que c'est également vrai pour lui. Son travail est terminé et une ville brillante l'attend. Que Dieu bénisse Ronald Reagan". Des membres du Congrès ont également été invités, notamment le sénateur John Edwards, candidat à l'investiture démocrate. La campagne de ce dernier a publié une courte déclaration beaucoup moins élogieuse sur le bilan de M. Reagan, soulignant plutôt sa forte personnalité et son engagement envers son épouse Nancy : "Quelle que soit sa politique, il était la voix de l'Amérique et il est toujours triste de voir disparaître l'un des grands Américains qui pouvait apporter du réconfort au monde".

Funérailles de Ronald Wilson Reagan, 40e président des États-Unis
Il n'a pas fallu longtemps pour que la politique revienne sur le devant de la scène, notamment avec l'ouverture de la saison des conventions. La première convention nationale a été celle du parti vert. L'éternel candidat Ralph Nader avait déjà annoncé son intention de se présenter pour la troisième fois à la présidence et son annonce avait effrayé certains démocrates qui considéraient sa campagne comme responsable d'avoir gâché les chances de Gore en 2000, et même certains des anciens partisans de Nader avaient retiré leur soutien à sa candidature, affirmant qu'ils devaient "s'unir contre Bush", mais Nader a réfuté les critiques : "J'ai décidé de me présenter en tant que candidat indépendant à l'élection présidentielle. ...] George Bush est une entreprise géante à la Maison Blanche qui se fait passer pour un être humain. Et l'intelligentsia libérale, a déclaré M. Nader, a permis à son parti de devenir captif des intérêts des entreprises. La décision de Nader de se présenter en tant qu'indépendant plutôt que de briguer l'investiture du parti vert a fait des vagues et les délégués étaient divisés. Nader était le candidat connu du parti et avait amené un nombre important de partisans au sein du mouvement, mais beaucoup d'autres pensaient qu'il était arrogant de la part de Nader de ne pas se présenter pour obtenir leur soutien et ont soutenu un rival, David Cobb, un activiste texan. En fin de compte, un compromis a été trouvé entre les délégués : le parti n'a pas officiellement désigné de candidat et a soutenu à la fois Cobb et Nader, laissant à chaque parti d'État le soin de choisir son propre candidat [1]. La candidature de Nader a suscité des haussements d'épaules feints de la part des porte-parole des autres candidats : "Si Ralph Nader se présente, le président Bush sera réélu, et si Ralph Nader ne se présente pas, le président Bush sera réélu", a déclaré le président du RNC, tandis que "John Edwards a fait ses preuves en attirant les progressistes, les modérés et les républicains mécontents, nous remporterons la Maison Blanche en novembre", a déclaré un collaborateur d'Edwards.
En plus des scandales et de la campagne, le documentariste américain Michael Moore (un ancien partisan de Nader) a sorti son nouveau film, Something CrookEd, qui se concentre sur la cupidité, la fraude et les scandales des entreprises américaines, en particulier Enron, World Com et K-mart. Moore a profité de l'occasion pour s'en prendre à la famille Bush et à son administration, en évoquant l'influence croissante des entreprises sur la politique. Something CrookEd a fait un bon démarrage pour un documentaire et a été salué par la critique, mais certains l'ont critiqué comme étant ouvertement partial en raison de sa sortie pendant l'année électorale (bien que le film ait attaqué les démocrates) et l'un d'entre eux l'a qualifié de "soutien prolongé à la campagne Edwards" Citizens United, un groupe conservateur, a intenté un procès, affirmant que le film était une publicité politique non divulguée. Le film a bénéficié du fait qu'Enron (l'élément central du film) est revenu dans l'actualité, grâce à l'inculpation de l'ancien PDG Kenneth Lay.

Affiche promotionnelle du documentaire Something CrookEd (2004)
Les démocrates se sont réunis pour leur convention à New York, une initiative soutenue par le maire progressiste Mark Green qui voulait montrer comment ses politiques libérales-progressistes réussissaient à réduire le taux de pauvreté de la ville et à améliorer la justice raciale tout en augmentant son budget et en maintenant la criminalité à un niveau bas.
À l'aube de la convention, de nombreux démocrates se sont montrés furieux contre le président Bush, mais après les appels de John Edwards en faveur d'une campagne axée sur la politique, la plupart d'entre eux ont serré les dents. "Il ne s'agit pas de Bush", a déclaré le président du parti, Lou Maguzzu, "il s'agit de l'avenir du pays". La convention était bondée et débordait dans les rues de New York, devant le Madison Square Garden. L'intention d'Edward était de se concentrer sur son message économique et de rester à l'écart des campagnes négatives afin d'éviter le stéréotype selon lequel les démocrates sont des obstructionnistes qui cherchent à enquêter sur la Maison Blanche plutôt qu'à gouverner. Cela n'a pas empêché le programme du parti démocrate de qualifier la politique de Bush de "faible et inefficace ... les revenus baissent et les prix augmentent ... il est temps que le gouvernement se concentre sur les Américains ordinaires". Le jour de l'ouverture de la convention, une nouvelle gaffe a été commise lorsque le vice-président Cheney, tentant de se moquer d'Edwards, a déclaré qu'il ne l'avait jamais rencontré parce qu'il se présentait rarement au Sénat, avant que de nombreuses photos des deux hommes ne soient diffusées peu après. Au début de la convention, les démocrates étaient très enthousiastes et positifs.
Le programme d'Edward comportait deux ruptures notables par rapport au courant dominant du parti. Il voulait s'éloigner de la critique de la politique irakienne de Bush et se concentrer sur l'échec de la politique étrangère de Bush dans son ensemble, ce qui a irrité une partie de l'aile gauche et militante du parti qui soupçonnait Edwards de soutenir une invasion de l'Irak alors que plusieurs membres du parti démocrate ont de toute façon fait connaître bruyamment leur propre opposition à la guerre contre l'Irak. La deuxième rupture concernait le libre-échange, soutenant une renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain "pour mieux protéger les emplois et le commerce américains", une question controversée étant donné que l'ancien président Clinton, qui avait finalisé l'ALENA, prendrait la parole. Le reste du programme comprenait l'annulation des réductions d'impôts pour les riches, l'augmentation du salaire minimum, le soutien à la main-d'œuvre américaine, la réduction du déficit et la réforme des soins de santé et des prix des médicaments aux États-Unis. Un délégué a qualifié le programme de "manifeste pour le changement", tandis qu'un républicain a déclaré qu'il lui donnait le tournis, "c'est comme s'ils étaient entrés dans un univers alternatif".
Les orateurs de la première soirée étaient des stars démocrates, notamment les anciens présidents Clinton et Carter, qui ont souligné l'engagement des démocrates en faveur de la coopération mondiale, de l'égalité des chances et de l'importance du gouvernement. La sénatrice Hillary Clinton a décrit M. Edwards comme le nouveau Clinton : "En 1992 et 1992, [Bill] a montré aux démocrates comment gagner, et John Edwards le fera aussi", Enfin, l'ancien vice-président Al Gore est monté sur scène et a plaisanté sur ses précédentes candidatures : "Comme vous le savez tous, j'espérais être ici dans des circonstances très différentes, mais croyez-moi, chaque vote compte. Ne laissez personne vous l'enlever ou vous convaincre de le gaspiller. "
Le deuxième jour de la convention, Elizabeth, l'épouse d'Edward, a parlé de l'importance de la foi et de la famille pour les Edwards : "Nous méritons des dirigeants qui permettent à leur foi et à leur morale de nous rapprocher, et non de nous éloigner les uns des autres. Nous méritons des dirigeants qui croient en chacun de nous et se battent pour nous tous".
Le révérend Al Sharpton a eu des mots enflammés pour les démocrates, réprimandant vivement Bush pour ses commentaires indiquant que les démocrates attendaient le vote afro-américain : "Monsieur le Président, je vous ai entendu dire que vous aviez des questions à poser aux électeurs, en particulier aux électeurs afro-américains. Et vous avez dit que le parti démocrate nous tenait pour acquis. Vous avez dit que le Parti républicain était le parti de Lincoln et de Frederick Douglass", a-t-il déclaré. "Il est vrai que M. Lincoln a signé la Proclamation d'émancipation. On nous avait promis 40 acres et une mule. Nous n'avons jamais eu les 40 acres. ... Nous n'avons pas eu la mule. Nous avons donc décidé de monter cet âne aussi loin qu'il nous mènerait".
L'oratrice principale de la convention, la gouverneure du Michigan Jennifer Granholm, a ensuite prononcé un discours enflammé sur l'économie et sur le fait que l'administration Bush avait perdu les "opportunités américaines" et qu'il fallait maintenant un Edwards "qui défende les Américains qui ont consacré leur vie à leur entreprise. Qui défendra les Américains et leurs familles confrontés à des plans de santé médiocres ou à des licenciements ? Qui défendra ces petits Américains qui apposent fièrement la mention "Made in America" sur leurs produits et qui veulent que cela reste ainsi ? John Edwards le fera."

En haut, de gauche à droite, le président Bill Clinton, la sénatrice Hillary Clinton, le président Carter, le vice-président Gore.
En bas, de gauche à droite, Elizabeth Edwards, le révérend Al Sharpton et la gouverneure Jennifer Granholm
Le lendemain, le candidat à la vice-présidence a été présenté. Le processus de sélection d'Edward incluait le sénateur Bob Graham de Floride, le gouverneur Tom Vilsack de l'Iowa et la gouverneure Janet Napolitano du Nouveau Mexique, qui étaient tous des démocrates issus d'États en pleine mutation. Il y avait aussi le sénateur Tom Daschle ou Hillary Clinton, qui pouvaient ajouter un peu de prestige au ticket (Hillary aurait été le premier choix d'Edward, mais on l'a informé qu'elle n'était pas intéressée par le poste). Enfin, il y avait ceux qui pouvaient apporter une diversité idéologique au ticket : la députée Nancy Pelosi de San Francisco, le sénateur Dick Durbin, le sénateur John Kerry et le président de la Chambre Dick Gephardt appartenaient tous à l'aile la plus libérale du parti.
La liste des candidats présélectionnés a été ramenée à cinq choix finaux : Bob Graham, Dick Gephardt, John Kerry, Janet Napolitano et Tom Vilsack. Le choix d'Edward s'est finalement porté sur la personne qui, selon lui, équilibrait le mieux le ticket, qui avait des opinions similaires aux siennes et qui disposait d'une expérience significative. Son choix a été dévoilé à la sortie de l'avion, les deux John, Edwards et Kerry.
John Kerry était considéré comme le candidat idéal pour équilibrer le ticket, un sénateur du Nord qui avait la réputation d'être un fervent opposant à la politique étrangère du Président, avec un passé de héros de guerre et une grande capacité à collecter des fonds. Cette décision a été saluée comme une bonne décision, car Kerry jouissait d'une bonne notoriété depuis le début de sa campagne, même si certains ont regretté que ce soit une occasion manquée pour un candidat à la vice-présidence plus énergique, mais ces inquiétudes ont été balayées par Edwards (selon les aides, Edwards ne voulait pas qu'un candidat à la vice-présidence lui fasse de l'ombre).
Kerry a été présenté par sa femme Teresa et ses filles, qui ont parlé de la perspicacité et des idéaux de Kerry : "John Kerry est un combattant. Il a gagné ses médailles à l'ancienne, en risquant sa vie pour son pays. Et personne ne peut aider à défendre cette nation plus vigoureusement que lui". Lorsque Kerry est monté sur scène, il a prononcé un discours vif et confiant, énumérant les échecs de Bush et louant le parcours d'Edward : "Je suis fier d'être le colistier d'un homme dont la vie est l'histoire du rêve américain, et qui a travaillé chaque jour pour que ce rêve devienne réalité pour tous les Américains - John Edwards, de Caroline du Nord". Ce fils d'ouvrier est prêt à diriger - et en janvier prochain, les Américains seront fiers d'avoir un combattant de la classe moyenne pour succéder à George Bush en tant que prochain président des États-Unis".

En haut, de gauche à droite, Teresa Kerry, titres de journaux identifiant puis corrigeant le choix d'Edwards comme vice-président, le sénateur et candidat à la vice-présidence John Kerry.
En bas, de gauche à droite, le sénateur Zell Miller et Ted Kenedy
Le dernier jour de la convention a été consacré à montrer l'attrait de John Edward pour l'ensemble du parti démocrate, avec des discours prononcés par ses flancs droit et gauche, les sénateurs Zell Miller et Ted Kennedy, tous deux opposés sur le plan idéologique. Zell Miller avait le plus souvent voté avec l'administration Bush et entrait régulièrement en conflit avec ses camarades démocrates. Les dirigeants républicains avaient tenté de le faire changer de parti pour prendre le contrôle du Sénat, mais Zell leur avait répondu qu'il était "démocrate jusqu'à sa mort". Son discours est largement axé sur le patriotisme de John Edwards et ses valeurs américaines, ainsi que sur un appel aux habitants du Sud à soutenir Edwards : "John Edwards vous comprend, il comprend votre famille, vos voisins et vos luttes, il est de notre devoir, en tant que démocrates, de mobiliser toutes les parties du pays et tous les aspects de la vie pour restaurer le rêve américain" [2].
Ce discours était à l'opposé de celui de Ted Kennedy, qui mettait l'accent sur la politique sociale et économique à venir, et critiquait Bush en le comparant à "un monarque nommé George qui a hérité de la couronne" et en se réjouissant du combat à venir : "Ce sont des combats familiers. Nous nous sommes déjà battus et nous avons déjà gagné. Et avec John Edwards et John Kerry à notre tête, nous les gagnerons encore et encore et encore, et nous rendrons l'Amérique plus forte chez elle et respectée une fois de plus dans le monde".
Le candidat est ensuite monté sur scène et a prononcé un discours enflammé axé sur son message économique concernant les "deux Amériques" et promettant que "nous vivons toujours dans deux Amériques différentes, l'une pour les gens qui sont prêts pour la vie, l'autre pour la plupart des Américains qui vivent d'un chèque de paie à l'autre". Il a fièrement raconté sa propre ascension et a déclaré que M. Kerry partageait ses valeurs. Nous devons construire une seule Amérique", a-t-il déclaré. Il a imploré les électeurs de rejeter ce qu'il a appelé "les vieilles politiques fatiguées, haineuses et négatives du passé" et d'embrasser l'espoir. À maintes reprises, il a repris le refrain : "L'espoir est en route !".
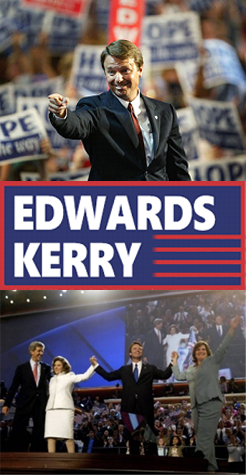
Nomination d'Edwards-Kerry en 2004
Les Républicains ont organisé leur convention à Tampa, en Floride (on craignait qu'un ouragan ne vienne perturber l'événement, mais une déviation a permis d'épargner la baie) pour désigner à nouveau le président Bush et le vice-président Dick Cheney. Les médias avaient brièvement évoqué la possibilité que Cheney soit écarté de la liste en raison des scandales en cours ou d'éventuelles complications de santé, mais l'équipe de Bush a écarté ces doutes : "Je ne sais pas d'où viennent toutes ces théories du complot", a déclaré Matthew Dowd, stratège en chef de la campagne de Bush. Ce ne sont que des discussions de café à l'intérieur du Beltway, c'est tout ce que c'est. Le thème de la convention était axé sur le conservatisme compatissant du président et sur la manière dont les électeurs devraient soutenir son administration qui a fait ses preuves face à Edwards, qui manquait cruellement d'expérience, et aux démocrates qui n'étaient pas dignes de confiance. L'accent a été mis sur la manière dont Bush allait perpétuer l'héritage de Reagan, à savoir une Amérique forte et pleine d'espoir, par rapport à la vision déprimante proposée par John Edwards.
John McCain a été l'un des principaux orateurs de la première soirée. Souvent mis en difficulté par le programme du président, son soutien vocal a été déterminant, son ton graveleux affirmant que les idéaux républicains étaient les idéaux américains et qu'ils devaient "soutenir notre président" et mettant en doute l'engagement du parti démocrate à s'opposer aux ennemis de l'Amérique.
Les membres républicains du Congrès ont dénoncé l'"obstruction" des démocrates qui n'ont pas soutenu le plan d'assurance-médicaments du président. Le frère du président, Jeb Bush, gouverneur de Floride, a prononcé un discours devant un public enthousiaste (où l'on pouvait voir quelques pancartes "Jeb 08"). Il a expliqué ce que représentait la famille Bush et a exhorté les conservateurs à soutenir le président face à ce qu'il a appelé un "raz-de-marée de dollars libéraux d'Hollywood" : "La famille Bush est synonyme de force à l'intérieur du pays et à l'étranger, et nous n'externaliserons jamais nos principes".
Le discours d'ouverture a été prononcé par l'autre sénatrice de Caroline du Nord, Elizabeth Dole, qui a démontré que le Grand Old Party était le parti de Lincoln, de Reagan (où des pancartes déclaraient "gagnons-en une pour le Gipper") et maintenant de Bush, célébrant l'engagement du parti en faveur du droit à la vie, de l'opposition aux dictateurs à l'étranger et de la place centrale de la foi dans le gouvernement : "La Constitution garantit la liberté de religion, et non la liberté de ne pas avoir de religion. Le droit d'adorer Dieu n'a pas été inventé par les républicains, mais c'est quelque chose que les républicains défendront". [3]
Parmi les autres discours, le sénateur de Pennsylvanie Rick Santorum a insisté sur le thème de la famille et s'en est pris aux démocrates pour leur soutien au mariage gay : "La clé d'une culture plus riche, ce sont des familles fortes, et la clé de familles fortes, ce sont des mariages forts... George Bush a montré sa compassion en faisant avancer ses initiatives religieuses, en renforçant le mariage et en se battant pour que ce soit le peuple américain qui définisse le mariage, et non des juges gauchistes". "
Etoile montante du parti, Paul Ryan, représentant du Wisconsin, a fait de la politique fiscale différente de Bush et d'Edwards la question centrale pour les Américains : "Grâce à l'allègement fiscal de Bush, chaque Américain qui paie l'impôt fédéral sur le revenu conserve désormais une plus grande partie de ce qu'il gagne, John Edwards prétend vouloir aider la classe moyenne, mais lorsqu'il a eu l'occasion de le faire, il a voté contre".
Le gouverneur de New York, M. Pataki, a fait l'éloge des réalisations de M. Bush : "George Bush a dit qu'il allait redresser l'économie et créer de nouveaux emplois. Il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Il a dit qu'il réduirait les impôts de la classe moyenne et qu'il allégerait la charge fiscale de tous les Américains. Il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Il a dit qu'il aiderait les petites entreprises, qu'il protégerait la sécurité sociale et qu'il développerait l'accès à la propriété. Il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Il y a bien d'autres choses encore, mais vous avez compris".

En haut, de gauche à droite, le sénateur John McCain, le gouverneur Jeb Bush, la sénatrice Elizabeth Dole
En bas, de gauche à droite, le sénateur Rick Santorum, le représentant Paul Ryan et le gouverneur George Pataki.
La première dame, Laura Bush, a pris la parole pour exprimer sa fierté de voir son mari "diriger notre pays avec force et conviction", "Les enjeux sont si importants", a déclaré Mme Bush. "C'est pourquoi je veux parler de la question qui me semble la plus importante pour mes propres filles, pour toutes nos familles et pour notre avenir : Le travail de George pour assurer l'avenir de notre pays et pour que tous les enfants puissent grandir dans un pays plus prospère". Ses filles, qui parlaient rarement de politique, ont encouragé les jeunes à voter : "Jenna et moi ne sommes pas très politisées, mais nous aimons trop notre père pour nous tenir à l'écart et le regarder depuis la ligne de touche. Nous avons compris que ce serait sa dernière campagne et que nous devions y participer, tout comme vous devriez le faire".
Dick Cheney a joué son rôle de chien d'attaque de l'administration en s'en prenant directement à Edwards : "Lors de ses quelques apparitions au Sénat, John Edwards s'est opposé à l'interdiction des avortements par naissance partielle, à la protection du droit des Américains à porter des armes, à l'indépendance énergétique des Américains, au renforcement de la lutte contre les terroristes et les tyrans, et à la réduction des impôts. La seule chose que le sénateur Edwards défend, c'est lui-même. Pourquoi diable laisserions-nous tomber notre commandant en chef pour un avocat spécialisé dans les dommages corporels qui s'est fait couper les cheveux à 500 dollars ?
Le président a été présenté par Mel Martinez, candidat républicain au siège vacant du Sénat de Floride. Il y a plus de quarante ans, mes parents m'ont envoyé, alors que j'étais un jeune enfant, hors d'un pays gouverné par un dictateur communiste et maintenant, il y a seulement quarante-huit heures, je suis devenu le candidat républicain au Sénat des États-Unis de ce grand État qu'est la Floride. Seulement en Amérique ! ... Je souhaite rembourser la dette de gratitude en défendant et en sauvegardant avec passion le rêve américain et c'est pourquoi je soutiens notre grand président George W. Bush !"

De gauche à droite, Laura Bush, Barabra et Jenna Bush, le vice-président Dick Cheney et le sénateur Mel Martinez.
Lorsque le président est monté sur scène, M. Bush a également joué sur le thème de l'espoir et a exposé ses projets de création d'emplois, de développement de l'éducation et des soins de santé, tout en dénonçant l'inauthenticité et l'inexpérience de M. Edwards, le tout sous les chants de "Four more Years". Même lorsque nous ne sommes pas d'accord, vous savez au moins que je suis sincère (...) Je me présente à l'élection présidentielle avec un projet clair et positif pour construire une Amérique plus porteuse d'espoir. Je me présente avec une philosophie conservatrice compatissante : le gouvernement doit aider les gens à améliorer leur vie, et non pas essayer de diriger leur vie. Je crois que cette nation a besoin d'une direction stable, cohérente et fondée sur des principes - et c'est pourquoi, avec votre aide, nous gagnerons cette élection".
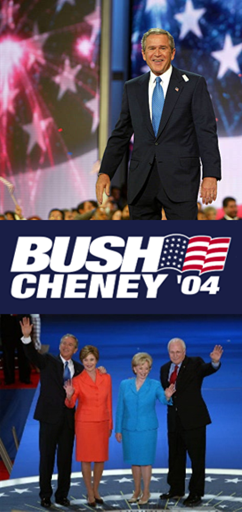
Renomination de Bush-Cheney en 2004
Le lendemain du jour où le président a accepté la renomination de son parti, le 4 septembre 2004, les Américains s'attendaient à voir les experts débattre du discours de Bush, jugeant s'il lui apporterait le coup de pouce nécessaire dans les sondages. Mais au lieu de cela, c'est une image différente qui s'est affichée sur leurs écrans et sur ceux du monde entier ...
4 septembre 2004.

[1] OTL le compromis n'a pas abouti et Nader a dû se débrouiller seul pour obtenir l'accès au scrutin.
[2] Zell Miller était un démocrate conservateur qui a soutenu Bush.
[3] La convention républicaine est moins modérée que celle OTL.
Logos des Conventions nationales du Parti démocrate et du Parti républicain de 2004
Washington grondait ; maintenant que les primaires étaient terminées, les bus de campagne faisaient le plein, les macarons et les panneaux de pelouse étaient imprimés et les querelles partisanes se faisaient de plus en plus bruyantes. Il n'y a pas que les campagnes qui ont électrifié la capitale, il y a eu aussi des scandales. Le président Bush a été critiqué par les médias et les démocrates du Congrès pour sa récente intervention militaire en Irak (opération Wolverine), qui n'a pas atteint son objectif présumé, à savoir tuer Saddam Hussein et imposer un changement de régime dans le pays. L'opinion publique, qui s'était brièvement ralliée à l'opération, s'est depuis lors divisée et la cote d'approbation du président se maintenait à 47 %. L'attention des médias et la désapprobation de l'opinion publique ont fait chuter le soutien national à la stratégie du président et, pour la première fois, une majorité d'Américains a désapprouvé la gestion de la crise irakienne par le président. La démocrate Nancy Pelosi a accusé Bush de n'avoir "aucune politique pour l'Irak fondée sur la réalité" et le sénateur Robert Byrd, critique virulent, s'est dit "stupéfait par l'absence de stratégie de cette administration pour traiter la question irakienne"
L'équipe de communication de la Maison Blanche a fait des heures supplémentaires pour soutenir le Président, qui a pris "les mesures appropriées pour faire face à la menace de Saddam Hussein", selon le secrétaire de presse Scott McClellan. "On ne peut attendre d'un président qu'il consulte des centaines de législateurs avant de prendre des décisions en une fraction de seconde, c'est moi qui suis décideur, c'est moi qui décide", a déclaré le président. Mais Bush a manifestement été blessé par son action. Il a été contraint de demander à deux hauts fonctionnaires de démissionner, Paul Wolfowitz (au centre d'une enquête du Congrès démocrate) et George Tenet, qui avait insisté pour démissionner en raison des échecs des services de renseignement. Mais les médias et les démocrates n'ont pas cessé de menacer de citer à comparaître les dossiers de la Maison Blanche relatifs à l'opération ainsi qu'à d'autres questions.
La cerise sur le gâteau a été la réapparition d'une vieille controverse, celle du service militaire du président Bush. Apparue en 2000, la controverse l'accusait de ne pas avoir respecté son contrat militaire qui consistait à servir dans la garde nationale par opposition à la guerre du Viêt Nam. L'implication était que Bush avait triché pour ne pas servir dans la guerre. La controverse s'est transformée en un jeu du chat et de la souris où divers journalistes ont trouvé des documents qui contredisaient les diverses affirmations du président selon lesquelles il avait déjà tout révélé il y a quatre ans. Indépendamment de la validité de la controverse, le déluge de rapports n'a pas été favorable à Bush, plusieurs commentateurs dénigrant son service comme étant "bien en deçà de ses obligations militaires". L'humoriste Larry David s'est moqué du président en comparant son propre service dans les réserves de l'armée : "Chaque fois que j'ai mentionné mon service dans la réserve pendant le Viêt Nam, j'ai été accueilli par des ricanements et des moqueries. Mais aujourd'hui, grâce au président Bush, je peux me lever fièrement à ses côtés et aux côtés de tous les autres gars qui ont gardé le front intérieur".
Les attaques politiques ont connu une brève accalmie lorsque, le 5 juin 2004, l'ancien président Ronald Reagan est décédé chez lui, en Californie, à l'âge de 93 ans. Toutes les campagnes ont été temporairement suspendues par respect pour le "Gipper" et des funérailles nationales ont été organisées, auxquelles ont participé le plus grand nombre de dignitaires étrangers depuis les funérailles de John F. Kennedy en 1963. Lors d'une conférence de presse, le président Bush a fait l'éloge de Reagan pour avoir "mis fin à une ère de division et de doute" et l'a remercié en termes grandioses d'avoir restauré la nation et contribué à sauver le monde. "Il nous a toujours dit que le meilleur était à venir pour l'Amérique. Nous nous consolons en sachant que c'est également vrai pour lui. Son travail est terminé et une ville brillante l'attend. Que Dieu bénisse Ronald Reagan". Des membres du Congrès ont également été invités, notamment le sénateur John Edwards, candidat à l'investiture démocrate. La campagne de ce dernier a publié une courte déclaration beaucoup moins élogieuse sur le bilan de M. Reagan, soulignant plutôt sa forte personnalité et son engagement envers son épouse Nancy : "Quelle que soit sa politique, il était la voix de l'Amérique et il est toujours triste de voir disparaître l'un des grands Américains qui pouvait apporter du réconfort au monde".
Funérailles de Ronald Wilson Reagan, 40e président des États-Unis
Il n'a pas fallu longtemps pour que la politique revienne sur le devant de la scène, notamment avec l'ouverture de la saison des conventions. La première convention nationale a été celle du parti vert. L'éternel candidat Ralph Nader avait déjà annoncé son intention de se présenter pour la troisième fois à la présidence et son annonce avait effrayé certains démocrates qui considéraient sa campagne comme responsable d'avoir gâché les chances de Gore en 2000, et même certains des anciens partisans de Nader avaient retiré leur soutien à sa candidature, affirmant qu'ils devaient "s'unir contre Bush", mais Nader a réfuté les critiques : "J'ai décidé de me présenter en tant que candidat indépendant à l'élection présidentielle. ...] George Bush est une entreprise géante à la Maison Blanche qui se fait passer pour un être humain. Et l'intelligentsia libérale, a déclaré M. Nader, a permis à son parti de devenir captif des intérêts des entreprises. La décision de Nader de se présenter en tant qu'indépendant plutôt que de briguer l'investiture du parti vert a fait des vagues et les délégués étaient divisés. Nader était le candidat connu du parti et avait amené un nombre important de partisans au sein du mouvement, mais beaucoup d'autres pensaient qu'il était arrogant de la part de Nader de ne pas se présenter pour obtenir leur soutien et ont soutenu un rival, David Cobb, un activiste texan. En fin de compte, un compromis a été trouvé entre les délégués : le parti n'a pas officiellement désigné de candidat et a soutenu à la fois Cobb et Nader, laissant à chaque parti d'État le soin de choisir son propre candidat [1]. La candidature de Nader a suscité des haussements d'épaules feints de la part des porte-parole des autres candidats : "Si Ralph Nader se présente, le président Bush sera réélu, et si Ralph Nader ne se présente pas, le président Bush sera réélu", a déclaré le président du RNC, tandis que "John Edwards a fait ses preuves en attirant les progressistes, les modérés et les républicains mécontents, nous remporterons la Maison Blanche en novembre", a déclaré un collaborateur d'Edwards.
En plus des scandales et de la campagne, le documentariste américain Michael Moore (un ancien partisan de Nader) a sorti son nouveau film, Something CrookEd, qui se concentre sur la cupidité, la fraude et les scandales des entreprises américaines, en particulier Enron, World Com et K-mart. Moore a profité de l'occasion pour s'en prendre à la famille Bush et à son administration, en évoquant l'influence croissante des entreprises sur la politique. Something CrookEd a fait un bon démarrage pour un documentaire et a été salué par la critique, mais certains l'ont critiqué comme étant ouvertement partial en raison de sa sortie pendant l'année électorale (bien que le film ait attaqué les démocrates) et l'un d'entre eux l'a qualifié de "soutien prolongé à la campagne Edwards" Citizens United, un groupe conservateur, a intenté un procès, affirmant que le film était une publicité politique non divulguée. Le film a bénéficié du fait qu'Enron (l'élément central du film) est revenu dans l'actualité, grâce à l'inculpation de l'ancien PDG Kenneth Lay.
Affiche promotionnelle du documentaire Something CrookEd (2004)
Les démocrates se sont réunis pour leur convention à New York, une initiative soutenue par le maire progressiste Mark Green qui voulait montrer comment ses politiques libérales-progressistes réussissaient à réduire le taux de pauvreté de la ville et à améliorer la justice raciale tout en augmentant son budget et en maintenant la criminalité à un niveau bas.
À l'aube de la convention, de nombreux démocrates se sont montrés furieux contre le président Bush, mais après les appels de John Edwards en faveur d'une campagne axée sur la politique, la plupart d'entre eux ont serré les dents. "Il ne s'agit pas de Bush", a déclaré le président du parti, Lou Maguzzu, "il s'agit de l'avenir du pays". La convention était bondée et débordait dans les rues de New York, devant le Madison Square Garden. L'intention d'Edward était de se concentrer sur son message économique et de rester à l'écart des campagnes négatives afin d'éviter le stéréotype selon lequel les démocrates sont des obstructionnistes qui cherchent à enquêter sur la Maison Blanche plutôt qu'à gouverner. Cela n'a pas empêché le programme du parti démocrate de qualifier la politique de Bush de "faible et inefficace ... les revenus baissent et les prix augmentent ... il est temps que le gouvernement se concentre sur les Américains ordinaires". Le jour de l'ouverture de la convention, une nouvelle gaffe a été commise lorsque le vice-président Cheney, tentant de se moquer d'Edwards, a déclaré qu'il ne l'avait jamais rencontré parce qu'il se présentait rarement au Sénat, avant que de nombreuses photos des deux hommes ne soient diffusées peu après. Au début de la convention, les démocrates étaient très enthousiastes et positifs.
Le programme d'Edward comportait deux ruptures notables par rapport au courant dominant du parti. Il voulait s'éloigner de la critique de la politique irakienne de Bush et se concentrer sur l'échec de la politique étrangère de Bush dans son ensemble, ce qui a irrité une partie de l'aile gauche et militante du parti qui soupçonnait Edwards de soutenir une invasion de l'Irak alors que plusieurs membres du parti démocrate ont de toute façon fait connaître bruyamment leur propre opposition à la guerre contre l'Irak. La deuxième rupture concernait le libre-échange, soutenant une renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain "pour mieux protéger les emplois et le commerce américains", une question controversée étant donné que l'ancien président Clinton, qui avait finalisé l'ALENA, prendrait la parole. Le reste du programme comprenait l'annulation des réductions d'impôts pour les riches, l'augmentation du salaire minimum, le soutien à la main-d'œuvre américaine, la réduction du déficit et la réforme des soins de santé et des prix des médicaments aux États-Unis. Un délégué a qualifié le programme de "manifeste pour le changement", tandis qu'un républicain a déclaré qu'il lui donnait le tournis, "c'est comme s'ils étaient entrés dans un univers alternatif".
Les orateurs de la première soirée étaient des stars démocrates, notamment les anciens présidents Clinton et Carter, qui ont souligné l'engagement des démocrates en faveur de la coopération mondiale, de l'égalité des chances et de l'importance du gouvernement. La sénatrice Hillary Clinton a décrit M. Edwards comme le nouveau Clinton : "En 1992 et 1992, [Bill] a montré aux démocrates comment gagner, et John Edwards le fera aussi", Enfin, l'ancien vice-président Al Gore est monté sur scène et a plaisanté sur ses précédentes candidatures : "Comme vous le savez tous, j'espérais être ici dans des circonstances très différentes, mais croyez-moi, chaque vote compte. Ne laissez personne vous l'enlever ou vous convaincre de le gaspiller. "
Le deuxième jour de la convention, Elizabeth, l'épouse d'Edward, a parlé de l'importance de la foi et de la famille pour les Edwards : "Nous méritons des dirigeants qui permettent à leur foi et à leur morale de nous rapprocher, et non de nous éloigner les uns des autres. Nous méritons des dirigeants qui croient en chacun de nous et se battent pour nous tous".
Le révérend Al Sharpton a eu des mots enflammés pour les démocrates, réprimandant vivement Bush pour ses commentaires indiquant que les démocrates attendaient le vote afro-américain : "Monsieur le Président, je vous ai entendu dire que vous aviez des questions à poser aux électeurs, en particulier aux électeurs afro-américains. Et vous avez dit que le parti démocrate nous tenait pour acquis. Vous avez dit que le Parti républicain était le parti de Lincoln et de Frederick Douglass", a-t-il déclaré. "Il est vrai que M. Lincoln a signé la Proclamation d'émancipation. On nous avait promis 40 acres et une mule. Nous n'avons jamais eu les 40 acres. ... Nous n'avons pas eu la mule. Nous avons donc décidé de monter cet âne aussi loin qu'il nous mènerait".
L'oratrice principale de la convention, la gouverneure du Michigan Jennifer Granholm, a ensuite prononcé un discours enflammé sur l'économie et sur le fait que l'administration Bush avait perdu les "opportunités américaines" et qu'il fallait maintenant un Edwards "qui défende les Américains qui ont consacré leur vie à leur entreprise. Qui défendra les Américains et leurs familles confrontés à des plans de santé médiocres ou à des licenciements ? Qui défendra ces petits Américains qui apposent fièrement la mention "Made in America" sur leurs produits et qui veulent que cela reste ainsi ? John Edwards le fera."
En haut, de gauche à droite, le président Bill Clinton, la sénatrice Hillary Clinton, le président Carter, le vice-président Gore.
En bas, de gauche à droite, Elizabeth Edwards, le révérend Al Sharpton et la gouverneure Jennifer Granholm
Le lendemain, le candidat à la vice-présidence a été présenté. Le processus de sélection d'Edward incluait le sénateur Bob Graham de Floride, le gouverneur Tom Vilsack de l'Iowa et la gouverneure Janet Napolitano du Nouveau Mexique, qui étaient tous des démocrates issus d'États en pleine mutation. Il y avait aussi le sénateur Tom Daschle ou Hillary Clinton, qui pouvaient ajouter un peu de prestige au ticket (Hillary aurait été le premier choix d'Edward, mais on l'a informé qu'elle n'était pas intéressée par le poste). Enfin, il y avait ceux qui pouvaient apporter une diversité idéologique au ticket : la députée Nancy Pelosi de San Francisco, le sénateur Dick Durbin, le sénateur John Kerry et le président de la Chambre Dick Gephardt appartenaient tous à l'aile la plus libérale du parti.
La liste des candidats présélectionnés a été ramenée à cinq choix finaux : Bob Graham, Dick Gephardt, John Kerry, Janet Napolitano et Tom Vilsack. Le choix d'Edward s'est finalement porté sur la personne qui, selon lui, équilibrait le mieux le ticket, qui avait des opinions similaires aux siennes et qui disposait d'une expérience significative. Son choix a été dévoilé à la sortie de l'avion, les deux John, Edwards et Kerry.
John Kerry était considéré comme le candidat idéal pour équilibrer le ticket, un sénateur du Nord qui avait la réputation d'être un fervent opposant à la politique étrangère du Président, avec un passé de héros de guerre et une grande capacité à collecter des fonds. Cette décision a été saluée comme une bonne décision, car Kerry jouissait d'une bonne notoriété depuis le début de sa campagne, même si certains ont regretté que ce soit une occasion manquée pour un candidat à la vice-présidence plus énergique, mais ces inquiétudes ont été balayées par Edwards (selon les aides, Edwards ne voulait pas qu'un candidat à la vice-présidence lui fasse de l'ombre).
Kerry a été présenté par sa femme Teresa et ses filles, qui ont parlé de la perspicacité et des idéaux de Kerry : "John Kerry est un combattant. Il a gagné ses médailles à l'ancienne, en risquant sa vie pour son pays. Et personne ne peut aider à défendre cette nation plus vigoureusement que lui". Lorsque Kerry est monté sur scène, il a prononcé un discours vif et confiant, énumérant les échecs de Bush et louant le parcours d'Edward : "Je suis fier d'être le colistier d'un homme dont la vie est l'histoire du rêve américain, et qui a travaillé chaque jour pour que ce rêve devienne réalité pour tous les Américains - John Edwards, de Caroline du Nord". Ce fils d'ouvrier est prêt à diriger - et en janvier prochain, les Américains seront fiers d'avoir un combattant de la classe moyenne pour succéder à George Bush en tant que prochain président des États-Unis".
En haut, de gauche à droite, Teresa Kerry, titres de journaux identifiant puis corrigeant le choix d'Edwards comme vice-président, le sénateur et candidat à la vice-présidence John Kerry.
En bas, de gauche à droite, le sénateur Zell Miller et Ted Kenedy
Le dernier jour de la convention a été consacré à montrer l'attrait de John Edward pour l'ensemble du parti démocrate, avec des discours prononcés par ses flancs droit et gauche, les sénateurs Zell Miller et Ted Kennedy, tous deux opposés sur le plan idéologique. Zell Miller avait le plus souvent voté avec l'administration Bush et entrait régulièrement en conflit avec ses camarades démocrates. Les dirigeants républicains avaient tenté de le faire changer de parti pour prendre le contrôle du Sénat, mais Zell leur avait répondu qu'il était "démocrate jusqu'à sa mort". Son discours est largement axé sur le patriotisme de John Edwards et ses valeurs américaines, ainsi que sur un appel aux habitants du Sud à soutenir Edwards : "John Edwards vous comprend, il comprend votre famille, vos voisins et vos luttes, il est de notre devoir, en tant que démocrates, de mobiliser toutes les parties du pays et tous les aspects de la vie pour restaurer le rêve américain" [2].
Ce discours était à l'opposé de celui de Ted Kennedy, qui mettait l'accent sur la politique sociale et économique à venir, et critiquait Bush en le comparant à "un monarque nommé George qui a hérité de la couronne" et en se réjouissant du combat à venir : "Ce sont des combats familiers. Nous nous sommes déjà battus et nous avons déjà gagné. Et avec John Edwards et John Kerry à notre tête, nous les gagnerons encore et encore et encore, et nous rendrons l'Amérique plus forte chez elle et respectée une fois de plus dans le monde".
Le candidat est ensuite monté sur scène et a prononcé un discours enflammé axé sur son message économique concernant les "deux Amériques" et promettant que "nous vivons toujours dans deux Amériques différentes, l'une pour les gens qui sont prêts pour la vie, l'autre pour la plupart des Américains qui vivent d'un chèque de paie à l'autre". Il a fièrement raconté sa propre ascension et a déclaré que M. Kerry partageait ses valeurs. Nous devons construire une seule Amérique", a-t-il déclaré. Il a imploré les électeurs de rejeter ce qu'il a appelé "les vieilles politiques fatiguées, haineuses et négatives du passé" et d'embrasser l'espoir. À maintes reprises, il a repris le refrain : "L'espoir est en route !".
Nomination d'Edwards-Kerry en 2004
Les Républicains ont organisé leur convention à Tampa, en Floride (on craignait qu'un ouragan ne vienne perturber l'événement, mais une déviation a permis d'épargner la baie) pour désigner à nouveau le président Bush et le vice-président Dick Cheney. Les médias avaient brièvement évoqué la possibilité que Cheney soit écarté de la liste en raison des scandales en cours ou d'éventuelles complications de santé, mais l'équipe de Bush a écarté ces doutes : "Je ne sais pas d'où viennent toutes ces théories du complot", a déclaré Matthew Dowd, stratège en chef de la campagne de Bush. Ce ne sont que des discussions de café à l'intérieur du Beltway, c'est tout ce que c'est. Le thème de la convention était axé sur le conservatisme compatissant du président et sur la manière dont les électeurs devraient soutenir son administration qui a fait ses preuves face à Edwards, qui manquait cruellement d'expérience, et aux démocrates qui n'étaient pas dignes de confiance. L'accent a été mis sur la manière dont Bush allait perpétuer l'héritage de Reagan, à savoir une Amérique forte et pleine d'espoir, par rapport à la vision déprimante proposée par John Edwards.
John McCain a été l'un des principaux orateurs de la première soirée. Souvent mis en difficulté par le programme du président, son soutien vocal a été déterminant, son ton graveleux affirmant que les idéaux républicains étaient les idéaux américains et qu'ils devaient "soutenir notre président" et mettant en doute l'engagement du parti démocrate à s'opposer aux ennemis de l'Amérique.
Les membres républicains du Congrès ont dénoncé l'"obstruction" des démocrates qui n'ont pas soutenu le plan d'assurance-médicaments du président. Le frère du président, Jeb Bush, gouverneur de Floride, a prononcé un discours devant un public enthousiaste (où l'on pouvait voir quelques pancartes "Jeb 08"). Il a expliqué ce que représentait la famille Bush et a exhorté les conservateurs à soutenir le président face à ce qu'il a appelé un "raz-de-marée de dollars libéraux d'Hollywood" : "La famille Bush est synonyme de force à l'intérieur du pays et à l'étranger, et nous n'externaliserons jamais nos principes".
Le discours d'ouverture a été prononcé par l'autre sénatrice de Caroline du Nord, Elizabeth Dole, qui a démontré que le Grand Old Party était le parti de Lincoln, de Reagan (où des pancartes déclaraient "gagnons-en une pour le Gipper") et maintenant de Bush, célébrant l'engagement du parti en faveur du droit à la vie, de l'opposition aux dictateurs à l'étranger et de la place centrale de la foi dans le gouvernement : "La Constitution garantit la liberté de religion, et non la liberté de ne pas avoir de religion. Le droit d'adorer Dieu n'a pas été inventé par les républicains, mais c'est quelque chose que les républicains défendront". [3]
Parmi les autres discours, le sénateur de Pennsylvanie Rick Santorum a insisté sur le thème de la famille et s'en est pris aux démocrates pour leur soutien au mariage gay : "La clé d'une culture plus riche, ce sont des familles fortes, et la clé de familles fortes, ce sont des mariages forts... George Bush a montré sa compassion en faisant avancer ses initiatives religieuses, en renforçant le mariage et en se battant pour que ce soit le peuple américain qui définisse le mariage, et non des juges gauchistes". "
Etoile montante du parti, Paul Ryan, représentant du Wisconsin, a fait de la politique fiscale différente de Bush et d'Edwards la question centrale pour les Américains : "Grâce à l'allègement fiscal de Bush, chaque Américain qui paie l'impôt fédéral sur le revenu conserve désormais une plus grande partie de ce qu'il gagne, John Edwards prétend vouloir aider la classe moyenne, mais lorsqu'il a eu l'occasion de le faire, il a voté contre".
Le gouverneur de New York, M. Pataki, a fait l'éloge des réalisations de M. Bush : "George Bush a dit qu'il allait redresser l'économie et créer de nouveaux emplois. Il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Il a dit qu'il réduirait les impôts de la classe moyenne et qu'il allégerait la charge fiscale de tous les Américains. Il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Il a dit qu'il aiderait les petites entreprises, qu'il protégerait la sécurité sociale et qu'il développerait l'accès à la propriété. Il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Il y a bien d'autres choses encore, mais vous avez compris".
En haut, de gauche à droite, le sénateur John McCain, le gouverneur Jeb Bush, la sénatrice Elizabeth Dole
En bas, de gauche à droite, le sénateur Rick Santorum, le représentant Paul Ryan et le gouverneur George Pataki.
La première dame, Laura Bush, a pris la parole pour exprimer sa fierté de voir son mari "diriger notre pays avec force et conviction", "Les enjeux sont si importants", a déclaré Mme Bush. "C'est pourquoi je veux parler de la question qui me semble la plus importante pour mes propres filles, pour toutes nos familles et pour notre avenir : Le travail de George pour assurer l'avenir de notre pays et pour que tous les enfants puissent grandir dans un pays plus prospère". Ses filles, qui parlaient rarement de politique, ont encouragé les jeunes à voter : "Jenna et moi ne sommes pas très politisées, mais nous aimons trop notre père pour nous tenir à l'écart et le regarder depuis la ligne de touche. Nous avons compris que ce serait sa dernière campagne et que nous devions y participer, tout comme vous devriez le faire".
Dick Cheney a joué son rôle de chien d'attaque de l'administration en s'en prenant directement à Edwards : "Lors de ses quelques apparitions au Sénat, John Edwards s'est opposé à l'interdiction des avortements par naissance partielle, à la protection du droit des Américains à porter des armes, à l'indépendance énergétique des Américains, au renforcement de la lutte contre les terroristes et les tyrans, et à la réduction des impôts. La seule chose que le sénateur Edwards défend, c'est lui-même. Pourquoi diable laisserions-nous tomber notre commandant en chef pour un avocat spécialisé dans les dommages corporels qui s'est fait couper les cheveux à 500 dollars ?
Le président a été présenté par Mel Martinez, candidat républicain au siège vacant du Sénat de Floride. Il y a plus de quarante ans, mes parents m'ont envoyé, alors que j'étais un jeune enfant, hors d'un pays gouverné par un dictateur communiste et maintenant, il y a seulement quarante-huit heures, je suis devenu le candidat républicain au Sénat des États-Unis de ce grand État qu'est la Floride. Seulement en Amérique ! ... Je souhaite rembourser la dette de gratitude en défendant et en sauvegardant avec passion le rêve américain et c'est pourquoi je soutiens notre grand président George W. Bush !"
De gauche à droite, Laura Bush, Barabra et Jenna Bush, le vice-président Dick Cheney et le sénateur Mel Martinez.
Lorsque le président est monté sur scène, M. Bush a également joué sur le thème de l'espoir et a exposé ses projets de création d'emplois, de développement de l'éducation et des soins de santé, tout en dénonçant l'inauthenticité et l'inexpérience de M. Edwards, le tout sous les chants de "Four more Years". Même lorsque nous ne sommes pas d'accord, vous savez au moins que je suis sincère (...) Je me présente à l'élection présidentielle avec un projet clair et positif pour construire une Amérique plus porteuse d'espoir. Je me présente avec une philosophie conservatrice compatissante : le gouvernement doit aider les gens à améliorer leur vie, et non pas essayer de diriger leur vie. Je crois que cette nation a besoin d'une direction stable, cohérente et fondée sur des principes - et c'est pourquoi, avec votre aide, nous gagnerons cette élection".
Renomination de Bush-Cheney en 2004
Le lendemain du jour où le président a accepté la renomination de son parti, le 4 septembre 2004, les Américains s'attendaient à voir les experts débattre du discours de Bush, jugeant s'il lui apporterait le coup de pouce nécessaire dans les sondages. Mais au lieu de cela, c'est une image différente qui s'est affichée sur leurs écrans et sur ceux du monde entier ...
4 septembre 2004.
[1] OTL le compromis n'a pas abouti et Nader a dû se débrouiller seul pour obtenir l'accès au scrutin.
[2] Zell Miller était un démocrate conservateur qui a soutenu Bush.
[3] La convention républicaine est moins modérée que celle OTL.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
 Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?
Chapitre 38: 4 Septembre 2004
Une horrible tragédie s'est produite dans notre pays. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a énormément souffert, tous les habitants de Moscou et toutes leurs souffrances courent dans nos cœurs. - Vladimir Poutine
Cet attentat barbare a rendu le monde malade, l'Amérique est en deuil avec le peuple russe et nous prions pour les victimes innocentes et leurs familles - George Bush
Nous sommes tous traumatisés par cette terrible tragédie. Nous ne savons pas encore combien de personnes ont été tuées ou blessées, mais il est inévitable que ce nombre soit élevé. - Kofi Annan
Pour venger les enfants de Tchétchénie, nous tuerons les vôtres - Shamil Basayev
Le ciel était légèrement couvert, mais il n'y avait aucun signe de pluie. L'Agence fédérale du transport aérien aurait dû connaître une journée normale, mais ce fut loin d'être le cas.
Les contrôleurs aériens de l'aéroport Domodedovo de Moscou ont remarqué quelque chose d'étrange 34 minutes après le début du vol : le vol Siberia 8335 était en train de dévier de sa trajectoire. Quelques minutes plus tard, l'inquiétude s'est transformée en alarme, puis en choc, lorsque le vol a soudainement disparu de leurs tableaux de bord. "C'était un week-end normal à Moscou", se souvient Konstantin Kavlev, responsable du trafic aérien, "nous avons été avertis d'un possible détournement". Selon les estimations, l'incident s'est produit à 12h34 : "l'avion ne répondait plus du tout et se comportait de manière erratique, puis notre radar a signalé que l'avion revenait... Je me suis immédiatement rendu à l'étage de la salle de contrôle du trafic aérien, mais nous ne pouvions toujours pas confirmer avec Siberia Airlines qu'il s'agissait d'un véritable détournement ou simplement d'un dysfonctionnement".
Kavlev s'est rendu à l'étage du contrôle aérien et a suivi Siberia Airlines 8335 en direction du nord à travers la ville. "J'ai demandé aux contrôleurs de l'aéroport d'observer le vol 8335, pour voir s'ils pouvaient voir son approche depuis la tour, pensant que l'avion pourrait tenter d'atterrir à l'aéroport, qu'il y avait peut-être une urgence. Il pensait que l'avion pourrait tenter d'atterrir à nouveau à l'aéroport, qu'il y avait peut-être une urgence, qu'il était peut-être partiellement désemparé ? - Enquêtes sur les accidents aériens, vol Siberia 8335
Ce jour-là, j'avais une réunion au ministère, au nom de l'Union européenne, concernant le rôle de la Russie dans les prochains pourparlers israélo-palestiniens. C'était à la dernière minute ; nous devions nous réunir le jeudi, mais la réunion a été repoussée au 4, c'est-à-dire au samedi. Je m'y suis rendu tôt, il y avait quelques gardes de sécurité, apparemment il y avait eu des protestations dans d'autres ministères cette semaine-là. Je suis entré dans le hall du bâtiment pour cette réunion, et je suis allé au sixième étage, puis juste avant la réunion, je suis allé aux toilettes pour m'assurer que j'étais prêt. - Rodrick Lyne Ambassadeur britannique auprès de la Fédération de Russie
Je logeais à l'hôtel Golden Ring, juste en face du ministère des affaires étrangères, sur la place principale. Je me tenais près de la fenêtre et je regardais la vue, on pouvait voir toute la ville, on pouvait tout voir. Puis j'ai entendu un avion approcher. Il semblait normal, mais il s'approchait très près, puis il y a eu un grondement et une énorme explosion. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait, mais je suis sûr que cet avion, et celui qui le pilotait, l'a fait voler à pleine vitesse, comme s'il était censé décoller. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'énormité du désastre, un énorme incendie en plein centre du bâtiment et un grand trou noir. - Pamela Brown Touriste canadienne, BBC Panorama, Survivre à Moscou
Nous faisions des tests d'équipement près de l'ambassade des Philippines, non loin du ministère. Je n'avais occupé le poste de commandement qu'une ou deux fois, d'habitude, je gérais le camion. Nous étions en train de tester les bouches d'incendie lorsque j'ai vu l'avion, j'ai vu à quel point il se rapprochait du sol et quelques secondes plus tard, j'ai entendu le crash, je ne voyais pas encore où mais je l'ai clairement entendu s'écraser. Nous avons fait retentir les sirènes, nous avons descendu la route en direction de la place et j'ai vu le bâtiment. J'ai donné le premier rapport à la radio et j'ai transmis une deuxième alarme, pour un crash d'avion, puis une troisième alarme pour une frappe directe sur le ministère, je pouvais voir la fumée du côté sud ... lorsque nous nous sommes arrêtés devant le bâtiment, nous avons pu voir qu'il y avait plusieurs personnes brûlées dans le hall, apparemment, le carburant des avions avait été projeté à travers de nombreuses parties du bâtiment, tuant et brûlant de nombreuses personnes ... c'était épouvantable. - Lev Borovinsky, pompier de Moscou, Un jour en Russie

La façade sud du ministère des Affaires étrangères de Moscou après avoir été touchée par le vol Siberia 8335
Nous avons été inondés d'appels, certains provenant de personnes se trouvant aux niveaux supérieurs du bâtiment central, piégées par la fumée ou le feu, certaines ayant trop peur pour bouger, et d'autres ne pouvant pas. Yuri, assistant d'un sous-ministre, a appelé un ami, Peter, qui se trouvait dans le bâtiment à ce moment-là.
Yuri : "Peter, ça va, fais-moi savoir si ça va".
Peter : "Il y a beaucoup de fumée"
Yuri : "Où es-tu, es-tu en train de sortir, est-ce que quelqu'un te sort de là ?"
Peter : "Non, c'est le bordel"
Yuri : " Il y a quelqu'un ? Vous êtes toujours là ?
Peter : "Oui, on ne peut pas bouger, il fait très chaud et il y a de la fumée."
Yuri : " Vous ne pouvez pas sortir ? "
Peter : " "Non, nous ne pouvons pas, nous sommes coincés.
- Les derniers appels hantés de Moscou
Les gens couraient dans tous les sens, paniqués, on sentait une odeur de carburant, comme de l'essence, qui emplissait le bâtiment. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que la salle de réunion avait été touchée, détruite en une seconde. D'instinct, je suis parti, j'ai fui par le premier escalier que j'ai vu, j'ai descendu dans le hall et je me suis retrouvé dans la rue. Je ne savais pas ce qui se passait, les gens regardaient en l'air, stupéfaits, et une femme se tenait la tête, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait. En m'approchant, j'ai vu qu'elle était gravement brûlée et qu'elle était encore en train de fumer, alors je l'ai amenée contre le mur. Elle m'a dit qu'elle ne voyait plus rien, que ses yeux étaient brûlés et qu'elle ne cessait de répéter "ne me laissez pas mourir, ne me laissez pas mourir" - Rodrick Lyne Ambassadeur du Royaume-Uni auprès de la Fédération de Russie
Il y avait beaucoup de bâtiments à couvrir, cela m'a ramené à mon service dans l'armée, aux marches, aux centaines de pièces et de bureaux, chacun devait être vérifié et il y en avait tellement. Cela m'a ramené en Tchétchénie et je me suis dit la même chose, de continuer à mettre un pied devant l'autre. Nous pouvions le voir sur les visages de tout le monde, la plupart étaient complètement vides, et personne ne savait ce qui se passait, nous ne savions pas lequel d'entre nous survivrait, mais nous savions que nous devions continuer à avancer. - Alex Satarov, pompier à Moscou, Un jour en Russie
À 12:54 Moscou 92, une station de radio locale a été la première à signaler la catastrophe, interrompant un bulletin météo pour détailler : "Nous savons que quelque chose s'est passé au ministère des Affaires étrangères, il y a des flammes, beaucoup de flammes et de la fumée dans la tour centrale, nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé, mais nous vous tiendrons au courant". Dès le premier rapport, il n'a pas fallu longtemps, à l'ère de l'information 24 heures sur 24 et de l'internet, pour que l'histoire se répande rapidement dans le monde entier, Reuters et l'Associated Press envoyant rapidement des dépêches aux médias internationaux. La première chaîne de télévision à avoir observé la scène a été REN TV, qui a fourni les premières images détaillées et les premiers reportages sur la scène, des scènes qui ont été rapidement reproduites par les autres chaînes nationales russes et internationales, avec des titres différents tels que FOREIGN MINISTERY FIRE, puis corrigés en PLANE CRASH AT FOREIGN MINISTRY - Moscow Burns : an oral history of Russia's greatest disaster (Incendie du ministère des affaires étrangères).

Premiers intervenants et couverture médiatique au ministère des affaires étrangères
J'étais en train de fouiller dans le congélateur et quand je suis sorti, tout le personnel était parti, mais je pouvais voir ce que je pensais être de l'eau sale s'écouler du plafond, par une fissure noire. Je n'ai trouvé personne, j'ai donc commencé à partir et j'ai reçu un peu d'eau sur moi et j'ai vu que c'était du sang. J'ai continué à sortir du bâtiment et je n'ai toujours trouvé personne, mais il y avait des papiers et des bagages éparpillés sur le sol pour une raison quelconque. Rien n'avait de sens, j'ai vu un couloir rempli de morceaux de personnes... des mains et des têtes partout - Gennadi Ondar, Kitchen Worker, Surviving Moscow
Aeroflot 8606 : "Aeroflot 8606, Moscou ... Nous n'avons pas pu joindre SBI 8335, il semble que quelqu'un ait coupé son microphone".
Centre de Moscou : "Nous cherchons ... contact négatif" ... "Vous le voyez ? A 5 kilomètres ?"
Aeroflot 8606 : "Aucun signe négatif, nous restons vigilants".
Quelques minutes plus tard, le chapitre suivant de l'horreur sans fin s'est déroulé lorsque le vol Aeroflot 8606 a pris un virage erroné par rapport à sa destination prévue, Volgograd, et a commencé à faire demi-tour. Les mêmes contrôleurs qui s'efforçaient frénétiquement de retrouver le Siberia 8335 se sont vu confier une seconde tâche. "Il n'y avait aucun bruit, aucune communication, comme pour le vol 8335. Comme auparavant, les appels répétés pour le vol 8606 ont été accueillis par un silence vide. Les premiers rapports sur le crash du 8335 au ministère arrivaient au moment même où les contrôleurs arrivaient à la conclusion que "ce doit être un autre, nous pourrions avoir une autre catastrophe" - Moscow Attacks : En temps réel, NBC
À 13 h 02, dans le district de Vostochny, un homme du nom de Vadim Kuzmin a reçu un appel de son frère Pyotr, passager de l'avion Aeroflot 8606. Son frère lui a dit : "Il y a une sorte d'attaque dans l'avion, des gars ont pris le contrôle de l'avant de l'avion, je pense qu'ils ont tué des gens, ils disent qu'ils ont une bombe, ils disent qu'ils nous emmènent en Afghanistan, ils pilotent l'avion bizarrement, je pense que tu devrais appeler quelqu'un, la compagnie aérienne ou le gouvernement" Vadim a alors appelé la police, mais n'a pas réussi à joindre la compagnie aérienne.
6 minutes plus tard, Vadim reçoit un second appel de son frère. "Les choses vont vraiment mal, des gens sont morts, je pense que c'est peut-être les pilotes, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont nous faire exploser, mais l'avion continue de tourner et les gens tombent malades, quelqu'un saigne gravement, je ne pense pas qu'ils sachent piloter, on est peut-être sur le point de s'écraser, oh mon dieu, oh mon dieu, dis à maman que je l'aime, oh mon dieu". L'appel téléphonique s'est alors terminé. Vadim a déclaré qu'il pouvait entendre les cris des autres passagers avant que l'appel ne s'achève. Le téléphone à la main, Vadim a allumé la télévision et quelques minutes plus tard, il a vu l'avion Aeroflot 8606 percuter l'aile est de l'université d'État de Moscou. -Commission parlementaire russe, rapport final
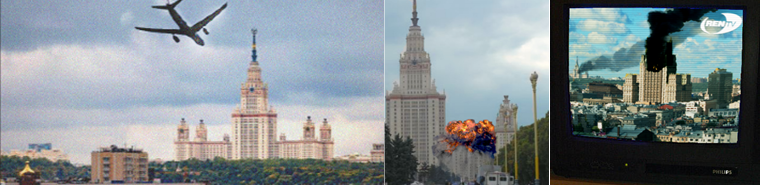
Face sud de l'Université d'État de Moscou avant et immédiatement après l'impact de l'avion Aeroflot 8606
Ren TV et BBC World Service couvraient l'accident du ministère des affaires étrangères de Moscou depuis sa façade nord, où l'on pouvait voir l'université d'État en arrière-plan de la couverture. Ren TV a été la première source d'information à signaler spécifiquement l'écrasement d'un avion sur le complexe (les autres sources d'information ont mis plusieurs minutes à identifier l'écrasement de l'avion).
Olga Romanova : Oh mon Dieu, c'était un autre crash, oh mon Dieu !
Elena Slav : Qu'est-ce que c'était ?
Olga Romanova : Il semble qu'il s'agisse d'une sorte d'attaque
Elena Slav : Était-ce un avion ?
Olga Romanova : Je crois qu'un avion, un deuxième avion qui volait bas, très bas, s'est écrasé sur l'Université, l'Université de Moscou.
Elena Slav : Mon Dieu
Olga Romanova : Un deuxième avion volant très bas s'est écrasé, probablement délibérément, mais nous ne le savons pas, sur l'Université d'État. Les dégâts sont inconnus pour l'instant, mais il semble que deux avions se soient écrasés dans la capitale, l'un après l'autre, c'est un désastre.
- Moscow Burns : an oral history of Russia's greatest disaster (Moscou brûle : une histoire orale du plus grand désastre de Russie)
Nos problèmes s'étaient encore aggravés ; nous étions en route pour le premier crash. Nous traversions la rivière lorsque nous avons vu l'avion, nous pouvions tous voir qu'il s'écrasait, il se déplaçait plus vite que tout ce que j'avais jamais vu. Il est passé à côté de nous, puis nous avons entendu l'explosion. Nous avons appelé la station pour le signaler et nous avons fait demi-tour pour suivre la fumée jusqu'à l'université. Nous sommes immédiatement entrés dans le bâtiment, un bâtiment gigantesque, et des centaines de personnes couraient dans tous les sens. Certains d'entre nous étaient complètement secoués et ne pouvaient pas parler. J'ai donc pris le temps de les regarder attentivement et de leur donner une tape dans le dos... certains ne sont pas revenus. -Sergey Svishchev, pompier de Moscou, Un jour en Russie.
Le président Poutine ne se trouvait pas à Moscou au moment de l'attentat, mais dans sa résidence de Sotchi, sur la mer Noire, où il revenait d'une visite dans une salle de judo locale, où il avait parlé à une classe de l'importance du sport et de la forme physique, lorsqu'il a été informé d'une explosion au ministère des affaires étrangères. Le président s'est alors entretenu avec plusieurs ministres et fonctionnaires, dont le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui se trouvait alors en Égypte pour rencontrer le président Moubarak, le ministre des situations d'urgence, Sergueï Shoigu, et le chef d'état-major du gouvernement, Dmitri Kozak. Lorsque la nouvelle de la deuxième frappe a été communiquée au président et que la couverture médiatique s'est accélérée, le président Poutine a de nouveau appelé le ministre de la défense, Sergei Ivanov, le ministre des transports, Igor Levitin, et les chefs des services de renseignement nationaux et étrangers, Nikolai Patrushev et Sergey Lebedev. Les déplacements du président n'ont jamais été détaillés, mais il est probable qu'il ait été transféré dans un complexe proche de sa résidence secondaire, plutôt que de prendre le risque de rentrer à Moscou.
Le ministère des transports et l'agence fédérale des transports ont commencé à émettre des ordres, réorientant les vols vers l'aéroport de Domodedovo et interdisant tous les départs, mais cette mesure a rapidement été étendue à tous les aéroports de Moscou et réorientant tous les vols à destination ou traversant l'espace aérien moscovite. - Examen par la Cour européenne des droits de l'homme de la réaction des autorités russes aux attentats du 4 septembre à Moscou.
Le président Poutine a rencontré des dirigeants européens le 2 septembre et a visité une salle de judo le 4 septembre.
"C'était la folie absolue, des centaines d'entre nous essayaient de sortir du bâtiment pendant que les pompiers essayaient d'y entrer, on pouvait à peine respirer tellement il y avait de fumée. J'ai eu la chance d'être près du sol, mais j'ai vu juste au-dessus de moi de nombreuses personnes qui criaient, disant qu'elles étaient piégées et qu'elles attendaient l'arrivée des pompiers. Je les vois encore aujourd'hui....... certains ont décidé de sauter plutôt que de brûler, je ne pouvais même pas l'imaginer". - Galina Mikhailova, étudiante à l'université de Moscou, Un jour en Russie
Une enquête ultérieure a révélé qu'une partie de la responsabilité des événements de la journée incombe aux compagnies aériennes qui n'ont pas signalé les risques de sécurité aux autorités compétentes, ce qui a rendu plus difficile la distinction entre les avions menaçants ou détournés et les vols légitimes. L'escalade des événements et des menaces a donné lieu à des dizaines de rapports erronés concernant des vols détournés en raison de défaillances techniques. Et plusieurs compagnies aériennes russes ont négligé d'informer leurs vols de la menace actuelle et croissante.
À 13 h 12, le vol 800 d'Aeroflot s'est silencieusement écarté de son plan de vol en effectuant un léger virage vers l'est, avant de disparaître quelques minutes plus tard du centre radar de Belgorod. Le contrôleur a déclaré que lorsqu'il a vu le changement de trajectoire projeté, il a tenté d'appeler l'avion par radio, puis la compagnie aérienne, mais qu'il n'a eu aucune nouvelle. N'ayant aucune connaissance de l'incident en cours à Moscou, il pensait que le problème du vol 800 était une grave défaillance mécanique ou une panne électrique, avec la possibilité d'une désintégration en vol.
Le centre radar de Belgorod a commencé à informer les autres stations de la disparition du vol 800 et a contacté les autorités locales pour savoir si elles avaient des informations sur des avions abattus. Au bout de 12 minutes, un contact a été établi avec les autorités aéronautiques centrales pour les informer de la disparition de l'appareil, puis, 10 minutes plus tard, avec l'Agence des transports et le ministère des Transports. À ce moment-là, l'aéroport de Belgorod était pleinement conscient de la possibilité d'autres détournements et respectait pleinement l'ordre d'immobiliser les vols, y compris le vol 962 de Kolavia. - Commission parlementaire russe, rapport final
Il n'y a même pas eu la grâce d'une mort instantanée. Au lieu de cela, il y a eu le temps d'appeler depuis le ciel de Moscou, les doigts pianotant sur les téléphones portables, les passagers terrifiés parlant une dernière fois à leurs proches.
Forcés de rester à leur place par des pirates de l'air prétendant être armés d'explosifs, les passagers et les membres d'équipage du vol 800 d'Aeroflot ont reçu l'ordre d'appeler leurs familles et les autorités pour leur faire part des exigences de leurs ravisseurs. Deux des victimes étaient des Américains, Thomas et Nicola Wilson, qui passaient des vacances en Europe.
Environ une heure après son décollage de l'aéroport international de Belgorod, dans le sud de la Russie, le vol 800, à destination de Moscou avec 108 personnes à bord, s'est soudainement transformé en un autre projectile géant visant le centre du gouvernement russe, le Kremlin ... - 2 Americans killed in crashed flight, The Washington Post
13:44 " Asseyez-vous, asseyez-vous, nous avons besoin que vous restiez calmes, nous avons une bombe, alors asseyez-vous, appelez les autorités et dites-leur, dites-leur d'écouter nos demandes " - extrait d'une conversation entendue par des passagers - Attentats de Moscou : In Real Time, NBC
13:46 "Nous avons un autre avion qui vient vers vous" Un superviseur des FATA transmet à l'agence "Il ne nous parle pas". Tout au long de la journée, les autorités aériennes ont eu du mal à transmettre les informations au gouvernement. Les ordres d'évacuation des hauts fonctionnaires ont été lents et partiels. Le parlement russe et le Kremlin sont restés occupés pendant des heures. Un responsable de la sécurité a expliqué les difficultés rencontrées pour relayer les ordres : "Nous avons continué à appuyer sur les boutons d'alerte, mais personne ne bougeait, ils étaient soit abasourdis, soit pensaient que c'était fini, apparemment quelqu'un a dû aller chercher le Premier ministre pour le faire partir, le prendre en main et le mettre dans sa voiture" - Surviving Moscow, BBC
Plusieurs contrôleurs de Moscou ont signalé des signes d'approche de l'avion 800 et toutes les tentatives pour joindre l'avion se sont heurtées au silence : "Observed target moving northbound extremely fast" (cible observée se déplaçant extrêmement vite vers le nord) a notifié un contrôleur de l'aéroport de Zhukovsky. Le même contrôleur a signalé plusieurs autres avions non identifiés, attribués à des vols détournés ou à des vols militaires.
Les forces spatiales russes, la branche de l'armée consacrée aux menaces aérospatiales, n'étaient toujours pas en mesure de réagir de manière adéquate et n'étaient pas informées des nouvelles menaces à mesure qu'elles apparaissaient. Les défenseurs de l'air ont continué à rechercher le vol 8606 et ont traité des rapports concernant l'avion qui n'existait plus et ont confondu 8606 et 800, ce qui a entraîné une plus grande confusion.
FATA : Militaires, ici Moscou, nous avons un rapport de votre part selon lequel l'AFT 8606 est toujours dans les airs. Il se dirige vers le centre de Moscou.
RSF : 8606 est toujours en vol ?
FATA : Non, c'était un autre, manifestement un autre avion a touché l'université, c'est le dernier rapport.
RSF : D'accord ?
FATA : Nous avons une autre identification pour vous, quelque part près du centre, se déplaçant vers le nord ... peut-être plus au sud.
RSF : Donc le 8606 n'est pas un détournement.
FATA : Non, c'est un pirate de l'air.
RSF : Alors ... 8606 est un pirate de l'air ?
FATA : Oui
RSF : Il se dirige vers le centre de Moscou ?
FATA : Oui, c'est un troisième avion.
- Examen par la Cour européenne des droits de l'homme de la réaction des autorités russes aux attentats du 4 septembre à Moscou
Contrairement au vol 8606, le crash du vol 800 n'a pas été filmé par les caméras de télévision, mais il y a des centaines de témoins de sa descente rapide. De nombreux civils pressés de quitter la place rouge font la même déclaration solennelle : un avion s'est écrasé dans le ciel, à une vitesse implacable, dans une descente contrôlée. "C'est arrivé d'un seul coup, il est tombé du ciel, on l'a entendu, on a levé les yeux et on l'a vu dévier vers la gauche" - Moscow Burns : an oral history of Russia's greatest disaster (Moscou brûle : histoire orale de la plus grande catastrophe de Russie)
Vers 13h59, le vol 800 d'Aeroflot, un 737 roulant à environ 800 km/h, s'est écrasé sur la tour d'Ostankino. Tous les passagers, ainsi qu'un nombre indéterminé de personnes se trouvant dans la tour, ont été tués sur le coup. - Article de Wikipédia, vol Aeroflot 800
La tour Ostankino, d'une hauteur de 540 mètres (1 771 pieds), a été érigée en 1967 pour célébrer le 50e anniversaire de la révolution bolchevique. Elle est l'un des principaux points de repère de Moscou et un symbole de la puissance technologique soviétique. - Visiter Moscou, Tour Ostankino

(Gauche) La tour Ostankion après l'achèvement de sa construction en 1967, ce qui en faisait la plus haute tour du monde.
(À droite) Tour Ostankino immédiatement après avoir été percutée par l'avion Aeroflot 800 en 2004, alors deuxième tour la plus haute du monde.
La tour était en cours de rénovation au moment de la collision. Deux de ses trois ascenseurs ne fonctionnaient pas en raison d'un incendie électrique survenu quatre ans plus tôt. L'escalier unique n'avait pas de lumière naturelle et de nombreuses marches étaient inégales. En raison des travaux de reconstruction, le pont d'observation et le restaurant n'étaient pas ouverts. Au moment de l'impact, une boule de feu de carburant s'est déclenchée et a dévalé l'escalier, sectionnant la cage d'escalier à 153 mètres de hauteur. Un incendie s'est rapidement déclaré et une épaisse fumée a envahi la tour. Des centaines de visiteurs et de membres du personnel coincés au-dessus de la zone d'impact n'ont pas pu descendre, et plusieurs se sont retrouvés coincés dans l'ascenseur encore en état de marche.
On ne sait pas si un ordre d'évacuation de la tour a été donné avant la collision, mais cela semble peu probable compte tenu du nombre de personnes présentes dans la tour à ce moment-là. Les efforts des pompiers de la tour n'ont pas suffi et le directeur des pompiers de l'immeuble a déclaré qu'il pensait que l'effondrement de la tour était imminent dans les minutes à venir, avertissant les pompiers de ne pas monter dans l'immeuble. - 4 septembre : Tragédie à Moscou
La collision et l'incendie de la tour ont privé la capitale russe d'émissions télévisées, et des millions de Moscovites, rivés à leur téléviseur pour suivre les catastrophes, se sont retrouvés soudain sans informations. Seule la chaîne privée NTV a été épargnée au moment de la collision. On a pu entendre les réactions en direct des studios au moment de l'écrasement de l'avion. "Nous entendons une autre explosion, tout près ... de nous, près de TV .... Le centre de télévision de Moscou se trouvait dans la zone des débris et le bâtiment a commencé à être évacué. NTV est restée en service toute la journée et les téléspectateurs ont pu assister en direct à la dévastation et à la destruction. - Les attentats de Moscou : En temps réel, NBC
À 14 h 03, la tour Ostankino s'est effondrée en 15 secondes, tuant tous les civils et le personnel d'urgence qui se trouvaient à l'intérieur, ainsi que de nombreux employés et civils qui se trouvaient dans le hall. Le bâtiment s'est effondré vers le nord. La station de métro Telecentre, partiellement construite, et le centre technique d'Ostankino ont subi d'importants dégâts à la suite de l'effondrement de la tour et des débris de l'avion. - Article de Wikipédia, Attaques du 4 septembre 2004

L'effondrement de la tour Ostankino et les images des secouristes
Lorsque le troisième avion a percuté la tour d'Ostankino, les forces spatiales russes et l'Agence fédérale de l'aviation ont procédé à la fermeture effective de tout l'espace aérien russe, ordonnant à tous les avions d'atterrir à l'aéroport le plus proche dès que possible. Plus d'un millier d'avions étaient en vol à ce moment-là et tous ceux qui se trouvaient au sol ont reçu l'ordre de suspendre leurs vols et de retourner à leur terminal respectif dès que possible. Les contrôleurs aériens se sont empressés d'immobiliser les vols et, vers 13 h 41, le vol Kolavia 962 retardé a informé ses passagers que leur vol ne décollerait pas.
À 13 h 43, alors que l'avion roule vers le terminal, deux hommes armés de couteaux se lèvent de leur siège et pénètrent dans le cockpit. Deux autres hommes se lèvent également et déclarent qu'ils sont des rebelles tchétchènes demandant que l'avion soit dirigé vers l'Afghanistan, dévoilant ce qu'ils prétendent être des explosifs enroulés autour de leur taille. Un passager a fait état d'une bagarre dans le cockpit, vraisemblablement entre les pilotes et les assaillants : "Il y a eu des cris et nous avons entendu le bruit de coups de poing et de pied". Quelques minutes auparavant, les pilotes avaient été prévenus par radio : "Attention aux intrusions dans le cockpit, risque important de détournement". L'avion, toujours en mouvement au sol, a dérivé sur la piste de l'aéroport pendant 11 minutes. Les contrôleurs aériens ont pu entendre par radio les exigences des pirates de l'air, qui ont demandé aux pilotes de faire décoller l'avion immédiatement. Les autres attaquants ont forcé les passagers à quitter leurs sièges et à se rendre à l'arrière de l'avion. Un passager, Isai Petrov, a été blessé par une lame à 13 h 50. Plusieurs appels téléphoniques ont été passés à l'aéroport de Belgorod pour l'informer de la tentative de détournement en cours. L'aéroport a ensuite appelé la police et d'autres agences gouvernementales pour les informer de la crise qui se déroulait à l'aéroport. Le vol 962 est entré en collision avec un hangar de l'aéroport. La lutte violente à bord de l'avion s'est poursuivie, plusieurs passagers s'échappant par la sortie de secours, avant que les assaillants ne reprennent le contrôle de l'avion endommagé et de leurs otages. - Commission parlementaire russe, rapport final
Il n'existe aucune trace historique du moment où le président Poutine a autorisé la destruction d'un avion civil, ni même si la décision a finalement été prise par lui ou par quelqu'un d'autre dans la chaîne de commandement, les communications entre le président confiné à Sotchi et Moscou ayant été rompues. Le gouvernement était dispersé en raison de l'évacuation des parlementaires. Néanmoins, il semble que si le président a autorisé des tirs, il l'a fait dans les minutes qui ont suivi le crash du vol 800 et l'effondrement de l'Ostankino, alors que les FATA et la RSF continuaient à s'occuper des signes de détournements potentiels, notamment des avions fantômes, de fausses observations et des erreurs électriques. Cependant, aucune preuve de cette affirmation n'a été trouvée. - 4 septembre : Tragédie au-dessus de Moscou
Selon Donald Munich, un ingénieur structurel chargé d'enquêter sur la catastrophe, des faiblesses dans la conception du ministère des affaires étrangères ont probablement contribué à l'effondrement quasi-total de sa tour centrale. "C'était un bâtiment solide, mais il présentait beaucoup trop de faiblesses", a déclaré M. Munich lors d'une réunion dans un centre d'ingénierie.
"Ce que Moscou a enduré le 4 septembre ressemble davantage à une catastrophe naturelle", a-t-il déclaré à l'auditoire. "Lors d'un tremblement de terre ou d'une tornade, les pertes en vies humaines sont souvent bien moindres sur l'ensemble de la ville que ce qui s'est passé à Moscou"
Munich a noté que les incendies du ministère et de l'université ont brûlé très longtemps après le crash de l'avion et que, malgré les efforts héroïques des pompiers, ils n'étaient pas équipés pour faire face à un incendie aussi rapide et puissant : "Moscou est une ville relativement plate, il n'y a que quelques gratte-ciel, contrairement à New York ou Chicago, par exemple, où les premiers intervenants sont équipés d'hélicoptères et formés pour les incendies dans les immeubles de grande hauteur".
Donald souligne également des défaillances dans la construction initiale : "Les techniques de construction modernes de base n'étaient pas en place, et le toit était beaucoup trop lourd pour le bâtiment [...] les extincteurs automatiques étaient défectueux, les installations électriques étaient endommagées, les portes coupe-feu n'avaient pas été mises en place ; tous ces éléments ont favorisé l'incendie et brisé les structures, qui semblaient solides mais qui, en fin de compte, n'étaient que de l'acier, et l'acier, comme toutes les choses, fond à des températures élevées".
Munich explique que lorsque le toit a commencé à s'effondrer à 15h30, cela a eu pour effet de faire tomber un bâtiment de cinq étages directement sur le reste, provoquant l'effondrement partiel de toute la tour centrale dans un glissement de terrain. Munich a également parlé de l'université et des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas effondrée...
- Un ingénieur en structure décrit ce qui s'est passé à l'intérieur du ministère des affaires étrangères de Moscou, Harvard News Service
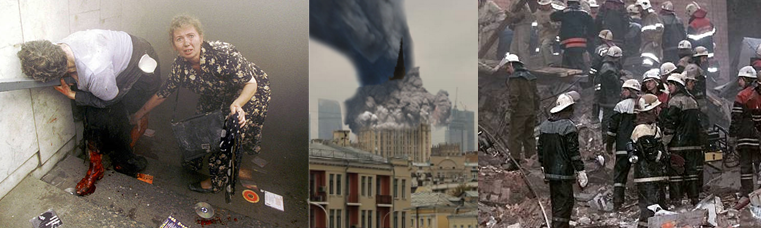
L'effondrement de la tour centrale du ministère russe des affaires étrangères
Belgorod, Russie, samedi 4 septembre - Le siège du vol Kolavia 962 s'est poursuivi pendant des heures, alors que le monde entier avait les yeux rivés sur la terreur qui régnait dans la capitale de la nation, et ce alors qu'au sud de la Russie une nouvelle panique s'est s'emparée de l'aéroport de Belgorod.
Des hommes armés de couteaux et d'explosifs, considérés comme des pirates de l'air, ont pris le contrôle d'un avion encore au sol, le vol 962, et ont pris en otage plus d'une centaine de personnes. La police, l'armée, les ambulances et les pompiers se sont précipités sur les lieux alors que l'impasse durait depuis deux heures. Les pirates de l'air ont fait part de leurs exigences par l'intermédiaire d'un otage libéré, demandant que l'avion soit acheminé vers l'Afghanistan et que les forces russes se retirent de Tchétchénie.
Les forces de sécurité ont bouclé la piste et semblaient prêtes à se battre pour empêcher le décollage et éviter une autre catastrophe majeure. Il est apparu clairement que le président de la Russie, Vladimir V. Poutine, avait donné l'ordre aux troupes de reprendre l'avion. "Profitant de la panique, plusieurs autres otages ont commencé à s'échapper", a déclaré Lev Dazasohov, porte-parole du gouvernement régional. "Les terroristes ont commencé à tuer des otages, et les forces spéciales de notre côté ont dû riposter, ce qui est très regrettable".
On ne sait pas exactement ce qui a déclenché l'explosion qui a détruit l'avion, si les pirates de l'air ont déclenché leurs explosifs volontairement ou par erreur, mais l'épave en feu a fait plus de 60 morts dans l'explosion et de nombreux otages s ont dû être immédiatement transportés par ambulance à l'hôpital. Si les assaillants étaient des pirates de l'air, quelle était leur cible ? Le gouvernement russe, le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile ? La scène qui s'est déroulée à l'aéroport n'est qu'une des nombreuses scènes qui ont émaillé cette sombre journée de l'histoire de la Russie. - Les Russes prennent d'assaut l'avion détourné, ABC News

(à gauche) Forces russes à l'aéroport de Belgorod, (à droite) conséquences de l'explosion à bord du vol Kolavia 962
Le 4 septembre, les contrôleurs aériens travaillaient d'arrache-pied pour sauver des vies et faire atterrir les avions en toute sécurité. Des centaines de personnes, qui se sont présentées pour une journée de travail normale, ont eu droit à tout sauf à une journée de travail normale.
Lorsque l'espace aérien russe a été fermé par le président Poutine, tous les vols dans l'espace aérien russe, y compris les vols internationaux du monde entier, ont dû atterrir. M. Poutine a personnellement appelé plusieurs pays voisins pour leur dire qu'il allait devoir faire atterrir des avions dans leurs aéroports parce qu'il n'y avait pas assez d'aéroports en Russie pour les contenir tous. Tous les vols ont été priés de revenir là où ils avaient décollé, sauf ceux qui n'avaient pas assez de carburant pour le faire. Ces avions ont reçu des points d'atterrissage d'urgence en Russie ou dans les pays voisins, à savoir le Kazakhstan, la Finlande, l'Ukraine et la Biélorussie.
L'un de ces avions était le vol 285 de Japan Airlines, un vol commercial régulier, un Boeing 747 en provenance de Tokyo, au Japon, à destination de Saint-Pétersbourg, à l'aéroport de Pulkovo, avec une escale prévue à Moscou.
Le vol 285 a décollé de Tokyo le 4 septembre, et lorsque le premier avion a percuté le premier bâtiment à Moscou, le vol 285 n'était plus en contact radio. Lorsque l'avion a traversé la Chine pour entrer dans l'espace aérien russe, des indices ont laissé penser que quelque chose ne tournait pas rond à bord. L'agence russe de l'aviation examinait les messages échangés entre l'avion et Japan Airways. Le 4, elle analysait tous les vols à la recherche d'alertes potentielles indiquant un détournement et a remarqué plusieurs messages erratiques du vol 285, y compris la phrase "HKJ", que l'agence a considérée comme un message codé possible pour un détournement. Les FATA ont pris ce message très au sérieux : "nous avons subi plusieurs attaques de la part de plusieurs avions en provenance de plusieurs aéroports, il semble logique qu'une attaque similaire ait pu avoir lieu en provenance de l'Extrême-Orient"
Ce jour-là, les autorités ont dû rattraper leur retard, la technologie n'étant tout simplement pas au point aujourd'hui, et les autorités étaient en état d'alerte maximale. Il s'agissait d'une situation sans précédent et certaines de ces technologies étaient expérimentales, pour dire les choses simplement, les responsables agissaient de manière très réactive.
À 15 heures, le vol 285 est resté sur sa trajectoire, diffusant un message apparemment ordinaire : "Ici 285, bonjour". Le message semble avoir été transmis normalement, sans aucune détresse, mais les forces spatiales russes ne prenaient aucun risque, l'espace aérien russe était fermé et il n'y aurait pas d'atterrissage possible à Moscou. Les forces spatiales russes ont autorisé la base aérienne de Domna à faire décoller des avions de chasse. Ceux-ci ont reçu l'ordre de suivre l'avion à une distance discrète afin d'empêcher d'éventuels pirates de l'air d'effectuer une manœuvre mortelle et de faire s'écraser l'avion.
Le contact entre l'avion et les contrôleurs aériens a parfois été tendu, en raison des différences de dialectes et des barrières linguistiques, mais il n'y avait aucun signe précis de détournement. Le vol semblait se dérouler en accord avec les contrôleurs aériens, mais quelque chose a mal tourné, l'avion a pris un virage à gauche inexpliqué et la radio est devenue momentanément silencieuse. Les contrôleurs ont pensé qu'un incident violent avait éclaté dans le cockpit, peut-être entre les pirates de l'air et les pilotes, mais il est également possible que le vol ait été effrayé par l'un des avions de chasse ou pour toute autre raison. La radio s'est rallumée et le pilote a tenté de rassurer les contrôleurs aériens en leur disant que tout allait bien et qu'il continuait à obéir aux ordres. Au même moment, en Russie, la prise d'otages sur le vol 962 s'est terminée lorsque les pirates de l'air ont déclenché des explosifs qui ont détruit l'avion sur le tarmac.
Les contrôleurs ont demandé au vol 285 d'envoyer le signe "7500", symbole international d'un détournement. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel était le raisonnement, mais il est possible que les contrôleurs aient pensé que si l'avion se conformait à la demande, cela confirmerait un détournement. Lorsqu'on lui a demandé de vérifier le code, l'avion s'est montré réticent. Peut-être les contrôleurs étaient-ils dans un monde différent, ayant assisté à trois crashs d'avion le même jour, ou bien les pilotes du 285 étaient-ils confus de recevoir ces demandes étranges de la part des contrôleurs, nous ne le savons pas, personne n'agissait clairement ici, alors les contrôleurs aériens ont émis une seconde demande à l'équipage de vol d'envoyer le code "7500". L'avion a répondu "7500"... - Vol 285 de Japan Airlines, podcast sur les incidents en vol
La dernière entrée de l'enregistreur de la voix du cockpit a eu lieu à 14:49:37 alors que l'avion était dans cette phase de descente. L'analyse de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) a conclu que l'équipage avait conservé un contrôle très limité de l'avion. Cependant, cela n'a duré que deux minutes. L'équipage a ensuite perdu tout contrôle. L'avion a commencé à descendre rapidement en spirale au-dessus des chaînes de montagnes de l'oblast de Kemerovo sur une distance de 4,2 km. L'avion s'est ensuite disloqué en plein vol et s'est écrasé au sol, près de la chaîne de montagnes des dents célestes. Les 102 personnes à bord ont été tuées. - Vol 285 de Japan Air, article de Wikipédia

(A gauche) MiG-29 russes en vol, (A droite) épave du Japan Air 285
4 septembre - Voici la transcription de l'allocution télévisée du président Vladimir V. Poutine au Kremlin samedi soir, telle qu'elle a été traduite par le New York Times :
Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher dans leur vie, leurs enfants, leurs parents, leurs proches. Je veux que vous vous souveniez de tous ceux qui sont morts aux mains des terroristes ces derniers jours. Nous avons été confrontés aujourd'hui non seulement à des meurtriers, mais aussi à ceux qui ont utilisé les armes les plus destructrices contre des personnes sans défense.
Comme je l'ai dit à maintes reprises, nous avons été confrontés à des crises, à des rébellions et à des actes terroristes à de nombreuses reprises. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ce crime sans précédent commis par des terroristes, d'une cruauté inhumaine, n'est pas un défi lancé au président, au Parlement ou au gouvernement. C'est un défi lancé à toute la Russie, à tout notre peuple. C'est une attaque contre nous tous.
Les terroristes pensent qu'ils sont plus forts, qu'ils pourront nous intimider, paralyser notre volonté, éroder notre société. Il semble que nous ayons le choix : résister ou céder et accepter leurs revendications ; abandonner et les laisser détruire et démanteler la Russie, dans l'espoir qu'ils finissent par nous laisser tranquilles.
Nous ne pouvons que constater l'évidence : il ne s'agit pas d'actes d'intimidation isolés, ni d'incursions individuelles de terroristes. Nous avons affaire à l'intervention directe de la terreur internationale aidée par les ennemis de la Russie, à une guerre totale et à grande échelle qui ôte la vie à nos compatriotes.
Toute l'histoire de la Russie montre que de telles guerres ne se terminent pas rapidement. Dans ces conditions, nous ne pouvons tout simplement pas, nous ne devons pas, vivre avec la même insouciance qu'auparavant. Tout comme nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont combattu et sont morts pendant la Grande Guerre patriotique, nous nous inclinons devant la mémoire des martyrs qui ont brûlé vifs et de nos pompiers qui sont morts le premier jour de cette juste bataille.
Certains veulent déchirer notre pays. D'autres les aident à le faire. Ils les aident parce qu'ils pensent que la Russie, qui est l'une des plus grandes puissances nucléaires du monde, représente toujours une menace, et que cette menace doit être éliminée. Et le terrorisme n'est qu'un instrument pour atteindre ces objectifs.
Il est impossible de réconcilier la douleur des pertes. Cette attaque nous a rapprochés encore plus, demain nous agirons. Aujourd'hui, nous devons être ensemble. Ce n'est qu'ainsi que nous vaincrons l'ennemi. - Putin Tells Russians : 'We Shall Defeat Terror' (Poutine dit aux Russes : "Nous vaincrons la terreur"), New York Times

(Gauche) Le drapeau russe en berne au Kremlin, (Centre) un public assiste au discours du Président Poutine, (Droite) des Russes déposent des roses lors d'une cérémonie en l'honneur des victimes.
Une horrible tragédie s'est produite dans notre pays. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a énormément souffert, tous les habitants de Moscou et toutes leurs souffrances courent dans nos cœurs. - Vladimir Poutine
Cet attentat barbare a rendu le monde malade, l'Amérique est en deuil avec le peuple russe et nous prions pour les victimes innocentes et leurs familles - George Bush
Nous sommes tous traumatisés par cette terrible tragédie. Nous ne savons pas encore combien de personnes ont été tuées ou blessées, mais il est inévitable que ce nombre soit élevé. - Kofi Annan
Pour venger les enfants de Tchétchénie, nous tuerons les vôtres - Shamil Basayev
Le ciel était légèrement couvert, mais il n'y avait aucun signe de pluie. L'Agence fédérale du transport aérien aurait dû connaître une journée normale, mais ce fut loin d'être le cas.
Les contrôleurs aériens de l'aéroport Domodedovo de Moscou ont remarqué quelque chose d'étrange 34 minutes après le début du vol : le vol Siberia 8335 était en train de dévier de sa trajectoire. Quelques minutes plus tard, l'inquiétude s'est transformée en alarme, puis en choc, lorsque le vol a soudainement disparu de leurs tableaux de bord. "C'était un week-end normal à Moscou", se souvient Konstantin Kavlev, responsable du trafic aérien, "nous avons été avertis d'un possible détournement". Selon les estimations, l'incident s'est produit à 12h34 : "l'avion ne répondait plus du tout et se comportait de manière erratique, puis notre radar a signalé que l'avion revenait... Je me suis immédiatement rendu à l'étage de la salle de contrôle du trafic aérien, mais nous ne pouvions toujours pas confirmer avec Siberia Airlines qu'il s'agissait d'un véritable détournement ou simplement d'un dysfonctionnement".
Kavlev s'est rendu à l'étage du contrôle aérien et a suivi Siberia Airlines 8335 en direction du nord à travers la ville. "J'ai demandé aux contrôleurs de l'aéroport d'observer le vol 8335, pour voir s'ils pouvaient voir son approche depuis la tour, pensant que l'avion pourrait tenter d'atterrir à l'aéroport, qu'il y avait peut-être une urgence. Il pensait que l'avion pourrait tenter d'atterrir à nouveau à l'aéroport, qu'il y avait peut-être une urgence, qu'il était peut-être partiellement désemparé ? - Enquêtes sur les accidents aériens, vol Siberia 8335
Ce jour-là, j'avais une réunion au ministère, au nom de l'Union européenne, concernant le rôle de la Russie dans les prochains pourparlers israélo-palestiniens. C'était à la dernière minute ; nous devions nous réunir le jeudi, mais la réunion a été repoussée au 4, c'est-à-dire au samedi. Je m'y suis rendu tôt, il y avait quelques gardes de sécurité, apparemment il y avait eu des protestations dans d'autres ministères cette semaine-là. Je suis entré dans le hall du bâtiment pour cette réunion, et je suis allé au sixième étage, puis juste avant la réunion, je suis allé aux toilettes pour m'assurer que j'étais prêt. - Rodrick Lyne Ambassadeur britannique auprès de la Fédération de Russie
Je logeais à l'hôtel Golden Ring, juste en face du ministère des affaires étrangères, sur la place principale. Je me tenais près de la fenêtre et je regardais la vue, on pouvait voir toute la ville, on pouvait tout voir. Puis j'ai entendu un avion approcher. Il semblait normal, mais il s'approchait très près, puis il y a eu un grondement et une énorme explosion. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait, mais je suis sûr que cet avion, et celui qui le pilotait, l'a fait voler à pleine vitesse, comme s'il était censé décoller. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'énormité du désastre, un énorme incendie en plein centre du bâtiment et un grand trou noir. - Pamela Brown Touriste canadienne, BBC Panorama, Survivre à Moscou
Nous faisions des tests d'équipement près de l'ambassade des Philippines, non loin du ministère. Je n'avais occupé le poste de commandement qu'une ou deux fois, d'habitude, je gérais le camion. Nous étions en train de tester les bouches d'incendie lorsque j'ai vu l'avion, j'ai vu à quel point il se rapprochait du sol et quelques secondes plus tard, j'ai entendu le crash, je ne voyais pas encore où mais je l'ai clairement entendu s'écraser. Nous avons fait retentir les sirènes, nous avons descendu la route en direction de la place et j'ai vu le bâtiment. J'ai donné le premier rapport à la radio et j'ai transmis une deuxième alarme, pour un crash d'avion, puis une troisième alarme pour une frappe directe sur le ministère, je pouvais voir la fumée du côté sud ... lorsque nous nous sommes arrêtés devant le bâtiment, nous avons pu voir qu'il y avait plusieurs personnes brûlées dans le hall, apparemment, le carburant des avions avait été projeté à travers de nombreuses parties du bâtiment, tuant et brûlant de nombreuses personnes ... c'était épouvantable. - Lev Borovinsky, pompier de Moscou, Un jour en Russie
La façade sud du ministère des Affaires étrangères de Moscou après avoir été touchée par le vol Siberia 8335
Nous avons été inondés d'appels, certains provenant de personnes se trouvant aux niveaux supérieurs du bâtiment central, piégées par la fumée ou le feu, certaines ayant trop peur pour bouger, et d'autres ne pouvant pas. Yuri, assistant d'un sous-ministre, a appelé un ami, Peter, qui se trouvait dans le bâtiment à ce moment-là.
Yuri : "Peter, ça va, fais-moi savoir si ça va".
Peter : "Il y a beaucoup de fumée"
Yuri : "Où es-tu, es-tu en train de sortir, est-ce que quelqu'un te sort de là ?"
Peter : "Non, c'est le bordel"
Yuri : " Il y a quelqu'un ? Vous êtes toujours là ?
Peter : "Oui, on ne peut pas bouger, il fait très chaud et il y a de la fumée."
Yuri : " Vous ne pouvez pas sortir ? "
Peter : " "Non, nous ne pouvons pas, nous sommes coincés.
- Les derniers appels hantés de Moscou
Les gens couraient dans tous les sens, paniqués, on sentait une odeur de carburant, comme de l'essence, qui emplissait le bâtiment. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que la salle de réunion avait été touchée, détruite en une seconde. D'instinct, je suis parti, j'ai fui par le premier escalier que j'ai vu, j'ai descendu dans le hall et je me suis retrouvé dans la rue. Je ne savais pas ce qui se passait, les gens regardaient en l'air, stupéfaits, et une femme se tenait la tête, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait. En m'approchant, j'ai vu qu'elle était gravement brûlée et qu'elle était encore en train de fumer, alors je l'ai amenée contre le mur. Elle m'a dit qu'elle ne voyait plus rien, que ses yeux étaient brûlés et qu'elle ne cessait de répéter "ne me laissez pas mourir, ne me laissez pas mourir" - Rodrick Lyne Ambassadeur du Royaume-Uni auprès de la Fédération de Russie
Il y avait beaucoup de bâtiments à couvrir, cela m'a ramené à mon service dans l'armée, aux marches, aux centaines de pièces et de bureaux, chacun devait être vérifié et il y en avait tellement. Cela m'a ramené en Tchétchénie et je me suis dit la même chose, de continuer à mettre un pied devant l'autre. Nous pouvions le voir sur les visages de tout le monde, la plupart étaient complètement vides, et personne ne savait ce qui se passait, nous ne savions pas lequel d'entre nous survivrait, mais nous savions que nous devions continuer à avancer. - Alex Satarov, pompier à Moscou, Un jour en Russie
À 12:54 Moscou 92, une station de radio locale a été la première à signaler la catastrophe, interrompant un bulletin météo pour détailler : "Nous savons que quelque chose s'est passé au ministère des Affaires étrangères, il y a des flammes, beaucoup de flammes et de la fumée dans la tour centrale, nous ne sommes pas sûrs de ce qui s'est passé, mais nous vous tiendrons au courant". Dès le premier rapport, il n'a pas fallu longtemps, à l'ère de l'information 24 heures sur 24 et de l'internet, pour que l'histoire se répande rapidement dans le monde entier, Reuters et l'Associated Press envoyant rapidement des dépêches aux médias internationaux. La première chaîne de télévision à avoir observé la scène a été REN TV, qui a fourni les premières images détaillées et les premiers reportages sur la scène, des scènes qui ont été rapidement reproduites par les autres chaînes nationales russes et internationales, avec des titres différents tels que FOREIGN MINISTERY FIRE, puis corrigés en PLANE CRASH AT FOREIGN MINISTRY - Moscow Burns : an oral history of Russia's greatest disaster (Incendie du ministère des affaires étrangères).
Premiers intervenants et couverture médiatique au ministère des affaires étrangères
J'étais en train de fouiller dans le congélateur et quand je suis sorti, tout le personnel était parti, mais je pouvais voir ce que je pensais être de l'eau sale s'écouler du plafond, par une fissure noire. Je n'ai trouvé personne, j'ai donc commencé à partir et j'ai reçu un peu d'eau sur moi et j'ai vu que c'était du sang. J'ai continué à sortir du bâtiment et je n'ai toujours trouvé personne, mais il y avait des papiers et des bagages éparpillés sur le sol pour une raison quelconque. Rien n'avait de sens, j'ai vu un couloir rempli de morceaux de personnes... des mains et des têtes partout - Gennadi Ondar, Kitchen Worker, Surviving Moscow
Aeroflot 8606 : "Aeroflot 8606, Moscou ... Nous n'avons pas pu joindre SBI 8335, il semble que quelqu'un ait coupé son microphone".
Centre de Moscou : "Nous cherchons ... contact négatif" ... "Vous le voyez ? A 5 kilomètres ?"
Aeroflot 8606 : "Aucun signe négatif, nous restons vigilants".
Quelques minutes plus tard, le chapitre suivant de l'horreur sans fin s'est déroulé lorsque le vol Aeroflot 8606 a pris un virage erroné par rapport à sa destination prévue, Volgograd, et a commencé à faire demi-tour. Les mêmes contrôleurs qui s'efforçaient frénétiquement de retrouver le Siberia 8335 se sont vu confier une seconde tâche. "Il n'y avait aucun bruit, aucune communication, comme pour le vol 8335. Comme auparavant, les appels répétés pour le vol 8606 ont été accueillis par un silence vide. Les premiers rapports sur le crash du 8335 au ministère arrivaient au moment même où les contrôleurs arrivaient à la conclusion que "ce doit être un autre, nous pourrions avoir une autre catastrophe" - Moscow Attacks : En temps réel, NBC
À 13 h 02, dans le district de Vostochny, un homme du nom de Vadim Kuzmin a reçu un appel de son frère Pyotr, passager de l'avion Aeroflot 8606. Son frère lui a dit : "Il y a une sorte d'attaque dans l'avion, des gars ont pris le contrôle de l'avant de l'avion, je pense qu'ils ont tué des gens, ils disent qu'ils ont une bombe, ils disent qu'ils nous emmènent en Afghanistan, ils pilotent l'avion bizarrement, je pense que tu devrais appeler quelqu'un, la compagnie aérienne ou le gouvernement" Vadim a alors appelé la police, mais n'a pas réussi à joindre la compagnie aérienne.
6 minutes plus tard, Vadim reçoit un second appel de son frère. "Les choses vont vraiment mal, des gens sont morts, je pense que c'est peut-être les pilotes, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont nous faire exploser, mais l'avion continue de tourner et les gens tombent malades, quelqu'un saigne gravement, je ne pense pas qu'ils sachent piloter, on est peut-être sur le point de s'écraser, oh mon dieu, oh mon dieu, dis à maman que je l'aime, oh mon dieu". L'appel téléphonique s'est alors terminé. Vadim a déclaré qu'il pouvait entendre les cris des autres passagers avant que l'appel ne s'achève. Le téléphone à la main, Vadim a allumé la télévision et quelques minutes plus tard, il a vu l'avion Aeroflot 8606 percuter l'aile est de l'université d'État de Moscou. -Commission parlementaire russe, rapport final
Face sud de l'Université d'État de Moscou avant et immédiatement après l'impact de l'avion Aeroflot 8606
Ren TV et BBC World Service couvraient l'accident du ministère des affaires étrangères de Moscou depuis sa façade nord, où l'on pouvait voir l'université d'État en arrière-plan de la couverture. Ren TV a été la première source d'information à signaler spécifiquement l'écrasement d'un avion sur le complexe (les autres sources d'information ont mis plusieurs minutes à identifier l'écrasement de l'avion).
Olga Romanova : Oh mon Dieu, c'était un autre crash, oh mon Dieu !
Elena Slav : Qu'est-ce que c'était ?
Olga Romanova : Il semble qu'il s'agisse d'une sorte d'attaque
Elena Slav : Était-ce un avion ?
Olga Romanova : Je crois qu'un avion, un deuxième avion qui volait bas, très bas, s'est écrasé sur l'Université, l'Université de Moscou.
Elena Slav : Mon Dieu
Olga Romanova : Un deuxième avion volant très bas s'est écrasé, probablement délibérément, mais nous ne le savons pas, sur l'Université d'État. Les dégâts sont inconnus pour l'instant, mais il semble que deux avions se soient écrasés dans la capitale, l'un après l'autre, c'est un désastre.
- Moscow Burns : an oral history of Russia's greatest disaster (Moscou brûle : une histoire orale du plus grand désastre de Russie)
Nos problèmes s'étaient encore aggravés ; nous étions en route pour le premier crash. Nous traversions la rivière lorsque nous avons vu l'avion, nous pouvions tous voir qu'il s'écrasait, il se déplaçait plus vite que tout ce que j'avais jamais vu. Il est passé à côté de nous, puis nous avons entendu l'explosion. Nous avons appelé la station pour le signaler et nous avons fait demi-tour pour suivre la fumée jusqu'à l'université. Nous sommes immédiatement entrés dans le bâtiment, un bâtiment gigantesque, et des centaines de personnes couraient dans tous les sens. Certains d'entre nous étaient complètement secoués et ne pouvaient pas parler. J'ai donc pris le temps de les regarder attentivement et de leur donner une tape dans le dos... certains ne sont pas revenus. -Sergey Svishchev, pompier de Moscou, Un jour en Russie.
Le président Poutine ne se trouvait pas à Moscou au moment de l'attentat, mais dans sa résidence de Sotchi, sur la mer Noire, où il revenait d'une visite dans une salle de judo locale, où il avait parlé à une classe de l'importance du sport et de la forme physique, lorsqu'il a été informé d'une explosion au ministère des affaires étrangères. Le président s'est alors entretenu avec plusieurs ministres et fonctionnaires, dont le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui se trouvait alors en Égypte pour rencontrer le président Moubarak, le ministre des situations d'urgence, Sergueï Shoigu, et le chef d'état-major du gouvernement, Dmitri Kozak. Lorsque la nouvelle de la deuxième frappe a été communiquée au président et que la couverture médiatique s'est accélérée, le président Poutine a de nouveau appelé le ministre de la défense, Sergei Ivanov, le ministre des transports, Igor Levitin, et les chefs des services de renseignement nationaux et étrangers, Nikolai Patrushev et Sergey Lebedev. Les déplacements du président n'ont jamais été détaillés, mais il est probable qu'il ait été transféré dans un complexe proche de sa résidence secondaire, plutôt que de prendre le risque de rentrer à Moscou.
Le ministère des transports et l'agence fédérale des transports ont commencé à émettre des ordres, réorientant les vols vers l'aéroport de Domodedovo et interdisant tous les départs, mais cette mesure a rapidement été étendue à tous les aéroports de Moscou et réorientant tous les vols à destination ou traversant l'espace aérien moscovite. - Examen par la Cour européenne des droits de l'homme de la réaction des autorités russes aux attentats du 4 septembre à Moscou.
Le président Poutine a rencontré des dirigeants européens le 2 septembre et a visité une salle de judo le 4 septembre.
"C'était la folie absolue, des centaines d'entre nous essayaient de sortir du bâtiment pendant que les pompiers essayaient d'y entrer, on pouvait à peine respirer tellement il y avait de fumée. J'ai eu la chance d'être près du sol, mais j'ai vu juste au-dessus de moi de nombreuses personnes qui criaient, disant qu'elles étaient piégées et qu'elles attendaient l'arrivée des pompiers. Je les vois encore aujourd'hui....... certains ont décidé de sauter plutôt que de brûler, je ne pouvais même pas l'imaginer". - Galina Mikhailova, étudiante à l'université de Moscou, Un jour en Russie
Une enquête ultérieure a révélé qu'une partie de la responsabilité des événements de la journée incombe aux compagnies aériennes qui n'ont pas signalé les risques de sécurité aux autorités compétentes, ce qui a rendu plus difficile la distinction entre les avions menaçants ou détournés et les vols légitimes. L'escalade des événements et des menaces a donné lieu à des dizaines de rapports erronés concernant des vols détournés en raison de défaillances techniques. Et plusieurs compagnies aériennes russes ont négligé d'informer leurs vols de la menace actuelle et croissante.
À 13 h 12, le vol 800 d'Aeroflot s'est silencieusement écarté de son plan de vol en effectuant un léger virage vers l'est, avant de disparaître quelques minutes plus tard du centre radar de Belgorod. Le contrôleur a déclaré que lorsqu'il a vu le changement de trajectoire projeté, il a tenté d'appeler l'avion par radio, puis la compagnie aérienne, mais qu'il n'a eu aucune nouvelle. N'ayant aucune connaissance de l'incident en cours à Moscou, il pensait que le problème du vol 800 était une grave défaillance mécanique ou une panne électrique, avec la possibilité d'une désintégration en vol.
Le centre radar de Belgorod a commencé à informer les autres stations de la disparition du vol 800 et a contacté les autorités locales pour savoir si elles avaient des informations sur des avions abattus. Au bout de 12 minutes, un contact a été établi avec les autorités aéronautiques centrales pour les informer de la disparition de l'appareil, puis, 10 minutes plus tard, avec l'Agence des transports et le ministère des Transports. À ce moment-là, l'aéroport de Belgorod était pleinement conscient de la possibilité d'autres détournements et respectait pleinement l'ordre d'immobiliser les vols, y compris le vol 962 de Kolavia. - Commission parlementaire russe, rapport final
Il n'y a même pas eu la grâce d'une mort instantanée. Au lieu de cela, il y a eu le temps d'appeler depuis le ciel de Moscou, les doigts pianotant sur les téléphones portables, les passagers terrifiés parlant une dernière fois à leurs proches.
Forcés de rester à leur place par des pirates de l'air prétendant être armés d'explosifs, les passagers et les membres d'équipage du vol 800 d'Aeroflot ont reçu l'ordre d'appeler leurs familles et les autorités pour leur faire part des exigences de leurs ravisseurs. Deux des victimes étaient des Américains, Thomas et Nicola Wilson, qui passaient des vacances en Europe.
Environ une heure après son décollage de l'aéroport international de Belgorod, dans le sud de la Russie, le vol 800, à destination de Moscou avec 108 personnes à bord, s'est soudainement transformé en un autre projectile géant visant le centre du gouvernement russe, le Kremlin ... - 2 Americans killed in crashed flight, The Washington Post
13:44 " Asseyez-vous, asseyez-vous, nous avons besoin que vous restiez calmes, nous avons une bombe, alors asseyez-vous, appelez les autorités et dites-leur, dites-leur d'écouter nos demandes " - extrait d'une conversation entendue par des passagers - Attentats de Moscou : In Real Time, NBC
13:46 "Nous avons un autre avion qui vient vers vous" Un superviseur des FATA transmet à l'agence "Il ne nous parle pas". Tout au long de la journée, les autorités aériennes ont eu du mal à transmettre les informations au gouvernement. Les ordres d'évacuation des hauts fonctionnaires ont été lents et partiels. Le parlement russe et le Kremlin sont restés occupés pendant des heures. Un responsable de la sécurité a expliqué les difficultés rencontrées pour relayer les ordres : "Nous avons continué à appuyer sur les boutons d'alerte, mais personne ne bougeait, ils étaient soit abasourdis, soit pensaient que c'était fini, apparemment quelqu'un a dû aller chercher le Premier ministre pour le faire partir, le prendre en main et le mettre dans sa voiture" - Surviving Moscow, BBC
Plusieurs contrôleurs de Moscou ont signalé des signes d'approche de l'avion 800 et toutes les tentatives pour joindre l'avion se sont heurtées au silence : "Observed target moving northbound extremely fast" (cible observée se déplaçant extrêmement vite vers le nord) a notifié un contrôleur de l'aéroport de Zhukovsky. Le même contrôleur a signalé plusieurs autres avions non identifiés, attribués à des vols détournés ou à des vols militaires.
Les forces spatiales russes, la branche de l'armée consacrée aux menaces aérospatiales, n'étaient toujours pas en mesure de réagir de manière adéquate et n'étaient pas informées des nouvelles menaces à mesure qu'elles apparaissaient. Les défenseurs de l'air ont continué à rechercher le vol 8606 et ont traité des rapports concernant l'avion qui n'existait plus et ont confondu 8606 et 800, ce qui a entraîné une plus grande confusion.
FATA : Militaires, ici Moscou, nous avons un rapport de votre part selon lequel l'AFT 8606 est toujours dans les airs. Il se dirige vers le centre de Moscou.
RSF : 8606 est toujours en vol ?
FATA : Non, c'était un autre, manifestement un autre avion a touché l'université, c'est le dernier rapport.
RSF : D'accord ?
FATA : Nous avons une autre identification pour vous, quelque part près du centre, se déplaçant vers le nord ... peut-être plus au sud.
RSF : Donc le 8606 n'est pas un détournement.
FATA : Non, c'est un pirate de l'air.
RSF : Alors ... 8606 est un pirate de l'air ?
FATA : Oui
RSF : Il se dirige vers le centre de Moscou ?
FATA : Oui, c'est un troisième avion.
- Examen par la Cour européenne des droits de l'homme de la réaction des autorités russes aux attentats du 4 septembre à Moscou
Contrairement au vol 8606, le crash du vol 800 n'a pas été filmé par les caméras de télévision, mais il y a des centaines de témoins de sa descente rapide. De nombreux civils pressés de quitter la place rouge font la même déclaration solennelle : un avion s'est écrasé dans le ciel, à une vitesse implacable, dans une descente contrôlée. "C'est arrivé d'un seul coup, il est tombé du ciel, on l'a entendu, on a levé les yeux et on l'a vu dévier vers la gauche" - Moscow Burns : an oral history of Russia's greatest disaster (Moscou brûle : histoire orale de la plus grande catastrophe de Russie)
Vers 13h59, le vol 800 d'Aeroflot, un 737 roulant à environ 800 km/h, s'est écrasé sur la tour d'Ostankino. Tous les passagers, ainsi qu'un nombre indéterminé de personnes se trouvant dans la tour, ont été tués sur le coup. - Article de Wikipédia, vol Aeroflot 800
La tour Ostankino, d'une hauteur de 540 mètres (1 771 pieds), a été érigée en 1967 pour célébrer le 50e anniversaire de la révolution bolchevique. Elle est l'un des principaux points de repère de Moscou et un symbole de la puissance technologique soviétique. - Visiter Moscou, Tour Ostankino
(Gauche) La tour Ostankion après l'achèvement de sa construction en 1967, ce qui en faisait la plus haute tour du monde.
(À droite) Tour Ostankino immédiatement après avoir été percutée par l'avion Aeroflot 800 en 2004, alors deuxième tour la plus haute du monde.
La tour était en cours de rénovation au moment de la collision. Deux de ses trois ascenseurs ne fonctionnaient pas en raison d'un incendie électrique survenu quatre ans plus tôt. L'escalier unique n'avait pas de lumière naturelle et de nombreuses marches étaient inégales. En raison des travaux de reconstruction, le pont d'observation et le restaurant n'étaient pas ouverts. Au moment de l'impact, une boule de feu de carburant s'est déclenchée et a dévalé l'escalier, sectionnant la cage d'escalier à 153 mètres de hauteur. Un incendie s'est rapidement déclaré et une épaisse fumée a envahi la tour. Des centaines de visiteurs et de membres du personnel coincés au-dessus de la zone d'impact n'ont pas pu descendre, et plusieurs se sont retrouvés coincés dans l'ascenseur encore en état de marche.
On ne sait pas si un ordre d'évacuation de la tour a été donné avant la collision, mais cela semble peu probable compte tenu du nombre de personnes présentes dans la tour à ce moment-là. Les efforts des pompiers de la tour n'ont pas suffi et le directeur des pompiers de l'immeuble a déclaré qu'il pensait que l'effondrement de la tour était imminent dans les minutes à venir, avertissant les pompiers de ne pas monter dans l'immeuble. - 4 septembre : Tragédie à Moscou
La collision et l'incendie de la tour ont privé la capitale russe d'émissions télévisées, et des millions de Moscovites, rivés à leur téléviseur pour suivre les catastrophes, se sont retrouvés soudain sans informations. Seule la chaîne privée NTV a été épargnée au moment de la collision. On a pu entendre les réactions en direct des studios au moment de l'écrasement de l'avion. "Nous entendons une autre explosion, tout près ... de nous, près de TV .... Le centre de télévision de Moscou se trouvait dans la zone des débris et le bâtiment a commencé à être évacué. NTV est restée en service toute la journée et les téléspectateurs ont pu assister en direct à la dévastation et à la destruction. - Les attentats de Moscou : En temps réel, NBC
À 14 h 03, la tour Ostankino s'est effondrée en 15 secondes, tuant tous les civils et le personnel d'urgence qui se trouvaient à l'intérieur, ainsi que de nombreux employés et civils qui se trouvaient dans le hall. Le bâtiment s'est effondré vers le nord. La station de métro Telecentre, partiellement construite, et le centre technique d'Ostankino ont subi d'importants dégâts à la suite de l'effondrement de la tour et des débris de l'avion. - Article de Wikipédia, Attaques du 4 septembre 2004
L'effondrement de la tour Ostankino et les images des secouristes
Lorsque le troisième avion a percuté la tour d'Ostankino, les forces spatiales russes et l'Agence fédérale de l'aviation ont procédé à la fermeture effective de tout l'espace aérien russe, ordonnant à tous les avions d'atterrir à l'aéroport le plus proche dès que possible. Plus d'un millier d'avions étaient en vol à ce moment-là et tous ceux qui se trouvaient au sol ont reçu l'ordre de suspendre leurs vols et de retourner à leur terminal respectif dès que possible. Les contrôleurs aériens se sont empressés d'immobiliser les vols et, vers 13 h 41, le vol Kolavia 962 retardé a informé ses passagers que leur vol ne décollerait pas.
À 13 h 43, alors que l'avion roule vers le terminal, deux hommes armés de couteaux se lèvent de leur siège et pénètrent dans le cockpit. Deux autres hommes se lèvent également et déclarent qu'ils sont des rebelles tchétchènes demandant que l'avion soit dirigé vers l'Afghanistan, dévoilant ce qu'ils prétendent être des explosifs enroulés autour de leur taille. Un passager a fait état d'une bagarre dans le cockpit, vraisemblablement entre les pilotes et les assaillants : "Il y a eu des cris et nous avons entendu le bruit de coups de poing et de pied". Quelques minutes auparavant, les pilotes avaient été prévenus par radio : "Attention aux intrusions dans le cockpit, risque important de détournement". L'avion, toujours en mouvement au sol, a dérivé sur la piste de l'aéroport pendant 11 minutes. Les contrôleurs aériens ont pu entendre par radio les exigences des pirates de l'air, qui ont demandé aux pilotes de faire décoller l'avion immédiatement. Les autres attaquants ont forcé les passagers à quitter leurs sièges et à se rendre à l'arrière de l'avion. Un passager, Isai Petrov, a été blessé par une lame à 13 h 50. Plusieurs appels téléphoniques ont été passés à l'aéroport de Belgorod pour l'informer de la tentative de détournement en cours. L'aéroport a ensuite appelé la police et d'autres agences gouvernementales pour les informer de la crise qui se déroulait à l'aéroport. Le vol 962 est entré en collision avec un hangar de l'aéroport. La lutte violente à bord de l'avion s'est poursuivie, plusieurs passagers s'échappant par la sortie de secours, avant que les assaillants ne reprennent le contrôle de l'avion endommagé et de leurs otages. - Commission parlementaire russe, rapport final
Il n'existe aucune trace historique du moment où le président Poutine a autorisé la destruction d'un avion civil, ni même si la décision a finalement été prise par lui ou par quelqu'un d'autre dans la chaîne de commandement, les communications entre le président confiné à Sotchi et Moscou ayant été rompues. Le gouvernement était dispersé en raison de l'évacuation des parlementaires. Néanmoins, il semble que si le président a autorisé des tirs, il l'a fait dans les minutes qui ont suivi le crash du vol 800 et l'effondrement de l'Ostankino, alors que les FATA et la RSF continuaient à s'occuper des signes de détournements potentiels, notamment des avions fantômes, de fausses observations et des erreurs électriques. Cependant, aucune preuve de cette affirmation n'a été trouvée. - 4 septembre : Tragédie au-dessus de Moscou
Selon Donald Munich, un ingénieur structurel chargé d'enquêter sur la catastrophe, des faiblesses dans la conception du ministère des affaires étrangères ont probablement contribué à l'effondrement quasi-total de sa tour centrale. "C'était un bâtiment solide, mais il présentait beaucoup trop de faiblesses", a déclaré M. Munich lors d'une réunion dans un centre d'ingénierie.
"Ce que Moscou a enduré le 4 septembre ressemble davantage à une catastrophe naturelle", a-t-il déclaré à l'auditoire. "Lors d'un tremblement de terre ou d'une tornade, les pertes en vies humaines sont souvent bien moindres sur l'ensemble de la ville que ce qui s'est passé à Moscou"
Munich a noté que les incendies du ministère et de l'université ont brûlé très longtemps après le crash de l'avion et que, malgré les efforts héroïques des pompiers, ils n'étaient pas équipés pour faire face à un incendie aussi rapide et puissant : "Moscou est une ville relativement plate, il n'y a que quelques gratte-ciel, contrairement à New York ou Chicago, par exemple, où les premiers intervenants sont équipés d'hélicoptères et formés pour les incendies dans les immeubles de grande hauteur".
Donald souligne également des défaillances dans la construction initiale : "Les techniques de construction modernes de base n'étaient pas en place, et le toit était beaucoup trop lourd pour le bâtiment [...] les extincteurs automatiques étaient défectueux, les installations électriques étaient endommagées, les portes coupe-feu n'avaient pas été mises en place ; tous ces éléments ont favorisé l'incendie et brisé les structures, qui semblaient solides mais qui, en fin de compte, n'étaient que de l'acier, et l'acier, comme toutes les choses, fond à des températures élevées".
Munich explique que lorsque le toit a commencé à s'effondrer à 15h30, cela a eu pour effet de faire tomber un bâtiment de cinq étages directement sur le reste, provoquant l'effondrement partiel de toute la tour centrale dans un glissement de terrain. Munich a également parlé de l'université et des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas effondrée...
- Un ingénieur en structure décrit ce qui s'est passé à l'intérieur du ministère des affaires étrangères de Moscou, Harvard News Service
L'effondrement de la tour centrale du ministère russe des affaires étrangères
Belgorod, Russie, samedi 4 septembre - Le siège du vol Kolavia 962 s'est poursuivi pendant des heures, alors que le monde entier avait les yeux rivés sur la terreur qui régnait dans la capitale de la nation, et ce alors qu'au sud de la Russie une nouvelle panique s'est s'emparée de l'aéroport de Belgorod.
Des hommes armés de couteaux et d'explosifs, considérés comme des pirates de l'air, ont pris le contrôle d'un avion encore au sol, le vol 962, et ont pris en otage plus d'une centaine de personnes. La police, l'armée, les ambulances et les pompiers se sont précipités sur les lieux alors que l'impasse durait depuis deux heures. Les pirates de l'air ont fait part de leurs exigences par l'intermédiaire d'un otage libéré, demandant que l'avion soit acheminé vers l'Afghanistan et que les forces russes se retirent de Tchétchénie.
Les forces de sécurité ont bouclé la piste et semblaient prêtes à se battre pour empêcher le décollage et éviter une autre catastrophe majeure. Il est apparu clairement que le président de la Russie, Vladimir V. Poutine, avait donné l'ordre aux troupes de reprendre l'avion. "Profitant de la panique, plusieurs autres otages ont commencé à s'échapper", a déclaré Lev Dazasohov, porte-parole du gouvernement régional. "Les terroristes ont commencé à tuer des otages, et les forces spéciales de notre côté ont dû riposter, ce qui est très regrettable".
On ne sait pas exactement ce qui a déclenché l'explosion qui a détruit l'avion, si les pirates de l'air ont déclenché leurs explosifs volontairement ou par erreur, mais l'épave en feu a fait plus de 60 morts dans l'explosion et de nombreux otages s ont dû être immédiatement transportés par ambulance à l'hôpital. Si les assaillants étaient des pirates de l'air, quelle était leur cible ? Le gouvernement russe, le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile ? La scène qui s'est déroulée à l'aéroport n'est qu'une des nombreuses scènes qui ont émaillé cette sombre journée de l'histoire de la Russie. - Les Russes prennent d'assaut l'avion détourné, ABC News
(à gauche) Forces russes à l'aéroport de Belgorod, (à droite) conséquences de l'explosion à bord du vol Kolavia 962
Le 4 septembre, les contrôleurs aériens travaillaient d'arrache-pied pour sauver des vies et faire atterrir les avions en toute sécurité. Des centaines de personnes, qui se sont présentées pour une journée de travail normale, ont eu droit à tout sauf à une journée de travail normale.
Lorsque l'espace aérien russe a été fermé par le président Poutine, tous les vols dans l'espace aérien russe, y compris les vols internationaux du monde entier, ont dû atterrir. M. Poutine a personnellement appelé plusieurs pays voisins pour leur dire qu'il allait devoir faire atterrir des avions dans leurs aéroports parce qu'il n'y avait pas assez d'aéroports en Russie pour les contenir tous. Tous les vols ont été priés de revenir là où ils avaient décollé, sauf ceux qui n'avaient pas assez de carburant pour le faire. Ces avions ont reçu des points d'atterrissage d'urgence en Russie ou dans les pays voisins, à savoir le Kazakhstan, la Finlande, l'Ukraine et la Biélorussie.
L'un de ces avions était le vol 285 de Japan Airlines, un vol commercial régulier, un Boeing 747 en provenance de Tokyo, au Japon, à destination de Saint-Pétersbourg, à l'aéroport de Pulkovo, avec une escale prévue à Moscou.
Le vol 285 a décollé de Tokyo le 4 septembre, et lorsque le premier avion a percuté le premier bâtiment à Moscou, le vol 285 n'était plus en contact radio. Lorsque l'avion a traversé la Chine pour entrer dans l'espace aérien russe, des indices ont laissé penser que quelque chose ne tournait pas rond à bord. L'agence russe de l'aviation examinait les messages échangés entre l'avion et Japan Airways. Le 4, elle analysait tous les vols à la recherche d'alertes potentielles indiquant un détournement et a remarqué plusieurs messages erratiques du vol 285, y compris la phrase "HKJ", que l'agence a considérée comme un message codé possible pour un détournement. Les FATA ont pris ce message très au sérieux : "nous avons subi plusieurs attaques de la part de plusieurs avions en provenance de plusieurs aéroports, il semble logique qu'une attaque similaire ait pu avoir lieu en provenance de l'Extrême-Orient"
Ce jour-là, les autorités ont dû rattraper leur retard, la technologie n'étant tout simplement pas au point aujourd'hui, et les autorités étaient en état d'alerte maximale. Il s'agissait d'une situation sans précédent et certaines de ces technologies étaient expérimentales, pour dire les choses simplement, les responsables agissaient de manière très réactive.
À 15 heures, le vol 285 est resté sur sa trajectoire, diffusant un message apparemment ordinaire : "Ici 285, bonjour". Le message semble avoir été transmis normalement, sans aucune détresse, mais les forces spatiales russes ne prenaient aucun risque, l'espace aérien russe était fermé et il n'y aurait pas d'atterrissage possible à Moscou. Les forces spatiales russes ont autorisé la base aérienne de Domna à faire décoller des avions de chasse. Ceux-ci ont reçu l'ordre de suivre l'avion à une distance discrète afin d'empêcher d'éventuels pirates de l'air d'effectuer une manœuvre mortelle et de faire s'écraser l'avion.
Le contact entre l'avion et les contrôleurs aériens a parfois été tendu, en raison des différences de dialectes et des barrières linguistiques, mais il n'y avait aucun signe précis de détournement. Le vol semblait se dérouler en accord avec les contrôleurs aériens, mais quelque chose a mal tourné, l'avion a pris un virage à gauche inexpliqué et la radio est devenue momentanément silencieuse. Les contrôleurs ont pensé qu'un incident violent avait éclaté dans le cockpit, peut-être entre les pirates de l'air et les pilotes, mais il est également possible que le vol ait été effrayé par l'un des avions de chasse ou pour toute autre raison. La radio s'est rallumée et le pilote a tenté de rassurer les contrôleurs aériens en leur disant que tout allait bien et qu'il continuait à obéir aux ordres. Au même moment, en Russie, la prise d'otages sur le vol 962 s'est terminée lorsque les pirates de l'air ont déclenché des explosifs qui ont détruit l'avion sur le tarmac.
Les contrôleurs ont demandé au vol 285 d'envoyer le signe "7500", symbole international d'un détournement. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel était le raisonnement, mais il est possible que les contrôleurs aient pensé que si l'avion se conformait à la demande, cela confirmerait un détournement. Lorsqu'on lui a demandé de vérifier le code, l'avion s'est montré réticent. Peut-être les contrôleurs étaient-ils dans un monde différent, ayant assisté à trois crashs d'avion le même jour, ou bien les pilotes du 285 étaient-ils confus de recevoir ces demandes étranges de la part des contrôleurs, nous ne le savons pas, personne n'agissait clairement ici, alors les contrôleurs aériens ont émis une seconde demande à l'équipage de vol d'envoyer le code "7500". L'avion a répondu "7500"... - Vol 285 de Japan Airlines, podcast sur les incidents en vol
La dernière entrée de l'enregistreur de la voix du cockpit a eu lieu à 14:49:37 alors que l'avion était dans cette phase de descente. L'analyse de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) a conclu que l'équipage avait conservé un contrôle très limité de l'avion. Cependant, cela n'a duré que deux minutes. L'équipage a ensuite perdu tout contrôle. L'avion a commencé à descendre rapidement en spirale au-dessus des chaînes de montagnes de l'oblast de Kemerovo sur une distance de 4,2 km. L'avion s'est ensuite disloqué en plein vol et s'est écrasé au sol, près de la chaîne de montagnes des dents célestes. Les 102 personnes à bord ont été tuées. - Vol 285 de Japan Air, article de Wikipédia
(A gauche) MiG-29 russes en vol, (A droite) épave du Japan Air 285
4 septembre - Voici la transcription de l'allocution télévisée du président Vladimir V. Poutine au Kremlin samedi soir, telle qu'elle a été traduite par le New York Times :
Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher dans leur vie, leurs enfants, leurs parents, leurs proches. Je veux que vous vous souveniez de tous ceux qui sont morts aux mains des terroristes ces derniers jours. Nous avons été confrontés aujourd'hui non seulement à des meurtriers, mais aussi à ceux qui ont utilisé les armes les plus destructrices contre des personnes sans défense.
Comme je l'ai dit à maintes reprises, nous avons été confrontés à des crises, à des rébellions et à des actes terroristes à de nombreuses reprises. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ce crime sans précédent commis par des terroristes, d'une cruauté inhumaine, n'est pas un défi lancé au président, au Parlement ou au gouvernement. C'est un défi lancé à toute la Russie, à tout notre peuple. C'est une attaque contre nous tous.
Les terroristes pensent qu'ils sont plus forts, qu'ils pourront nous intimider, paralyser notre volonté, éroder notre société. Il semble que nous ayons le choix : résister ou céder et accepter leurs revendications ; abandonner et les laisser détruire et démanteler la Russie, dans l'espoir qu'ils finissent par nous laisser tranquilles.
Nous ne pouvons que constater l'évidence : il ne s'agit pas d'actes d'intimidation isolés, ni d'incursions individuelles de terroristes. Nous avons affaire à l'intervention directe de la terreur internationale aidée par les ennemis de la Russie, à une guerre totale et à grande échelle qui ôte la vie à nos compatriotes.
Toute l'histoire de la Russie montre que de telles guerres ne se terminent pas rapidement. Dans ces conditions, nous ne pouvons tout simplement pas, nous ne devons pas, vivre avec la même insouciance qu'auparavant. Tout comme nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont combattu et sont morts pendant la Grande Guerre patriotique, nous nous inclinons devant la mémoire des martyrs qui ont brûlé vifs et de nos pompiers qui sont morts le premier jour de cette juste bataille.
Certains veulent déchirer notre pays. D'autres les aident à le faire. Ils les aident parce qu'ils pensent que la Russie, qui est l'une des plus grandes puissances nucléaires du monde, représente toujours une menace, et que cette menace doit être éliminée. Et le terrorisme n'est qu'un instrument pour atteindre ces objectifs.
Il est impossible de réconcilier la douleur des pertes. Cette attaque nous a rapprochés encore plus, demain nous agirons. Aujourd'hui, nous devons être ensemble. Ce n'est qu'ainsi que nous vaincrons l'ennemi. - Putin Tells Russians : 'We Shall Defeat Terror' (Poutine dit aux Russes : "Nous vaincrons la terreur"), New York Times
(Gauche) Le drapeau russe en berne au Kremlin, (Centre) un public assiste au discours du Président Poutine, (Droite) des Russes déposent des roses lors d'une cérémonie en l'honneur des victimes.

Uranium Colonel- Messages : 1902
Date d'inscription : 31/07/2019
Age : 25
Localisation : République Démocratique de l'Icaunais
Thomas aime ce message
Page 2 sur 3 •  1, 2, 3
1, 2, 3 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Un mois de Septembre différent (Non à Maastricht)
» Et si Laval avait été tué en septembre 1943?
» L'Atlas d'Au Bord de l'Abîme
» Bienvenue « Au Bord de l’Abîme et au-delà »
» Appels à textes et concours
» Et si Laval avait été tué en septembre 1943?
» L'Atlas d'Au Bord de l'Abîme
» Bienvenue « Au Bord de l’Abîme et au-delà »
» Appels à textes et concours
Page 2 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 Aujourd'hui à 15:30 par Uranium Colonel
Aujourd'hui à 15:30 par Uranium Colonel
» Ils arrivent !
» Terra Ignota, Ada Palmer
» Statut exact du domaine français de Terre Sainte
» Un cours d'histoire ancienne
» Que pourrait changer une mort prématurée de Churchill ?
» Présentation d'Ammonios
» L'échange de Brennert
» Les épisodes uchroniques